 Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
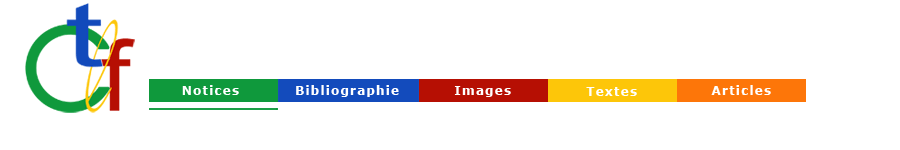
| Domaine | Compilations, linguistique historico-comparative, linguistique générale, phonétique et phonologie |
| Secteur | Linguistique générale [5301] |
| Auteur(s) | Humboldt, Wilhelm von |
Datation: 22 juin 1767 - 8 avril 1835 Erudit, philologue, philosophe du langage et diplomate allemand, né à Potsdam, mort à Berlin. Une des figures de proue de la vie politique et culturelle de l'Allemagne à la jonction du 18e et du 19e s. Sa vie peut se distribuer en trois périodes, correspondant chacune à une des faces de ses activités: 1790-1800 (philologie grecque, traductions, essais divers), 1800-1820 (activité publique: fondation de l'université de Berlin, diplomatie); 1820-1835 (la retraite consacrée à la recherche linguistique). L'activité linguistique traverse en fait chacun de ces moments; latente jusqu'en 1800 où elle cristallise soudain au cours d'un voyage en Espagne (découverte des Basques et du Basque); explicite et obstinée à partir de 1820. Linguiste donc, mais en un sens tout à fait singulier. La question du langage marque le point d'orgue d'une interrogation philosophique portant sur le destination de l'homme (anthropologie), au croisement des Lumières et du Romantisme: l'homme en procès de lui-même, inventant librement le sens de son être au long d'un devenir ponctué par ses œuvres (sciences, littérature, philosophie) dont le langage est le foyer et le vecteur. Mais, contemporain de l'essor de la grammaire comparée, Humboldt ne se borne pas aux recherches généalogiques sur l'indo-européen. Ce sont toutes les langues usitées à la surface de la planète (jusqu'aux langues amérindiennes et polynésiennes) qui sont convoquées à une élucidation dont l'horizon global (le sens de l'humanité) requiert d'autant plus impérieusement l'examen du détail langagier le plus infime. Au nom d'une inversion de l'adage classique: à l'extension maximale doit désormais répondre une compréhension renforcée ("Il n'est qu'une langue propre à l'homme, mais qui se manifeste de manière différenciée dans les langues innombrables de la sphère terrestre"). La différenciation de la puissance langagière, indéfiniment démultipliée, conditionne et soutient la mise en œuvre d'un nouvel infini: la création conjointe, sans terme assignable, de l'humanité et du monde. | |
| Titre de l'ouvrage | Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts |
| Titre traduit | Sur la différence de construction du langage dans l'humanité et l'influence qu'elle exerce sur le développement spirituel du genre humain – Introduction à l'ouvrage sur le Kawi |
| Titre court | Einleitung zum Kawi-Werk |
| Remarques sur le titre | |
| Période | |19e s.| |
| Type de l'ouvrage | Essai de philosophie du langage, entreprise sans équivalent de théorisation philosophico-empirique du langage dans la multiplicité de ses configurations. Mise à l'épreuve, à travers la diversité différentielle des langues traquées dans toutes leurs dimensions, d'une hypothèse novatrice sur l'essence du langage: celui-ci est, non pas représentation d'objets ni expression d'idées, les uns et les autres déjà constitués, mais invention d'objectivités (ordre du monde) couplée à l'auto-institution d'une pensée en acte, selon un jeu d'influences réciproques indéfiniment poursuivies. |
| Type indexé | Linguistique générale | Philosophie du langage |
| Édition originale | Deux éditions posthumes, pratiquement contemporaines (1836), par les soins du dernier secrétaire de Humboldt, Eduard Buschmann: 1) texte en "Introduction" aux recherches sur le Kawi (langue de Java), 3 volumes (1836-1839); 2) texte séparé, se présentant dès lors comme traité autonome. Les deux éditions présentent quelques différences minimes; elles sont accompagnées d'une préface d'Alexander von Humboldt, le géographe, frère aîné de Wilhelm. |
| Édition utilisée | Gesammelte Schriften [Œuvres complètes], publiées par l'Académie royale des Sciences de Prusse à partir de 1903, par les soins d'Albert Leitzmann (1903-1936). Tome 7, 1907. Réédition photomécanique, Berlin, De Gruyter 1968. Texte reproduit dans le |
| Volumétrie | Dans l'édition de 1907, le texte comprend 344 pages; nombre moyen de signes par page: 2500. |
| Nombre de signes | 860000 |
| Reproduction moderne | UTB (Uni-Taschenbücher n° 2019) avec une introduction de Donatella Di Cesare, Paderborn, F. Schöningh, 1998. |
| Diffusion | Histoire tourmentée, marquée d'entrée par une dualité (introduction aux recherches sur le Kawi ou texte autonome. C'est ce dernier trait qui l'emporte. Autres éditions marquantes: 1841-1852, par Carl Brandes, Berlin, Reimer; 1876, par A. F. Pott, Berlin, Calvary; 1883-1884, par H. Steinthal, Berlin, Dümmler. Traductions: russe (1859 et 1984, Moscou, Progress, par G. B. Ramišvili); française (Paris, Seuil, par P. Caussat); japonaise (1984, Tokyo, par K. Kameyama); anglaise (1988, Cambridge University Press, par P. Heath, avec introd. de H. Aarsleff); espagnole (1990, Barcelone / Madrid, par A. Agud); italienne (1991, par D. Di Cesare). |
| Langues cibles | En droit, toutes les langues de la planète, avec mention particulière du sanscrit, du grec, des langues romanes, du "mexicain" (aztèque), des langues sémitiques, des langues amérindiennes (Delaware), des langues malaises, du chinois, du birman, des langues d'Océanie (Polynésie, tagalog) |
| Métalangue | Allemand |
| Langue des exemples | |
| Sommaire de l'ouvrage | Quatre grandes parties, prélevées dans un ensemble non rigoureusement distribué: a) considérations anthropologiques sur le déploiement de l'espèce humaine en cultures et en nations différenciées (chap. 1-9, p. 368-414); b) forme et structuration internes des langues, ou comment les langues montent leurs règles opératoires (chap. 10-32, p. 414-584); c) caractère des langues (œuvres des langues, essentiellement littérature) (chap. 33, p. 584-603): d) esquisse d'une typologie raisonnée des langues indépendamment de leur parenté (chap. 34-36, p. 603-756). |
| Objectif de l'auteur | Condenser et accomplir trente-cinq ans de recherche focalisées sur le langage en tant que point nodal d'une anthropologie pleinement philosophique, au sens kantien, c'est-à-dire soucieuse de faire la synthèse entre les préoccupations transcendantales (la puissance langagière et ses potentialités immanentes) et le détail empirique (examen minutieux des modalités mises en œuvre par chacune des langues apparues à la surface du globe). |
| Intérêt général | Invention d'un paradigme nouveau de la langue, à l'écart de la réduction à l'unicité d'un même modèle (logiciste, sémiotique) et d'un champ étroitement spécifié (philologie indo-européenne). D'où l'effort obstiné, au nom de l'égale dignité de toutes les langues, pour pratiquer un comparatisme généralisé à double portée: dégager les opérations structurantes à l'œuvre dans chaque langue (devenir et structures liés) et en faire le tremplin pour une herméneutique de l'humanité en travail d'elle-même dans l'œuvre de la parole. |
| Parties du discours | |
| Innovations term. | La terminologie connaît un renouvellement complet, par l'invention d'une conceptualité appropriée à la logicité immanente des langues (et singularisée par l'exigence d'exploiter les ressources de la langue théorisante – l'allemand), en particulier pour les points suivants: le problème de la flexion; celui de l'unité nominale; l'interaction nom / verbe; le pronom relatif. |
| Corpus illustratif | |
| Indications compl. | Renouvellement de la question de l'arbitraire en tant que lié à la notion de "forme interne"; concept d'"articulation" (conceptualisation latente de "structure" et de "phonème"); renouvellement des rapports entre morphologie et syntaxe; essai d'une typologie des langues; notion de langue comme "vision du monde" (Weltansicht: perspective sur le monde). |
| Influence subie | Celle de l'Antiquité classique (surtout les Grecs); Herder, Kant et Fichte; F. et A. W. Schlegel; Bopp et Grimm; Schiller; selon la thèse, peu défendable, d'Aarsleff: les Idéologues français. |
| Influence exercée | Souvent implicite, voire refoulée, au nom du caractère réputé inaccessible de son discours (sauf en Russie qui a été le premier pays à le traduire; influence sur Potebnia). Reconnaissance chez les philosophes (Cassirer et Heidegger). Convergence avec les thèses de Sapir et de Whorf ("néo-humboldtianisme"). Influence prétendue sur Saussure (Jäger) et sur Hjelmslev. Reconnaissance, mais biaisée, chez Chomsky. Depuis les années 1960, les études savantes se multiplient (Trabant en Allemagne, Di Cesare en Italie, Quillien en France). |
| Renvois bibliographiques | Borsche T. 1981; Cassirer E. 1972; Gadamer H.-G. 1996; Gipper H. 1992; Hansen-Løve O. 1972; Jäger L. 1975; Menze W. 1965; Meschonnic H. 1975; Meschonnic H. 1995; Quillien J. 1991; Trabant J. 1986; Trabant J. 1990; Trabant J. 1990; Trabant J. 2009 |
| Rédacteur | Caussat, Pierre |
| Création ou mise à jour | 2000 |