 Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
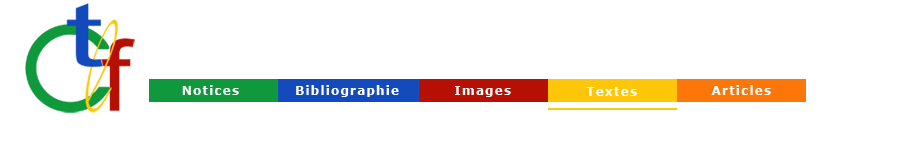
Préface de l'auteur
à l'édition française
Depuis la publication de la seconde édition de mon
ouvrage en 1875, une véritable révolution s'est produite
dans la philologie comparée des langues indo-européennes.
Le sanscrit a été détrôné de la place élevée qu'il occupait
comme représentant par excellence de la langue-mère
aryenne, et l'on a reconnu qu'à bien des égards les langues
européennes ont conservé plus fidèlement les sons et les
formes primitives que ne l'ont fait les langues de l'Inde.
La vieille théorie qui faisait naître l'inflexion d'une période
antérieure d'agglutination est déjà considérée comme
compromise, et le professeur Delbrück, son dernier avocat,
dans son Introduction à l'étude du langage, après avoir
admis que la théorie agglutinative ne peut pas prétendre
avec certitude « avoir été vérifiée dans des cas individuels »,
fait reposer son unique défense de cette théorie sur la
ressemblance des deux premiers pronoms personnels avec
les terminaisons des deux premières personnes verbales.
M. Fick, si longtemps le théoricien principal de la doctrine
généralement reçue touchant les racines, la rejette
aujourd'hui complètement (Gött. Gelehrte Anzeigen,
6 avril 1881) et parle du « point de vue dépassé » de
Panini avec son « vain babillage de racines et de suffixes »
xiii(Gött. Gelehrte Anz., 9 nov. 1881.) Il pense que le verbe
aryen consiste seulement en infinitifs et en infixes. Suivant
l'exemple de Benfey, le même savant a montré que les
thèmes du présent de verbes comme λείπω, ἔχω (σέχω) sont
plus anciens et plus primitifs que les radicaux abrégés de
l'aoriste, ἔλιπον, ἔσχον, qui sont résultés d'un recul de l'accent.
L'axiome de l'école des « néo-grammairiens », à
savoir que les lois phonétiques n'admettent pas d'exceptions,
a fait reconnaître la vérité de la thèse que j'ai
soutenue dans le dernier chapitre de ce livre : c'est l'analogie
et l'assimilation, non l'altération phonétique, qui
sont la cause principale des changements dans les langues.
Mais c'est dans le domaine de la phonétique aryenne
primitive que s'est accomplie la révolution la plus importante.
Les travaux de MM. Brugman, Osthoff, Johannes
Schmidt, Collitz, Fick et plus particulièrement de Saussure,
ont prouvé que j'ai eu raison de dire, que « l'alphabet
originel qu'on suppose avoir été possédé par nos ancêtres
les plus reculés… est, comme le langage des racines, un
point de départ logique, et non historique. » Au lieu des
sons simples et peu nombreux auxquels tous les mots
indo-européens ont été réduits par l'analyse étymologique,
on a prouvé que la langue-mère possédait un alphabet
très riche en consonnes et en voyelles. A côté de k, g et gh
existaient les gutturales vélaires kʹ, gʹ et ghʹ, qui se prononçaient,
je crois, kw, gw et ghw. M. Schmidt voudrait
y ajouter κʹ, γʹ et γʹh, représentées en sanscrit par ç, jʹ et
h, en zend par ç, z, et en vieux bulgare par s et z. Le θ grec
(sanscrit h) est le descendant de deux sons différents qui
apparaissent en vieux bulgare comme z et z˅ ; et, d'autre
part, Osthoff a rendu vraisemblable que la langue-mère a
dû posséder deux sifflantes, l'une sonore et l'autre sourde.
C'est en voyelles surtout que l'alphabet aryen primitif
était très riche. L'a monotone du sanscrit est un
amalgame d'au moins trois sons différents que M. Brugman,
xivle véritable auteur de cette découverte, voudrait
représenter par a1 , a2, a3. M. Collitz, avec raison ce me
semble, préfère substituer à ces trois symboles phonétiques
les lettres européennes ĕ, ă et ŏ. Mais l'ŏ lui-même, comme
l'a remarqué M. de Saussure, n'était pas un son unique.
Il y avait un ŏ que l'on trouve dans le grec πόσις et le
latin potis, et un second qui permute avec ĕ. La corrélation
de ces deux voyelles a été expliquée par M. Fick ;
là où nous trouvons ŏ et ĕ corrélatifs, comme dans λέγο-μεν
et λέγε-τε, le premier (ŏ) représente une syllabe originairement
non accentuée, tandis que le second (ĕ) paraît dans
la même syllabe lorsqu'elle a reçu l'accent. De même qu'il
y avait deux ŏ, il devait aussi y avoir deux ĕ.
La découverte de ces voyelles primitives a produit une
révolution importante dans l'étymologie. Non seulement
elle a montré que le sanscrit n'est pas cet étalon de la phonétique
européenne que l'on supposait précédemment ; elle
a prouvé aussi que les lois phonétiques qui régissent
l'équivalence des sons vocaliques sont aussi strictes que
celles qui gouvernent l'équivalence des consonnes, que par
suite des racines contenant ă, ĕ et ŏ ne doivent jamais
être confondues entre elles. Dès lors, il devint impossible
de faire dériver magnus et μέγας de la même racine.
Une autre découverte phonétique d'une égale importance
est due aux recherches de MM. Brugman et de Saussure.
C'est celle de l'existence de liquides, de labiales et de
nasales sonores dans la langue-mère. Les Aryens primitifs
possédaient des sonores r, l, m, n, qui sont devenus αρ, αλ
ρα, λα, etc. en grec, or, ul, en, em en latin, aúr, ul, un, um
en gothique. Ici encore, le progrès du langage a été
marqué par des simplifications successives ; les anciennes
distinctions entre les sons se sont perdues et le multiple
s'est réduit à l'un.
Il est inévitable qu'au milieu de tant de découvertes
simultanées mes propres opinions sur bien des points
xvaient subi quelques modifications pendant les huit années
qui viennent de s'écouler. Quoique les théories et les principes
que j'ai soutenus dans le présent volume me paraissent
avoir été vérifiés et confirmés par les découvertes
récentes, il y a bien des points de détail sur lesquels je
m'exprimerais aujourd'hui d'une manière différente. Je
voudrais en signaler ici deux seulement, puisqu'il s'agit de
questions aussi importantes que la flexion verbale et l'origine
du genre.
Comme je l'ai dit plus haut, le dernier défenseur de la
vieille théorie Boppienne de l'agglutination se trouve
obligé de faire reposer son argumentation sur la ressemblance
entre les deux premiers pronoms personnels et les
deux personnes correspondantes de la conjugaison. Suivant
le professeur Delbrück, cette ressemblance prouve
que les désinences de ces personnes sont d'anciens pronoms
qui sont devenus des signes de flexion. Jusqu'à ces
derniers temps, j'étais disposé à être du même avis, et
j'aurais volontiers continué à expliquer cette ressemblance,
comme je l'ai fait dans le présent volume, en
remarquant que le nom étant plus ancien que le verbe,
les désinences du nom furent le modèle auquel se conformèrent
les désinences verbales. Les pronoms personnels
attachés au verbe cédèrent, avec le temps, à l'analogie du
type infléchi général du langage.
Mais cette théorie qui voit dans les désinences personnelles
du verbe les restes de pronoms personnels, soulève
des objections graves, objections que je crois aujourd'hui
irréfutables. Le radical verbal ne peut être distingué du
radical nominal ; ἀγο-μεν et ἀγό-ς sont la même chose.
Toutes les tentatives pour expliquer les désinences de la
troisième personne par des pronoms personnels ont été
vaines ; il en est de même des efforts que l'on a faits pour
découvrir les suffixes pronominaux du duel et du pluriel
dans le duel et le pluriel du verbe. La seconde personne du
xvisingulier du verbe perd toute ressemblance extérieure
avec le second pronom personnel dès que nous nous rappelons
que la forme originaire de ce dernier était tw(ŏm)
et non pas σύ comme en grec, tandis que d'autre part la
même personne était aussi caractérisée par la terminaison
θα, qui non seulement ne correspond à aucun pronom
personnel mais servait également à marquer la première
personne du pluriel dans les formes en -μεσ-θα et -με-θα.
Enfin, les recherches de MM. Scherer et Brugman ont
prouvé que les formes grecques et latines de la première
personne du singulier en ō n'ont rien de commun avec les
formes en m et mi, mais sont dues à une fusion de la
voyelle finale de la racine avec le suffixe a. Il est à peine
besoin de faire observer qu'on ne connaît l'existence
d'aucun pronom personnel de la forme a = moi.
D'autre part, les désinences personnelles sont toutes des
suffixes nominaux, dont beaucoup appartiennent à des
substantifs abstraits et à des infinitifs, et l'infinitif, il faut
se le rappeler, est fréquemment employé à la place du
verbe fini. La troisième personne du singulier φέρε-τι, lorsqu'on
la compare avec un nom comme γένεσις, ne paraît
guère pouvoir être autre chose qu'un nom abstrait de
même ordre, employé soit au locatif, soit comme les infinitifs
du genre de ceux en -μεν et Ϝεν (φεφε-Ϝεν = φέρειν), à
l'état de thème nu. La troisième personne du singulier du
temps passé en turc est pareillement un nom abstrait. La
troisième personne du pluriel φέρο-ντι peut être rapprochée
du participe présent, φέροντι étant à φερέ-τι ce que le sanscrit
bhárantam est à bharatás. Je suppose que l'analogie
de la seconde personne du pluriel, où les désinences -tĕs et
-tĕ étaient employées ensemble, fut cause que φέροντες devint
φέροντε et que cette forme à son tour fut ensuite assimilée
au singulier φερέ-τι. En turc, comme dans les langues sémitiques,
la troisième personne du verbe est exprimée par le
participe présent. Quant à la première personne verbale,
xviije ne vois aucun moyen de dériver la désinence dite secondaire,
-m, de la désinence primaire -mi ; ni la phonétique,
ni l'analogie ne le permettent. Au contraire, si nous admettons
que la désinence secondaire est la plus ancienne, il
n'y aurait aucune difficulté à supposer qu'au temps présent
elle a été assimilée à la désinence vocalique de la troisième
personne (en -i). Or, la désinence secondaire est simplement
le suffixe de l'accusatif ou cas objectif du nom et,
comme celui-ci, elle peut se présenter sous la forme de la
sonore m0. La même explication conviendra pour la
seconde personne du singulier ; là aussi l'-s secondaire, qui
sert non seulement de suffixe au nominatif singulier et
pluriel et à l'accusatif pluriel du nom, mais aussi de suffixe
aux radicaux abstraits — serait la désinence primitive.
Par suite, « I bear », « thou bearest » (je porte, tu portes)
auraient été exprimés à l'origine par ěghǒm bhěrǒm, twǒm
bhěrěs, correspondant exactement au latin « ego verbum »,
« tu scelus ». Ce n'est que par degrés que la signification
de la phrase, qui d'abord reposait sur le contexte et la
position des mots, fut transférée aux désinences des mots
eux-mêmes, devenant ainsi l'origine de la flexion verbale.
Un verbe véritable fait encore défaut à beaucoup de langues
actuellement parlées, et dans les dialectes polynésiens
c'est encore la position et les cas du nom qui tiennent lieu
du verbe et en remplissent la fonction. Si nous considérons
maintenant le pluriel, nous trouverons -μεν, -με (sanscrit
-ma) et -μες employés pour marquer la première personne,
quoique -μεν soit un suffixe bien connu de l'infinitif,
comme Ϝεν qui semble apparenté avec le -va et le -vas de
la première personne du duel sanscrit. A la voix moyenne,
le suffixe θα est attaché à -με et μες exactement comme -σι
au suffixe nominal -(ε)ς dans un mot comme πόδεσ-σι, et
puisque, au dire d'Apollonius Dyscole, la forme éolienne de
-μεθα était -μεθεν, tandis que -θε est le suffixe de la seconde
personne du pluriel, il est clair que nous avons affaire au
xviiimême suffixe nominal qui paraît dans δυρανόθεν et ὕπαιθα. A
l'impératif nous avons même le -θι nominal. Je me trouve
en conséquence obligé de souscrire sans réserves à la conclusion
de M. Fick, à savoir que non seulement des formes
comme bháve, la première personne du singulier de la
voix moyenne en sanscrit, sont en réalité d'anciens infinitifs,
mais que les autres formes du verbe sont des infinitifs
également. Toutefois, je ne puis donner mon assentiment
à sa conclusion subséquente — du moins dans les termes
où cette conclusion est formulée — que les formes ont été
différenciées au moyen d'infixes. Je doute que des infixes,
ou, comme on les appelait autrefois, des lettres pléonastiques,
aient été jamais introduits dans le corps d'un mot
non composé si ce n'est par l'effet de l'analogie.
D'autre part M. Fick, suivant une indication donnée par
Benfey, a clairement prouvé, à mon sens, que ce qu'on
appelle le thème du présent est plus ancien que le thème
de l'aoriste. Dans πείθω, par exemple, la « racine » apparaît
sous une forme plus primitive que dans ἔ-πιθο-ν, où la
voyelle a été abrégée par le fait que l'accent portait à
l'origine sur la dernière syllabe. Le prétendu « aoriste
fort » devrait donc être plutôt appelé « l'aoriste faible »,
puisqu'il présente la racine verbale sous une forme
affaiblie. Comme Benfey l'a indiqué le premier, il est
vraiment l'imparfait d'un radical du présent faible, et c'est
à cause de cela que les Grecs étaient incapables de déterminer
si ἔλυον était un aoriste ou un imparfait. En réalité,
il y avait trois thèmes du présent dans la langue-mère, un
thème fort comme dans πείθω, un thème affaibli et un
thème redoublé, et il est possible que le thème fort comme
le thème affaibli admissent le redoublement. Ces thèmes
ne peuvent pas être rapportés à quelque « racine » antérieure,
en partie parce que le thème faible est seulement
le résultat d'une prononciation rapide dans un mot qui a
déjà sa forme pleine, en partie parce que dans le cas de
xixmots comme σπέσθαι ou σχεῖν les « racines » devraient être
des groupes purement consonnantiques σπ, σχ, ce qui est
inadmissible. Enfin, il est impossible de séparer des noms
comme ἀγό-ς de verbes comme ἄγο-μεν. Ici, la « racine »
commune serait ἀγο qui, augmentée de certains suffixes et
employée avec un certain contexte, doit être regardée
comme un thème nominal, tandis qu'avec d'autres suffixes
et un autre contexte elle devient un thème verbal.
Le second point que je voudrais traiter brièvement est
la question de genre, au sujet de laquelle mes opinions
se sont légèrement modifiées depuis la publication de cet
ouvrage. Je ne vois pas encore de raison pour douter que
Bleek ne fût dans le vrai lorsqu'il considérait les classes
entre lesquelles doit être distribué le nom cafre comme
étant en substance identiques aux genres des langues
aryennes et sémitiques. Mais voici comment j'expliquerais
maintenant le développement des distinctions de genre
dans ces deux familles de langues. Il fut un temps, je
crois, dans l'histoire de la famille aryenne, où aucuns
suffixes spécifiques n'avaient encore été réservés pour
marquer les distinctions de genre. Comme dans les langues
agglutinantes, il existait le sentiment du genre sexuel et
non du genre grammatical. Les noms étaient distingués
l'un de l'autre par le genre seulement en tant que désignant
des êtres mâles et femelles, tant eux-mêmes que
les pronoms qui s'y rapportaient. Comme l'homme peu
cultivé est prompt à personnifier tous les objets de la
nature qu'il voit autour de soi, la plupart des noms vinrent
à être classés dans le genre masculin et dans le genre
féminin ; mais cette classification ne dépendait que de
leur signification et des pronoms qu'on employait avec
eux. Nous pouvons retrouver des vestiges de cette période
du langage dans des termes ordinaires marquant la
parenté comme « père » ou « mère », qui continuèrent à
être déclinés exactement de la même manière dans les
xxlangues indo-européennes sans aucune marque distinctive
du genre. Des vestiges semblables peuvent être découverts
dans des mots qui font exception à la règle habituelle
d'après laquelle les thèmes en -ǒ sont masculins tandis que
les thèmes en -ǎ sont féminins. Ainsi le grec ὁδὸς et le latin
humus témoignent d'une époque où les désinences -os et
-us n'étaient pas encore associées à l'idée du masculin.
Graduellement, toutefois, commencèrent à se former de
petites classes de noms qui avaient accidentellement les
mêmes suffixes et se rapportaient au même sexe. Par
exemple, des noms dont les thèmes se terminaient par les
voyelles i et ya (yĕ, yŏ) se trouvèrent appliqués de préférence
à des personnes du sexe féminin ou à des objets
assimilés à ces personnes. De la sorte naquirent certains
groupes de noms qui, par la force de l'analogie, tendirent
à s'assimiler d'autres noms qui se rapportaient au même
sexe ou avaient les mêmes suffixes. Tous les thèmes en i
et ya tendirent à entrer dans la classe des noms féminins,
tous ceux en -ŏ dans celle des noms masculins. Par suite,
le genre sexuel devint le genre grammatical ; les pronoms
qui étaient associés à des noms masculins et féminins
devinrent eux-mêmes masculins et féminins et à leur tour
furent cause que d'autres noms, avec lesquels ils étaient
associés, devinrent masculins et féminins. Là s'arrêtèrent
les langues sémitiques. La personnification primitive
d'objets naturels, d'une part, et, d'autre part, l'influence
de l'analogie, s'étendirent plus loin que dans les langues
aryennes et finirent par ranger tous les noms dans une de
ces deux classes. Dans les langues aryennes, cependant, un
certain nombre de mots restaient encore sans genre. D'une
part, l'objet pouvait être employé comme sujet avec un
verbe passif, auquel cas l'accusatif devenait un nominatif ;
de l'autre, après que la phrase primitive eût été analysée
et qu'on en eût extrait en quelque sorte les relations grammaticales,
il resta un certain nombre de noms qui, lorsqu'on
xxiles employait comme sujets, étaient privés des
suffixes affectés à la désignation du genre et du cas.
Lorsque ces noms représentaient clairement des idées
comme « père » ou « mère », on les traita naturellement
comme des masculins et des féminins, mais quand il n'en
était pas ainsi on les réunit dans une classe distincte comprenant
des noms comme μέθν en grec ou virus en latin.
A la même classe furent attribués les noms qui, bien
qu'employés comme sujets de verbes passifs, étaient
réellement au cas objectif et ne pouvaient par suite être
régardés comme des personnes du genre masculin ou
féminin. De la sorte se formèrent les trois grandes classes
de « genres » entre lesquels les noms furent partagés ; il
ne resta plus qu'à l'altération phonétique et à l'assimilation
le pouvoir de les modifier et de les changer en faisant
passer les noms d'une classe à l'autre. Ainsi en allemand,
la perte de l'n final de Sonnen (le soleil), fut cause qu'on
associa ce nom à des féminins en -e, tandis que Mond (la
lune) fut pareillement transféré de la classe des féminins
à celle des masculins. Mais jusqu'à la fin ces divisions restèrent
des classes pareilles à celles des noms en zoulou et
ces classes furent distinguées l'une de l'autre par les pronoms
avec lesquels se construisaient les noms.
Il y a une ou deux autres questions de détail sur lesquelles
mes vues se sont modifiées ou développées par
suite du progrès scientifique accompli depuis huit ans ;
mais elles ne sont pas assez impprtantes pour que je doive
les traiter ici. Il ne me reste que l'agréable devoir de
remercier celui qui a pris tant de peine pour habiller mes
idées en français et en particulier M. Bréal, qui veut bien
présenter ce livre au public lettré de son pays.
A. H. Sayce.
Oxford, 1er juin 1883.xxii