 Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
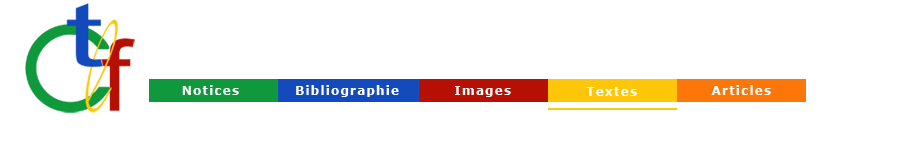
Appendice
I
Quelle route ont suivie les aryens 11 occidentaux dans leur
migration en Europe ?
L'une des questions historiques soulevées par l'élude du
langage et à laquelle l'étude du langage doit fournir une réponse
est celle-ci : Par quelle route nos ancêtres aryens sont-ils
entrés en Europe ? On a prouvé, je crois, que leur demeure
première fut l'Asie et plus particulièrement les hauts plateaux
272de l'Hindou-Koush. Quand la Philologie comparée nous
les fait connaître d'abord, ils étaient depuis longtemps sortis
de la barbarie primitive et avaient atteint un haut degré de
civilisation. C'étaient des pâtres et des cultivateurs, vivant dans
des maisons et des communautés, ayant des coutumes immuables
et un gouvernement établi, déjà familiarisés avec l'usage
des métaux. Une telle civilisation indique une période relativement
récente de développement, infiniment éloignée de cette
période imaginaire des racines découverte par l'analyste, qui
représenterait la plus ancienne période du langage aryen à
laquelle nous puissions atteindre. J'admets que Fick 12 a démontré
contre Schmidt que les Aryens occidentaux ou européens
vivaient ensemble en un corps de nation après s'être séparés
de leurs frères orientaux en Asie, et que le groupe européen
ne se divisa qu'après son arrivée en Europe. De même qu'il y
avait eu une langue aryenne primitive, il y eut aussi une langue
européenne primitive et la séparation de l'aryen oriental et
occidental eut son pendant dans la séparation du lithuanien,
du slavon, du celtique, du teuton, de l'italique et de l'hellénique.
Alors se pose cette question : Ceux qui parlaient cette langue
européenne primitive se portèrent-ils vers l'Occident au
nord ou au sud de la Caspienne, à travers le désert de Sagart,
la Médie, l'Arménie et l'Asie Mineure — ou à travers les steppes
de la Tartarie et la chaîne de l'Oural ?
On croyait autrefois que nos ancêtres avaient passé au sud
de la Caspienne et laissé sur leur route des corps d'émigrants
en Médie, en Arménie et en Asie Mineure. Mais la science du
langage montra bientôt que les langues de la Médie et de
l'Arménie appartiennent au groupe iranien et peuvent en conséquence
être regardées comme originaires de la Perse. D'autre
part, Fick, il y a peu de temps, a clairement montré que les
dialectes aryens de l'Asie Mineure, dont on peut regarder le
phrygien comme le principal représentant, appartiennent incontestablement
au groupe européen. Ce fait est en parfaite
harmonie avec la tradition grecque d'après laquelle les Briges
273ou Phrygiens avaient primitivement émigré de la Thrace 13,
ainsi qu'avec les ressemblances que Platon signalait entre des
mots grecs et phrygiens 24. Comme je l'ai indiqué ailleurs 35,
l'absence de fer dans les restes préhelléniques, trouvés à Hissarlik
par M. Schliemann, montre qu'il ne pouvait y avoir eu
aucun rapport entre la côte ouest de l'Asie Mineure et les grands
travailleurs en métaux des pays situés au delà de l'Halys. Les
inscriptions assyriennes nous amèneraient aussi à supposer
qu'aucune nation aryenne n'était établie à l'est de cette rivière,
du moins au douzième siècle avant J.-C. Les inscriptions trouvées
à Van et dans les environs sont écrites en une langue
qui, bien qu'à flexions, n'est pas aryenne et appartient probablement
au groupe alarodien 46 dont on peut regarder le géorgien
comme le type. Nous ne trouvons pas trace de l'aryen en
Arménie ni même en Médie antérieurement au VIIIe siècle avant
Jésus-Christ. Les Assyriens connurent pour la première fois les
Mèdes ou Amadai, comme ils les appelaient alors, sous le règne
de Shalmaneser III (840 av. J.-C.) ; les Mèdes, à cette époque,
vivaient au loin vers l'est, et les Parsuas ou Parthes les séparaient
de l'Assyrie. C'est seulement au temps de Rimmonnirari,
vers 790 avant Jésus-Christ, qu'ils s'avancèrent dans la contrée
que les géographes classiques appellent Media Rhagiana 57. Les
légendes du Vendidad représentent la marche des Iraniens
vers l'ouest comme lente et graduelle ; et la langue aryenne de
l'Iron ou des Ossètes dans le Caucase est, comme l'arménien
et le kurde, un membre de la famille iranienne. Il est ainsi
complètement évident que, si la branche européenne de la
famille aryenne se dirigea vers sa demeure actuelle le long
274des rivages méridionaux de la Caspienne, elle ne laissa sur sa
route ni traînards, ni traces de son passage. Les dialectes
aryens de cette partie de l'Asie ont émigré de la Perse à une
période récente et les Aryens établis en Asie Mineure vinrent
d'Europe en traversant la mer pour subjuguer les anciens
habitants de la contrée.
L'une des découvertes les plus curieuses qui soient résultées
du déchiffrement des inscriptions assyriennes et babyloniennes,
c'est que tout le pays compris dans l'Assyrie, la Chaldée, la
Susiane et la Médie était à l'origine habité par une race touranienne,
à langue agglutinante, qui inventa l'écriture cunéiforme,
bâtit de grandes cités, fonda les monarchies du Tigre
et de l'Euphrate. Ces peuples furent, en définitive, les pionniers
de la civilisation dans l'Asie occidentale. Leurs traditions
indiquaient comme leur berceau la région montagneuse au
sud-ouest de la Caspienne, et la montagne de Nizir dans le
pays de Guttium, entre le 34e et le 35° degré de latitude (le pic
actuel d'Elwand, à ce qu'il semble), était le lieu sacré où l'arche
s'était arrêtée et où l'humanité avait trouvé sa seconde patrie.
Les langues accadienne, susienne et protomédique qu'ont
fait connaître le progrès des études cunéiformes, ont des rapports
plus ou moins étroits les unes avec les autres et avec les
dialectes modernes du groupe ougrien. On a depuis longtemps
montré que les ancêtres des Finnois durent venir de quelque
point de l'Asie méridionale et les noms mêmes de Suomir et
d'Akkarak (Akkarak, soit dit en passant, n'a pas d'étymologie
possible en finnois) que donnent leurs traditions aux premières
divisions de la race, ressemblent étrangement à Sumir et Accad,
les deux cantons de la Babylonie touranienne 18. Les légendes de
la création, le déluge, les géants et les monstres dont parle le
poème épique des Yogouls demi-sauvages ressemblent à ceux
de l'antique Chaldée 29. Reuta, « fer », en finnois, paraît être
parent de l'accadien urud, « bronze 310. » Il semblerait que la
branche finnoise de la famille touranienne se soit dirigée vers
le nord à travers le Caucase et à l'ouest de la Caspienne jusqu'aux
275monts Ourals, mais la position actuelle des membres
tatars, mongols et tongouses de la famille avec lesquels l'accadien
offre de remarquables ressemblances et dans le vocabulaire
et dans la grammaire, impliquerait que le berceau médique
fut un second et non un premier point de départ de la race.
Quoiqu'il en soit, toute la bande de pays qui va de la Caspienne
au golfe Persique fut au pouvoir d'une population touranienne
aux époques les plus anciennes que nous puissions connaître ;
et il est peu probable que le flot de l'émigration aryenne vers
l'Europe ait commencé avant l'occupation de cette partie du
monde par les Touraniens 111.
Il m'a été impossible de découvrir quelques traces d'une
influence aryenne sur l'accadien et les langues qui lui sont
alliées. Si les émigrants aryens s'étaient frayé une route à
travers la population touranienne du pays, il est probable
que quelques mots indo-européens au moins se retrouveraient
dans le vocabulaire accadien. Sans doute on ne doit tenir aucun
compte des ressemblances de son et de sens qui peuvent exister
entre les racines aryennes et accadiennes. De quelque façon
qu'on explique ces ressemblances, les Aryens étaient depuis
longtemps sortis de la période des racines au moment où nos
ancêtres européens partirent pour leurs courses dans l'Occident
et, si les Accadiens leur avaient emprunté quelques termes, ils
leur auraient pris des mots tout formés, et non des racines.
Mais le lexique accadien ne révèle aucun emprunt de ce genre.
Si nous considérons qu'il en est de même du lexique assyrien,
nous sommes amenés, semble-t-il, à cette conclusion que la
population touranienne de la Médie et des régions du Tigre et
276de l'Euphrate, aussi bien que leurs conquérants et successeurs
sémites, ne furent jamais en contact immédiat avec une tribu
aryenne jusqu'à la période récente où les Mèdes aryens et les
Perses achéménides paraissent sur la scène. Ce n'est qu'à
l'époque d'Assur-bani-pal ou Sardanapale, au VIIe siècle avant
Jésus-Christ, que nous trouvons sur des tablettes assyriennes
des gloses aryennes, et ces gloses appartiennent à la branche
iranienne de la famille. Ainsi urdhu (Zend eredhwa) est donné
comme un synonyme de « haut » et Mitra comme un synonyme
de « soleil ». Tout confirme la supposition que d'autres
motifs nous ont déjà fait concevoir : les Aryens occidentaux
durent entrer en Europe par une route qui les conduisit au
nord, et non au sud, de la mer Caspienne.
En outre, on peut tirer une autre conclusion de l'absence
de toute influence aryenne sur une langue aussi ancienne que
l'accadien. Si cette langue ne montre aucun signe de contact
avec l'aryen dès une époque indéfiniment plus ancienne que
3000 avant Jésus-Christ, lorsque les Accadiens avaient déjà
quitté depuis longtemps leurs montagnes natales du nord et
s'étaient établis en Babylonie, ceux qui parlaient aryen et ceux
qui parlaient ces langues dont l'accadien est le représentant
ont difficilement pu se connaître les uns les autres. Le désert
de Sagart doit avoir été une barrière effective entre eux et les
Portes Caspiennes n'avaient pas encore été forcées par des envahisseurs
venus de l'Orient.
Il s'élève maintenant une très curieuse question. Gerland,
dans son livre sur l'Odyssée 112, a essayé de montrer à l'aide de
la mythologie comparée que les Aryens primitifs vivaient sur
les bords d'une grande mer intérieure sous les flots de laquelle
le soleil se couchait chaque soir. Humboldt croyait que la mer
d'Aral est le dernier reste de cette vaste étendue d'eau qui, à
une période relativement peu éloignée, renfermait la Caspienne
et le Pont-Euxin, et de récentes recherches ont confirmé cette
opinion 213. Nous aurions alors les Aryens primitifs d'un côté de
ce vaste lac et les tribus ougriennes primitives de l'autre ; la
277nature déserte de la contrée qui se trouvait entre les demeures
des deux races empêchait toute communication, excepté par
eau. Les deux peuples communiquèrent-ils par eau ? L'absence
de traces d'influences aryennes en accadien nous permet de
répondre négativement, et le peu d'aptitude aux entreprises
maritimes que la Philologie comparée nous montre chez les
Aryens primitifs vient à l'appui de cette conclusion. Nous pouvons
en toute sûreté croire que nos premiers ancêtres voyagèrent
vers l'ouest par terre et non par mer, que le désert de
Sagart arrêta leur marche vers le sud et que par conséquent
la route qu'ils adoptèrent fut celle qui les conduisit le long des
rivages septentrionaux de la Caspienne. C'est donc par la
Russie que les Aryens auraient pénétré en Europe et nous pouvons
découvrir un reflet du caractère froid et brumeux de la
région que les émigrants avaient à traverser dans ce fait que
le sapin (πίτυς, pinus, sanscr. pitu-dârus) et le bouleau (sanscr.
bhurja, vieil-allemand birca) furent les seuls arbres dont les
Aryens européens se rappelèrent le nom après leurs longues
migrations. Le chemin qu'ils avaient choisi fut encore suivi,
semble-t-il, bien des siècles après par les Scythes ou Sarmates
dont le langage, comme Müllenhoff l'a prouvé 114, était iranien et
se rattachait ainsi à celui des Perses, des Mèdes et des Bactriens.
Comme les Scythes, les Aryens ont pu revenir à l'état nomade
en passant à travers les steppes inhospitalières de la Tartarie et
de la Russie ; de toute manière, ce ne fut qu'après s'être établis
sur les bords occidentaux de la mer Noire (ou peut-être sur
ceux de la Baltique) qu'ils se séparèrent pour former les différentes
races de l'Europe aryenne, comme le démontre la concordance
des langues européennes dans les mots qui ont rapport
à la mer et dans le nom du hêtre qui ne croît qu'à l'ouest
d'une ligne tirée de Kœnigsberg à la Crimée.278
II
Origine des désinences casuelles en aryen.
La plus grande partie des pages précédentes était imprimée
quand je reçus un excellent et très savant article de M. Bergaigne
publié dans les Mémoires de la Société de Linguistique
de Paris (tome II, fasc. I) sous ce titre : Du rôle de la dérivation
dans la déclinaison indo-européenne. J'ai longtemps cru qu'un
examen sans préjugés et approfondi de la déclinaison aryenne
montrerait que son origine était semblable à celle du nom
sémitique, les cas ayant été différenciés selon les besoins
au moyen de terminaisons plus ou moins insignifiantes ou
de « suffixes de dérivation », si l'on préfère cette dernière
expression. M. Bergaigne a clairement montré que telle est la
vérité. Il a de cette façon donné à ceux qui croient aux racines
pronominales le moyen d'échapper à toutes les difficultés qui
les enveloppent. Presque chaque ligne du travail de M. Bergaigne
laisse entrevoir cette affirmation : « la Glottologie commence
avec la phrase, et non avec le mot », bien que cette
opinion ne soit jamais exprimée en termes formels, et la
seule conclusion logique qu'on puisse tirer des recherches de
l'auteur, c'est que la déclinaison des noms, au moins, est
sortie d'un procédé d'adaptation et non d'agglutination. Comme
il le remarque très justement, nous ne pouvons pas attribuer
la formation des cas au même procédé que celui par lequel ils
ont été remplacés à l'époque plus récente de l'analyse, et supposer
qu'une préposition (comme bhi) puisse avoir été employée
comme postposition pour former un cas, c'est non seulement
oublier que les prépositions se sont développées fort tardivement,
c'est aussi ignorer la distinction entre les prépositions
et les postpositions. J'ai été moi-même entraîné par le texte
Pada du Rig-Véda et ce que je croyais être son témoignage à
admettre le caractère agglutinatif du suffixe bhi, bien que j'aie
remarqué que la préposition à laquelle on l'a rattaché n'est
pas bhi, mais abhi ou âbhi, formée au moyen même du suffixe
279en question. Bhi ne donnait primitivement aucune signification
particulière au nom ; deux faits le montrent clairement :
d'une part il est commun à beaucoup de cas (en
vieux slave, par exemple, le datif et le vocatif sont te-bě, le
génitif te-be et l'instrumental to-bojã ; il manque, d'autre part,
à certaines langues aux cas où il apparaît dans les dialectes
apparentés. Ainsi en sanscrit nous avons sivais à côté de
sive-bhis et en latin dominis ou rosis à côté de arcubus ou de
deabus. Au datif pluriel en gothique, à l'instrumental et au
datif pluriel et duel en vieux slave et en lithuanien, il est remplacé
par sma ou smi, suffixe que nous rencontrons dans les
pronoms sanscrits ta-smai, ta-sma-t ; a-smā-n, yu-shmā-n. M. Bergaigne
a certainement raison de regarder bhi comme le même
« suffixe de dérivation » que celui que nous trouvons dans le
sanscrit garda-bha-s, « un âne », vrisha-bha-s, « un taureau, »
ou dans le grec ἔλα-φο-ς (cerf), ἔρι-φο-ς (chevreau), κρότα-φο-ς
(tempe) ou κορυ-φή (tête) 115.
Le point le plus important que ses recherches mettent en
lumière, c'est qu'il existe une différence essentielle entre les
cas forts (nominatif, accusatif et vocatif) et les cas faibles. Les
premiers étaient primitivement autant de noms abstraits, les
derniers, de simples adjectifs employés adverbialement. Les
désinences formatives des cas forts (-as [-ās], -i [-ī], -a [-yā], -an)
marquèrent jusqu'à la fin des noms abstraits, comme le sanscrit
áhan, « jour », lipi, « l'action d'écrire », vrajyā, « l'action
de voyager », mudā, « joie », le grec φυγ-ή ; et la même forme
sanscrite vákas est différenciée en grec dans le pluriel ὄπες ; et
le singulier ἔπος ;. A l'origine, cependant, vakas n'exprimait
aucune distinction de nombre ou de genre et nous voyons
combien peu la terminaison avait de rapports avec le cas par
l'apparition de la terminaison aux cas obliques, comme dans
le grec πόδεσ-σι ou ποδῶν (= ποδέσ-ων) où l'on a suivi l'accentuation
des cas forts. Bref, les cas forts, avec toutes leurs
variétés de nombre et de genre, sortirent par une évolution
graduelle des noms abstraits auxquels on appropria une multitude
de suffixes sans signification. Nous pouvons comprendre
280ainsi pourquoi l's final manque dans tant de nominatifs et
d'accusatifs pluriels ou pourquoi le même suffixe peut indifféremment
appartenir aux trois genres.
Quant aux cas faibles, comme le génitif en -sya, qui depuis
longtemps a été comparé au suffixe des adjectifs grecs tels que
δημό-σιο-ς 116 ou aux pronoms sanscrits ta-sya-i, ta-sya-s, ils sont
tous issus d'adjectifs pris adverbialement. Dans maintes formes
on ajouta suffixe à suffixe ; ainsi le -hwa (-swa) et -σι (-swi) des
locatifs zend et grec unissent les suffixes -a et -i au suffixe -su.
M. Bergaigne remet à un autre moment la discussion sur l'origine
des terminaisons -s, -t et -m aussi bien que des terminaisons
verbales ; mais on voit à quelle origine il voudrait les
rapporter.
Presque en même temps que l'article de M. Bergaigne,
paraissait une brochure allemande de Gustave Meyer, intitulée :
Histoire de la formation des racines et de la déclinaison
dans les langues indo-germaniques 217. Elle contient quelques vues
semblables à celles de M. Bergaigne, mais l'auteur ne va pas
aussi loin que le philologue français. Il s'exprime ainsi (page 3) :
« Dès le début, je dois exprimer ma conviction que la langue-mère
aryenne contenait une variété extraordinairement grande
de formes qui n'avaient entre elles aucune différence de signification
réelle, ou du moins évidente pour nous. Cette variété,
je pense, fut graduellement restreinte par le pouvoir classificateur
de l'intelligence qui grandissait. » Ces nombreuses
« formations synonymes » ont .pu, croit-il (page 3), se distinguer
l'une de l'autre par l'accent et le geste ; mais toutes traces
d'un pareil mode de distinction sont à coup sûr perdues maintenant.
M. Meyer essaie aussi d'analyser les pronoms personnels.
Il ne croit pas que dans agh-am (ego) nous ayons la racine
agh, « parler », car, selon lui, « le parleur » était un nom
281trop abstrait pour l'Aryen primitif. Il préfère résoudre agham
en a-gha-m et il retrouve le premier élément de ce composé
dans un grand nombre de formes qui marquent la troisième
personne. « Cet emploi indifférent (du même mot) pour la
première et la troisième personnes, ajoute-t-il, prouve évidemment
combien peu marquée était la différence de sens entre
ces racines pronominales. » Il y aurait une conclusion plus vraie
à tirer de là : c'est que les substantifs d'où elles sont venues en
réalité pouvaient être employés pour l'une ou l'autre des trois
personnes. Meyer observe ensuite que la confusion entre la première
et la seconde personnes, que nous rencontrons dans le
thème va-, est encore plus frappante. Il fait aussi ressortir les
difficultés qu'entraîne l'hypothèse d'une langue-mère uniforme.
« Au contraire, dit-il, je suis convaincu qu'il existait en
elle un grand nombre de ce que nous pouvons appeler des
différences dialectales, différences qui se sont conservées en
partie dans les diverses langues aryennes. » C'est ainsi que
nous sommes forcés, semble-t-il, d'admettre la coexistence
des formes sa et tas pour le démonstratif. Le professeur
Whitney, dans son nouvel ouvrage sur la Vie et le développement
du langage (page 177), s'est fortement prononcé contre
les idées que j'ai émises sur ce sujet et qu'à l'exemple du
professeur Max Müller je me suis efforcé d'exposer dans le
présent volume. Mais il me semble confondre la question de
l'origine des langues — question qui est en dehors de la province
de la Glottologie — avec celle de leurs périodes les plus
anciennes auxquelles nos données nous permettent de remonter.
Comme simples glottologistes, nous n'avons pas à nous
occuper du procédé par lequel les langues ont été créées. Pour
nous, elles ne peuvent exister que dans une société et doivent
par conséquent avoir été aussi nombreuses que les communautés
primitives qui les parlèrent. Sans nul doute, pour
qu'on se comprît mutuellement, il était nécessaire qu'un seul
dialecte fût parlé dans l'intérieur de la même communauté ;
encore faut-il admettre les différences du parler individuel.
Jusqu'à quel point des conditions semblables de vie et de
pensée, de nourriture et de climat peuvent avoir produit indépendamment
des langages semblables dans des sociétés voisines,
282mais isolées, c'est là une question à laquelle nous
n'avons aucun moyen de répondre.
III
De la correction grammaticale 118
Le but de la grammaire est de transmettre la pensée, et dès
que ce but est atteint, le mécanisme employé pour l'atteindre
est d'une importance relativement secondaire. La manière
dont nous combinons les mots et les phrases importe peu
pourvu que notre pensée soit claire pour autrui. Les expressions
horseflesh et flesh of a horse (viande de cheval) sont également
intelligibles pour un Anglais, et par suite également
reconnues par la grammaire anglaise. Le Chinois marque le
génitif en plaçant le mot qui définit devant celui qu'il définit,
comme dans koue-jin « homme de royaume », littéralement
« royaume-homme », et la seule raison pour laquelle un tel
arrangement de mots serait incorrect en français et en italien,
c'est qu'il serait inintelligible pour un Italien et pour un Français.
Par suite, il est évident que la correction et l'incorrection
grammaticale d'une expression dépend de son intelligibilité,
c'est-à-dire de l'usage ordinaire d'une langue donnée. Tout ce
qui est peu ordinaire au point de n'être pas généralement intelligible
est contraire à la grammaire. En d'autres termes,
cela est contraire à l'usage d'une langue en tant qu'il est déterminé
par le consentement et les habitudes de ceux qui la
parlent.
De cette manière nous pouvons expliquer comment il se fait
que la grammaire d'un dialecte cultivé et celle d'un dialecte
local, dans un même pays, soient si souvent en désaccord.
Ainsi, dans le dialecte du Somerset occidental, thee est le nominatif
du pronom de la seconde personne du pluriel, alors qu'en
anglais littéraire l'accusatif pluriel you (anglo-saxon eow) représente
283aujourd'hui un nominatif singulier. L'un et l'autre sont
grammaticalement corrects dans la sphère de leurs dialectes
respectifs, mais non au delà. You serait aussi incorrect en
West-Somerset que thee l'est en anglais classique ; et you et
thee, comme nominatifs singuliers, auraient été également
incorrects en ancien anglais. La correction grammaticale n'est
pas autre chose que l'usage établi d'un groupe particulier de
personnes à une période déterminée de leur histoire.
Il suit de là que la grammaire d'un peuple, comme sa prononciation,
change d'âge en âge. La grammaire de l'anglo-saxon
ou du vieil anglais n'est pas plus la grammaire de l'anglais
moderne que la grammaire latine n'est la grammaire de
l'italien moderne ; et défendre une construction ou une inflexion
peu ordinaires par la raison qu'elle existait autrefois dans
l'anglo-saxon littéraire, est une aussi grande erreur que d'introduire
une particularité de quelque dialecte local dans la
grammaire du langage cultivé. Il suit encore de là que des
langages différents ont des grammaires différentes, et que
les différences sont plus ou moins grandes selon la parenté
plus éloignée ou plus proche des langues elles-mêmes, et de
la manière de penser de ceux qui les parlent. Par conséquent,
forcer une langue à entrer dans le cadre grammatical d'une
autre, c'est mal comprendre la nature de cette dernière et causer
un préjudice sérieux à l'étude. Par exemple, la grammaire
chinoise ne peut être bien comprise qu'à condition de rejeter
non seulement la terminologie de la grammaire européenne,
mais jusqu'aux conceptions que recouvre cette terminologie ;
les langues polysynthétiques de l'Amérique défient toutes les
tentatives faites pour découvrir en elles les « parties du discours »
et les différentes idées grammaticales qui tiennent une
si grande place dans nos grammaires scolaires. Toute la peine
que l'on s'est donnée pour retrouver dans la grammaire anglaise
les distinctions de la grammaire latine, n'a eu pour résultats
que des erreurs ridicules et une inintelligence complète
de l'usage de notre langue.284
IV
Le syllabaire asianique
Depuis le déchiffrement des inscriptions chypriotes, qui,
bien que conçues dans un dialecte grec, sont écrites avec des
caractères qui n'ont aucun rapport avec ceux de l'alphabet
grec, plus d'une tentative a été faite pour découvrir l'origine
du syllabaire chypriote. Deecke a essayé de le faire dériver des
caractères cunéiformes de Ninive, mais l'assyriologie doit considérer
cette tentative comme manquée. Les caractères cunéiformes,
auxquels on a comparé le syllabaire chypriote, appartiennent
à des monuments d'époques et de provenances
différentes ; d'autres n'ont même jamais existé. En outre, la
phonologie du syllabaire assyrien est absolument différente de
celle du syllabaire chypriote, et la date à laquelle l'hypothèse
de Deecke l'oblige d'assigner l'introduction de la nouvelle écriture
à Chypre, est beaucoup trop tardive pour s'accorder avec
les faits connus. Bien loin d'être l'invention de quelque Chypriote
de Paphos, vers 710 av. J.-C, le syllabaire chypriote a
dû être en usage bien avant cette époque sur le continent de
l'Asie Mineure.
En effet, l'on a trouvé dans différentes parties de l'Anatolie
des inscriptions écrites avec des formes particulières de l'alphabet
grec. Outre les lettres connues de l'alphabet gréco-phénicien,
ces alphabets locaux en possèdent d'autres, dont la
plupart n'ont aucun rapport avec celles que les Grecs empruntèrent
aux Phéniciens. D'autre part, plusieurs de ces lettres
additionnelles se rencontrent dans plus d'un de ces alphabets
locaux, bien qu'il y ait d'autres lettres qui caractérisent un
alphabet seulement. L'un de ces alphabets locaux est le lycien,
dont nous possédons un nombre considérable d'inscriptions
qui ont été déchiffrées à l'aide de textes bilingues. Un autre
est l'alphabet carien, qui compte de trente à quarante caractères.
J'ai réuni treize courtes inscriptions écrites dans cet alphabet ;
douze d'entre elles viennent d'Egypte où, comme Lepsius
285l'a indiqué le premier, elles étaient dues sans doute aux
mercenaires cariens de la dynastie Saïte. Une troisième variété
d'alphabet est celle que l'on trouve sur les monnaies de
Pamphylie ; il est peut-être permis d'en rapprocher l'alphabet
pisidien représenté surtout par l'inscription de Sillyon 119. Une
quatrième variété est l'alphabet de Lydie ; il n'en reste, il est
vrai, qu'un fragment d'une inscription unique gravée sur l'une
des Caelatae columnae offertes par Cyrus au temple d'Artémis,
à Éphèse 220. Un autre fragment d'inscription, reproduit par
MM. Perrot et Guillaume à la planche VI de leur grand ouvrage
Exploration de la Bithynie et de la Galatie, nous fournit
une cinquième variété que nous pouvons appeler mysienne.
Enfin, une inscription trouvée par Hamilton à Eyuk (si tant est
que sa copie soit correcte), offrirait une sixième variété, l'alphabet
cappadocien. Tous ces alphabets sont absolument sans
relation avec les alphabets araméens des monnaies de Cilicie
et de Sinope, et appartiennent à une période bien antérieure
de l'histoire de l'Asie-Mineure. Ils sont aussi distincts de l'ancien
alphabet de Phrygie, qui, comme l'a découvert récemment
M. Ramsay, était aussi en usage dans la Cappadoce du
nord, puisque ce dernier ne contient pas d'autres lettres que
celles de l'alphabet gréco-phénicien 321.
Toutefois l'alphabet phrygien, et ce que je propose d'appeler
les alphabets asianiques, présentent une analogie. L'alphabet
phrygien et la partie grecque des alphabets asianiques doivent
avoir été empruntés à une même période dans l'histoire de
l'écriture grecque. Les uns et les autres présentent le digamma,
dont la présence suffit à indiquer une époque fort ancienne.
M. Ramsay s'est même efforcé d'établir que l'alphabet phrygien
a été emprunté aux marchands grecs de Sinope, dès le huitième
siècle avant J.-C.
Mais d'où sont venues les lettres non helléniques que l'on
rencontre dans les alphabets asianiques ? La question fut
286d'abord soulevée à propos des inscriptions lyciennes, et des
tentatives furent laites pour y répondre en dérivant les caractères
nouveaux des caractères grecs ; mais ces tentatives
échouèrent. Le mystère fut immédiatement éclairci lorsque
l'on put les comparer aux caractères du syllabaire chypriote.
Non seulement les formes asianiques et chypriotes étaient
identiques, mais là où l'on connaissait les valeurs phonétiques
des caractères asianiques, comme dans le cas des inscriptions
lyciennes, les valeurs phonétiques étaient identiques également.
Par exemple, l'a et l'u lyciens sont l'a et l'u chypriotes,
le vu de l'inscription de Sillyon est le vu du syllabaire de
Chypre.
Les conclusions à tirer de ce fait se présentent d'elles-mêmes.
Tout d'abord, les caractères additionnels des alphabets asianiques
doivent être syllabiques plutôt qu'alphabétiques. Ceci est
confirmé par la comparaison de deux inscriptions cariennes,
dans l'une desquelles le chypriote mi est immédiatement suivi
de la lettre s, tandis que dans l'autre une voyelle est insérée
dans le même mot entre mi et s. En second lieu, il est clair
que le syllabaire chypriote n'était pas chypriote d'origine, mais
qu'il fut une fois en usage sur les côtes d'Asie Mineure aussi
loin dans le nord que la Mysie. Par suite, il faudrait l'appeler
non pas chypriote, mais asianique, le syllabaire des inscriptions
de Chypre n'en étant qu'une variété locale. En troisième
lieu, lorsque cet alphabet fut remplacé par l'alphabet plus simple
des Grecs, certains caractères furent conservés pour exprimer
des sons que ne représentait aucune des lettres grecques. Ces
lettres supplémentaires furent choisies diversement suivant les
lieux, et de là naquirent les alphabets pamphylien, lycien, carien,
lydien et mysien. Ce n'est qu'à Chypre, dont l'isolement
explique les instincts conservateurs, que le vieux syllabaire
survécut dans toute son intégrité jusqu'au quatrième siècle
avant l'ère chrétienne.
Notre conclusion que le syllabaire asianique servit autrefois
sur toute la côte de l'Asie Mineure, méridionale et occidentale,
peut être confirmée aujourd'hui par d'autres preuves.
Parmi les objets découverts par M. Frank Calvert, consul des
Etats-Unis aux Dardanelles, dans la nécropole de Thymbra
287(Troade), se trouve une patère de la plus ancienne époque
grecque sur laquelle sont peints deux fois les caractères chypriotes
re et zo. Non loin de là, dans les couches préhistoriques
d'Hissarlik, M. Schliemann a découvert des inscriptions
qui m'ont paru, comme à MM. Haug et Gompertz, écrites à
l'aide des caractères du syllabaire asianique, et que nous avons
essayé de lire en conséquence. Parmi elles est le caractère mo,
qui se rencontre sur deux cônes de terre cuite jaune — probablement
des poids — qui ressemblent à un cône découvert
par George Smith sous le pavement du palais d'Assur-bani-pal,
à Koujoundjik. Sur ce dernier est une inscription en trois caractères
asianiques. Ils n'appartiennent pas cependant à la
variété chypriote de ce syllabaire, mais ressemblent d'une manière
frappante aux caractères trouvés à Hissarlik, et le cône
peut, en conséquence, avoir été apporté de Mysie par les ambassadeurs
que le roi lydien Gygès envoya à Assur-bani-pal.
Selon Strabon (XIII, p. 590), l'empire de Gygès s'étendait en
effet jusqu'à la Troade.
Un autre poids épigraphe trouvé à Hissarlik, a été rendu à
la lumière l'an passé 122. Les deux faces portent des caractères
gravés profondément qui montrent que le sceau en terre cuite,
déterré à une profondeur de près de 23 pieds et figuré dans
l'Ilios de M. Schliemann (p. 693, n° 1519), doit être lu e-si-re. Il
résulte de ces découvertes que le syllabaire asianique était
connu en Troade dès l'époque de la quatrième cité préhistorique
d'Hissarlik et continua à y être employé jusqu'à l'époque
où Thymbra fut colonisée par les Grecs. Le cône de Koujoundjik
fournit un témoignage analogue.
C'est donc en Asie Mineure qu'il faut chercher l'origine de
ce syllabaire, et nous devons nous efforcer de découvrir si
quelque système d'écriture plus ancien a existé dans cette partie
du monde. Des recherches récentes nous ont permis d'en
acquérir la certitude 223. Nous savons maintenant que les Hittites
de Carchémish, sur l'Euphrate (ville représentée par les monticules
de Gerablûs ou Jerabès), possédaient un système d'hiéroglyphes
288particulier et portèrent jadis leurs armes à travers
l'Asie Mineure jusqu'aux rives de la mer Egée, laissant des
documents écrits comme traces de leur passage. L'art de Carchémish,
inspiré lui-même de l'art babylonien archaïque, est
identique à l'art de Boghaz-Keni et Eyuk en Cappadoce, où
existaient autrefois une cité et un palais hittites. La cité était
probablement celle qu'Hérodote appelle Ptéria ; en tous les
cas, le district où elle se trouvait était habité par les Leucosyriens
de Strabon, ainsi nommés pour les distinguer des Syriens
à teint foncé ou Araméens sémitiques. Certains faits, tels que
le caractère de leur costume et la forme de leurs hiéroglyphes,
me disposent à croire que les tribus hittites habitaient à l'origine
la Cappadoce et l'Arménie Mineure, et que ce fut de ces
régions montagneuses qu'elles descendirent dans le territoire
sémitique du sud, où elles s'établirent dans les deux forteresses
de Carchémish et Kadesh, sur l'Oronte. Quoi qu'il en soit,
nous apprenons par les inscriptions égyptiennes qu'elles purent
appeler à leur aide, au quatorzième siècle av. J.-C, les
Teucriens, les Dardaniens, les Méoniens et d'autres nations de
l'Asie Mineure occidentale. Les hiéroglyphes, d'un style particulier,
que nous trouvons à Carchémish, Hamath, Merash,
Ghurun, Eyuk et Boghaz-Keni, sont reproduits dans des inscriptions
et des œuvres de sculpture découvertes à Bor (l'ancienne
Tyana), Ivris et Bulgar-Maden, en Lycaonie ; Beyshehr,
en Pisidie ; Giaur-Kaleyr, en Mysie, et Karabel, en Lydie. Ici les
deux figures où Hérodote croyait reconnaître le Sésostris égyptien,
représentent des guerriers hittites, et l'une d'elles est encore
accompagnée d'hiéroglyphes hittites. A la distance de
quelques milles de là, au nord du mont Sipyle, est un autre
monument hittite auquel les premiers colons grecs de la côte
de Lydie attachèrent la légende de Niobé (Iliade, XXIV, 614-7),
tandis que les Lydiens eux-mêmes, selon leur historien Xanthos
(Fragmenta historicorum græcorum, I, p. 39), considéraient
cette image, avec plus de raison, comme celle de la Déesse
asiatique, fille d'Assaôh et femme du dieu solaire Rilossos. Un
cartouche, contenant une inscription conçue en hiéroglyphes
hittites identiques à ceux de Carchémish, a été trouvé, il y a
trois ans, à côté de la figure, par M. le consul George Dennis,
289et, plus récemment encore (1882), le docteur Gollob (de Vienne)
a trouvé là une seconde inscription hittite ainsi que le cartouche
de Ramsès II en caractères égyptiens. Ce dernier confirme
la date que j'avais préalablement attribuée au monument,
qui ressemble d'une manière remarquable à l'image de
Hofretari, femme de Ramsès II, que l'on voit subsister dans un
rocher un peu au nord d'Abn-Simbel.
Ainsi la contrée où le syllabaire asianique était principalement
employé est précisément celle où, à une période antérieure,
des inscriptions hittites avaient été gravées officiellement.
Il est, par suite, assez naturel d'inférer que l'origine de
l'alphabet asianique doit être cherchée dans les hiéroglyphes
de ces inscriptions. D'ailleurs, il y a quelques arguments à
l'appui de cette conclusion. Ainsi, les textes hittites sont écrits
boustrophedon, et tel paraît aussi avoir été le cas pour les plus
anciennes inscriptions cariennes, qui sont écrites parfois de
droite à gauche et parfois de gauche à droite, ainsi que pour
les légendes chypriotes dont la plupart courent de droite à
gauche, bien que celles de Paphos courent de gauche à droite.
En outre, la particularité du syllabaire chypriote consistant à
ne pas distinguer les sons k, g et kh, t, d et th, p, b et ph,
peut être rapprochée du fait que le nom de Carchémish est
écrit avec un c (k) en hébreu, avec un g en assyrien et avec
un k en égyptien.
Mais je crois qu'il m'est possible maintenant d'alléguer un
argument précis à l'appui de l'énigme hittite du syllabaire
asianique, argument beaucoup plus convaincant que toutes
les considérations générales. Avec l'aide d'une inscription bilingue
du roi Tarkondêmos j'ai réussi à déchiffer, ce me semble,
un certain nombre de caractères hittites. Parmi ces caractères
il y en a huit qui expriment soit une voyelle simple, soit une
consonne suivie d'une voyelle. Or, lorsque je vins à les comparer
aux caractères du syllabaire chypriote ayant les mêmes
valeurs phonétiques, je trouvai que dans chaque cas la ressemblance
entre les formes hittites et chypriotes était exacte.
Comme la comparaison fut faite quelques mois après que j'eus
déterminé les valeurs des caractères hittites, la détermination
à laquelle je me suis arrêté n'a été nullement influencée par la
290ressemblance que je n'ai découverte que subséquemment
entre ces caractères et ceux du syllabaire chypriote. Il me
semble difficile de trouver une vérification plus convaincante
de mon hypothèse, formulée pour la première fois en 1876 124,
sur l'écriture hiéroglyphique des Hittites et l'origine du syllabaire
asianique.
V
La langue et la race 225
L'erreur d'après laquelle la langue serait un indice certain
de la race est une de celles qu'un philologue comparateur ne
commettrait plus guère aujourd'hui. Il n'y a pas d'assertion
qui puisse plus aisément être confrontée avec l'histoire ni qui,
confrontée avec elle, paraisse plus évidemment insoutenable.
Le langage n'est pas une nécessité physiologique ; ce n'est pas
une de ces marques physiques qui caractérisent une race et
sont inséparables de l'homme comme la couleur de la peau,
ou la conformation du crâne. Nous ne pouvons faire que nous
n'ayons pas des cheveux d'un caractère particulier ou même
peut-être telle disposition particulière, mais il n'est pas nécessaire
que nous ayons tel ou tel langage. Un homme peut ne
pas parler toute sa vie durant ; il peut n'avoir jamais l'occasion
de parler, mais il n'en sera pas moins un homme. Nous pouvons
aisément concevoir une race de sourds-muets qui ne feraient
jamais usage du langage dans le sens ordinaire du
mot ; en fait, c'est une opinion qui commence à gagner du
terrain parmi les linguistes, que tout langage articulé dérive
d'une langue de gestes antérieure, langue qui, naturellement,
était à peu près la même partout, et ne pouvait pas constituer
une différence de race. Mais, bien que le langage ne soit pas
un indice de la race, il est un indice de la société. La société,
même la plus rudimentaire, ne pourrait exister sans langage ;
assurément, aucune société civilisée ne saurait exister sans lui.
291Le langage est social par son origine et par sa nature, il est le
produit et le miroir de la société non moins que le lien qui la
tient unie. Si les hommes avaient toujours vécu isolés, tout
moyen de communiquer entre eux aurait été inutile et le langage
n'aurait pas eu besoin de prendre naissance. De même
que l'écriture fut inventée pour les besoins d'une société civilisée,
de même nous pouvons dire que le langage fut inventé
pour les besoins d'une société qui n'était pas civilisée encore.
La faculté du langage articulé était possédée par l'homme tout
comme celle de faire des lois ou des raisonnements mathématiques ;
mais si les nécessités sociales ne s'étaient pas fait sentir,
cette faculté serait restée endormie, sans un mobile qui
pût la faire entrer en exercice et servir de moyen de communication
entre les hommes. Bref, la société implique le langage,
et la race ne l'implique pas ; et, par suite, si nous pouvons
affirmer que le langage témoigne d'un contact social, nous
pouvons affirmer, avec non moins de certitude, qu'il ne témoigne
pas de la race.
Cette conclusion est confirmée par l'examen des faits. Le
langage que nous parlons n'est pas inné en nous à notre naissance.
L'enfant doit apprendre lentement et péniblement sa
langue maternelle, bien qu'il hérite sans doute d'une certaine
aptitude à cet égard. S'il est né en Angleterre, il apprend l'anglais ;
s'il est né en France, il apprend le français. Si deux
langues, ou davantage, sont parlées par ceux qui l'entourent,
il est probable qu'il apprendra ces langues plus ou moins bien,
suivant qu'il sera en relations plus ou moins assidues avec
ceux qui les parlent. Des langues, autrefois parfaitement sues,
peuvent être entièrement oubliées, et une langue étrangère
peut devenir aussi familière à l'homme que si elle était sa langue
maternelle. On voit des enfants, dont la langue était l'hindoustani,
oublier entièrement cette langue après un court séjour
en Angleterre, et il devient souvent difficile de reproduire
un son que l'on avait toujours sur les lèvres dans l'enfance.
Ce qui est vrai de l'individu l'est également de la communauté
qui se compose d'individus. Ici aussi, le langage parlé
dépend des influences qui agissent sur la communauté. Tout
ce qui brise, unit et mêle l'a communauté a le même effet sur
292le langage qu'elle parle. La communauté, à cet égard, doit être
soigneusement distinguée de la race. La même race peut être
divisée en une multitude de communautés, chacune séparée et
indépendante, et ayant des caractères propres. Bien plus, excepté
sous la pression d'une civilisation centralisée, de pareilles
communautés indépendantes doivent exister dans toutes les
races et la variété, la dissemblance des communautés entre
elles seront reproduites par la variété et la dissemblance de
leurs langues et de leurs dialectes. La diversité de mœurs et
de coutumes ne sera pas aussi grande que la diversité des langues,
puisque le langage est la réflexion de tout l'ensemble des
mœurs et des coutumes, passées et présentes, dans chaque
société. Les sociétés, en nombre infini, qui ont existé durant
la longue période où l'homme a vécu sur la terre, impliquent
un nombre égal de formes du langage, et comme ces sociétés
n'ont cessé de s'influencer mutuellement, de se détruire, de
s'absorber, de se modifier de mille manières, les langues ou
dialectes qu'elles représentent ont passé par des vicissitudes
analogues. Les langues auraient même été affectées dans une
plus grande mesure que les sociétés elles-mêmes. Une société
peut continuer à exister grâce à ses usages ou aux influences de
race, tandis que la langue qu'elle parlait peut avoir disparu par
l'effet des besoins et communications quotidiennes entre d'autres
sociétés plus puissantes. Ainsi les sociétés juives existent
dans le monde entier en tant que sociétés séparées, avec des
rites et des coutumes particulières, et cependant les langues
qu'elles parlent sont, pour la plupart, celles des peuples au
milieu desquels vivent les Juifs. Les Juifs de l'Autriche du sud
sont venus d'Espagne, et je crois que le vieux castillan est leur
langue sacrée ; les Juifs d'Abyssinie, de Chine ou d'autres
pays parlent les dialectes des pays où ils sont établis. Cet
exemple montre clairement à quel point le langage témoigne
du contact social. Si nous ne voyions que les rites et coutumes
des communautés juives, nous n'aurions aucune idée des vicissitudes
qu'elles ont traversées, des sociétés nombreuses au
milieu desquelles elles ont vécu sans s'allier à elles. Ce n'est
qu'en considérant les langues qu'elles parlent que leur histoire
devient claire pour nous ; et le langage est un témoin si
293exact des influences sociales que, même sans le secours de
l'histoire, nous aurions pu découvrir l'origine espagnole des
Juifs de l'Autriche du sud.
Il y a bien peu de races dont le sang soit aussi peu mêlé
que celui des Juifs. Si nous considérons l'antiquité du genre
humain et l'histoire des tribus de sauvages modernes qui sont
constamment à guerroyer entre elles, à prendre pour femmes
les prisonnières qu'ils font à la guerre, on admettra que les
races non moins que les sociétés doivent être fort mélangées.
Bien des races ont pu, comme les Juifs, perdre leur langue
primitive. Le celtique est éteint parmi les Celtes du pays de
Cornouailles et de l'île de Man ; le même destin semble menacer
les autres dialectes celtiques de la Grande-Bretagne et de
la France. Le lithuanien a disparu de la Prusse, et le basque
reste comme le seul représentant des langues proto-celtiques
de l'Europe occidentale. Le celtique céda au latin en Gaule et
en Espagne, comme le punique en Afrique ; les Normands,
après avoir perdu leur langue maternelle en Normandie, perdirent
de nouveau la langue qu'ils avaient acquise en Normandie
lorsqu'ils s'établirent en Angleterre. Les colonies Scandinaves
qui existèrent au Groënland pendant 500 ans, ne laissèrent aucune
trace après elles, et l'arabe en Sicile, comme le visigothique
en Espagne, ont été complètement extirpés. Les Mélanésiens
et les Papous appartiennent à des races différentes et parlent
cependant des langues semblables ; il en est peut-être de même
des Finnois et des Lapons. Quelques inscriptions, d'une signification
douteuse, voilà ce qui nous reste de la langue étrusque.
La race qui la parlait était nombreuse et puissante ; c'était une
langue civilisée et lettrée qui lutta avec succès contre l'invasion
du latin jusqu'à une époque assez récente ; mais les fragments
qui en restent ont vainement été comparés à toutes les
langues mortes et vivantes, possibles et impossibles, et je considère
l'étrusque comme le dernier vestige d'une famille de
langues qui s'est éteinte tout entière. Suivant Humboldt et
Bonpland, « un million des aborigènes de l'Amérique ont abandonné
leur langue native pour adopter une langue européenne. »
Les nègres de Haïti ont adopté le français ; les soldats envoyés
par le sultan Selim, en 1420, dans la Nubie inférieure, désapprirent
294bientôt le turc, qui était leur langue maternelle.
Ces faits suffisent à démontrer que le langage est un témoignage
du contact social et non de la race. Là où une langue
présente des traces de deux ou plusieurs autres langues,
ou lorsque deux races distinctes parlent la même langue, nous
pouvons conclure, avec certitude, qu'il y a eu un contact social
ou littéraire ; mais là où l'on ne trouve aucune trace de ce genre,
nous ne sommes aucunement justifiés à conclure qu'il
n'y a pas eu de contact social. L'exemple des Scandinaves au
Groënland est, à cet égard, un avertissement à retenir. En ce
qui concerne la race, le langage ne nous apprendra rien. Il
n'autorise même pas la présomption que ceux qui parlent une
même langue ont la même origine. Nous n'avons, pour nous
en convaincre, qu'à jeter les yeux sur les grands Etats de l'Europe,
avec leurs races mélangées et leurs idiomes communs.
Le langage montre seulement qu'elles se sont trouvées ensemble
soumises à certaines influences identiques. Lorsque nous trouvons
des noms locaux qui doivent être expliqués par la langue
d'un autre pays, nous pouvons en conclure seulement une
différence de société, mais non de race. Sans doute, l'identité
des relations sociales peut impliquer, et implique souvent en
effet, l'identité de la race ; mais ce n'est pas le langage qui
nous informe de cela. Le langage nous dit ce qu'ont été les
relations sociales ; de là, d'autres données et d'autres sciences
peuvent nous éclairer sur le compte de la race. En pesant les
témoignages, deux vérités doivent être présentes à l'esprit : la
première, c'est que la civilisation tend vers l'unité, combinant
et centralisant des sociétés, des langues et des coutumes diverses ;
la seconde, c'est que les sociétés sauvages sont dans
un état de mobilité constante. Par suite, dans une époque encore
sauvage, nous avons surtout affaire à des dialectes, et,
dans un siècle civilisé, à des langues.
Fin295
11. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler l'étymologie du mot
« aryen » que la philologie et l'ethnologie appliquent à l'ensemble
de la race indo-européenne. « Arya » était le nom que se donnaient
les Hindous dès les temps reculés, où, quittant les hauteurs du
Pamir, ils marchèrent à la conquête du pays qu'habitaient les Dravidas.
C'était une épithète laudative qui signifiait « noble », « illustre »,
« propriétaire. » On a rattaché ce mot à la racine sanscrite ar, labourer
(ἀρόω-ῶ, lat. aro). Les conquérants se distinguèrent, grâce
à cette épithète, des races domptées que les écrivains sanscrits
appellent les Mlecchas, les Nishadas et les Dasyus et que représentent
encore quelques peuples dégradés tels que les Bhils et les
Gounds, les Mhairs et les Minas, tous ennemis jurés des brahmanes.
Le mot arya se retrouve en zend sous la forme airya, « respectable »,
« vénérable », qui s'appliquait en Perse comme dans l'Inde à la
race et au pays. L'Avesta appelle la Perse Airyana ou Airya-dagya
(Airyâna Vaêja), « le pays habité par la race des Aryas ou des
hommes nobles » (Burnouf, Commentaire sur le Yaçna, CXII). Un
historien grec, Hellanicus de Lesbos, confirme le fait. Ἀρια, dit-il,
περσικὴ χώρα. D'Airyana vinrent Ἀριανή, Ariana et l'Airan de la Perse
sassanide (Iran moderne). Au dire d'Étienne de Byzance, Aria aurait
été aussi le premier nom de la Thrace. — Trad.
21. Voy. Fick, Die ehemalige Spracheinheit der Indo-Germanen
Europas, 1873.
31. Hérodote, VII, 73 ; VIII, 138 ; Strabon, XIV, 618 ; X, 471 ; VII,
295 ; Arrien, dans les « Remarques sur Denys le Périégète », d'Eustathe,
322.
42. Cratyle, 410 A.
53. Academy, 30 mai 1874.
64. On appelle ces langues « alarodiennes » du nom des Alarodiens,
peuple qui habitait dans l'antiquité sur les bords et à l'ouest de la
Caspienne, au sud du Caucase, dans l'ancienne Albanie. — Trad.
75. Ainsi nommée à cause de Rhagès (Raggan dans les cunéiformes),
l'une des plus anciennes cités de la Médie. Il est parlé de
de cette ville au livre de Tobie. — Trad.
81. Lenormant, La Magie chez les Chaldéens, p. p. 272, 273.
92. Cf. Adam, Une Genèse vogoule (Revue de philologie, I, 1874).
103. Voy. Lenormant, Les premières civilisations, I, p. 119.
111. On a remarqué qu'il serait peut-être difficile de justifier à
l'aide de l'histoire le nom de « touranien » que nous donnons aujourd'hui
aux peuples ougro-finnois. Certaines médailles pehlvies
portent des inscriptions ainsi conçues : « roi d'Iran et du Touran. »
Le Zend-Avesta et le Shah-nameh parlent continuellement des
luttes entre les Aryas et les Touryas, l'Iran et le Touran. Mais où
se trouvait le Touran ? aucun de ces monuments ne nous l'apprend.
Quelques savants estiment même que cette appellation désigne les
populations sémitiques de la Syrie contre lesquelles la race iranienne
dut souvent guerroyer. La Syrie s'appelait Athoura ; on en aurait
fait Toura, de même qu'on a tiré Syrie d'Assyrie. — Trad.
121. Altgriechische Märchen in der Odyssee, Magdebourg, 1869.
132. Voy. Spörer, dans les Mittheilungen de Petermann (1868-72) et
Nature, 20 mai 1875.
141. Monatsbericht d. Königl. Akademie d. Wiss. zu Berlin,
2 août 1866, p. 549 sq.
151. C'est ce qu'avait déjà soupçouné M. Curtius, Zur Chonologie etc.
p. 79 et Jahn's Jahrbücher, LX, p. 95.
161. Comme le σ tombe ordinairement en grec entre deux voyelles,
il faut peut-être rapporter plutôt ce suffixe à -tya qu'à -sya. Ces deux
suffixes, pourtant, remplissaient la même fonction et il y a entre
eux le même rapport qu'entre sa et ta.
172. Zur Geschichte der indogermanischen Stammbildung und Declination,
Leipzig, 1875.
181. Extrait d'un article dans la 9e édition de l'Encyclopedia britannica
(en cours de publication).
191. Voir W. M. Ramsay, Journal of Hellenic Studies, I (1880).
202. Voir mon Appendice au livre de Schliemann, Ilios, p. 698.
213. Ramsay, Sur lus plus anciennes relations historiques entre la
Phrygie et la Cappadoce, dans le Journal de la Société Asiatique,
XV, 1 (1883).
221. Voir l'Academy du 29 juillet 1882, p. 90.
232. Voir mes mémoires sur les Monuments des Hittites dans les
Transactions de la Société d'Archéologie biblique, VII, 5 (1881).
241. Transactions de la Société d'Archéologie biblique, V, 1.
252. Extrait du Journal de l'Institut Anthropologique.