 Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
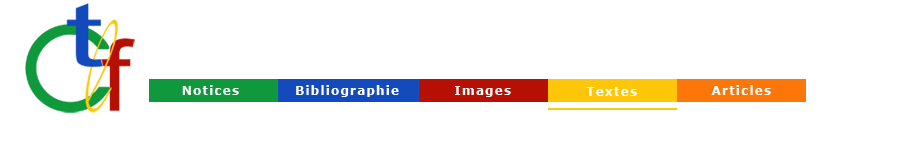
Les classifications de la linguistique
En relisant attentivement la Vie du langage de M. Whitney
et le Grundriss der Sprachwissenschaft de M. F. Müller,
j'ai reconnu qu'il est devenu nécessaire de soumettre,
dans notre Revue, à l'épreuve de la discussion les points
fondamentaux de la science du langage. M. Abel Hovelacque
a partagé cet avis, et il m'a encouragé à aborder
de front ces questions ardues. Je me propose de critiquer
dans ce premier article les classifications morphologique,
psychologique et généalogique.
De la classification morphologique.
Tout le monde va répétant qu'au point de vue de
l'expression de la relation, c'est-à-dire de la forme, les
langues sont isolantes, agglutinantes ou flexionnelles. Mais,
pour peu qu'une personne étrangère à nos études s'avise
de consulter les ouvrages des linguistes les plus autorisés,
elle découvre que la flexion s'entend, ici de l'union externe
à la racine de signification d'une racine de relation, là
d'une mutation vocalique se produisant à l'intérieur, soit
de la racine de signification, soit de la racine de relation.
Il y a là une équivoque des plus fâcheuses qui vicie et
compromet la classification morphologique.217
I
La classification morphologique date de 1808, et, chose
remarquable, elle a été proposée par F. Schlegel en des
termes prêtant déjà à l'équivoque.
Bien qu'il rangeât les langues sémitiques dans la classe
des langues agglutinantes et que, suivant M. F. Müller (1)1,
il n'entendit pas la flexion dans le sens de mutation vocalique
interne, il lui échappa de dire que, dans les langues
à flexions, spécialement en sanscrit et en grec, les idées
de relation sont indiquées par un changement interne.
Voici, au surplus, le passage entier tel qu'il a été traduit
par M. Michel Bréal : « Dans la langue indienne ou dans
la langue grecque, chaque racine est véritablement ce que
dit ce nom, une racine, un germe vivant, car les idées de
rapport étant marquées par un changement interne, la
racine peut se déployer librement, prendre des développements
indéfinis, et en effet elle est quelquefois d'une
richesse admirable. Mais tout ce qui sort de cette façon
de la simple racine conserve la marque de la parenté,
fait corps avec elle, de manière que les deux parties se
soutiennent réciproquement. »218
Séduit par une fausse analogie, Schlegel considérait les
langues isolantes et les langues agglutinantes comme étant
inorganiques, et il attribuait aux langues flexionnelles un
principe de vitalité organique. Dans cet ordre d'idées,
chaque racine lui apparaissait comme un germe vivant
dont les flexions étaient les pousses. M. Steinthal oppose
rudement à cette poésie, à ce mysticisme, que les racines
ne sont ni des graines, ni des œufs. Schlegel ne l'ignorait
pas, et il a simplement voulu dire que, par opposition à ce
qui se passe dans les langues agglutinantes, où « les particules
affixées sont encore généralement faciles à séparer (1)2 »,
dans les langues flexionnelles « ces mêmes particules
commencent à se fondre et à s'identifier avec le
mot (2)3 ».
Bopp modifia profondément la classification de Schlegel
en faisant rentrer les langues indo-européennes dans la
classe des langues agglutinantes, et en créant pour les
langues sémitiques une troisième classe caractérisée par
la modification vocalique interne.
J'emprunte à M. Michel Bréal la traduction de la partie
doctrinale du § 108 de la Grammaire comparée :
« Nous établirons, comme le fait A. G. de Schlegel,
trois classes, et nous les distinguerons de la sorte :
1° idiomes sans racines véritables, sans faculté de composition,
par conséquent sans organisme, sans grammaire.
A cette classe appartient le chinois, où tout, en apparence,
n'est encore que racine, et où les catégories grammaticales
et les rapports secondaires ne peuvent être reconnus
219que par la position des mots dans la phrase ; 2° les langues
à racines monosyllabiques, capables de les combiner
entre elles et arrivant presque uniquement, par ce moyen,
à avoir un organisme, une grammaire. Le principe essentiel
de la création des mots, dans cette classe de langues,
me parait être la combinaison des racines verbales avec
les racines pronominales, les unes représentant en quelque
sorte l'âme, les autres le corps du mot. A cette classe
appartiennent les langues indo-européennes, ainsi que tous
les idiomes qui ne sont pas compris dans la première ou
dans la troisième classe, et dont les formes se sont
assez bien conservées pour pouvoir être ramenées à
leurs éléments les plus simples ; 3° les langues à racines
verbales dissyllabiques, avec trois consonnes nécessaires,
exprimant le sens fondamental. Cette classe comprend
les langues sémitiques et crée ses formes grammaticales,
non pas seulement par composition, comme la seconde,
mais aussi par la simple modification interne des
racines. »
G. de Humboldt, qui divise les langues en deux grandes
classes, suivant qu'elles sont parfaites ou imparfaites,
range les langues sémitiques à côté des langues indo-européennes,
dans la subdivision des langues flexionnelles.
Mais qu'est ce pour lui que la flexion ?
Selon M. Max Schasler, Humboldt aurait entendu par
flexion le changement intérieur (innere Verœnderung), et
il aurait distingué, en dehors de ce procédé, d'abord la
formation du mot par la simple juxtaposition à la racine
d'un crément conservant toujours son caractère significatif
originel (Anfügung), puis sa formation par la suffixation
d'un crément ayant perdu sa signification originelle
220(Anbildung) (1)4. Reste à savoir ce que le maître entendait par
innere Verœnderung. Voici à cet égard un passage de
M. Max Schasler, duquel il me paraît résulter que dans la
pensée de Humboldt le changement intérieur ne consistait
point dans la mutation vocalique : « Ce que l'Anfügung
des affixes est à l'Anbilgung des suffixes, cette dernière
l'est au changement intérieur par flexion. La différence
importante est que la flexion ne peut avoir eu originellement
aucune autre signification, tandis qu'au contraire la
syllabe dont le mot s'est accru a possédé le plus souvent
une signification propre. Mais l'auteur n'entend pas cet
accroissement intérieur de la flexion dans le sens où l'entend
Becker, qui y voit une pousse effective de la substance
de la racine, aussi bien en ce qui concerne le son qu'en
ce qui concerne l'idée. Pour M. de Humboldt, ce qui
exerce ici son influence, c'est une loi de formation indépendante
de la substance de la racine, loi qu'il qualifie
de symbolique et dont il trouve le principe le plus
général dans l'opposition absolue de la subjectivité de
la perception à l'objectivité de l'expression extérieure.
Aussi ne considère-t-il pas le fait que le suffixe aurait
eu originellement une signification propre comme un
obstacle invincible à la pureté de la véritable flexion, ce
qui ne peut s'expliquer que parce qu'il tient pour symbolique
la croissance de la flexion par le dedans. En effet,
dès lors que le suffixe a perdu son existence propre et qu'il
s'est incorporé au mot comme un simple Moment, non
seulement il cesse d'exister en vertu d'un principe vital à
221lui propre ; mais encore, vu qu'une substance réellement
privée de vie ne peut figurer dans le langage, il lui faut
viser à acquérir un autre principe vital, lequel ne peut
être que semblable à celui sur lequel la racine elle-même,
avec laquelle il est intimement uni, influe d'une manière
immédiate par le processus de sa relation, c'est-à-dire
précisément un principe vital symbolique. La différence
entre la flexion et le suffixe qui a perdu sa signification
originelle consiste en ce que la création symbolique
est dans la flexion une création effective, tandis qu'elle
n'est dans ce suffixe qu'une sorte de transubstantiation
qui, dans tous les cas, ne s'est pas produite brusquement,
mais peu à peu (1)5. »
Quoi qu'il en soit de cette phraséologie, Humboldt a dit
très-explicitement : « Les langues agglutinantes ne diffèrent
pas spécifiquement des langues flexionnelles… Ces langues
ne diffèrent entre elles que par la mesure dans laquelle les
unes et les autres ont plus ou moins atteint un même
but (2)6. »
M. Max Müller distingue trois degrés dans la formation
des mots :
1° Les racines peuvent être employées comme mots,
chacune d'elles conservant sa pleine indépendance. C'est
l'étage radical appelé aussi monosyllabique ou isolant.
2° Deux racines peuvent être jointes ensemble pour former
un mot, et dans ce composé l'une des racines peut
222perdre son indépendance. C'est l'étage désinentiel, appelé
aussi agglutinant.
3° Deux racines peuvent être jointes ensemble pour former
un mot, et dans ce composé les deux racines peuvent
perdre leur indépendance. C'est l'étage inflexionnel, appelé
aussi amalgamant ou organique.
Le premier étage exclut absolument la corruption phonétique ;
le second l'exclut dans la racine principale, mais
l'admet dans les éléments secondaires ou déterminatifs ; le
troisième l'admet tout à la fois dans la racine principale
et dans les terminaisons.
Entre les langues du second et du troisième étage, « la
différence est en quelque sorte la même qu'entre une mauvaise
et une bonne langue. Les mots aryens semblent faits
tout d'une pièce, tandis que les mots touraniens laissent
voir distinctement les sutures et les fissures des petites
pierres cimentées ensemble… Dans les langues aryennes,
les modifications du mot qui constituent la déclinaison et
la conjugaison ont été à l'origine exprimées par agglutination ;
mais les parties composantes commencèrent bientôt
à s'unir de manière à former un mot intégral sujet à la
corruption phonétique, dans une mesure telle qu'il devint
par la suite impossible de décider quelle partie était la
racine et quelle autre l'élément modificateur (1)7. »
Comme Humboldt, M. Max Müller range les langues
sémitiques dans la même classe que les langues indo-européennes.
M. Whitney n'attribue qu'une importance minime « à la
distinction sommaire des langues en monosyllabiques,
223agglutinantes et à flexions, distinction qui est devenue
courante, familière, et présente un moyen commode, mais
peu exact, de se rendre compte de la structure linguistique (1)8. »
Quoi qu'il en soit, cette classification étant donnée, l'éminent
indianiste entend la flexion comme l'entendait Bopp,
comme l'entend Max Müller. « La langue scythique, dit-il,
est le type de ce qu'on appelle les langues agglutinantes,
pour les distinguer des langues à flexions indo-européennes.
On veut signifier par ce mot que les éléments
d'origine diverse qui composent les mots et les formes
scythiques sont moins fondus, moins étroitement aggrégés,
et qu'ils sont plus mutuellement indépendants que dans
les langues indo-européennes. Toutes nos formes, nous
l'avons vu, commencent par l'agglutination, et des mots
comme un-tru-th-ful-ly en conservent encore le caractère.
Si tous les mots ressemblaient à celui-là, il n'y aurait
aucune différence marquée entre les deux familles sur le
point fondamental, car les éléments dans la langue scythique
ne découvrent pas tous aisément leur premier état
de mots indépendants. Ils sont, comme les affixes indo-européens,
de purs signes de relation et de modification
de sens. Mais les formes scythiennes ne vont pas jusqu'à
la fusion de la racine avec la terminaison, ni même jusqu'à
la substitution de la flexion interne à la flexion externe. »
Cette expression de flexion interne me conduit à examiner
la doctrine de Schleicher et de son école.224
II
Dans son ouvrage intitulé : Les langues de l'Europe
moderne (1)9, Schleicher, après avoir défini la flexion « la
signification et la relation incorporées dans des mots particuliers
sans déroger à l'unité (2)10 », avait montré par des
exemples tirés de la formation des participes grecs qu'il
entendait bien par flexion l'union de l'élément signification
avec l'élément relation, union rendue plus étroite et comme
indissoluble par des accidents phonétiques ne laissant plus
apparaître les traces de la soudure. « La fusion indissoluble,
dit-il, fusion intellectuelle, de la signification avec
la relation s'exprime dans les langues à flexion par l'inséparable
fusion matérielle ou phonétique, c'est-à-dire que
le radical peut lui-même subir une flexion…
Pour comprendre tout ce qu'il y a de différence entre
la classe agglutinante et la classe à flexion, on n'a qu'à
comparer la conjugaison et la déclinaison agglutinantes
avec celles d'une langue à flexion quelconque, soit sémitique,
soit indo-germanique, pourvu que celle-ci ne soit
pas tout à fait déchue.
D'abord la déclinaison. Elle ne nous montre dans les
idiomes agglutinants qu'une séparation peu visible entre
le cas et sa postposition, le pluriel exprimé par un son
indiquant le nombre et l'apposition des terminaisons de
225cas, absolument comme dans le singulier. La fusion de
ces divers sons entre eux et avec le mot n'existe pas encore ;
il n'y en a tout au plus qu'un faible commencement. Les
genres masculin et féminin manquent de marque.
Prenons au contraire le participe grec tuptôn, tuptousa,
tupton, pour exemple de la flexion. Ici, nous
voyons le genre dûment annoncé, et cela non d'une manière
matérielle, mais symbolique, comme cela doit être
dans une classe élevée. Nous y voyons le radical qui est
tupt-ont ; le féminin est désigné symboliquement par une
voyelle longue, ici principalement î, qui est remplacée en
grec toujours par ia ; le nominatif se sert de la consonne
démonstrative s, mais les féminins dans les langues les
plus antiques n'ont que rarement cette consonne. Le genre
neutre, comme presque partout ailleurs, reste ici sans
recevoir une marque particulière ; il se distingue précisément
par ce défaut.
Ainsi, nous avons les formes fondamentales : nominatif
masculin tupt-ont-s, féminin tupt-ont-ia, neutre
tupt-ont. Ces formes ne sont cependant point permises
d'après les lois phonétiques de la langue grecque ; elle a
des lois qui possèdent, plus que dans une langue agglutinante,
la puissance de fondre les éléments des mots pour
en produire des unités. Dans tuptonts et tuptont, on voit
ainsi s'effacer ts et t ; alors va se montrer de nouveau la
force de l'expression symbolique que prend la relation,
car le nominatif masculin, qui est censé exprimer un objet
animé, après avoir perdu deux lettres finales nt, est dédommagé,
pour ainsi dire, par la prolongation de la
voyelle précédente, c'est-à-dire o devient ô, tupto devient
tuptôn. Quant au neutre tuptont, il rejette seulement son
226t et devient tupton. Dans le féminin, -ti se raccourcit en
s, devant lequel, d'après la loi phonétique grecque, on se
transformera en ou ; le résultat est donc tuptousa, au lieu
du primitif tuptoutsa (1)11. »
Mais voici venir un développement dans lequel le phénomène
de l'ablaut est assimilé à la flexion interne des
langues sémitiques :
« Cette comparaison établie entre une déclinaison flexive
et une déclinaison agglutinante suffit, je pense, pour démontrer
la différence qui sépare les deux grandes classes
de langues à l'égard du substantif, ce qui se démontrera
plus encore à l'égard du verbe, véritable âme de la phrase.
Et d'abord, nous rencontrons ici, comme dans la dérivation
des mots leg-ô et log-o-s, le symbolisme de la relation,
la réduplication, la transformation des radicaux ; nous n'y
trouvons plus, comme dans la classe agglutinante, la syllabe
extérieurement accolée : en grec, leipô, elipon,
leloipa, d'un radical lip ; en gothique greipa (temps présent),
graip (temps passé), gripans (participe passé), d'un
radical grip ; nima et nam, pluriel némum, numans. Cette
formation revient fréquemment dans le sémitique (2)12. »
Postérieurement, dans son Compendium, Schleicher a
confondu la flexion externe avec l'agglutination et il a fait
consister la flexion dans l'expression de la relation par un
changement dans l'intérieur de la racine.
« On peut, dit-il, provisoirement au moins, classer les
langues d'après leur caractère morphologique. Il y a :
1° des langues qui ne consistent qu'en des sons de signification
227ne s'articulant pas entre eux et invariables (par
exemple le chinois, l'annamite, le siamois, le birman) ; ce
sont les langues isolantes ; nous représenterons le son invariable
de ces langues par R (racine). L'indo-germanique
serait formé de cette manière si par exemple le mot
ai-mi (je vais, grec ei-mi) ne sonnait pas de la sorte, mais
i ou i ma (R ou R + r) ; 2° des langues qui peuvent joindre
à ces sons de signification invariables, par devant, au
milieu, par derrière ou en plusieurs lieux, des sons de
relation que nous représentons par s (suffixe), p (préfixe),
i (infixe). Ce sont les langues agglutinantes (par exemple
les langues finnoises, tatares, dravidiennes, le basque, les
langues des aborigènes du Nouveau-Monde, les langues
sud-africaines ou bantoues, etc.). A ce degré de développement,
le mot ai-mi sonnerait i-ma ou i-mi (Rs) ; 3° des
langues qui peuvent régulièrement changer la racine elle-même
pour exprimer la relation, et qui en même temps
emploient le moyen de l'agglutination ; ce sont les langues
à flexion. Nous représentons la racine ainsi modifiée, en
vue d'exprimer la relation, par Rx (R1, R2, etc.). Jusqu'à
présent, on ne connaît que deux familles linguistiques de
cette classe, la famille sémitique et la famille indo-germanique.
Celle ci n'a pour tous les mots qu'une forme, à
savoir Rx s (s représente un ou plusieurs suffixes), c'est-à-dire
que la racine régulièrement modifiable est suivie
d'un suffixe exprimant la relation, par exemple ai-mi, grec
ei-mi, de la racine i.
La famille sémitique, laquelle n'est point apparentée à la
famille indo-germanique, possède plusieurs formes de mot,
notamment les formes Rx et pRx qui sont tout à fait étrangères
à cette dernière famille. Au surplus, le vocalisme
228des langues sémitiques diffère totalement de celui des
langues indo-germaniques (1)13. »
Schleicher a eu en France deux disciples qui lui ont fait
honneur : MM. A. Hovelacque et Vinson.
A cette question : Qu'est-ce que la flexion ? M. A. Hovelacque
répond : « Ici la racine peut exprimer par une modification
de sa propre forme les rapports qu'elle a avec
telle ou telle autre racine. La flexion, c'est la possibilité
pour une racine d'exprimer en se modifiant ainsi une certaine
modification du sens. Dans tous les mots d'une
langue à flexion, la racine n'est pas nécessairement modifiée ;
elle demeure parfois telle quelle, comme dans la
période de l'agglutination, mais elle peut être modifiée.
Si nous représentons par un exposant x cette puissance de
la racine, la formule Rr de l'agglutination peut devenir
Rxr dans la période de la flexion, la formule rR peut
devenir rRx, la formule rRr peut devenir rRxr, et ainsi
de suite. »
Après avoir reproduit fidèlement la pensée de Schleicher,
M. A. Hovelacque qui, ainsi qu'on le verra tout à
l'heure, s'est parfaitement rendu compte que le phénomène
du gouna ne modifie en quoi que ce soit la signification,
M. Hovelacque, dis-je, s'ingénie à transporter la
flexion du radical dans le suffixe, ce qui est en réalité
l'abandon de la doctrine.
« Il y a plus, continue-t-il. Non seulement la racine
que les Chinois auraient appelée « pleine » peut recevoir
cet exposant, comme nous le voyons dans la formule précédente ;
mais la racine qui forme l'élément de relation,
229le suffixe, peut également être modifiée. Voici, pour plus
de clarté, un exemple de ce fait pris dans le système des
langues indo-européennes. Le sanskrit êti « il va », le
latin it, dont la vieille forme est eit, le lithuanien eiti
procèdent tous d'une forme commune aiti « il va ». Les
deux racines qui ont contribué à former ce mot sont i
« aller » et ta, pronom démonstratif, que nous retrouvons
dans le grec to « le » (au neutre), dans le latin iste.
Ces deux racines ont été soumises à la flexion dans le
mot qui nous occupe. Nous ne savons pas, à la vérité,
quelle est la cause qui détermina la modification du radical
i en ai, mais nous savons fort bien que l'élément ta
a été changé en ti pour passer du sens passif au sens
actif (1)14. »
Plus loin, revenant à la forme aiti, M. A. Hovelacque
confesse plus explicitement encore « qu'il est difficile de
reconnaître en quelle façon cette modification de la voyelle
radicale (gouna) apporte un changement quelconque à la
signification même du mot. Y a-t-il bien ici une véritable
flexion, une flexion au sens vrai du mot, c'est-à-dire
(comme nous l'avons vu plus haut) une modification
interne de la racine ? Le fait est possible ; mais ce rapport
n'est pas encore démontré. Quant au second procédé de
la variation des voyelles, il constitue, à n'en pas douter,
une véritable flexion. Il consiste en ce fait que la voyelle
a des éléments pronominaux ta, na, etc., se changeant
en i, u, ces éléments de dérivation deviennent actifs de
passifs qu'ils étaient (2)15. »230
Comme M. A. Hovelacque, M. Vinson a fini par transporter
le siège de la flexion aryenne du radical dans le suffixe.
Il dit, après avoir parlé de l'agglutination : « Un pareil
procédé, quelque ingénieux qu'il soit, est cependant encore
insuffisant, puisqu'il nécessite l'emploi de deux sons, de
deux mots, pour un seul acte de l'esprit. Il suit de là que
le meilleur système linguistique sera celui qui indiquera
la relation par un changement dans la forme de la racine
significative, laquelle restera une. Ce système a été réalisé
par les langues du troisième groupe, où il consiste à indiquer
les rapports par une altération, une variation de la
voyelle radicale du mot significatif. L'hébreu dit PaQâD
« il a vu », PiQQeD « il a vu souvent », iaPQoD) « il
verra », etc., et ces mots ne diffèrent que par leurs
voyelles ; la même chose a lieu dans les langues indo-européennes,
en sanscrit par exemple, où l'intercalation
d'un a dans la dernière syllabe de dadâmi « je donne »
change en objectivité la subjectivité du pronom, et produit
la voix moyenne dadâmai. C'est donc uniquement en
considération de cette faculté que les langues indo-européennes
peuvent revendiquer une place à côté des langues
sémitiques, qui sont évidemment les langues à flexion par
excellence (1)16. »
Dans un écrit antérieur, M. Vinson avait maintenu le
siège de la flexion dans le radical, en attribuant une valeur
flexionnelle au phénomène de l'ablaut. « Les idiomes du
troisième groupe expriment les relations par une altération,
une variation de la voyelle radicale du mot significatif, ce
qu'on appelle une flexion. Par exemple, en français,
231le prétérit « je fis » ne se distingue du présent « je fais »
que par la substitution de la voyelle i à la voyelle ai,
c'est-à-dire par la flexion (1)17. »
III
Je me propose de montrer : 1° que le renforcement de
la voyelle du radical par le gouna et la vriddhi est un
phénomène phonétique absolument étranger à l'expression
de la relation ; 2° qu'il en est de même des phénomènes
de l'ablaut et de l'umlaut ; 3° que les variations vocaliques
des suffixes tiennent à des causes secondaires, sans rapport
aucun avec l'expression de la relation.
M. Michel Bréal a dit, au sujet de la formule Rxr :
« Le x placé comme exposant auprès de R (racine) fait
allusion au renforcement (gouna, vriddhi) de la voyelle
radicale. Il semble que cette faculté de changer un a en â,
un i en ê ou âi, un u en ô ou âu, soit propre à la racine.
Le regrettable linguiste, en inventant cette formule qu'il
oppose à Rs, formule des langues finnoises, présente
comme une faculté inhérente à la racine ce qui est certainement
postérieur à la formation des mots : tout porte
à croire que le gouna et à plus forte raison la vriddhi
n'ont commencé d'exister qu'à partir du moment où la
racine s'est adjoint des suffixes (2)18. »
Cette observation est confirmée « par la coïncidence,
232sinon absolue, au moins générale, qui existe entre l'accent
tonique et le renforcement. Dans la majorité des cas, le
renforcement se rencontre avec le libre accent du sanscrit.
Ainsi, la racine bhid (fendre) fait au parfait redoublé
bibhaida (j'ai fendu) avec gouna du radical accentué, et
bibhidima (nous avons fendu) sans gouna du radical inaccentué.
On a de même tutauda (j'ai piqué) et tutudima
(nous avons piqué). Le verbe i (aller) frappe de gouna le
radical dans les personnes du présent où le radical est
accentué, et le laisse sans renforcement dans les personnes
où il n'est pas accentué : áimi, áisi, áiti, imás, ithá, jánti
pour iánti… Si l'on recherche la raison du gouna, de la
vriddhi et des renforcements en général, il est naturel d'y
voir une insistance emphatique de la voix, destinée à
appeler l'attention sur la syllabe qui les porte et à lui
donner plus d'importance (1)19. »
Mais alors même que cette explication serait hypothétique,
ne suffit-il pas, pour ruiner par la base la doctrine
de Schleicher, de ce simple fait pris en soi : que dans les
verbes, et notamment dans le verbe i (aller), certaines personnes
présentent le phénomène du renforcement, tandis
que d'autres ne le présentent point ? Ainsi, il y aurait
flexion dans áimi, áiti, áisi, et agglutination dans imás,
ithá. Dans áimi, la relation serait exprimée par la flexion
de i en ai et non par la suffixation de -mi, et dans imás
la relation serait exprimée par l'agglutination de -mas !
Relativement à l'ablaut et à l'umlaut, M. Whitney a
montré que ces altérations de la voyelle radicale « ne sont
233que d'apparentes contradictions au principe du développement
par addition externe ou aggrégation… Une partie
des mots dérivés ou infléchis semblent formés par voie de
modification interne plutôt que par addition externe. Sans
doute on dit en anglais boy et boys, mais on dit aussi man
et men ; on dit love et loved, mais on dit également read et
read ; et, en allemand, on trouve ce phénomène très-étendu
et très-imporlant de la variation de la voyelle radicale dans
de grandes classes de mots, dont l'anglais présente l'analogue,
par exemple dans sing, sang, sung et song, dans
break, broke et breach. Le grec a de même, quoique d'une
façon moins visible, un léger changement de voyelles dans
un grand nombre de verbes et de dérivés verbaux, comme
leipô, elipon, leloipa, et comme tréphô, étrapon, tétropha,
treptós, trapêx, tropos, etc. Ce sont ici d'apparentes contradictions
au principe du développement par addition
externe. Cependant, si l'on arrive à prouver que ces cas,
en apparence divergents, sont soumis à ce même principe,
ils lui prêteront une nouvelle force.
Commençons par read et read, comme étant plus récents
et plus simples. En anglo-saxon, ce verbe et le petit nombre
de ceux qui lui ressemblent n'avaient point cette différence
de voyelle entre le prétérit et le présent, et ils prenaient
la même terminaison que les verbes réguliers ou nouveaux :
les formes étaient rœdan pour read (lire) et rœdde
pour read (lu). Mais le principe phonétique de la commodité
a agi ici comme ailleurs : la pénultième de rœdde
avait une voyelle longue devant une double consonne, et on
allégea la difficulté en prononçant brève cette voyelle, procédé
si commun dans toutes les langues germaniques, que
l'on marque presque toujours comme voyelles brèves
234toutes celles qui se trouvent devant les consonnes doubles.
Lors donc que, plus tard et par la suppression des voyelles
finales des mots, les deux formes furent réduites à être
monosyllabiques, la double consonne disparut, et il ne
resta point d'autre signe de la différence de temps entre
read et read que la manière de prononcer la voyelle radicale,
longue ou brève. Le cas est analogue, d'une part, à
leave, left (laisser, laissé), feel, felt (sentir, senti), dans
lesquels il y a prononciation brève de la voyelle, pour la
même raison, mais où le groupe des consonnes a été conservé ;
d'autre part, à set, put, etc., qui ont aussi perdu
leurs terminaisons au prétérit, mais qui, ayant une voyelle
courte au présent, n'ont point été différenciés dans les
deux temps et ont conservé la même forme. La distinction
entre read et read, entre lead et lead est donc purement
un accident phonétique ; c'est un moyen de rendre compte,
dans un but grammatical, d'une différence qui s'est produite
d'une façon secondaire comme conséquence imprévue
d'une addition externe, quand cette addition a disparu
par le déclin phonétique.
Quant à man et men, c'est un exemple de ce que en
allemand on appelle umlaut ou modification de voyelle,
phénomène très-commun dans la langue germanique et
très-rare dans la langue anglaise. C'était, dans l'origine, le
changement du son de l'a au son de l'e par l'influence
assimilante de l'i qui suivait, changement qui dépend du
caractère des terminaisons des cas et qui n'a rien à voir
avec la distinction du nombre. Il arrivait en anglo-saxon
qu'un des cas singuliers (le datif) prenait l'e et que deux
des cas pluriels (le génitif et le datif) prenaient l'a. Mais,
en vertu de leur influence d'assimilation, les terminaisons
235disparurent (de la même manière que le second d, par la
suppression duquel on avait raccourci la voyelle longue de
read), de façon que datif et génitif perdirent au pluriel
leur forme distincte, et que man et men restèrent en face
l'un de l'autre, le premier comme expression du singulier
et le second du pluriel. Et parce que cette différence de
voyelle suffisait à distinguer les deux nombres, on ne fit
point double emploi en ajoutant un s comme dans ear,
ears. Ceci est encore un cas dans lequel on s'est appliqué
à faire une distinction grammaticale d'une différence de
forme qui, dans son origine, a été inorganique, c'est-à-dire
accidentelle.
Il faudrait beaucoup plus d'espace que nous n'en
avons pour discuter et pour expliquer le cas qui reste,
celui de l'ablaut ou variation de la voyelle radicale dans
bind, bound, band, bond (lier, lié, bande, lien, etc.), et
cela nous conduirait à soulever quelques questions restées
obscures et sur lesquelles disputent encore les chercheurs.
Mais nous ne trouverions, dans l'histoire de ces variations,
rien d'essentiellement contraire aux principes qui ressortent
des exemples déjà cités. Le prétérit, le participe, le
dérivé avaient chacun, dans l'origine, leur élément formatif
externe : le premier avait la réduplication, comme dans
cano, cecini, trépô, tétropha, haldan, haihald ; les deux
autres, leurs terminaisons de dérivés, et il n'existait pas
de différence de voyelle. Quand cette différence commença
à se montrer, elle n'avait pas plus de signification que
celle de feel et de felt ou de l'allemand männer de mann ;
elle ne s'était produite que sous des influences purement
euphoniques ; c'était tantôt l'affaiblissement du son d'un a,
l'accroissement de force donné à un i ou à un u au moyen
236d'un accent, et la fusion de la réduplication qui appartenait
au prétérit, avec la racine du mot. Il n'y a pas lieu d'admettre
ici des exceptions à cette règle générale que, dans nos
langues, les formes sont nées de l'aggrégation externe des
éléments séparés (1)20. »
Dans son Introduction à la grammaire comparée de
Bopp, M. Michel Bréal dit, au sujet de l'ablaut : « Ce n'est
pas le lieu d'exposer la théorie de Grimm sur l'apophonie :
il nous suffira de dire que, non content d'attribuer à ces
modifications de la voyelle une valeur significative, il y
voyait une manifestation immédiate et inexplicable de la
faculté du langage. M. Bopp combattit cette hypothèse
comme il avait combattu la théorie de F. Schlegel sur l'origine
des flexions. Il s'attacha à montrer, par la comparaison
des autres idiomes indo-européens, que l'apophonie
telle qu'elle existe dans les langues germaniques n'a rien
de primitif, que les modifications de la voyelle n'entrainaient,
à l'origine, aucun changement dans le sens, et que
ces variations du son étaient dues à l'influence de l'action
tonique (2)21. »
On a vu plus haut que MM. A. Hovelacque et Vinson,
passant condamnation sur les phénomènes du gouna, de
la vriddhi, de l'umlaut et de l'ablaut, ont localisé la flexion
interne dans les suffixes. Il n'est pas besoin d'un long
examen pour se convaincre que les mutations vocaliques
qui se sont produites dans les suffixes, au cours de la
période dite de décadence formelle, n'ont apporté aucun
237changement dans la signification. Il est certain, par
exemple, « que dans ai-mi, -mi est un affaiblissement de la
syllabe ma, qui est le thème, en sanscrit et en zend, des
cas obliques du pronom de la première personne. Mais il
y a le même rapport entre la syllabe mi dans dádâmi
qu'entre l'i du latin abjicio et l'a de jacio. Dans les formes
secondaires, par un nouvel affaiblissement, mi est devenu
m. L'accord remarquable qui règne entre toutes les
langues indo-européennes prouve que la division en formes
primaires et en formes secondaires appartient à un âge
très-reculé. Je ne crois pas cependant qu'il faille la faire
remonter jusqu'à cette période primitive où l'organisme
grammatical dans la fleur de la jeunesse n'avait encore
rien perdu de son intégrité ; je pense plutôt que les désinences
se sont émoussées à la longue, et que la cause de
cet affaiblissement a été le besoin d'alléger le verbe quand
le commencement du mot se chargeait d'une syllabe additionnelle
ou quand une insertion se faisait a l'intérieur (1)22. »
Il y a dans ce passage de Bopp une double réfutation
de la théorie de MM. Abel Hovelacque et Vinson.
Ma s'est affaibli en mi, en vertu d'une loi phonétique
dont la cause doit être cherchée dans la différence de gravité
des voyelles et dans l'influence de l'accent tonique (2)23.
Mais ce premier affaiblissement par mutation a été suivi
d'un second affaiblissement par apocope : mi s'est raccourci
en m. Il ne peut plus être ici question de flexion interne,
238non plus que dans le grec pher-ô (sanscrit bár-â-mi), où
le suffixe a disparu tout entier, ne laissant pour indice de la
relation que la caractéristique (ô) de la classe du verbe (1)24.
Il apparaît donc manifestement que le phénomène dans
lequel MM. Abel Hovelacque et Vinson ont été amenés a
voir la flexion n'est que le moindre des accidents phonétiques
qui ont atteint les racines pronominales agglutinées
aux racines verbales, et les ont transformées en véritables
suffixes.
J'ajouterai, sauf à y revenir, que si la flexion consiste
dans le changement de la voyelle du suffixe, il faut assigner
aux langues ouralo-altaïques une place quelconque
dans la classe des langues flexionnelles. En effet, l'harmonie
vocalique consiste essentiellement en ce fait morphologique
qu'à la longue un très-grand nombre des
radicaux agglutinés ont perdu, par le changement de la
voyelle, leur caractère significatif originel, pour ne plus
jouer que le rôle de simples exposants de la relation.
L'harmonie vocalique est sans doute, ainsi que l'a dit
M. Abel Hovelacque, un phénomène relativement récent ;
mais la date importe moins que le fait en lui-même, et le
fait est des plus caractéristiques. Par le procédé de l'harmonisation,
la plupart des langues ouralo-altaïques ont
franchi la période de l'agglutination proprement dite, et le
procédé consiste bien à fléchir la voyelle propre du radical
agglutiné.239
IV
D'après M. F. Müller, F. et G. Schlegel ont rangé les
langues sémitiques parmi les langues agglutinantes. Voici
en effet le schême de leur classification (1)25.
A) Langues inorganiques
I. Langues sans structure grammaticale (le chinois).
II. Langues à affixes (toutes les langues polysyllabiques,
à l'exception des langues indo-européennes).
B) Langues organiques.
III. Langues à flexions (les langues indo-européennes).
a) Synthétiques (les anciennes).
b) Analytiques (les nouvelles).
On a vu que Bopp avait créé, pour les langues sémitiques,
une classe à part, et qu'il comprenait dans une
même classe, la seconde, les langues indo-européennes et
les idiomes agglutinants.
Enfin, MM. Max Müller, Schleicher, A. Hovelacque et Vinson
font figurer les langues sémitiques dans la classe des
langues flexionnelles, à côté des langues indo-européennes.
La question que je veux traiter est celle de savoir la
place qu'il convient d'attribuer aux langues sémitiques et
aux langues ouralo-altaïques.
Tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'au-dessus
de l'étage de l'isolation il y a celui.de l'agglutination.
240Il est, en outre, hors de doute que les langues indo-européennes
ont été agglutinantes avant de devenir
flexionnelles, et c'est précisément parce qu'elles ont vécu
tout d'abord à l'état agglutinant que Bopp a cru ne pas
devoir distinguer, au point de vue morphologique, la
flexion (Anbildung) de l'agglutination (Anfügung). Comme
Bopp, M. Vinson ne voit dans la flexion externe « qu'un
degré d'agglutination ».
Je pense, avec MM. Max Müller et Whitney, qu'il y a
lieu de distinguer le procédé rudimentaire de la simple
agglutination de celui de la flexion, non seulement parce
que la transformation du mot vide en suffixe proprement
dit constitue un fait morphologique très-important à raison
de son étendue et de son intensité, mais encore parce que
les langues parvenues à l'état flexionnel diffèrent absolument,
dans leur allure générale, des langues demeurées
agglutinantes. Dans un accès de mauvaise humeur, M. Steinthal
a mis en relief les caractères qui différencient les deux
classes de langues. « Qu'importe que le lien qui unit les
syllabes grammaticales aux racines soit lâche ou étroit ?
Qu'est-ce que lâche, et qu'est-ce qu'étroit ? Il est admis tacitement
que l'étroitesse du lien a une valeur plus grande.
Bien des gens estiment, au contraire, que c'est un avantage,
pour les langues agglutinantes à lien lâche, que tout y soit
plus clair, plus reconnaissable, plus analytique et tellement
plus régulier, qu'il ne s'y rencontre pas d'anomalies. Dans
les langues indo-européennes, les mêmes relations grammaticales
sont indiquées par des désinences différentes ;
par exemple les cas sont autrement formés au singulier
qu'au pluriel et au duel, et d'un autre côté plusieurs de
ces cas sonnent de même. Dans les langues agglutinantes,
241il n'y a qu'une déclinaison et qu'une conjugaison ; au contraire,
il y a dans les langues indo-européennes plusieurs
déclinaisons, plusieurs conjugaisons et une masse de
formes irrégulières. L'indice de la dualité ou de la pluralité,
qui appartient à la racine et non à la désinence
casuelle, est extrêmement difficile à reconnaître et se place
tantôt devant, tantôt derrière la désinence casuelle. N'est-ce
pas la chose du monde la plus absurde ? Et voilà, parmi
les fleurs du langage, ce qu'il faudrait considérer comme
des roses, sans doute à cause de leurs épines (1)26 ! »
Quant aux langues sémitiques dont M. Vinson a dit
« qu'elles sont évidemment les langues flexionnelles par
excellence, » je constate avec M. Whitney « qu'elles ont
un caractère exceptionnel, anormal ; qu'elles forment une
famille plus isolée dans le monde qu'aucune autre, même
que le chinois, si pauvre et si nu, même aussi que l'américain,
si indéfiniment synthétique (2)27. »
Les langues sémitiques diffèrent profondément de toutes
les autres par deux caractères : 1° la trilittéralité de leurs
racines, lesquelles consistent exclusivement en consonnes ;
2° la modification de la signification et, dans une certaine
mesure, l'expression de la relation par le changement interne
des voyelles et par la réduction du radical disyllabique
en un monosyllabe.
Quand on sépare les éléments formatifs d'un groupe de
mots sémitiques, il reste trois consonnes. Soit, par exemple,
le groupe suivant : en arabe katal-tu « je tuai », katal-a « il
242tua, » katal-a-t « elle tua », katal-tu-mâ « vous tuâtes à
vous deux », kutil-tu « j'ai été tué », a-ktal a « il fut tué »,
ta-ktul-u « elle tue », kâtil « tuant », katl « tuer », kitl
« ennemi », kutl « massacrant », i-ktâl « qui fait tuer »,
mu-ktîl « faisant tuer » ; en hébreu kâtúl « tué », ktul-âh
« tueé », kôtêl « tuant », ktôl « tue », etc. Il est visible
que la fonction des voyelles consiste à modifier la signification
et à exprimer certaines relations, et que ces voyelles
mises de côté, ainsi que les affixes, il reste trois consonnes,
k, t, l, qui représentent par elles-mêmes l'idée fondamentale
de « tuer ». Dans katal-tu et kutil-tu, il y a
changement interne de voyelles ; dans katl, kitl, ktul,
ktôl, il y a tout ensemble changement de voyelles et réduction
de la racine en un monosyllabe.
Sans prétendre que ces deux caractères soient « des
faits primitifs non seulement inexpliqués, mais encore
inexplicables », je dis qu'ils sont organiques, et que l'hypothèse
d'un parler sémitique simplement agglutinatif,
sans flexion interne, est absolument inadmissible. Il est
vrai que le simple bon sens condamne la supposition
qu'une langue aurait commencé par des racines consonnantiques
impossibles à prononcer ; mais la signification
et la relation sont deux éléments inséparables in concreto ;
il est donc de toute évidence que les premiers Sémites qui
ont employé la racine k, t, l l'ont articulée avec le secours
d'une ou de plusieurs voyelles, c'est-à-dire en indiquant
une relation quelconque.
Quoi qu'il en soit, les langues sémitiques actuelles
n'appartiennent ni à la classe des langues agglutinantes,
ni à celle des langues à flexions, et il leur faut assigner
une place à part.243
Restent les langues ouralo-altaïques qui, jusqu'à ce
jour, ont été rangées par tous les linguistes dans la
classe des langues agglutinantes. Il importe, croyons-nous,
d'assigner à ces idiomes le rang auquel leur donne droit
l'emploi du procédé de l'harmonisation. Par cela seul que
le changement de la voyelle du radical agglutiné a pour
effet direct ou indirect de transformer ce radical en un
suffixe, en un pur indice de la relation, les langues ouralo-altaïques
ont, ainsi que je l'ai dit plus haut, franchi du
plus au moins la période de l'agglutination. En admettant
que l'harmonie vocalique ne puisse prouver à elle seule « la
descendance commune des cinq groupes de la famille (1)28 »,
toujours est-il qu'elle constitue un procédé morphologique
supérieur à celui de la simple agglutination. « Nous avons
affaire, a-t-on dit, à un fait historique… à un phénomène
de décadence (2)29 ». Cette objection ne m'ébranle point.
Et d'abord, si les langues ouralo-altaïques, livrées à elles-mêmes,
sont entrées dans la voie de l'harmonisation, c'est
évidemment que la langue mère renfermait le germe de
ce progrès. Je dis à dessein progrès, car ce qu'on appelle
décadence formelle, corruption phonétique, a été pour ces
idiomes, comme pour les langues indo-européennes, la
condition, l'instrument du développement linguistique.
Par l'harmonie, par la flexion, les unes et les autres ont,
dans une mesure inégale, dépassé l'étage de l'agglutination.
En somme, je propose d'adopter, pour le changement
des voyelles dans l'intérieur du radical, l'expression de
244version, de réserver celle de flexion pour désigner le
procédé externe, depuis le changement de voyelle du
suffixe jusqu'à l'apocope partielle ou totale, et je divise
les langues en cinq classes morphologiques :
1° Les langues isolantes (chinois, annamite, siamois,
birman, tibétain) ;
2° Les langues versionnelles (les langues sémitiques) ;
3° Les langues agglutinantes (toutes les langues qui ne
sont point comprises dans l'une des quatre autres classes) ;
4° Les langues harmoniques (les langues ouralo-altaïques) ;
5° Les langues flexionnelles (les langues indo-européennes).
V
La classification morphologique a été de la part de
M. Whitney l'objet de critiques ne tendant à rien moins
qu'à contester sa légitimité et sa valeur.
« La distinction sommaire des langues en monosyllabiques,
agglutinatives et à flexions, distinction qui est devenue
courante et familière, présente un moyen commode, mais
peu exact, de se rendre compte des caractères de la structure
linguistique. Les trois degrés se suivent, mais se
mêlent. Prendre ces caractères pour base d'une classification
des langues, c'est comme si l'on faisait de la couleur
des cheveux et de la peau les bases d'une classification
ethnologique, ou du nombre des pétales et des
étamines celle d'une classification botanique ; c'est ignorer
245ou négliger d'autres caractères d'une bien plus grande
importance. Si le naturaliste avait la même certitude que
le linguiste de l'origine commune de plusieurs espèces
du même genre, il se mettrait peu en peine de chercher
d'autres moyens de classification, mais s'appliquerait tout
entier à perfectionner l'emploi de celui-là. Il y a là pour
le linguiste une tâche suffisante, et, jusqu'à ce qu'elle
soit remplie, le reste est pour lui secondaire (1)30. »
Que la classification généalogique soit la classification
naturelle de la science du langage, cela n'est pas douteux ;
mais M. Whitney n'a pas pris garde que, dans les
trois classes de la distinction devenue courante, on a vu
l'indication des phases successives du développement linguistique,
et qu'en réalité la classification dont il s'agit
est tout ensemble morphologique et embryogénique.
« Toute langue, dit M. Topinard (2)31, a passé par trois
états, a eu trois phases de perfectionnement. Les unes les
ont traversées rapidement ; les autres en sont restées,
après une durée infinie, à la première ou à la seconde
étape. De là trois types de langues : les monosyllabiques,
les polysyllabiques ou langues agglutinatives, et les langues
à flexion. »
C'est à ce point de vue qu'il faut se placer pour apprécier
la valeur de la classification morphologique. Si elle est
en même temps embryogénique, c'est-à-dire si les différentes
classes de langues correspondent à autant d'étapes
parcourues par les plus parfaites, par celles qui se sont
complètement développées, cette classification est naturelle,
246au même titre que la classification généalogique.
Dans le cas contraire, c'est à bon droit que M. Whitney
la déclare artificielle.
Or, encore bien que les mots sémitiques n'aient point
été ramenés à des racines monosyllabiques analogues à
celles des langues indo-européennes, et qu'on ne puisse
passer de l'agglutination à la version sémitique, comme
on passe de ce même état à la flexion aryenne, toujours
est-il que les langues indo-européennes ont passé par les
phases du monosyllabisme, de l'agglutination et de la
flexion, les langues ouralo-altaïques par celles du monosyllabisme,
de l'agglutination et de l'harmonie. D'autre
part, l'effort agglutinatif se fait sentir dans les langues
monosyllabiques, et des cas de flexion se manifestent dans
les langues agglutinantes. Il y a, dans ces faits dûment
constatés, un ensemble tel, que la valeur embryogénique
de la classification morphologique ne peut être contestée.
M. Whitney a très-bien dit, au sujet des particularités de
la structure sémitique : « Si toutes les langues sont devenues
ce qu'elles sont par voie de développement, il a dû
en être de même du parler sémitique ; si toutes sont parties
de racines articulables formées d'une voyelle et d'une
consonne (?), on ne doit point croire légèrement que le
système sémitique n'est pas dans le même cas ; et, sous
les racines à triple consonne et sous la flexion interne
des mots en cette langue, doit se cacher quelque chose
d'analogue à ce qui a servi de point de départ aux autres
langues (1)32. »247
VI
De la classification psychologique.
Bien que la classification dite psychologique soit l'œuvre
de M. Steinthal, je crois utile de présenter tout d'abord au
lecteur le schême de la classification proposée antérieurement
par Humboldt :
Langues imparfaites.
a) Langues à particules, le
verbe sans expression caractéristique … Les langues maléo-polynésiennes,
le birman, etc.
b) Langues à pronoms, le
verbe caractérisé par des
affixes pronominaux … Les langues américaines.
Langues parfaites.
a) Isolation … Le chinois.
b) Flexion … a) Langues sémitiques. | b) Langues indo-européennes.
« La classification psychologique, dit M. F. Müller, procède
de la considération du langage comme expression de
la pensée et s'appuie sur une analyse de ce qui exprime
la pensée, c'est-à-dire de la phrase… Elle repose sur
l'opposition qui existe entre la substance et la forme des
matériaux linguistiques, non dans le mot, mais dans la
phrase ; elle cherche comment les diverses langues conçoivent
cette opposition et par quels moyens elles l'expriment (1)33. »248
Voici comment M. Steinthal développe cette synthèse :
« Le sentiment interne du langage (innere Sprachsinn)
produit la forme interne du langage (innere Sprachform),
c'est-à-dire le système particulier des catégories grammaticales
d'une langue. C'est d'abord, et de préférence,
d'après le sentiment interne ou d'après son produit, la
forme interne, qu'il faut déterminer la base de la classification,
c'est-à-dire d'après les catégories du langage,
d'après les formes grammaticales qu'un peuple crée dans
sa conscience (in seinem Bewufstsein), ou d'après les
formes dans lesquelles un peuple fait passer ses intuitions
à l'état de représentation. Cette création intérieure des
formes se manifeste extérieurement d'une manière bien
déterminée. La forme intérieure s'unit au son et donne
ainsi naissance à la forme extérieure ou sonore. En
réalité, la chose a lieu de telle sorte, que la forme intérieure
se produit avec et dans la forme sonore, car l'une
ne précède pas l'autre. Cette expression sonore est aussi
à prendre en considération dans la classification des
langues. En conséquence, nous avons d'abord à déterminer
les langues d'après leur nature psychologique, puis
ensuite à tenir compte de la formation extérieure, en tant
que résultat de cette impulsion intérieure. Nous avons ainsi
à renforcer ce premier caractère psychologique par un élément
morphologique issu de lui, produit par lui.Par la réunion
de ces deux déterminations, manière de concevoir,
manière de former, la forme de la langue sera déterminée.
Nous devons donc, pour chaque langue, rechercher
premièrement si et dans quelle mesure l'esprit particulier
du peuple a eu la force, sich die Form seines Gedankeninhaltes
zur Vorstellung zu bringen und diese Selbstvorstellung
249in der Lautform auszuprœgen. Plus profondément
et plus nettement l'esprit d'un peuple aura saisi l'essence
de la l'orme, plus élevé sera le degré auquel parviendra sa
langue, car d'autant elle se sera rapprochée des catégories
de l'idée. Pour aucun peuple le contenu (Inhalt) ne peut
être tout à fait dépourvu de forme ; mais la nature différente,
opposée, de la forme et du contenu, ainsi que leur
rapport réciproque, ne sont pas saisis partout, et il en
est de même du sentiment véritable des formes. Si l'élément
formel n'est lui-même qu'une substance juxtaposée
à un contenu, c'est-à-dire à une autre substance, ce contenu
manquera de forme, et le langage sera non-formel.
Il en sera ainsi notamment quand les catégories seront
exprimées par des mots-substance visiblement matériels,
quand le pluriel sera exprimé par « beaucoup, tous », les
temps par des particules comme « jadis », les prépositions
par des substantifs comme « dos, côté », sans que ces
mots auxiliaires soient convenablement fléchis. L'essence
formelle du langage réside surtout dans la construction,
c'est-à-dire dans l'activité pure, dans la synthèse en
soi, dans l'expression du prédicatif, de l'attributif, de
l'objectif, en tant que fonctions spirituelles de l'idée linguistique (1)34 ».
Si j'ai bien compris, M. Steinthal base
sa classification sur la manière dont les mots, considérés
non en eux-mêmes, mais bien comme éléments de la
phrase, traduisent l'opposition qui existe, dans la pensée,
entre la signification et la relation, la substance et la
forme, l'idée proprement dite et le rapport.250
Tout à l'heure, on recherchait comment la signification
et la relation sont combinées ensemble dans le mot. Il
s'agit maintenant de savoir comment les mots qui, dans
une phrase, expriment une relation, se différencient de
ceux qui y expriment une signification, et aussi comment
la phrase est construite, c'est-à-dire comment les mots
sont assemblés. En somme, M. Steinthal se propose de
classer les langues d'après le degré de précision et de
netteté auquel elles sont parvenues dans la distinction
sensible des catégories ou parties du discours, ainsi que
dans l'assemblage des mots. A cette double base des
catégories et de la construction, l'auteur en ajoute une
troisième, laquelle n'est autre que la classification morphologique.
Il dit en effet : « Ces trois déterminations
morphologiques de l'isolation ou juxtaposition, de l'agglutination
ou Anfügung, de la flexion ou Anbildung, sont
aussi les résultats différents d'impulsions psychologiques
différentes, des expressions différentes de modes différents
de la Selbstvorstellung, des formes sonores différentes de
sentiments intérieurs de la forme différents. En effet, si
l'isolation et l'agglutination ont pour cause un même
manque de séparation et de distinction entre la substance
et la forme, et si par cela même elles font, dans une
égale mesure, contraste avec la flexion, elles se différencient
néanmoins entre elles au point de vue de leur intuition
interne, et c'est cette différence interne qui a déterminé
leur différence externe (1)35. »
Voici le schème de la classification de M. Steinthal :251
Langues non formelles.
1. Juxtaposantes … I. Les langues indo-chinoises.
2. Amalgamantes.
a) Exprimant les déterminations
du contenu par la réduplication
et les préfixes … II. Les langues polynésiennes.
b) Exprimant les déterminations
du contenu par des racines
suffixées … III. Les langues ouralo-altaïques.
c) Exprimant les relations et les
déterminations du contenu
par l'incorporation … IV. Les langues américaines.
Langues formelles
1. Juxtaposantes … V. Le chinois.
2. Amalgamantes.
a) Simple agglutination des éléments
grammaticaux … VI. L'égyptien.
b) Changement interne dans la
racine … VII. Langues sémitiques.
c) Suffixes véritables … VIII. Langues indo-européennes.
On remarquera : 1° que la division des langues en formelles
et en non-formelles reproduit exactement la division
en langues parfaites et en langues imparfaites de Humboldt,
et que l'initiative de ranger le chinois à côté des
langues sémitiques et des langues indo-européennes
appartient en propre à ce linguiste ; 2° que l'embranchement
des langues formelles comprend exclusivement les
langues des peuples historiques, les langues à littérature,
les langues classiques, tandis que l'embranchement des
langues non-formelles comprend exclusivement des idiomes
réputés inférieurs et parlés par des peuples demeurés
dans l'ombre.
Quoi qu'il en soit, cette classification étant donnée, il
faut l'examiner dans sa base et dans ses traits principaux.
Et d'abord, la qualification de psychologique est
252usurpée, car du moment où la distinction de la substance
et de la forme se manifeste extérieurement dans le langage
soit par les catégories, soit par l'emploi des mots
vides, elle passe du domaine de la psychologie dans celui
de la grammaire. Or, si les langues différent au point de
vue grammatical, si les procédés qu'elles emploient pour
exprimer la relation sont plus ou moins parfaits, on ne
peut légitimement inférer de ces différences, de ces
inégalités, que les peuples qui parlent ces langues pensent
différemment, inégalement. La pensée proprement dite, telle
qu'elle se traduit, dans la phrase, dans la proposition,
consiste en une série de jugements, et tout jugement implique
également la distinction de la signification et de la
relation. Il n'y a point de catégories grammaticales dans
la langue birmane ; mais quand un Birman énonce une
série de jugements, il distingue tout comme nous la relation
de la signification, et si nous prenons la peine d'analyser
grammaticalement les propositions qu'il vient
d'émettre, nous constaterons que tel mot fait fonction de
substantif, tel autre d'adjectif, de préposition, de verbe,
d'adverbe, etc. Il est rigoureusement exact de dire que
les catégories grammaticales essentielles sont dans la pensée
du Birman, bien qu'elles ne se manifestent pas d'une
façon effective et sensible dans la langue birmane demeurée
rudimentaire.
La classification proposée par M. Steinthal est donc
spécifiquement grammaticale. Mais, en réalité, son auteur
n'a fait qu'élargir la classification morphologique, en s'attachant
à la distinction de la signification et de la relation,
non plus dans le mot pris isolément, mais dans le
mot considéré comme élément de la proposition et dans la
253proposition elle-même. La classification dite psychologique
repose, comme la classification morphologique, sur la
distinction fondamentale de la signification ou substance
et de la relation ou forme. Ces deux classifications ont
donc le même objet ; elles poursuivent un même but.
Sans doute « les mots n'ont une valeur déterminée qu'en
tant qu'ils sont des parties constitutives de la proposition,
et celle-ci est l'unité dans laquelle se découvre la fonction
du langage » ; mais qui ne voit que le mot objet de la
classification morphologique est précisément le mot à valeur
déterminée ?
La morphologie n'est pas en effet la science du thème ;
elle est surtout celle du mot proprement dit, c'est-à-dire
du mot tel qu'il figure dans la proposition. Quand, par
exemple, il a été constaté par l'analyse que dans ippo-s
la signification « cheval » est unie à la relation dite du
nominatif ; que dans bhara-ti la signification « porter » est
unie à la relation de la troisième personne et à celle du
présent ; que dans soror-em la signification « sœur » est
unie a la relation dite de l'accusatif ; que dans me-a-m la
signification « moi » est unie aux relations de l'accusatif,
du genre féminin et de l'attribut, la proposition indo-européenne
ne se trouve-t-elle pas avoir été étudiée dans
ses parties consécutives, dans des mots ayant une valeur
déterminée ?
La classification prétendue psychologique n'est donc au
fond que la classification morphologique présentée de
biais ; aussi n'en diffère-t-elle pratiquement que par la
place assignée au chinois entre les langues américaines
et l'égyptien ; mais à cet égard Humboldt et M. Steinthal
se sont gravement mépris sur l'essence même de la grammaire
254chinoise, en même temps qu'ils ont fait en faveur
de cette langue une exception que la linguistique n'autorise
pas, celle de suppléer à son indigence morphologique
par les sous-entendus de la syntaxe. C'est uniquement
dans cette exception qu'intervient la psychologie. La légitimité
de la classification dépend donc tout entière de la
question de savoir si les sous-entendus de la syntaxe
peuvent être pris en considération dans le chinois, alors
qu'on n'en tient pas compte dans les langues indo-chinoises.
Après avoir constaté que « le chinois ne possède ni
parties du discours, ni flexions, ni substantif, ni verbe, ni
déclinaison, ni conjugaison » (1)36, M. Steinthal caractérise
ainsi qu'il suit sa grammaire : « Il n'y a qu'un moyen essentiel
par lequel la langue chinoise exprime les relations
des idées, à savoir l'ordre déterminé dans lequel les racines
sont prononcées les unes après les autres. Toutefois,
à ce moyen s'en ajoute un autre bien secondaire, car on
ne l'emploie que concurremment avec le premier, et même
il peut être négligé : c'est celui des mots auxiliaires (2)37.
D'après la loi de position de la langue chinoise, chaque
détermination plus précise (l'attribut, que ce soit un adjectif
ou un génitif, et même un adverbe ou une locution
adverbiale) se place devant ce qui est à déterminer (le substantif
et le verbe) ; mais le complément (l'objet) se place
derrière ce qui est a compléter (le verbe régissant). Le
sujet se place devant le prédicat, tandis que l'objet suit
derrière ; le prédicat se place derrière le sujet, tandis que
255l'attribut passe devant. De cette manière, on distingue
parfaitement les trois rapports fondamentaux du discours
humain : le prédicatif, l'attributif et l'objectif, d'après leur
double opposition de sujet et d'objet, de prédicat et d'attribut (1)38. »
Voilà la méprise ; voici maintenant l'exception : « La
langue chinoise contraint à penser les formes logiques
qu'elle n'indique point grammaticalement, et par le
simple moyen de la position elle arrive, avec une entière
netteté, à une grande détermination des relations formelles
essentielles ; elle veut peu et obtient beaucoup. Nous
verrons, en examinant d'autres types de langues, comment
on peut vouloir davantage et obtenir moins, parce qu'on
ne vise pas à obtenir ce qu'il faut. Le Chinois pense au-delà
de ce qu'il y a dans sa langue, mais la langue chinoise
contraint l'esprit à mettre en elle ce qu'elle ne dit
point d'une façon expresse. Par sa loi de position, non
seulement elle exprime suffisamment la forme grammaticale,
mais encore elle excite à saisir les formes logiques
(sujet, objet, prédicat, attribut) (2)39. »
En donnant à la règle de position cette importance
qu'elle serait essentiellement le moyen par lequel la langue
chinoise exprime la relation ou la forme, et en faisant
de l'emploi des mots auxiliaires un procédé secondaire
pouvant être négligé, M. Steinthal est tombé dans l'erreur
où était tombé Schleicher dans ses Langues de l'Europe
moderne. Il a pris pour type l'ancienne langue littéraire.
« Quelques mots, a dit Schleicher, sont descendus jusqu'à
256une signification générale, et ils fonctionnent comme des
particules pour exprimer la relation, surtout dans la
langue de conversation et de littérature d'aujourd'hui, le
kouan-hoa, à côté duquel il faut encore citer le dialecte
de Kouang-ton on de la ville de Canton et de la province
maritime de Tou-Kian. Mais ces particules ne sont pas
nécessaires ; on les rencontre rarement dans le koû-wen,
l'ancienne langue littéraire ; du reste, elles n'appartiennent
pas au génie particulier de la langue chinoise ; elles sont
en quelque sorte des ballons d'essai lancés pour élever
celle-ci à une catégorie supérieure dans le développement (1)40. »
Là où Schleicher voyait de simples ballons d'essai, les
Chinois ont vu le fond même de leur grammaire.
« Qu'est-ce que la grammaire ? demande à son élève
l'instituteur chinois. — C'est un art très-utile, répond
l'élève, un art qui nous enseigne à distinguer les mots
pleins et les mots vides (2)41. »
De ce que, durant une période préhistorique très-lointaine,
la règle de position aurait été le seul procédé en
usage, s'en suivrait-il que le développement grammatical
de la langue par l'emploi des mots vides soit un fait linguistique
secondaire, accessoire, inorganique ? Voilà bien
cependant où aboutit la thèse de M. Steinthal. Le degré
de développement qui fait passer les langues isolantes à
l'état de langues agglutinantes serait étranger à leur
génie ! Une proposition semblable se réfute par son seul
énoncé.257
Non seulement le procédé grammatical des mots vides
appartient au génie propre de la langue chinoise ; mais
encore, par cela seul qu'il permet d'exprimer la relation
phoniquement, il est de beaucoup supérieur au procédé
syntaxique de la règle de position. Le langage, en effet,
consiste essentiellement à incarner la substance et la forme
dans le son. Sans doute, comme le dit M. Whitney, « le
domaine des rapports est infini, et il est loin d'être épuisé
par les moyens formels qui se trouvent dans les langues
les plus riches (1)42. » Il n'en est pas moins certain que la
langue la plus parfaite ne sera jamais celle qui contraindra
à penser les relations les plus usuelles, mais bien celle
qui exprimera par des mots le plus grand nombre de
relations.
A l'encontre de cette vérité axiomatique, M. Steinthal
n'attribue au chinois la dignité de langue formelle qu'à
raison du procédé muet de la règle de position. « La
différence, dit-il, entre le chinois et les langues indo-chinoises
consiste : 1° en ce que les langues indo-chinoises
ont une règle de position absolument simple et inflexible,
ce qui fait qu'elles émoussent la précision de la détermination
chinoise ; 2° en ce qu'elles cherchent à remédier à
l'indétermination par un usage plus fréquent, plus constant
de mots auxiliaires ayant une signification matérielle,
et qu'ainsi, non seulement elles demeurent non-formelles,
mais encore entravent dans sa marche l'activité linguistique
pensante par des éléments matériels mal appropriés.
Le chinois a sur ces idiomes le double avantage d'avoir
une détermination de la pensée plus formelle et de ne pas
258autant altérer, par des éléments matériels bruts, l'activité
formelle. Enclin à comprendre la forme par la seule position,
le Chinois habitue son esprit à considérer les éléments
auxiliaires de relations moins exempts de signification
comme de simples appuis pour la compréhension de
la forme. Par l'emploi constant des mots auxiliaires, par
l'indétermination de sa règle de position, le Siamois et le
Birman s'habituent à une compréhension des formes purement
matérielle (1)43. »
Tout cela est faux. La règle de position des langues
indo-chinoises n'a point été portée, par l'effort littéraire,
au même point d'acuité que celle du kou-wen ; mais grâce
à l'emploi des deux procédés qui sont communs à ces
langues et au kouan-hoa, les Siamois, les Birmans
indiquent et saisissent aussi bien que les Chinois les diverses
relations grammaticales inhérentes à la pensée.
Quant aux mots vides, dont l'emploi est non moins fréquent
dans le kouan-hoa que dans le siamois et le birman,
c'est un paralogisme que d'y voir des « éléments
matériels bruts ». Ce n'est point en tant que substance
(als Stoff) qu'un mot vide est placé à côté d'un mot plein ;
c'est en tant que signe de relation (als Formelles). En soi
le procédé est défectueux ; il ne vaut pas ceux de la flexion,
de la version, de l'agglutination ; mais les mots vides du
birman sont des « éléments formels » au même degré.
La langue chinoise est incontestablement plus riche que
la langue birmane ; les Chinois sont incontestablement
plus civilisés et plus intelligents que les Birmans ; mais
259pas plus que ceux-là ceux-ci ne confondent la forme et la
substance. Ainsi que l'a très-bien dit M. Whitney : « Il n'y
a point de langue humaine qui soit dépourvue de moyens
d'exprimer les rapports, et appeler certaines langues
langues formelles est un abus des mots qu'on ne peut
expliquer qu'en ce sens : c'est qu'elles possèdent à un
degré supérieur ou exceptionnel une propriété qui est
commune à toutes les autres (1)44. »
Plus d'un lecteur aura fait à la classification que je
viens de discuter cette objection décisive : que logiquement
son auteur aurait dû assigner au chinois le premier rang
parmi les langues formelles. M. Fr. Müller n'a pas reculé
devant cette énormité. « Das Chinesische formt die unbestimmten
Stoffwurzeln innerhalb des Satzes zu bestimmten
concreten Wortformen durch die Vortstellung, also ein
rein syntaktiches Moment, was nach unserer Ansicht eine
viel tiefere, geistigere Auffassung der Form verräth, als
sie selbst in unseren so vollendeten flectirenden Sprachen
stattfindet (2)45. »
VII
Il y a néanmoins à retenir de la classification proposée
par M. Steinthal que la proposition est l'unité fondamentale
du langage, en tant que celui-ci manifeste la pensée.
On pourrait donc, utilement, rechercher comment la proposition
260se construit dans les diverses langues, et classer
celles-ci au point de vue syntaxique.
Dans un précédent écrit (1)46, j'ai émis incidemment à
ce sujet des vues inexactes que je m'empresse de rectifier
ainsi qu'il suit :
Envisagées au point de vue de la syntaxe des pronoms
personnels et des pronoms possessifs, les langues sont ou
analytiques, ou synthétiques, ou polysynthétiques, ou incorporantes.
Dans les langues de la première classe, le pronom-sujet
et le pronom-objet sont juxtaposés au verbe, au
nom et à la préposition, Ex. en anglais : i love thee, my
father, for you.
Dans les langues synthétiques, le pronom-sujet est
affixé au thème verbal, tandis que le pronom-objet est
simplement juxtaposé. Ex. en latin : amo, amo te, pater
meus, ad te.
Dans les langues polysynthétiques, le pronom-sujet et le
pronom-objet sont affixés au thème verbal, au nom et à la
préposition. Ex. en hébreu : peqadouhou « ils l'ont visité »,
chiraq « ton cantique », lo « à lui ».
Dans les langues incorporantes, le pronom-objet est
infixé entre le pronom-sujet et le thème verbal. Ex. en
nahuatl : ni-mitz-tlaçotla « je t'aime ».261
VIII
De la classification généalogique.
« La généalogie, a dit M. Max Müller, là où elle est
applicable, est la forme de classification la plus parfaite (1)47…
Mais il y a beaucoup de langues qui n'ont
pas encore été rattachées à une famille, et bien qu'il n'y
ait aucune raison de douter que plusieurs d'entre elles
seront plus tard comprises dans un système de classification
généalogique, il faut néanmoins dès l'abord se mettre
en garde contre la supposition commune, mais absolument
gratuite, que le principe de la classification généalogique
soit applicable à toutes les langues. Dans la science du
langage, la classification généalogique s'appuie principalement
sur les éléments formels ou grammaticaux, lesquels,
après qu'ils ont été affectés par le changement phonétique,
ne peuvent avoir été conservés que par une tradition
continue… C'est pourquoi la classification généalogique
ne s'applique rigoureusement qu'aux langues en
décadence, dans lesquelles la croissance grammaticale a
été arrêtée par l'influence de la culture littéraire, dans
lesquelles rien de nouveau n'est ajouté, tandis que tout ce
qui est ancien est conservé aussi longtemps que possible,
et où ce que nous appelons développement n'est pas
autre chose que le progrès de la corruption phonétique.
262Mais avant que les langues déchoient, elles ont traversé
une période de croissance, et on semble avoir perdu de
vue que les dialectes qui ont divergé durant cette première
période résisteront à toute tentative de classification
généalogique… (1)48 Rigoureusement, les langues aryennes
et les langues sémitiques sont les seules qui constituent
véritablement des familles. Les unes et les autres présupposent
l'existence d'un système grammatical complet, antérieur
à la divergence (2)49. »
Si le principe de la classification généalogique n'est
pas applicable à toutes les langues, la linguistique est une
science sans avenir, une science mort-née. Mais, en fait,
le nombre des familles dès aujourd'hui constituées contredit
victorieusement l'assertion de M. Max Müller. C'est en
Afrique la grande famille bantou, dans l'Inde celle des
langues dravidiennes, dans la haute Asie et à l'est de
l'Europe la famille des langues ouralo-altaïques, au sud-ouest
de l'Europe la famille basque, dans l'Amérique du
Nord la famille des langues algonquines, etc. Il y a sans
doute encore beaucoup a faire pour que ces familles soient
déterminées aussi complètement que les grandes familles
aryenne et sémitique. Les documents historiques font défaut ;
le nombre des travailleurs est restreint ; cependant
la science fait d'année en année des conquêtes ; les efforts
vont se multipliant, et la spécialisation, que l'immensité
de la tâche à accomplir rend de jour en jour plus nécessaire,
saura triompher des idiomes les plus rebelles.
Comment les linguistes sont-ils déjà parvenus à constituer
263tant de familles, et pourquoi sont-ils assurés de poursuivre
avec succès l'application du principe de la classification
généalogique ? Je ne puis répondre plus pertinemment à
cette question qu'en mettant en regard des travaux de
MM. Weske, O'Donner, Budenz, le livre de Samuel Gyarmathi :
Affinitas linguæ hungaricæ cum linguis fennicæ
originis grammatice demonstrata, Gottingæ, 1799. Gyarmathi
avait pris connaissance des grammaires votiake,
tchérémisse et tchouvache, publiées en 1775 à Saint-Pétersbourg ;
frappé des analogies que ces idiomes présentaient
avec le magyar, sa langue maternelle, il eut la
curiosité de chercher dans le lapon, le finnois ou suomi,
l'esthonien, le vogoul, le permien, le sirjène, le mordouine,
le turc et le tatare, de nouveaux traits de ressemblance.
Sa méthode était pour l'époque remarquablement exacte,
car il faisait peu de cas des rapprochements de mots, et
c'était dans les désinences, les suffixes, la déclinaison, la
conjugaison, qu'il cherchait des points de comparaison.
Appliquant dans cet esprit la méthode comparée, il paraîtrait
qu'il dût aboutir à affirmer la parenté de toutes les
langues finnoises et fonder ainsi la science du langage.
Mais, comme la plupart de ses contemporains, il croyait
à l'unité primordiale de toutes les langues. Avant lui, P.
Beregssassi avait publié un ouvrage indigeste dans lequel
il s'était ingénié à montrer ce que le magyar aurait eu de
commun avec l'hébreu, le chaldéen, le syriaque, l'éthiopien,
l'arabe, le persan, le turc, le curdique, le zend, le
pehlvi, le sanscrit, le kalmouk, l'hindoustani, le mandchou,
le tatare, le chinois, l'arménien, le géorgien. Gyarmathi
admirait ce livre, « trésor très-estimable, dans
lequel les amateurs de la littérature hongroise peuvent
264puiser avec volupté, beaucoup de choses inconnues servant
à faire connaître la nature de la langue de la patrie et
montrant son affinité avec toutes ces langues (1)50. » Et il
ajoutait : In hoc ergo opere inveniet lector, sciendi cupidus,
plurima quæ lingua nostra ex oriente acquisivit.
Quid autem septentrio, hanc ad rem illustrandam obtulerit,
illud evolvere jam mei erit instituti (2)51.
On le voit, Gyarmathi ne se doutait même pas que le
magyar, le vogoul, le turc, le lapon, le finnois, l'esthonien
fussent étroitement apparentés entre eux. Convaincu que
sa langue maternelle avait des affinités avec l'hébreu, le
sanscrit, le chinois et le géorgien, il tenait à honneur de
faire voir qu'elle en avait également avec les langues du
nord. C'est ainsi qu'armé de la méthode de Bopp, il a
passé à côté d'une grande découverte.
Tout autre est le point de vue auquel se place M. Michael
Weske, dont je transcris ces quelques lignes : « C'est
un fait bien connu que les différentes langues des peuples
de race finnoise indiquent une langue fondamentale commune.
Cependant le rapport dans lequel chacune des
langues finnoises se trouve au regard des autres et au
regard de la langue mère n'a point encore été jusqu'à ce
jour déterminé, comme l'a été le rapport des langues
indo-européennes à leur langue mère. Il est donc absolument
nécessaire de chercher à déterminer les rapports
dont il s'agit (3)52. »265
Et maintenant je reprends la question posée plus haut.
Comment M. Weske a-t-il été amené à affirmer nettement
que les langues finnoises procèdent d'une langue fondamentale
commune et qu'elles constituent une famille ? Je
réponds : par les résultats acquis à la science dans le
domaine indo-européen et dans le domaine sémitique.
Postérieurement à Gyarmathi, il a été démontré jusqu'à
l'évidence que l'étroite affinité des langues romanes
a pour cause leur descendance commune d'une langue
mère qui nous est parfaitement connue. Du français, de
l'italien, du provençal, de l'espagnol, du portugais, du
roumain, on remonte jusqu'au latin avec une entière certitude,
et chemin faisant on suit pas à pas les transformations
des flexions grammaticales, en même temps que l'on
constate l'identité originelle d'un très-grand nombre de
mots qui n'ont point été l'objet d'emprunts réciproques.
« Les dialectes germaniques, dit M. Whitney, présentent
les mêmes sortes de ressemblances que les langues romanes.
Les mots de broeder en hollandais, bruder en allemand,
brodhir en islandais, broder et bror en danois et en
suédois, qui tous répondent au brother anglais, ne sont
pas moins clairement des variations d'un même mot que
les différents produits du frater latin. Le vieux mot germanique
weib (femme) se trouve dans la plupart des
langues germaniques modernes et y a conservé une forme
tiès-reconnaissable et d'une valeur identique ; mais, en
anglais où il fait wife, il a pris le sens de l'italien moglie
(épouse). Il n'est pas moins certain que wife, weib,
wif, sont le même mot, qu'il ne l'est que muger et moglie
sont le latin mulier. Nous croyons aussi bien à l'existence
du grand-père que nous n'avons jamais vu, parce qu'il
266est mort depuis longtemps, quand nous avons devant nous
un groupe de cousins, que nous croyons à celle du
grand père qui vit encore au milieu de ses petits-enfants (1)53. »
M. Max Müller, qui nie le grand-père décédé durant la
période préhistorique en disant : « Le grammairien qui revendique
une réalité historique pour le type primitif d'une
langue teutonique se met dans le cas de l'historien qui
verrait dans Francus, petit-fils d'Hector, l'ancêtre de tous
les Francs » (2)54 ; M. Max Müller, dis-je, reconnaît néanmoins
« qu'il doit y avoir existé une langue plus primitive
que le grec, le latin et le sanscrit, une langue formant le
fond commun de ces trois langues, aussi bien que des
langues teutoniques, celtiques et slaves » (3)55. C'est là le
point important. Grâce à la découverte du sanscrit et aux
recherches dont cet événement a été le point de départ, la
science du langage s'est fondée sur cette loi universelle et
absolue : que les affinités grammaticales et lexiologiques
existant entre un certain nombre de langues attestent une
communauté originelle, et que ces langues forment une
famille. C'est en vertu de cette loi que M. Weske a entrepris
de reconstituer la langue mère des idiomes finnois,
et que les linguistes travaillent, en ce moment, à grouper
les langues du monde entier par familles.
M. F. Müller a cru devoir donner à la classification généalogique,
non il est vrai comme base, mais comme point
de départ, la série des races humaines constituée d'après
267un caractère anthropologique, dont je n'ai pas à discuter
l'importance : il s'agit de la chevelure. L'utilité et la légitimité
de cette incursion dans le domaine de l'ethnographie
sont également contestables. En effet, M. Fr. Müller
constate lui-même que le nombre des Sprach-typen (au
delà de 100) est bien supérieur à celui des Rassen-typen
(12).
Le même auteur a émis, au sujet de la base même de
la classification généalogique, une théorie qui, prise à la
lettre, serait en contradiction avec la méthode suivie
depuis Bopp. Procédant par triade, à la façon de Hegel,
M. F. Müller donne pour bases : à la classification morphologique,
la forme ; à la classification généalogique,
la substance ; à la classification psychologique, le rapport
de la forme à la substance ; et il dit expressément de la
seconde : « La classification généalogique considère, dans
les langues, la substance qui est le point d'appui de leurs
formes, c'est-à-dire les racines. » La vérité est que la
classification généalogique considère, dans les langues, et
la substance et la forme, et les racines et les mots ; que
les langues sont groupées en famille d'après leurs affinités
grammaticales et leurs affinités lexiologiques, et que l'étymologie
appliquée au dégagement des racines serait à elle
seule un guide des plus dangereux.
Lucien Adam.268
1(1) « Doch scheint F. v. Schlegel von der Flexion einen anderen
Begriff sich gebildet zu haben, als es der heut zu Tage unter den
Sprachforschern geltende ist, da er sonst nicht die semitischen Sprachen
zu den agglutinirenden rechnen würde. » (Grundriss der Sprachwissenschaft,
t. I, p. 66) Bopp a compris autrement la pensée de Schlegel.
V. Grammaire comparée (traduction de M. Michel Bréal), t, I, p. 226.
2(1) Grundriss der Sprachwissenschaft, t. I, p. 65.
3(2) Ibid.
4(1) Die Elemente der philosophischen Sprachwissenschaft Wilhelm
von Humboldt's, p. 43, § 41.
5(1) Die Elemente der philosophischen Sprachwissenschaft Wilhelm
von Humboldt's, p. 42, 43.
6(2) Steinthal, Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des
Sprachbaues, p. 61.
7(1) Lectures on the Science of language, p. 304 et passim.
8(1) La vie du langage, p. 227.
9(1) Traduction d'Hermann Ewerbeck. Paris, 1852.
10(2) Ibid., Introduction, p. 12.
11(1) Les langues de l'Europe, p. 147 et suiv.
12(2) Id., p. 152, 153.
13(1) Compendium der vergleichenden Grammatik, etc., p. 3.
14(1) La linguistique, p. 202.
15(2) Id., p. 256, 257.
16(1) Le basque et les langues américaines, p. 3, 4.
17(1) La science du langage, p. 2.
18(2) Mélanges, p. 401.
19(1) Grammaire comparée des langues classiques, par F. Baudry,
p. 53.
20(1) La vie du langage, p. 105, 106, 107.
21(2) Grammaire comparée des langues indo-européennes, t. I, Introduction,
p. XXV.
22(1) Grammaire comparée des langues indo-européennes, t III,
§439.
23(2) Baudry, Grammaire comparée des langues classiques, § 22.
24(1) Bopp, Grammaire comparée, t. III, § 434.
25(1) Grundriss der Sprachwissenschaft, t. I, p. 67.
26(1) Steinthal, Charakteristik der hauptsächlichsten Typen der
Sprachbaues, p. 12.
27(2) Whitney, Vie du langage, p. 204.
28(1) A. Hovelaque, La linguistique, 2e édit., p. 147.
29(2) Ibid., p. 146, 147.
30(1) La vie du langage, p. 227.
31(2) Anthropologie, p. 437.
32(1) La vie du langage, p. 207.
33(1) Grundriss der Sprachwissenschaft, p. 77.
34(1) Charakteristik der hauptsächlichsten Typen der Sprachbaues,
p. 316, 317, 318.
35(1) Charakteristik der hauptsächlichsten Typen der Sprachbaues,
p. 319, 320.
36(1) Charakteristik der hauptsächlichsten Typen der Sprachbaues,
p. 113.
37(2) Ibid., p. 114.
38(1) Charakteristik der hauptsächlichsten Typen der Sprachbaues,
p. 115.
39(2) Ibid., p. 116, 117.
40(1) Les langues de l'Europe moderne, p. 66.
41(2) Abel Hovelacque, La linguistique, p. 47.
42(1) La vie du langage, p. 182.
43(1) Characteristik der hauptsächlichsten Typen der Sprachbaues,
p. 148.
44(1) La vie du langage, p. 183.
45(2) Grundriss der Sprachwissenschaft, t. I, p. 105.
46(1) Grammaire caraïbe du P. Raymond Breton, Introduction,
p. XXVII.
47(1) Lectures on the science of language, p. 123.
48(1) Lectures on the science of language, p. 178, 179.
49(2) Ibid., p. 294.
50(1) Affinitas linguæ hungaricæ cum linguis fennicæ originis grammatice
demonstrata, p. XI.
51(2) Ibid., p. XII.
52(3) Untersuchungen zur vergleichenden Grammatik des finnischen
Sprachstammes von Dr Michael Weske.
53(1) La vie du langage, p. 138, 139.
54(2) Lectures on the science of language. p. 184.
55(3) Ibid., p. 173.