 Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
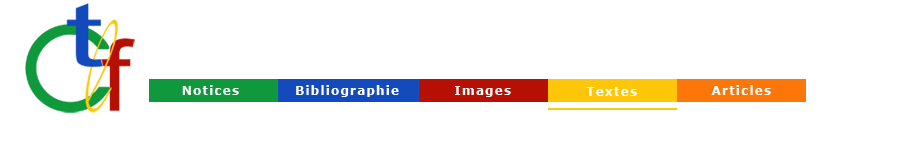
[Programme et méthodes de la linguistique théorique]
Chapitre premier
Science des faits et science des lois. — Justification
rationnelle d'une linguistique théorique.
La linguistique se définit par son objet : c'est la science du
langage.
Il est inutile de dire ici plus exactement ce que c'est que
le langage. Ce n'est pas autour d'une définition abstraite,
mais à l'occasion d'un ensemble de faits d'un ordre très spécial
et aisément reconnaissables comme tels, que la linguistique
s'est constituée. Dès longtemps le langage humain a
donné lieu à des études de toutes sortes. Aujourd'hui une
ample littérature est consacrée à la science qui nous occupe ;
elle comprend le plus modeste manuel de conversation
comme le plus savant Thésaurus, les ouvrages élémentaires
où nos écoliers apprennent à conjuguer rosa, la rose, aussi
bien que les puissantes synthèses de la grammaire comparée.
La linguistique pousse sans cesse ses investigations plus avant
et s'attache à décrire de plus en plus complètement un nombre
toujours croissant de faits. Sans cesse de nouvelles langues
sont étudiées par les grammairiens, et les anciennes donnent
lieu à de nouveaux travaux, comme si elles offraient aux
investigations humaines un champ indéfiniment exploitable.
Mais la plupart de ces travaux d'ailleurs fort divers ont un
caractère commun. Ils s'attachent à fixer et à décrire des faits
historiques, c'est-à-dire des faits localisés dans le temps et
1dans l'espace. En tel lieu, en tel temps, tel était l'état linguistique
observable, telle manière de parler était correcte. La
déclinaison latine de l'âge d'or, l'usage de Cicéron relativement
à l'emploi du subjonctif dans les subordonnées, le vocabulaire
français au XVIe siècle, les articulations dont se sert
une peuplade sauvage, et qu'un missionnaire s'efforce de reproduire
par un système alphabétique, voilà autant de faits
historiques, contingents, et qui sont dus, sinon au hasard, du
moins à un concours « fortuit » de conditions — et probablement
pour une bonne part aussi à certaines initiatives humaines —
qui, en un lieu et en un temps donnés et nulle part ailleurs,
se sont rencontrées pour produire ce résultat.
La linguistique est donc pour nous avant tout une science
des faits historiques ou plus simplement une science des
faits 11 Tantôt elle se contente de décrire des états de
langage observés dans le présent ou dans le passé : l'allemand
d'aujourd'hui, ou le gothique d'Ulfilas. Tantôt avec un
grand nombre de documents empruntés à diverses époques,
elle cherchera à retracer un aperçu des évolutions
d'une même langue pendant une période plus ou moins
longue, par exemple ce sera l'histoire de l'allemand ou du
français depuis les plus anciens monuments littéraires jusqu'à
l'état actuel. Tantôt encore elle abordera une tâche plus
difficile, et elle essayera par la comparaison de divers idiomes
apparentés, suivant une méthode ingénieuse et précise, de
nous renseigner sur des faits linguistiques oubliés qui appartiennent
à la préhistoire. C'est ainsi qu'en comparant du
sanscrit avec du grec, des idiomes italiques, du slave, etc.,
pris de préférence dans leurs documents les plus archaïques,
on est arrivé à connaître l'indo-européen ou du moins à fixer
2certains éléments du langage commun hypothétique dont
toutes ces langues diverses sont sorties par évolution.
Cette science des faits nous apparaît donc dans un triple
rôle : elle décrit, elle raconte, elle reconstitue. Toutes les
sciences des faits se présentent en effet dans ces diverses
fonctions. Il est vrai que lorsqu'il s'agit de l'activité humaine,
il est souvent difficile, pour des raisons que nous n'avons pas
à développer ici, d'ajouter à la description et à l'histoire, la
reconstitution du passé qui nous échappe. On peut décrire
par exemple les mœurs et les institutions des peuples, raconter
leurs évolutions pour autant que l'histoire nous permet
de les suivre ; mais en ce qui concerne les périodes oubliées
du passé, nous en sommes réduits dans ces domaines à de
vagues hypothèses qui ne constituent point une science.
Il n'en est pas tout à fait de même quand on aborde l'étude
du monde physique et organique. Tandis que la géographie
physique décrit le globe et nous raconte les transformations
qu'il subit tous les jours et celles qu'il a subies de mémoire
d'homme, la géologie nous dit par quelles phases il a dû
passer à travers des milliers et des milliers de siècles oubliés,
pour parvenir à l'état actuel ; et l'origine même de ce globe
ne nous est pas inconnue, des hypothèses scientifiques établies
et contrôlées par de sûres méthodes, nous permettent
d'assister en imagination à sa genèse du sein de la nébuleuse
primitive. Il n'en est pas autrement en zoologie par
exemple ; cette science classe les espèces animales observées
dans les divers lieux et dans les divers temps, et sous le
nom de paléontologie, elle nous décrit en les reconstituant,
les formes dont il ne nous reste que des débris. Elle va
plus loin encore, puisque s'inspirant de certaines méthodes
fondées sur certains principes, elle prétend même établir en
quelque mesure la généalogie des espèces actuellement existantes,
et montrer les principaux anneaux de la chaîne ininterrompue
qui, de génération en génération, les relie aux premiers
organismes cellulaires.
Une science qui reconstitue le passé doit pouvoir, par une
3application inverse des mêmes méthodes, prévoir l'avenir.
C'est ce qui a lieu en astronomie pour les éclipses, en géographie
physique pour les marées, en météorologie pour la
prévision du temps ; mais pour que la prévision soit possible,
il faut que les causes en jeu soient suffisamment connues et
leurs effets aisément calculables. Ce sont des conditions qui
ne se réalisent déjà plus guère dans les sciences de la vie
organique, et qu'on ne saurait plus du tout rencontrer là où
intervient comme facteur l'agent humain. La linguistique en
particulier qui reconstitue le passé, n'a jamais prétendu
annoncer l'avenir.
Quoiqu'il en soit, les sciences des faits dans leur ensemble
s'efforcent d'embrasser tous les faits de tout ordre et dans
tous les temps, aussi loin que la capacité de l'intelligence
humaine permet de les atteindre. Mais elles n'épuisent cependant
pas toute la science. A côté des sciences des faits, il
y a, comme s'exprime Adrien Naville, les sciences des lois.
Ces sciences n'ont pas d'autres objets, mais elles les considèrent
à un autre point de vue. Elles cherchent derrière le contingent,
le général et le nécessaire. Partant de ce postulat
scientifique que partout où les mêmes conditions sont
réalisées le même effet doit se produire (postulat qui ne
supprime pas nécessairement l'idée de la liberté, mais
la limite seulement, en imposant au réel les conditions du
possible), partant donc de ce postulat, elles ne se soucient
point de savoir en quel lieu et en quel temps tel phénomène
s'est réalisé, mais elles recherchent d'une façon générale
les conditions des phénomènes. Les vérités qu'elles énoncent
n'ont point de date, ni de localisation, elles sont partout
et toujours vraies, bien qu'hypothétiques dans leurs prémices :
partout et toujours si une figure est circonscrite par trois
droites, ces trois droites formeront entre elles trois angles
dont la somme est égale à deux angles droits, etc.
Ces deux ordres de recherches sont distincts par leur fin
4et par leur principe d'ordonnance. Dans l'un on veut fixer le
fait, dans l'autre découvrir la loi ; l'un connaît principalement
l'ordonnance chronologique et topographique ; il s'agit
d'une reconstitution de la réalité telle qu'elle s'est passée ou
telle qu'elle est ; l'autre ne connaît que les ressemblances ou
les différences qualitatives, toute chose est analysée en ses
éléments, et chaque élément expliqué suivant les lois spéciales
de l'ordre auquel il appartient. En géographie, une
montagne se décrit par sa situation, sa forme, sa nature,
son climat, sa faune, etc. Si l'on peut dire quand et par
quel soulèvement elle s'est produite, on le dit, et l'on ajoute,
si c'est possible, l'histoire des transformations qu'elle a
subies. Mais c'est là un ensemble très complexe de faits dont
les lois très diverses ressortissent chacune à une science spéciale.
Ces sciences sont, dans l'ordre de la nature matérielle et
pour ne nommer que les principales divisions : les mathématiques,
la mécanique, la physique, la chimie et la biologie.
Cette montagne a une forme et tous ses éléments sont susceptibles
d'être mesurés et nombrés. Sa genèse et son histoire,
sa vie pour ainsi dire se réduit à un très grand nombre
de mouvements : l'eau coule sur ses flancs ou dans son
sein selon toutes les lois de l'hydrostatique. Les forces physiques
de la chaleur, de l'électricité, etc., règnent dans sa
matière, dont d'ailleurs la chimie ou la cristallographie nous
expliqueront la constitution ou les changements. Enfin sa
faune et sa flore sont dues à l'apparition de faits biologiques
à sa surface. Le but idéal des sciences des lois serait de pouvoir
intervenir à propos de chacun de ces phénomènes pour
en fournir une explication adéquate ou du moins suffisante
et rendre ainsi le phénomène total qui est une somme, mais
aussi une combinaison et une résultante, intelligible à l'esprit
humain.
Ces deux ordres de recherches, si divers qu'ils soient dans
leur définition, sont cependant étroitement solidaires, puisque
5les faits historiques sont toute la matière de la science
des lois qui n'existe que pour eux. S'il n'y avait pas de faits
particuliers, concrets, il n'y aurait pas de science des lois, et
tout fait concret, fût-ce le plus facilement interprétable dans
son idée générale, comme une figure géométrique ou l'ébullition
de l'eau, se présente d'abord à nous comme un événement
spécial dans le complexe enchevêtrement des faits historiques.
Il faut donc commencer par la méthode empirique
pure qui consiste à observer, à constater les faits ; mais cette
méthode ne conduit pas loin. Pour aller au-delà de la simple
représentation brute, il faut se servir d'une autre méthode
qui est du ressort de l'intelligence, et que la science des faits
possède en commun avec la science des lois, de telle sorte que
l'une ne peut se construire sans que l'autre ne s'édifie en
même temps, nous voulons parler de la méthode rationnelle
c'est-à-dire de l'induction et de la déduction.
Il est impossible en effet de décrire ou même de nommer
les choses sans faire déjà un travail de comparaison et d'abstraction.
Dire que le soleil a une apparence circulaire, qu'il
est chaud et lumineux et qu'il parcourt un certain chemin
dans le ciel, c'est déjà de la science rationnelle puisqu'on a
recours à des notions générales de mécanique, de géométrie,
de physique.
Ce qui est vrai pour le premier pas est vrai aussi pour
tous les pas suivants. Bien décrire c'est classer, et les classifications
vraiment utiles et claires sont celles qui se fondent
sur la nature réelle des choses. Les autres ne sont que confusion,
sous une illusoire apparence d'ordre. Comment la
minéralogie classerait-elle les pierres sans le secours de la
chimie et de la cristallographie ? Qu'importe les apparences
de couleur, de forme, de poids, etc., les diversités de provenance
et d'utilisation technique, si on ne peut les ramener à
d'autres plus essentielles ?
Les principes des sciences des faits se rencontrent donc
avec les principes sur lesquels les sciences des lois doivent
s'édifier. Ces caractères essentiels que découvre une induction
6bien dirigée, servent à la fois à de bonnes descriptions,
à de bonnes classifications et à de bonnes explications. C'est
pour cela que malgré certaines apparences contraires, jamais
ces deux ordres de recherches n'ont progressé que d'une
manière parallèle en s'entr'aidant mutuellement. On a longtemps
observé les étoiles et décrit leurs mouvements, tout en
n'ayant que des notions rudimentaires sur l'explication de
ces faits. Mais cette science trop empirique était condamnée
à croupir dans les spéculations fantaisistes de l'astrologie,
jusqu'au jour où quelques grands esprits se sont avisés d'explications
rationnelles génialement pressenties, que l'observation
a confirmées, et qui ont lancé tout à nouveau la science
sur la voie de fécondes découvertes. Cela nous retarderait
trop de chercher à décrire le mécanisme de cette action réciproque ;
contentons-nous de constater ce fait évident et concluant
à lui seul sur le point qui nous occupe, que c'est à la
méthode rationnelle, à la connaissance des lois, que les recherches
historiques empruntent tous ces procédés de reconstitution
du passé ou de prévision de l'avenir auxquels
nous avons fait allusion plus haut. Sans la mécanique et la
physique, Kant ni Laplace n'auraient jamais tenté de nous renseigner
sur les périodes où notre monde, en gestation dans une
nébuleuse primitive, s'est formé peu à peu et a pris l'aspect
que nous lui voyons aujourd'hui. Sans la chimie, la géologie
décrirait des terrains et des roches, sans en tirer aucune
lumière sur l'histoire de notre globe, et sans certains principes
de biologie, on accumulerait dans les galeries de nos
musées les débris des faunes disparues, mais ce ne serait
qu'un fatras inutile qui nous étonnerait sans nous instruire.
Nous avons donc affaire avec une seule méthode qui est
mise au service de deux fins distinctes, et les mêmes vérités
scientifiques servent à construire deux édifices dont les principes
d'ordonnance sont différents. Dans l'un de ces édifices
la science s'attache au fait, qu'on considère comme événement
réel et concret dans la situation topographique et chronologique
7qui lui appartient, seulement on s'efforce de le
décrire, de le classer et de l'expliquer dans ses parties autant
que faire se peut. Dans l'autre on part aussi du fait, mais on
n'y revient plus ; on remonte à ses principes généraux et
c'est à ces principes qu'on s'arrête ; on les définit, on les dénombre,
on les justifie rationnellement dans la mesure où
cela se peut, et avec ces principes, au lieu d'essayer de reconstruire
imparfaitement le réel de l'histoire, on édifie par
déduction dans chaque ordre le système général des possibles,
dont le réel n'est qu'une application contingente.
Ces deux fins correspondent à deux éléments que l'on
trouve dans toute connaissance et qui en sont comme les
deux pôles nécessaires : le contenu contingent de la perception
qui est donné, le phénomène ; et la forme intelligible
dans laquelle cette perception est saisie, forme qui intellectuellement
parlant, ne saurait se distinguer du sujet apercepteur
lui-même. La science historique nous renseigne sur le
monde tel qu'il est en dehors de nous dans le temps et l'espace,
la science des lois nous dit ce qu'il est en nous.
Dans la théorie du déterminisme absolu, et en supposant
qu'on arrivât à connaître toutes les conditions et toutes les
lois, la science du possible finirait par coïncider avec celle du
réel, et tout ce qui arrive nous apparaîtrait comme un effet
nécessaire d'une seule et même cause éternelle ; et si les lois
connues étaient toutes rationnellement intelligibles comme
celles de la géométrie, le monde entier avec toute sa multiplicité,
ne serait plus pour nous qu'un vaste théorème que la
science des lois démontrerait, et que l'histoire confirmerait
expérimentalement.
Cette conception se heurte à des difficultés philosophiques
que nous n'avons pas à dire ici. Pratiquement la science
semble condamnée à marcher toujours vers ce double but :
explication des faits réels par l'application de lois générales,
et explication des lois générales empiriquement constatées
par leur démonstration rationnelle, mais sans jamais atteindre
pleinement ni l'un ni l'autre ; et nous sommes de ceux
8qui s'en consolent sans peine, parce que cela leur permet de
réserver dans l'ensemble des choses la place de contingences
irréductibles, d'une liberté dont l'existence en condamnant
la science absolue, sauve les droits de la morale 12.
Cette rapide esquisse d'une théorie sur la classification des
sciences était nécessaire pour faire voir que la distinction de
la science historique des faits et de la science théorique des
lois est également applicable à toute espèce d'objet et particulièrement
à la linguistique.
La linguistique historique, celle des faits, doit donc avoir
quelque part sa science des lois. De même qu'au-dessus
de l'idée des langues particulières nous concevons celle du
langage en général, nous pouvons sans peine imaginer
une science qui traite de ce phénomène pris dans son
idée abstraite, à côté de celle que nous trouvons dans nos
grammaires et qui nous parle toujours de quelque forme particulière
9du langage ; ce serait ce que nous appellerons d'un
terme plus commode la linguistique théorique. Et si ce que
nous avons dit est juste, cette linguistique théorique est aussi
indispensable au vrai progrès de la science des faits linguistiques,
que peuvent l'avoir été la physique et la chimie
au progrès de la géologie, ou les mathématiques à ceux de
l'astronomie.
Cette science existe-t-elle ? Le simple fait qu'on puisse se
poser cette question indique assez clairement que si elle
n'est pas entièrement négligée, elle n'a du moins pas encore
réussi à se constituer d'une manière quelque peu satisfaisante.
Cependant la linguistique des faits existe et progresse
tous les jours. Il y a là un état de choses qui semble contredire
aux principes que nous venons d'exposer.
Avant d'aborder de front ce qui concerne la constitution
de la linguistique théorique, il sera bon d'examiner la situation
actuelle de nos deux sciences et de répondre aux questions
qu'elle soulève.10
Chapitre II
Des relations de la linguistique des faits et de
la linguistique théorique dans l'état actuel de la science.
Depuis qu'Aristote a établi ses fameuses catégories et a
fourni ainsi aux grammairiens certaines données fondamentales
de logique qui ont passé dans leur terminologie, la
science théorique n'a plus contribué que d'une manière
extrêmement fragmentaire et intermittente aux progrès de
la science des faits en linguistique.
Ce n'est pas cependant que les tentatives pour établir les
principes généraux de cette science aient manqué. Depuis
Herder et Humboldt jusqu'à Hermann Paul et au-delà, on
pourrait citer une longue liste d'auteurs qui ont tenté de
quitter l'étude des idiomes particuliers pour s'attacher au
langage et à ses lois générales. Mais ces essais, quels que
soient leurs mérites, sont restés sans influence appréciable
sur les études de linguistique descriptive ou historique.
Les grammairiens ont fait progresser leur science par
leurs propres efforts et sans le secours des théoriciens. Semblables
au mécanicien qui au cours de son travail fabrique
lui-même les outils plus spéciaux dont il peut avoir besoin,
ils ont perfectionné leur terminologie, et avec quelques notions
générales de psychologie et surtout de logique, ils ont
créé l'arsenal des concepts abstraits nécessaires pour décrire
les états de langage et leurs transformations. Bien plus, ils
11ont inventé eux-mêmes des méthodes fécondes de recherche.
Ce sont les grammairiens indous qui nous ont appris à
analyser les mots en leurs parties constitutives et à remonter,
par l'abstraction des suffixes, préfixes et autres caractères
de dérivation, du mot donné à une racine idéale qui
est l'élément commun de tout ce qui appartient à une même
famille. Cette méthode déjà précieuse de description et de
classement, par laquelle toute la morphologie d'une langue
se résume en formules de dérivation, est devenue entre les
mains des premiers indogermanistes un procédé d'explication
et de reconstitutions historiques. En l'appliquant non
plus seulement à la comparaison des formes simultanées
d'une même langue, mais à celle des formes de diverses langues
apparentées, on est arrivé à retrouver des racines communes
à ces langues, racines qui n'étaient plus de simples
entités abstraites, mais les éléments constitutifs d'une langue
plus ancienne parlée par des ancêtres communs.
Pour arriver à ce but il fallait faire intervenir l'idée de
temps et considérer les faits linguistiques dans leur rapport
génétique ; il fallait en outre que ces rapports eussent des
lois certaines, car toute reconstitution du passé est un calcul
qui suppose des données et des lois. C'est ainsi que ceux qui
ont été les initiateurs de la grammaire comparée, ont d'abord
pressenti, puis découvert ou démontré par le succès même de
leur entreprise, le grand fait des correspondances régulières
de certains sons d'une langue à l'autre, et l'ont ramené
au principe qui domine toute l'évolution du langage,
de la régularité des lois phonétiques.
Nous ne nous attarderons pas à décrire ce principe familier
à tous les linguistes et sur lequel nous aurons à nous étendre
longuement plus tard, nous voulons seulement montrer par
un exemple frappant comment la linguistique des faits a su
se frayer seule la voie vers ses plus admirables découvertes.
La science théorique n'a fait que suivre. Cette régularité des
lois phonétiques, cette hypothèse empiriquement vérifiée et si
12heureusement utilisée par les grammairiens, il fallait en fournir
une démonstration rationnelle. On l'a tenté, mais, nouvelle
infériorité des théoriciens vis-à-vis des praticiens, il faut
avouer qu'on n'y a guère réussi jusqu'à aujourd'hui et que,
si l'on continue à croire à ce principe fécond, c'est parce
qu'on le constate et parce qu'il est utile, et point du tout
parce qu'on le comprend.
Une science théorique qui n'apporte à la pratique aucun
secours, qui la suit tant bien que mal au lieu de la précéder,
une telle science court le danger de tomber dans le discrédit
comme inutile. Quand on constate en outre qu'elle est instable,
qu'elle n'arrive pas à se constituer solidement et qu'elle
semble en fait de méthode et de résultats livrée à l'arbitraire
des fantaisies individuelles, on est près de conclure qu'elle
est illusoire, et que ses spéculations, quel que soit leur intérêt
propre, ne méritent guère qu'on s'y arrête. Les esprits
positifs, en quête de vérités solides, se tournent d'un autre
côté.
Cependant, si ce que nous avons dit sur la justification rationnelle
de la linguistique théorique et sur l'utilité d'une
telle science, n'est pas tout à fait faux, nous devons considérer
la situation que nous venons de décrire, comme anormale,
et nous dire que ce discrédit dans lequel notre science risque
de tomber, a des causes qu'il importe de rechercher pour
pouvoir plus sûrement y remédier.
Ces causes nous semblent être de deux sortes. Nous considérerons
d'abord et plus longuement celles dont les grammairiens
eux-mêmes portent la responsabilité, pour parler ensuite
plus brièvement de celles qui ont leur origine en dehors
de la linguistique proprement dite.
Les grammairiens, disons-nous, sont pour une bonne part
responsables du peu de cas que l'on fait de la science théorique
en matière de langage. Les origines de la linguistique
sont scolaires. On a étudié les langues pour des fins pratiques ;
il s'agissait au début, avant tout, de fixer un usage
13correct, de fournir les notions nécessaires à la critique et à
l'exégèse d'un texte littéraire. Ainsi les brahmanes étudiaient
les Vêdas, et les Alexandrins chargeaient de scolies le texte
d'Homère.
Ensuite il s'est agi d'enseigner ou d'apprendre des idiomes
étrangers. Les plus anciennes grammaires françaises
que l'on possède ont été écrites aux XIVe et XVe siècles pour
l'usage des Normands d'Angleterre qui commençaient à oublier
la langue apportée par leurs ancêtres sur le sol britannique,
et qu'ils tenaient à conserver comme un parler aristocratique.
Aujourd'hui encore le seul mot de grammaire
fait penser spontanément à un manuel de classe.
Cependant la grammaire est devenue une science qui
existe en dehors des fins pratiques auxquelles elle peut servir.
Sous le nom de linguistique, elle se dégage des préoccupations
philologiques ou scolastiques qui l'accompagnaient
au début, et elle considère les langages comme des phénomènes
humains qui méritent d'être décrits et analysés scientifiquement,
sans autre but que la satisfaction d'une curiosité
intelligente.
Mais ce n'est pas tout de connaître, il faut encore comprendre.
Et c'est ici, semble-t-il, que les linguistes se sont
contentés d'une ambition trop restreinte. Nous comparerions
volontiers le grammairien qui se contente de décrire une
langue ou d'en raconter les destinées sans aller plus loin, au
collectionneur de papillons qui range dans ses cadres, par
genre, espèces et variétés, les insectes qu'il a capturés.
Pour se livrer avec succès à la chasse et à l'élevage des
papillons, il faut sans doute quelques notions pratiques
d'histoire naturelle, et la détermination des espèces demande,
avec un œil bien exercé, la connaissance des principaux organes
extérieurs ; mais là s'arrête la science de notre lépidoptérologiste.
Est-ce à dire qu'il aura le droit de faire peu
d'estime de ces sciences des lois qui s'appellent la biologie
et la physiologie ? Non certes, car s'il en reste là, il pourra
être tout ce qu'il voudra : amateur passionné, collectionneur
14émérite, érudit incomparable dans sa partie, descripteur fécond
de nouvelles formes et de nouvelles variétés, jamais il
ne sera un savant dans toute la force du terme ; la nature
qu'il voit mais ne connaît pas, ne lui révélera aucun de ces
secrets réservés à ceux qui savent pénétrer dans son intimité.
N'est-ce pas ce qui est arrivé aux sectateurs de la linguistique,
et en collectionnant les riches matériaux qui s'offraient
de toutes parts à leur prise, ne se sont-ils pas contentés de
faire une besogne préliminaire utile, mais inférieure ? Et
tandis qu'ils croient posséder leur science, n'aurait-on
pas quelque raison de leur dire que l'essentiel est encore à
faire ?
Dégagée de ses fins utilitaires, la linguistique doit tendre
consciemment vers une fin supérieure, qui est celle de
la science elle-même. Elle doit pour sa part et dans une collaboration
consciente avec d'autres disciplines connexes, apporter
sa contribution à la connaissance de la nature et de
l'homme. C'est ici sans doute que la linguistique a été et est
encore au-dessous de sa tâche. Elle a gardé de ses habitudes
scolaires un goût plus prononcé pour l'aspect formel que
pour l'aspect intime des choses.
La grammaire existe pour elle-même, comme un ensemble
de faits, un code de lois d'une nature spéciale, sans liaison
organique avec les autres lois de la nature. On dit : tel adjectif,
par exemple le latin plenus, demande le génitif. Mais
qu'est-ce que le « génitif », et qu'entend-on par ce terme
« demander » ? Ces expressions familières au grammairien
ont une valeur empirique et formelle, mais ne disent rien,
pas même à ceux qui s'en servent avec autorité, sous le rapport
de l'intelligence générale des choses. Presque partout
on se contente de décrire le comment, sans se soucier outre
mesure du pourquoi ; on ne sort guère de la grammaire,
domaine fermé réservé aux seuls grammairiens, pour arriver
à l'homme, qui est le sujet vivant et actif de son langage.
Le propre de la science des lois, c'est, comme nous l'avons
15vu au chapitre précédent, de mettre chaque fait, ou chaque
élément constitutif d'un fait, en rapport avec les autres faits
que les mêmes lois régissent. Le langage est une activité
psychique de l'homme qui s'exerce par l'intermédiaire de
son organisme. La physiologie, la psychologie, la logique
doivent concourir chacune pour leur part à l'explication du
phénomène total. Sans doute, et par la force des choses, ce
sont ces sciences qui ont fourni toutes les notions générales
bien définies dont le grammairien fait usage. La logique surtout
a été largement, trop largement, mise à contribution.
Cette science formelle des relations abstraites a répondu
trop longtemps à tous les besoins des grammairiens d'école.
A elle seule elle ne pouvait procurer qu'une connaissance
superficielle du langage. La physiologie aussi a été appelée à
fournir des données au linguiste qui en avait besoin pour
la description et la définition des sons. Quant à la psychologie,
on lui a aussi toujours fait des emprunts d'occasion là
où la logique pure était manifestement insuffisante. On dit
par exemple que la règle de l'emploi des cas est violée en grec
lorsque le cas de l'antécédent se transmet au relatif par l'effet
d'une sorte d'attraction ou d'assimilation. Mais ces éléments
rationnels qui s'introduisent de toute part dans la linguistique
des faits, ne suffisent pas pour changer son caractère
général. Ils sont seulement mis au service de la connaissance
grammaticale et empirique des langues ; on ne leur demande
pas autre chose. Ils servent à classer et à fixer. C'est la
langue que l'on veut connaître, et on croit avoir assez fait
quand avec le secours de cet appareil de notions rationnelles
plus ou moins adéquates à leur objet, on est arrivé à
mettre noir sur blanc les règles générales et les particularités
d'un idiome.
Ce qu'il faudrait, ce serait de pénétrer dans la vie de cet
idiome, aussi bien en ce qui concerne son fonctionnement que
ses évolutions. En théorie, chacun est enclin à avouer qu'il ne
saurait y avoir de document plus riche et plus exact sur la
mentalité des peuples et des individus que leur langage. Le
16style c'est l'homme, et si le caractère d'un individu se dévoile
par les traits de son écriture, comme d'ailleurs par tout
ce qui porte l'empreinte de son activité, à plus forte raison
se dévoilera-t-il dans ce langage qui est comme l'émanation
directe de son âme, le miroir fidèle de sa vie psychique.
Seulement c'est un document qu'il faudrait savoir interpréter,
comme on interprète l'histoire des religions ou celle de
l'art, afin que l'histoire des langages apporte, elle aussi, sa
contribution intéressante à l'histoire de l'homme.
Il ne suffit pas de dire qu'ici la tâche est plus difficile.
Elle s'impose ; la science de l'homme, l'anthropologie
générale, est en droit de demander à la linguistique,
non seulement des faits, mais des faits présentés de telle
façon qu'ils apportent leur interprétation avec eux.
Si les grammairiens avaient toujours été conscients de
cette tâche qui leur incombe, ils auraient mieux compris que
les progrès réels de leurs études étaient solidaires de ceux
d'une science théorique, et que derrière les phénomènes
spécifiquement grammaticaux dont ils essayaient de fixer les
lois formelles, il leur fallait chercher à saisir le travail de
l'esprit humain, dont les lois intimes et constantes se manifestent
dans l'infinie variété des faits linguistiques.
Il faut cependant avouer que ceux qui ont fait des langues
l'objet spécial de leur étude sont excusables de n'avoir pas
cherché à pénétrer plus profondément dans l'intelligence de
leur objet, ou de n'y avoir pas réussi. L'étude de l'esprit humain,
la psychologie elle-même était aussi engagée dans de
mauvaises voies. Si la linguistique en vertu d'une tradition
était trop scolastique, la psychologie d'autre part était également
détournée de son vrai but par ses origines historiques
qui la liaient à la métaphysique. Elle était rendue solidaire
de spéculations extrascientifiques, et ses explications n'étaient
pas du même ordre que celles que la science reconnaît pour
siennes. Entre les principes métaphysiques de la psychologie
et les lois le plus souvent toutes formelles qu'enseignait la
17grammaire, il était difficile de saisir une relation nécessaire,
et quand quelque savant, amateur d'idées générales, essayait
de faire une théorie du langage en se basant sur une psychologie
toute spéculative, son œuvre participait à l'instabilité
de cette psychologie elle-même. Elle était vouée à tomber
dans le discrédit avec la doctrine philosophique qui lui servait
de base.
Cependant dans la mesure où les chercheurs dans les deux
domaines ont fait effort pour embrasser leur objet tout entier
et porter sur lui la lumière d'une saine méthode, on a vu la
science du langage et celle de l'esprit humain, la linguistique
et la psychologie, se rapprocher l'une de l'autre.
Nous avons dit plus haut quelle place importante occupe
dans la linguistique moderne la connaissance des lois phonétiques.
Plus l'attention s'est portée du côté des faits de cet
ordre, plus la linguistique a pris contact avec la physiologie.
Mais actuellement un courant assez puissant porte les linguistes
du côté des études de sémantique et de syntaxe. On
comprend que la grammaire comparée qui ne s'occupe que
des sons et des formes déterminées par leur qualité matérielle,
est incomplète, et qu'elle a besoin d'être doublée d'une
science des valeurs. Or le problème de l'évolution des valeurs
est un problème essentiellement psychologique, et les grammairiens
se constituent psychologues d'occasion ou viennent
demander à ceux qui font autorité en ces matières, les principes
de classification et d'explication dont ils ont besoin.
Les premières études générales qui ont été faites sur le
langage humain, ont consacré les termes connus de : langues
isolantes, langues agglutinantes et langues à flexions, dans
lesquelles on croyait résumer clairement nos connaissances sur
les divers types de structure que les langues pouvaient présenter.
Mais à mesure qu'on s'est attaché à étudier et à comparer
un plus grand nombre de formes de langage, et particulièrement
de celles qui sont tout à fait en dehors de nos
habitudes indo-européennes, on s'est aperçu que ces termes
18n'étaient que de grossières approximations, et qu'ils recouvraient
mal une série infiniment nuancée de types divers. Il
a bien fallu se rendre compte que seule une connaissance
approfondie de l'esprit humain et des conditions de son
fonctionnement quand il est créateur de langage, pourrait
nous faire comprendre l'infinie diversité des phénomènes
grammaticaux.
D'un autre côté les psychologues sont venus au-devant des
linguistes. Ils se sont efforcés de dégager leur science des
liens qui l'attachaient à la métaphysique et d'en faire une
doctrine basée sur les faits, une doctrine qui fournisse de
toutes les manifestations de la vie psychique l'explication rationnelle
dont elles sont susceptibles, en tenant compte de la
double série des conditions physiques et psychiques. C'est
ainsi qu'est née la psychologie physiologique, qui est en droit
la véritable science des lois du langage, comme aussi de toutes
les autres manifestations naturelles de l'esprit humain
agissant par l'intermédiaire de son organisme physique.
Cette science tendant à baser ses inductions sur des faits toujours
plus nombreux et toujours plus divers, devait naturellement
aborder les faits du langage et entrer pour ainsi dire
en concurrence avec la linguistique.
Cependant, avant d'aborder le problème du langage dans
son ensemble, les psychologues de l'école nouvelle se sont attaqués
d'abord à des faits isolés que la linguistique proprement
dite avait négligés ou avait considérés à un tout autre point de
vue ; on étudia par exemple les phénomènes qui accompagnaient
l'aperception des mots sous leur forme auditive ou graphique,
et les associations si complexes qui constituent ou accompagnent
ces éléments de nos phrases. C'est ainsi qu'au moment
même où les grammairiens commençaient à se préoccuper sérieusement
de psychologie, les psychologues de leur côté abordaient
à leur manière des sujets qui confinaient tout au
moins à la grammaire. Il y avait rencontre, et sans doute des
deux parts la conviction était née dans bien des esprits que
cette dualité apparente de deux sciences diverses abordant
19l'étude d'un même objet avec deux méthodes différentes,
était destinée à se résoudre en une harmonieuse collaboration,
et que la linguistique traditionnelle trouverait un jour
un précieux auxiliaire dans sa nouvelle rivale. Tandis qu'elle
continuerait à s'occuper des faits, la psychologie physiologique
les éclairant de sa lumière, lui aiderait à les mieux
comprendre et à les mieux décrire. Cependant personne
n'avait encore osé tirer la conséquence pratique qui s'imposait,
et aborder en face le problème pour essayer de tirer de
la psychologie moderne une linguistique théorique.
Les choses ont un peu changé quand, en 1900, Wundt a
publié son ouvrage sur la Psychologie du Langage 13, qui,
basé essentiellement sur les résultats généraux de la linguistique
moderne, constitue la première tentative de donner
un exposé de cette science des lois, avec toutes les ressources
dont dispose actuellement la psychologie.
Cet ouvrage a une portée plus grande encore. Il est la première
partie d'un traité complet de psychologie collective
devant étudier, outre le langage, tout ce qui se rapporte aux
mythes, croyances et coutumes des peuples. Mais il a déjà
une importance considérable au point de vue de la seule
science du langage. Aussi a-t-il provoqué un mouvement
général d'intérêt de la part des linguistes, et soit par lui-même,
soit par les discussions qu'il a suscitées et par les travaux
qu'il a fait naître 24 ou fera naître encore, il marquera
une date dans l'histoire des recherches linguistiques.
On ne saurait exagérer les mérites de l'œuvre de Wundt.
20On admire la vigueur intellectuelle de l'homme qui, sortant
du domaine plus restreint de ses études spéciales, sait s'assimiler
la substance d'une science aussi vaste et aussi complexe
que la linguistique moderne. Dans ce domaine il acquiert
une information assez ample pour que rien d'essentiel
ne lui échappe, et assez précise pour se former, quand il le
faut, une opinion indépendante. Puis son esprit rompu aux
analyses de la psychologie moderne, renouvelle la science
qu'il aborde, en semant sur ses pas des hypothèses originales,
et donne sur la plupart des points des leçons aux linguistes
dont il s'était constitué l'élève. Seul un maître était capable
d'une œuvre aussi puissante.
Mais quels que soient les mérites de Wundt, on a cependant
le droit de se demander si le but auquel il a visé, a été
du premier coup parfaitement atteint. Cette nouvelle science
à laquelle il fallait donner un corps, est-elle arrivée au monde
sous sa forme définitive, comme Minerve qui sortit tout armée
du cerveau de Jupiter ? Telle que Wundt l'a créée, peut-elle,
être d'emblée un auxiliaire utile de la linguistique des faits,
ou n'a-t-elle pas besoin d'une mise au point qui la transforme
dans une plus ou moins grande mesure ?
Cette question, qui ne porte aucun préjudice à notre reconnaissance
et à notre admiration, et qui est bien naturelle
à l'égard de toute première tentative, nous avons été amené
à nous la poser, et à y répondre en disant qu'en effet la psychologie
physiologique du langage telle que Wundt nous la
présente, est loin d'être encore tout ce qu'on serait en droit
de souhaiter.21
Préoccupé de trouver une méthode vraiment rationnelle
pour l'étude des transformations syntactiques 15, nous avons
ouvert l'ouvrage de Wundt dans l'espoir d'y découvrir une
solution, ou du moins les éléments d'une solution au problème
que nous nous étions posé, et nous avons été déçu dans
notre attente. S'il est cependant un problème qui intéresse la
linguistique historique, mais dont la solution doive être
attendue de la science théorique, c'est bien celui-là. La vraie
méthode pour étudier et exposer les évolutions syntactiques
d'une langue doit se déduire de vues générales
sur la nature de ce qui évolue, et sur les causes et les procédés
de ces évolutions. Une science théorique qui ne nous renseigne
pas directement et clairement sur tous ces points
est incomplète ou mal ordonnée.
Cette conclusion qui s'est imposée à nous d'abord en vertu
d'un simple syllogisme, nous a amené à examiner de plus
près l'ouvrage en question pour tâcher d'y découvrir la lacune
ou le défaut d'ordonnance présumés. Nous avons comparé
les dispositions générales de la psychologie du langage
telle qu'on nous l'offrait avec celles de cette science selon
l'idée que nous nous en faisions. Qu'on nous permette d'exposer
au lecteur le résultat de cet examen. Etant données
l'autorité de Wundt et l'importance capitale de son ouvrage,
il ne sera pas déplacé, au moment où nous allons essayer de
parler des mêmes sujets que lui, bien que d'une façon entièrement
différente, de dire ce qui à nos yeux rend cette entreprise
nécessaire.
Ce sera le sujet du chapitre suivant.22
Chapitre III
Critique de l'œuvre de Wundt.
La critique essentielle que nous croyons devoir formuler
à l'égard de Wundt peut se résumer en quelques mots : Il a
abordé tous les problèmes de la linguistique qui lui semblaient
présenter un intérêt psychologique, et il a négligé
tout ce qui lui a paru être plus spécialement du domaine de
la grammaire ; en un mot, il n'a pas compris l'importance du
problème grammatical. Nous nous expliquons :
Wundt étudie les phénomènes dus à l'activité de l'homme
intervenant pour créer ou modifier son langage. Il se désintéresse
de la création ou de la modification acquises à partir du
moment où, passées à l'état d'habitude, elles sont incorporées
à l'ensemble de nos dispositions linguistiques. C'est pourtant
grâce à cet ensemble d'habitudes ou de dispositions linguistiques
que nos pensées les plus complexes trouvent une expression
spontanée et comme automatique. C'est donc là l'objet
sinon unique, du moins principal de la linguistique théorique.
Ces habitudes ne constituent dans leur ensemble un moyen
utile pour l'expression de la pensée, que parce qu'elles forment
un système de représentations de sons et d'idées associées
entre elles d'une façon appropriée à cette fin du langage.
En outre ce système n'existe dans chaque individu
qu'en vertu des dispositions acquises dans ses centres nerveux ;
il fait partie intégrante de sa vie psychophysique en
23général, et comme phénomène — dispositions acquises et
manifestations concrètes — il n'est explicable en dernière
analyse que par les principes généraux qui président à cette
vie ? Puisqu'on appelle grammaire les règles du langage en
général, on peut étendre le sens de ce mot, et l'appliquer à
tout l'ensemble des lois qui règlent le langage acquis par un
individu ou par une collectivité à un moment donné, à tout
ce qui repose sur une habitude, une disposition, une association
d'idées régulière, depuis la distinction des articulations
constitutives des mots, jusqu'aux plus insaisissables nuances
de stylistique en passant par la lexicographie, les flexions et
la syntaxe. On peut appeler problème grammatical celui qui
se pose quand on cherche derrière la grammaire le fondement
psychophysiologique de ses origines, de ses lois et de son
fonctionnement.
L'objet du problème grammatical, ce n'est plus l'homme parlant
et agissant sur son langage, mais le langage lui-même
comme organisme linguistique, ou si l'on aime mieux, c'est
l'homme parlant, en tant qu'il subit les lois de son langage.
Wundt n'est pas le seul à n'avoir pas vu l'importance du
problème grammatical. C'est une question généralement négligée,
et un problème qui n'a encore jamais été, à notre connaissance
posé en ses propres termes 16. Nous voudrions contribuer
24par cet essai à attirer l'attention de tous les théoriciens
du langage sur ce point.
Il est assez facile de comprendre pourquoi l'auteur de la
Psychologie du Langage n'a pas tourné son attention vers ce
problème grammatical. Il est psychologue avant d'être grammairien,
et ce qui l'intéresse c'est le libre jeu des facultés
par lesquelles l'homme crée des moyens d'expression pour
sa pensée et, une fois en possession d'un langage, le modifie
sans cesse pour le plier aux exigences de nouvelles impulsions
psychiques. Aux grammairiens de faire voir par quelles
combinaisons compliquées de signes régis par des lois,
nous arrivons à représenter nos pensées. C'est une tâche d'un
moindre intérêt dont le psychologue pense pouvoir se dispenser,
du moins provisoirement.
Or il ne le peut pas, et cela pour deux raisons. La première,
c'est qu'on n'a pas donné une véritable psychologie du
langage, si le problème grammatical n'a pas été méthodiquement
traité. La grammaire existe dans notre vie psychique
et physique au même titre que tous les autres facteurs
qui concourent à la production de la parole, et c'est
pur arbitraire que d'en vouloir faire abstraction. La seconde
raison, c'est qu'on n'a ni le droit ni le pouvoir d'étudier
les phénomènes de transformation du langage, aussi
longtemps qu'on ne connaît que le sujet actif, et qu'on ignore
la vraie nature de l'objet à transformer, puisque la nature
de cet objet doit nécessairement conditionner le phénomène.
Le problème grammatical est d'ailleurs si essentiel que
Wundt n'a pu faire autrement que de le rencontrer, et même
parfois de l'aborder. Nous lui reprochons de ne l'avoir pas
abordé en face et considéré dans son ensemble. Pour faire
voir comment il se comporte vis-à-vis de ce problème, il est
nécessaire de le suivre pas à pas dans son œuvre, en en donnant
une rapide analyse.25
Wundt commence son ouvrage par la théorie des mouvements
expressifs (Ausdrucksbewegungen) qui constituent,
soit sous leur forme instinctive (Triebbewegungen), soit sous
leur forme volontaire (willkürliche Bewegungen), la fonction
primordiale d'où tout le langage découle. Puis il nous
décrit les phénomènes du langage des gestes, dans lequel
l'élément grammatical tel que nous venons de le définir, ne
joue encore qu'un rôle très restreint, puisque, comme le
montre Wundt, la convention qui intervient d'une façon limitée
pour fixer la forme des signes, ne se fait pas sentir sur
leur ordonnance dans la phrase. La convention, c'est justement
ce qui échappe à l'influence directe des sujets parlants.
Le langage par gestes a des règles psychologiques, il n'a
guère de règles grammaticales. C'est encore une espèce de
langage naturel.
Passant ensuite au langage articulé, Wundt traite d'abord
de la faculté de produire des sons telle qu'elle est dérivée
des mouvements expressifs. Il nous parle du cri et de l'onomatopée.
Ce sont là les manifestations les plus rudimentaires
du langage articulé ; mais elles sont encore vivantes et actives
dans notre langage perfectionné sous la forme d'interjections
et de sons figuratifs (Lautgeberde, Lautmetapher,
Wurzelvariationen). Vient enfin l'étude des transformations
lentes ou brusques des sons et des lois psychologiques qui y
président.
On voit que dans toute cette première partie de l'œuvre,
consacrée à l'étude de l'élément phonétique de la langue
(chapitres III et IV), l'auteur s'occupe de deux problèmes
qui lui servent à ordonner sa matière : la genèse et l'évolution.
Il ne faut pas oublier cependant que tout langage organisé,
c'est-à-dire toute grammaire, demande comme éléments
constitutifs non pas des sons simplement, mais un système de
sons, quelque chose qui soit à notre parler à peu près ce que
l'alphabet est à notre langue écrite. Ces sons, admis en
nombre limité, constituent pour le langage une règle ; on
les articule et on les perçoit en raison d'habitudes acquises.26
C'est là donc un fait d'ordre grammatical. On sait que ce
système varie passablement d'une langue à l'autre ; chacune
a sa gamme d'articulations caractérisée par le nombre et par
la qualité des sons qui y sont admis. Mais l'existence même
de cette gamme paraît être nécessaire au langage. Il y a par
conséquent un problème linguistique concernant la grammaire
et qui a pour objet ce système de sons lui-même.
Laissons pour le moment de côté la question de savoir
comment ce système apparaît et se transforme au cours des
évolutions du langage ; nous pouvons nous demander au
moins dans quelles conditions ce système de sons existe et
fonctionne chez le sujet parlant. Si nous réservons, comme
nous le ferons plus loin, le terme de phonétique pour tout ce
qui concerne les sons dans leur devenir et leurs transformations,
nous pouvons appeler le système de sons que connaît
une langue à un moment donné, son système phonologique
et nommer la première partie du problème grammatical
que ce système pose au psychologue : le problème phonologique.
Wundt a-t-il complètement ignoré ce problème ? Non, sans
doute. Il s'agit d'un phénomène trop important pour que
l'on puisse parler du langage et ne le rencontrer nulle part.
Aussi l'auteur de la Psychologie du Langage nous donne-t-il
à deux reprises une définition de ce qu'est le son, non en
lui-même, mais comme partie intégrante du système phonologique.
La première fois c'est à propos du langage des enfants
(I, p. 300), la seconde, au sujet des phénomènes qui se
produisent quand deux langues s'influencent et se mélangent
(I, p. 385). Le son, dit-il, repose sur une association d'impressions
acoustiques et visuelles et d'habitudes des mouvements
articulatoires ; il est saisi en vertu d'une aperception,
c'est-à-dire que nous n'avons pas de lui une impression objective,
mais plutôt une représentation basée sur le fait que
nous le reconnaissons en l'assimilant à un son déjà connu.
Il en parle aussi à propos de l'emprunt des mots étrangers
(I, p. 475), et ailleurs encore il touche à ce problème en nous
27montrant que chacun de ces sons représente une variété indéfinie
d'articulations voisines oscillant autour d'une articulation
moyenne, qu'on peut considérer comme normale (Spielraum
der normalen Artikulationen, p. 365). Chaque fois
Wundt nous dit des choses fort intéressantes, soit sur ce phénomène
en lui-même, soit sur ses conséquences, mais nous
regrettons de ne pas pouvoir lire le chapitre qu'il aurait
écrit si, au lieu de découvrir ce phénomène primordial au
hasard des rencontres, il lui avait accordé sa vraie place dans
l'ensemble des faits linguistiques.
On dira peut-être ici que le mal n'est pas très grand, et
que les explications que l'auteur donne chemin faisant sur
ce phénomène, suffisent à éclairer les sujets plus spéciaux
qu'il traite. Admettons que cela soit vrai dans ce sens que le
problème phonologique est d'une solution relativement facile,
et pourtant on ne devrait jamais se hâter de considérer un
problème comme simple, et d'en conclure qu'on peut se contenter
de le résoudre en passant. Ceci admis, il reste néanmoins
vrai qu'il n'est en aucun cas indifférent de mal ordonner
les questions et de ne pas attribuer à chaque problème
la place qui lui revient. On y perd toujours quelque chose.
Preuve en soit que l'auteur, qui a rencontré le problème phonologique,
mais qui ne l'a pas posé en propres termes et
pour lui-même, a complètement ignoré un autre problème
grammatical qui n'aurait pas pu lui échapper, si le premier
avait été nettement formulé ; nous voulons parler du problème
phonétique.
Dans toutes les pages que Wundt consacre aux évolutions
des sons, nous ne voyons jamais qu'on s'occupe de savoir
comment ces transformations se comportent à l'égard du
système phonologique admis. Car il y a évidemment une
antinomie entre ces deux faits de linguistique également
avérés : l'existence d'un système fixe des sons, d'une gamme
d'articulations, et la propriété qu'ont les sons d'évoluer ;
résoudre cette antinomie et montrer comment le système
phonologique s'accommode de l'évolution phonétique, c'est
28un problème des plus intéressants, et c'est, comme nous essayerons
de le montrer plus loin, un des problèmes qu'il suffit
de poser clairement pour mettre certaines questions embarrassantes
dans leur vraie lumière et s'acheminer vers des
solutions simples.
Dans les chapitres qui suivent, Wundt aborde l'étude des
éléments significatifs du langage et de leurs valeurs. Ici le
facteur grammatical, la règle, joue encore un rôle plus évident.
Son existence, sa genèse et les conditions de son fonctionnement
nous posent un nouveau problème que nous désignerons,
d'après une terminologie justifiée plus loin, du
nom de problème morphologique.
Wundt ne l'ignore pas tout à fait ce problème, pas plus
que celui de la phonologie ; il l'aborde ici et là, mais jamais
il ne le formule nettement. Il en résulte que beaucoup de
questions ne sont pas posées, ou que, si elles le sont, elles ne
reçoivent que des solutions incomplètes.
Dès le début du chapitre V consacré à la formation des
mots, nous nous apercevons de cette lacune. Rien n'est plus
instructif pour le linguiste que de s'initier sous la direction
de Wundt à l'analyse psychologique du mot, et d'apprendre
de quel ensemble d'associations est composé cet élément de
phrase, que par un acte d'aperception nous isolons du reste
en lui prêtant une individualité distincte. Nous apprenons
comment cette unité verbale est douée à la fois d'une valeur
de représentation et d'une valeur de relation, et comment à
ces deux éléments de son sens correspondent souvent deux
éléments matériels : la racine et un élément formatif. Nous
voyons enfin comment ce mot ainsi composé s'est détaché
de l'unité primordiale plus vaste qu'est la phrase.
Cependant après tout cela le linguiste reste perplexe,
parce qu'on n'a pas pris soin de lui dire ce qu'il y a de commun
entre cette description psychologique idéale et les mots
de nos langues. On sait que tous les degrés de composition
existent entre les divers éléments de la phrase ; il y en a
29qui se confondent dans une unité évidente et d'autres qui
sont nettement distincts. Entre ces cas extrêmes il y a une
infinité de cas intermédiaires et par conséquent douteux. Il
est souvent difficile de savoir où il faut placer la limite des
mots. La grammaire ordinaire n'a guère de principes sur ce
point, mais plutôt des règles arbitraires, souvent incohérentes
d'un cas à l'autre. Or, si nous désirons, comme nous
en avons le droit, donner du mécanisme syntactique d'une
langue une description scientifique basée sur des principes
certains, nous avons besoin d'une définition du mot en grammaire
qui soit la traduction en langage grammatical de la
définition psychologique que Wundt nous fournit. Cette
définition, Wundt nous en procure certains éléments, il
nous y achemine (voir particulièrement I, p. 563), mais
nous aurions voulu qu'il prît soin de nous la donner lui-même 17.
Dans le chapitre consacré à la formation de mots nouveaux
par composition (I p. 602 sv.), on peut constater clairement
comment Wundt néglige dans les phénomènes qu'il
étudie leur aspect grammatical. Il cherche dans cette partie
de son ouvrage quels sont les procédés psychologiques qui
sont à la base des créations de cet ordre, et il détermine trois
types qui lui semblent embrasser tous les cas possibles.
Il y a d'abord le composé qui résulte simplement de l'analyse
de la phrase, quand on prend pour une unité verbale
ce qui à l'origine avait formé deux mots distincts. Ainsi le
français pourboire représente un fragment de la phrase : je
vous donne cet argent pour boire. Il y a ensuite le composé
qui, tout en se basant sur le même procédé, manifeste cependant
30l'intervention d'une synthèse psychologique par les
modifications que les deux éléments ont subies pour être accolés
l'un à l'autre. Tel est l'allemand Trinkgeld (= Geld
zum Trinken). Enfin vient le type purement synthétique
où une idée est introduite dans la phrase et se compose
avec celle d'un de ses termes en vertu d'une puissante
association. Wundt en donne comme exemple : Hirschkäfer
— c'est-à-dire un scarabée (Käfer) qui fait penser à un cerf
(Hirsch). — Ces trois types sont dénommés : composition par
association de deux éléments en contact, composition par
association de deux éléments voisins et composition par
association de deux éléments éloignés.
Sans vouloir nier la valeur de cette classification en tant
qu'il s'agit de créations spontanées et produites par l'association
des idées, il n'est pas superflu de rappeler que la
composition telle qu'on l'observe en réalité a d'autres causes
pour le moins aussi efficaces. Dans l'immense majorité des
cas un composé se fait par voie d'analogie sur un autre composé,
ainsi guerre russo-japonaise d'après guerre franco-allemande,
etc. Wundt ne l'ignore pas (p. 606), mais il n'y voit
qu'une simple assimilation, un adjuvant psychologique.
Or selon nous il y a plus : c'est la mise en œuvre d'un moyen
d'expression connu ; c'est un produit de l'habitude, c'est
d'ordre grammatical.
Et s'il s'agit d'expliquer ces habitudes, il ne suffit pas de
parler du type psychique de la race. Sans négliger ce facteur
essentiel, on doit se rappeler, pour décrire ce phénomène
sous tous ses aspects, que le composé conserve à la faveur de
la composition elle-même d'anciennes syntaxes, disparues
d'ailleurs, qui restent ainsi dans la langue comme des fossiles,
des témoins de ce que la grammaire vivante a été jadis.
C'est ainsi qu'un composé comme Hôtel-Dieu contient l'ancien
cas régime Dieu équivalent pour le sens au latin Dei.
On en peut conclure que beaucoup de nos composés sont,
soit en eux-mêmes, soit par les types sur lesquels ils ont été
formés, des vestiges de procédés grammaticaux depuis longtemps
31hors d'usage. On a appliqué avec raison cette explication
aux composés de thèmes grecs et latins comme φιλό-σοφος,
Luci-fer, dans lesquels il faut voir d'anciennes agglutinations
antérieures à la fixation des suffixes de flexion.
Ces considérations grammaticales ne remplacent pas l'analyse
psychologique ; elles la placent dans ses véritables conditions
et dans ses véritables limites.
Il semble qu'avec le chapitre suivant, consacré à l'étude
des formes grammaticales, nous entrions en plein dans le
domaine de la grammaire. L'auteur y étudie les quatre principales
classes de mots ou catégories grammaticales (selon
lui : substantif, adjectif, verbe et particule), et pour celles
d'entre elles qui sont susceptibles de déterminations diverses,
il passe en revue toutes ces déterminations. Il traitera à
propos du nom, de son genre, de ses nombres, de ses cas ; à
propos du verbe, de la personne, de la voix, du mode, etc. Il
cherche à nous montrer par quels procédés psychologiques
les notions des valeurs ainsi représentées se sont formées et
fixées.
Ce chapitre est des plus riches et des plus intéressants ;
cependant, ici encore, nous avons de graves critiques à formuler
sur la manière dont l'auteur a abordé et traité sa matière.
Et d'abord une critique de méthode. L'auteur se contente
de constater l'existence de ces quatre classes et de leurs sous-déterminations.
Il rejette dans un chapitre qui suivra l'exposé
du principe rationnel qui sert de base à ce système
grammatical. Ne cherchons donc pas ici une explication
générale de la forme intellectuelle des mots, déduite des
principes mêmes de toute langue et de toute pensée. Le point
de départ est empirique ; au lieu d'être dans le domaine abstrait
du possible ou du nécessaire, nous sommes dans le domaine
concret du réel, et les explications psychologiques ne
s'appliquent qu'à des phénomènes isolés, ou à des groupes
de phénomènes historiquement constatés, non pas au phénomène
en général. Là où nous attendions un chapitre de linguistique
32théorique, nous trouvons des fragments épars de
grammaire historique avec un commentaire psychologique.
Quand même ces commentaires auraient une portée assez
générale pour dépasser de beaucoup les étroites limites des
faits qui y donnent lieu, quand même ces faits choisis dans
toutes sortes de langues différentes pourraient passer pour
représenter la somme de ce qui est possible en fait de langage
humain, cela n'empêcherait pas la méthode de pécher
par la base. Ce chapitre est différent des autres chapitres du
livre. Ailleurs les faits illustrent, comme il convient dans
une science des lois, les lois psychologiques dont l'auteur
nous montre le principe général ; ici au contraire, c'est l'explication
psychologique qui s'attache pas à pas aux faits
constatés par l'histoire. Un tel chapitre ne peut et ne doit
avoir aux yeux de son auteur qu'une valeur provisoire. C'est
un compromis entre la science des lois et la science des faits,
et il ne peut servir qu'à éprouver sur des faits concrets bien
documentés la valeur de certains procédés explicatifs.
Si Wundt ne résout pas ici le problème grammatical en
ce qui concerne les formes des mots parce qu'il se sert d'une
méthode qui n'est pas tout à fait satisfaisante, il y manque
encore parce qu'il comprend mal quel devrait être l'objet de
son étude. Wundt entend par forme grammaticale des mots,
leur valeur de relation et de fonction, sans égard au procédé
par lequel cette valeur est exprimée. Il entreprend, comme
il nous le dit dès le début, de traiter en même temps et sans
les distinguer, les formes que nous appellerons explicites
(äussere Wortformen) et les formes implicites (innere Wortformen).
Les premières sont caractérisées par quelque signe
extérieur, un suffixe par exemple, qui correspond à leur
fonction : ainsi l'allemand will-st avec son suffixe qui marque
la seconde personne du singulier ; les secondes, tout en ayant
une valeur grammaticale complexe, ne sont pas analysables
en éléments matériels correspondant à leurs déterminations
de valeur : ainsi en allemand ich est un pronom personnel
de la première personne du singulier au nominatif, mais ce
33sens total s'applique au mot tout entier et non à ses parties.
On voit donc que Wundt ne s'intéresse qu'aux valeurs et
non aux signes des valeurs ; il pense pouvoir considérer les
catégories grammaticales in abstracto dans leur entité psychologique
et logique en dehors de la nature des signes qui
les portent. Le vrai problème grammatical, ou plutôt morphologique
selon notre appellation, est cependant de savoir
comment doit être organisé matériellement, in concreto, un
système de signes pour être le correspondant d'un système
abstrait d'idées et de relations ; et l'importance de ce problème
consiste en ceci que le moyen d'expression et la chose
exprimée se conditionnent mutuellement et sont absolument
solidaires. Si la langue n'exprimait que des relations logiques,
on pourrait sans doute étudier ces relations en elles-mêmes
sans s'inquiéter de ce qui peut y correspondre en grammaire ;
mais si, comme Wundt l'affirme à plusieurs reprises et avec
raison, tout dans la langue a un coefficient psychologique, ce
coefficient n'est ni déterminable ni pensable en dehors de
l'association de l'idée avec certains signes. Ces signes prêtent
à l'idée leur forme psychologique, et c'est par leur intermédiaire
qu'elle s'associe à son tour avec d'autres idées de
même forme. Aucune valeur grammaticale n'existe que pour
autant qu'elle a trouvé un point d'appui matériel, un signe
correspondant dans la langue. La valeur existe dans ce signe
et par ce signe ; la considérer en dehors de ce qui l'incarne,
lui attribuer une qualité psychologique en dehors de celle
que le procédé grammatical peut avoir, c'est substituer à la
réalité une représentation arbitraire, a priori, de ce qu'on
pense qui est, au lieu de prendre les choses telles qu'elles
sont ; c'est — que Wundt nous le pardonne — faire de la
psychologie vulgaire au sens où il entend ce mot.
Voici un exemple pour illustrer ce que nous voulons dire.
Il est question entre autres choses dans ce chapitre, de deux
manières propres aux langues primitives pour exprimer l'idée
verbale avec des mots qui sont par nature des substantifs
34(II, p. 150). Les unes disent pour je porte quelque chose qu'on
pourrait interpréter comme porter-moi, les autres quelque
chose qui correspondrait à mon-porter. Wundt nous dit quelle
est la justification psychologique des deux procédés. Il explique
comment on a pu être amené à employer le pronom
possessif, et dit en particulier (II, p. 153) que sa nature de mot
conjoint s'unissant étroitement au substantif pour exprimer
l'idée d'une qualité qui lui est tout à fait interne, l'a rendu
plus propre à être utilisé dans ce cas.
N'est-ce pas une erreur d'appréciation de considérer dès
l'abord ces mots primitifs comme de véritables substantifs au
sens que nous donnons à ce mot, nous qui possédons des
langues beaucoup plus parfaites au point de vue logique ?
Et n'est-ce pas une autre erreur toute semblable de raisonner
sur les particules qui servent à construire ces formes verbales,
comme si elles représentaient pour les sujets parlants exactement
ce que les mots moi et mon représentent pour nous ?
Ne serait-ce pas plus conforme à la vraie nature des choses,
que d'aborder ce problème en tenant compte de la réalisation
concrète de ces catégories encore vaguement distinctes ? Il ne
faut pas dire que la particule est utilisable comme suffixe personnel
parce qu'elle est un pronom possessif et par conséquent
conjointe, mais au contraire, qu'elle est à la fois et pronom
possessif et suffixe personnel parce qu'elle est conjointe,
et qu'elle exprime l'idée de la première personne comme
étroitement unie et comme confondue avec l'idée du mot principal
portant l'accent.
S'il en est ainsi, c'est cette seule distinction grammaticale
du conjoint et du non-conjoint, plus générale, plus fruste,
plus subjective ou modale, qui a trouvé son expression dans
la langue, et qui par conséquent a le droit d'entrer en ligne
de compte. Est modal en grammaire tout ce qui exprime le mode
du sujet, son attitude psychologique à l'égard de l'idée exprimée.
Ici le non-conjoint répond à une analyse claire des
deux parties opposées, le sujet et l'action ; le conjoint exprime
que l'une des idées est vue dans l'autre, le sujet dans le prédicat,
35comme la qualité dans sa substance. Tout indique que
dans l'évolution des langues vers une perfection relative l'expression
des valeurs modales a toujours précédé celle des
valeurs d'ordre logique et strictement intellectuelles ; les
modes des verbes sont plus anciens que leurs temps ; c'est
un fait bien connu, et nous ne ferions ici que d'appliquer un
principe que la psychologie et l'histoire justifient également.
Et comment avons-nous été amené à le faire ? En considérant
le fait morphologique tout entier, tel qu'il s'offre à nous,
sans en séparer les deux éléments solidaires, et en nous laissant
instruire, en dehors de toute idée préconçue, de la valeur
psychologique du signe par sa nature et par l'emploi
qui en est fait.
La partie du livre dans laquelle Wundt apporte certainement
la plus précieuse contribution à la solution du problème
morphologique, c'est le VIIe chapitre traitant de la
construction des phrases. Il nous y donne la définition générale
de la phrase, nous décrit les diverses espèces de phrases
possibles, et nous dit quelles doivent en être les parties essentielles
dans chacune de ses formes typiques.
Suivant une théorie moderne dont Wundt s'est fait le défenseur
convaincu, ni les mots ni les formes grammaticales
explicites ou implicites n'existent pour eux-mêmes ; ce sont
des parties intégrantes de la phrase, nécessaires et se conditionnant
l'une l'autre, qui s'en sont détachées par voie d'analyse.
Cette théorie dont on a abusé, il est vrai, et sur laquelle
nous dirons ailleurs notre opinion tout entière, est juste
dans son principe, et l'on ne saurait nier la priorité logique
de la phrase sur le mot. Il en résulte que la connaissance
de cette unité supérieure, dans laquelle tout
est virtuellement contenu, est la condition primordiale
de toute connaissance rationnelle du mécanisme grammatical.
Pour Wundt il y a phrase quand : « le sujet exprime par
le langage le résultat d'une opération intellectuelle qui analyse
une unité aperceptive en ses parties constitutives et
36perçoit le lien qui les unit 18». Par cette définition Wundt a
mis en lumière le fond commun, la source unique d'où découlent
et notre langage grammaticalement agencé et l'exercice
de notre raison discursive. Ce sont deux phénomènes,
dont l'un est objectif, l'autre subjectif, mais qui sont liés
l'un à l'autre comme l'âme l'est au corps. C'est sur cette
définition qu'on peut s'appuyer avec Wundt pour dire quelles
sont les parties nécessaires de la phrase, et comment nos
catégories grammaticales et nos constructions syntactiques
en dérivent. Au cours de cette déduction on pourra aussi
montrer comment à des types psychologiques divers, doivent
correspondre des types grammaticaux divers qui en sont
les produits naturels. Ici nous ne reprocherons rien à
Wundt sauf de s'être arrêté sur le seuil d'une discipline linguistique
après nous en avoir fourni les premiers éléments.
Il est vrai qu'il nous donne quelques exemples de constructions
syntactiques de divers types, et qu'il les discute au
point de vue psychologique. Mais ce faisant, l'auteur a l'air de
planer au-dessus de la grammaire et de la juger comme de
haut ou du dehors ; ce qui nous manque c'est l'exposé aussi
élémentaire qu'on voudra, mais général et systématique de
ce qui est possible en fait de procédé d'expression linguistique.
Si Wundt ne l'a pas fourni, c'est qu'il a toujours eu
en vue d'étudier le sujet parlant, et qu'il n'a pas cru que la
grammaire elle-même fût un objet d'étude psychologique
distinct de ce sujet. Et pourtant le linguiste a affaire à des
organismes linguistiques dont les sujets parlants subissent
les lois, et qu'ils ne sauraient modifier que dans des limites
restreintes. Ce sont ces organismes qu'il s'agit d'analyser
dans leurs parties constitutives et d'expliquer dans leur
fonctionnement. Il y a donc place ici pour toute une grammaire
rationnelle et générale dont Wundt ne nous donne
que quelques principes insuffisamment coordonnés. Il y
37aurait aussi lieu de nous dire, une fois cette grammaire
constituée, comment l'activité psychique spontanée du sujet
se comporte à son égard, et comment de la résultante de ces
deux forces, on voit naître l'évolution de la langue dans ses
procédés d'expression. Wundt n'a pas cru devoir poser le
premier de ces problèmes, et les suivants lui ont nécessairement
échappé.
Voici encore un dernier point où l'on constate clairement
comment notre auteur évite de parti pris, quand il le
peut, les problèmes grammaticaux. Il s'agit de la 6me partie
de ce chapitre, où il traite de l'ordonnance des mots.
Comme il le déclare lui-même (II, p. 348), il ne s'intéresse à
l'ordonnance des termes de la phrase que quand le sujet en
dispose au gré des impulsions psychiques du moment. Il en
est ainsi dans la plupart des cas en grec et en latin : aucune
tradition, nous eussions dit aucune règle de grammaire, ne
force à dire Romulus urbem condidit plutôt que urbem
condidit Romulus, ou Romulus condidit urbem. Wundt
nous explique, il est vrai, par quels procédés psychologiques
l'ordre des mots, libre d'abord, peut se fixer dans des habitudes
(II, p. 362 sv.) ; mais il néglige de nous dire l'importance
grammaticale de ce phénomène. L'ordre des mots quand il
est fixé par une règle, devient à son tour un signe, c'est-à-dire
un moyen de reconnaître les fonctions. Il prend place
parmi les facteurs du mécanisme grammatical, et si ce procédé
se généralise, toute l'économie de la grammaire et la
forme même de la pensée en subissent une profonde transformation.
Nous venons de dire que Wundt évite de parti pris les
problèmes grammaticaux quand il le peut ; mais, comme
nous l'avons vu à propos de la phonologie, il ne le peut pas
toujours, et cela est encore plus vrai ici, où il s'agit de la
langue comme procédé d'expression. L'auteur qui n'a pas cru
devoir aborder en face cette partie du problème grammatical
que nous appelons le problème morphologique, ne saurait
38pourtant l'éviter complètement. Il s'impose si bien quand on
veut considérer les phénomènes du langage, qu'il est impossible
de ne pas le rencontrer sur son chemin et de ne pas lui
consacrer, ne fût-ce qu'en passant, une partie de son attention.
Wundt le rencontre, sans l'aborder positivement, toutes
les fois qu'il l'écarte de son chemin. C'est ce que nous
venons de voir à propos de l'ordonnance fixe des mots. Il en
est de même à propos de la définition de la phrase. Avant de
la donner, il nous avertit (II, p. 238) que sa définition ne s'applique
qu'aux phrases qui offrent tous les caractères d'un
acte spontané et arbitraire. Mais il y en a d'autres qui sont
du ressort de l'automatisme psychologique, et dont l'énonciation
repose sur la répétition et l'habitude. En réalité,
ajouterons - nous, toutes nos phrases sont des produits de
l'activité de ces deux facteurs : l'automatisme et la spontanéité
libre, qui se combinent dans des proportions infiniment
variables. Même les plus automatiques, ne sont pas
la simple répétition brute, le simple écho d'une phrase déjà
dite ou déjà entendue ; elles sont le résultat d'un acte intelligent
et volontaire se frayant un chemin à travers un tissu
d'habitudes de langage. D'autre part et inversement, celles
qui sont au contraire émises avec une conscience lucide de
toutes leurs parties et de leur agencement, sont cependant
un produit de l'automatisme psychologique dans la mesure
où elles empruntent leurs éléments à une langue organisée.
Il n'y a pas création pure, mais déclanchement de certaines
dispositions acquises. Le signe répond à l'idée par le jeu d'un
réflexe en vertu d'une habitude.
Et l'on ne saurait exagérer l'importance de cet automatisme
dans le langage. C'est justement parce que la langue a
grâce à lui une espèce d'existence propre, une fixité relative,
qu'elle a pu de degré en degré se perfectionner au point de
vue intellectuel. Et cela se comprend : c'est par la puissance
de l'habitude qu'elle conserve tous les procédés d'expression
éprouvés comme pratiques par l'usage. Au fur et à mesure
39qu'il se crée quelque chose d'utile, cela est enregistré par la
grammaire qui garde ainsi l'empreinte de tous les progrès de
l'intelligence humaine, les consacre, les conserve et en permet
de nouveaux. Sans l'automatisme la langue serait condamnée
à un éternel recommencement ; elle serait toujours
dans l'enfance, et c'est grâce à lui seul que l'organisme compliqué
de nos propositions et de nos périodes est possible.
L'automatisme apparaît dès les débuts du langage, dans ses
formes les plus frustes, qu'il s'agisse de mouvements instinctifs
ou de réflexes acquis, et ce phénomène, qui semble à première
vue ôter au langage naissant quelque chose de son intérêt
psychologique, est au contraire le principe méconnu de
toute l'évolution linguistique avec ses créations merveilleuses
et ses phénomènes infiniment variés et complexes.
Il y a donc place à côté de la définition purement psychologique
de la phrase, telle que Wundt nous la fournit, pour
une seconde définition qui tienne compte du facteur grammatical,
et qui nous dise comment, dans la formation de nos phrases,
l'acte intellectuel de la combinaison s'unit à l'acte inconscient
de l'expression automatique. Celle que nous avons citée plus
haut est utile, mais elle ne suffit pas.
Wundt se heurte encore au même problème, quand il se
demande (II p. 251) pourquoi un impératif — ainsi le mot
komm ! vien(s) ! sans élément suffixal — paraît avoir les caractères
d'une phrase à lui tout seul, alors qu'il les dénie à
une simple interjection comme hierher ! ici ! Il dit que cet
impératif a le caractère d'un mot fléchi. Comparé aux autres
formes du système verbal, komm représente un impératif singulier
de la deuxième personne ; par là il évoque l'idée du sujet
de l'action, et l'on obtient ainsi les deux parties essentielles
à toute phrase, selon la définition. Il est évident que cette
explication n'est valable qu'au point de vue grammatical.
Bien souvent le sujet parlant ne fera pas une analyse plus
complète de sa pensée en disant : viens ! qu'en disant : ici !
Mais la grammaire fait cette analyse et la lui propose. C'est
dans le système abstrait du langage, et non pas nécessairement
40dans un acte psychologique isolé de quelque sujet, que
se trouvent le principe et la consécration de cette différence.
Enfin Wundt fait un pas dans le domaine qu'il évite en
général, quand il explique pourquoi il se refuse à nommer avec
Hermann Paul dans ses Prinzipien 19, « sujet logique » le mot
qui, dans une phrase déclarative, représente l'idée psychologiquement
dominante, et à l'opposer ainsi au sujet grammatical.
Selon Paul, si par exemple quelqu'un tient à faire connaître
la date d'un voyage dont ses auditeurs savent déjà le but
et dit : Je pars aujourd'hui pour Berlin, aujourd'hui serait
le sujet logique opposé au sujet grammatical je. Dans une
autre supposition pour Berlin ou tout autre membre d'une
phrase plus complexe pourrait être ce sujet logique.
Wundt refuse donc de se servir de ce terme et lui préfère
celui de « représentation dominante » (II p. 260), et il justifie
son opinion en disant qu'en dehors de la grammaire il n'y a
pas de relations logiques entre les parties de la phrase, mais
seulement des différences d'accent ou d'intensité entre les
représentations. C'est là une vue juste, profonde et féconde
sur les rapports qui existent entre la grammaire et la pensée.
Nous entrevoyons comment notre raison discursive est étroitement
liée à l'expression par le langage, et par conséquent
à ses règles. En dehors de leur association avec cet organisme
grammatical, nos idées, faute de trouver un instrument qui
fixe et rende sensible leurs relations logiques, ne sont plus
que des représentations plus ou moins clairement associées
avec d'autres et munies d'un coefficient affectif.
Si tel est le rôle du langage et de sa grammaire dans notre
vie psychique, avons-nous tort d'estimer que la science théorique
qui s'en occupe doit nous expliquer le mécanisme, le
fonctionnement et la vie de ce merveilleux instrument, et que
la psychologie du sujet parlant et de ses fonctions créatrices
ne doit servir que d'introduction à une science plus haute ?
41Quand tout aurait été dit sur ce premier sujet l'essentiel resterait
à faire.
Ayant consacré un chapitre à la théorie de l'évolution des
sons, Wundt en consacre un naturellement à l'évolution des
sens (chapitre VIII, Bedeutungswandel). Nous n'avons rien
à en dire ici, puisqu'il s'agit par définition d'un phénomène
qui modifie les habitudes du langage, donc de quelque chose
qui est au-dessus des lois traditionnelles, en dehors de la
grammaire. Nous ne pouvons cependant nous dispenser de
répéter ici que ces phénomènes se produisant à la fois en
dépit et au service de la grammaire — en effet par les évolutions
des sens d'anciennes règles sont battues en brèche,
mais de nouvelles sont créées — leur étude demanderait à
être encadrée dans celle de la grammaire ; c'est elle qui fait
connaître leur véritable milieu et les conditions dans lesquelles
ils se produisent.
L'ouvrage se termine par un court chapitre sur les origines
du langage.
Nous avons déjà dit l'estime que nous faisons de l'ouvrage
que nous venons d'analyser et de critiquer à un point de vue
spécial. Qu'on ne nous blâme pas de nous en être tenu ici à la
facile critique de ce qui manque, et de nous être appliqué à
dire ce que l'auteur n'a pas mis dans son livre, et dans bien
des cas n'a pas voulu y mettre. Nous nous sommes efforcé de
faire ressortir un seul point : l'auteur n'a pas conçu la tâche
de la psychologie du langage comme il nous semble qu'elle
aurait dû l'être. Nous essayerons plus tard de montrer comment
ce problème grammatical laissé de côté par Wundt, peut
être abordé et résolu, et nous verrons qu'on arrive par ce moyen
à poser chaque problème linguistique du plus simple au plus
complexe, dans son vrai jour et avec ses véritables données.
Avant d'entreprendre ce travail nous avons encore à dire
42quelques mots sur l'ordonnance des matières que Wundt a
fait entrer dans son champ d'études. Cela nous permettra
de mieux faire sentir le défaut essentiel de cette œuvre, d'ailleurs
si belle par d'autres côtés. Si Wundt n'a pas abordé de
front le problème linguistique, s'il n'a pas compris qu'il ne
pouvait se résoudre indépendamment du problème grammatical,
c'est que, psychologue plutôt que linguiste, il a été plus
préoccupé de faire de la psychologie à propos du langage
que la psychologie du langage à proprement parler. Ce manque
de concentration sur l'objet particulier de son étude se
traduit également par une absence totale d'ordonnance rationnelle
entre les divers problèmes qu'il aborde.
On a pu voir par l'analyse ci-dessus qu'il a sérié ses chapitres
en s'inspirant visiblement de l'ordre traditionnel familier
aux grammaires : le son, le mot, la flexion, la phrase.
Cela ne semble pas très indiqué dans un ouvrage où l'auteur
nous démontre avec force et clarté que les phrases n'ont pas
plus été faites par l'addition de mots et de formes préexistants,
que les mots n'ont été fabriqués en ajoutant des lettres et
des syllabes. Le mot est d'après Wundt un produit de l'analyse
de la phrase, et la syllabe ou l'articulation est abstraite
du mot (I, pp. 560, 561 ; II, pp. 234-238). Il semble donc
que l'ordre inverse aurait été mieux en accord avec
la doctrine du livre. Cependant cet ordre, même renversé,
nous apparaît illusoire, quand nous apprenons, chemin
faisant, qu'il n'y a ni limite déterminable, ni différence essentielle
entre la phrase et son fragment le mot (I, p. 560 ; II,
p. 240). Cela n'indique-t-il pas que ce n'était pas à cette distinction
qu'il fallait recourir pour diviser rationnellement le
sujet ?
Il n'est pas difficile de faire toucher du doigt la confusion
réelle des problèmes qui se cache sous un ordre apparent
dans la distribution de ces matières. Wundt fait suivre le
chapitre consacré aux sons, d'un autre qui traite des évolutions
des sons. De même, après avoir parlé ensuite des
mots, de leurs formes et des phrases, c'est-à-dire des éléments
43significatifs du langage, il étudie dans un chapitre
subséquent les transformations de valeur que ces éléments
peuvent subir. A première vue cela semble bien naturel :
d'abord étudier les sons ou les valeurs puis voir comment ils
se transforment. Mais, si l'on observe que dans les chapitres
consacrés au premier de ces deux sujets, il n'est pas question
seulement des sons ou des valeurs dans leur être simple, à
l'état immobile, mais qu'on y étudie aussi leur genèse, l'apport
primitif ou nouveau des facultés créatrices de l'homme
qui les fait apparaître, on ne peut s'empêcher d'objecter que
les deux sujets successivement abordés, celui de la genèse et
celui de la transformation ultérieure, sont solidaires au point
de se confondre presque. Un exposé ainsi ordonné ne pourra
se faire sans de nombreuses répétitions. Ainsi dans le paragraphe
consacré aux imperfections de la prononciation enfantine
(I, p. 297), nous entendons déjà parler des déformations
produites dans l'articulation par l'influence d'un son
sur le son voisin (assimilation), sujet qui sera repris dans
l'étude des transformations phonétiques. C'est ainsi également
que dans le chapitre VI, où Wundt nous donne de nombreuses
hypothèses sur les origines historiques des classes de mots et
de leurs flexions en tant que système de valeurs, il opère sans
cesse avec des éléments de langage qui changent de sens, qui
prennent des valeurs nouvelles, et cependant l'étude des transformations
de valeur est réservée pour un chapitre subséquent
(le VIIIe).
Nous avons déjà donné à entendre ce qu'il y a d'étrange à
parler des mots et de leurs formes grammaticales avant de
nous avoir parlé de la phrase, puisque le mot avec sa forme
et sa valeur de relation ne s'explique que comme partie
constitutive de la phrase. Wundt se voit souvent forcé par
cette anomalie dans l'ordonnance des sujets qu'il traite,
d'énoncer d'avance certains principes qu'il n'établira que
plus tard. Ainsi la troisième partie du chapitre V sur la
place qu'occupe dans la phrase le mot composé d'un élément
radical et d'un élément formatif ou de relation, contient
44déjà en substance toute la doctrine de la phrase exposée dans
le chapitre VII. On peut d'ailleurs en dire autant du chapitre
VI consacré à l'étude détaillée des formes grammaticales
du nom et du verbe. Tout y est déjà basé en principe sur
une doctrine qui ne sera exposée complètement et avec tous
ses considérants que dans le chapitre qui suit.
On voit que les parties du livre ne marchent pas progressivement
vers une connaissance toujours plus complète de
l'objet à étudier, mais que l'auteur, ayant par devers soi la
connaissance totale de cet objet, va de l'avant suivant un
ordre artificiel, étudiant les problèmes au fur et à mesure
qu'ils se présentent. Si l'on nous accorde que les questions
de méthode et d'ordonnance ont une valeur pratique en
science, que ces questions bien résolues apportent pour le
présent la clarté, et pour l'avenir des garanties de progrès
normal, on devra avouer que cette seule considération —
abstraction faite de celle que nous avons présentée plus haut
— nous invite à reprendre l'œuvre de Wundt pour essayer
de faire mieux que lui, tout en profitant des apports précieux
qu'il a fournis à la science théorique.
Les pages suivantes n'ont d'ailleurs pas d'autre prétention
que d'esquisser un programme. Edifier l'œuvre est un travail
de plus longue haleine et qui dépasse nos forces. Il n'est
pourtant jamais inutile de tracer un bon plan bien conçu et
justifié par des calculs exacts. C'est un plan de cette nature
que nous voudrions offrir à tous ceux, linguistes et psychologues,
qui collaboreront à l'édification de la science théorique
du langage.
La tâche que nous entreprenons offre une difficulté spéciale
du fait que nous aurons à parler à la fois à deux sortes
de lecteurs : aux linguistes qui ne sont pas encore familiarisés
avec les méthodes de la psychologie, et aux psychologues
qui doivent être initiés à des faits et à des principes qui
n'ont rien que de banal pour les linguistes. Les uns et les
autres nous sauront peut-être gré d'être sur tous les points
45aussi explicite que possible, et de présenter une matière
nécessairement ardue et abstraite d'une façon accessible à
tout lecteur de bonne volonté. Pour cela nous étayerons
notre exposé d'exemples empruntés la plupart du temps
au français et que chacun peut comprendre sans le secours
d'une érudition spéciale.46
Chapitre IV
La Linguistique théorique ressortit à la Psychologie
individuelle et à la Psychologie collective.
Dans les premiers chapitres de cet essai nous avons justifié
en principe l'existence de la linguistique théorique, et nous
avons montré que sa méthode propre est différente de celle
de la linguistique des faits. Cette dernière range les faits
suivant leur ordre empiriquement constaté dans le temps et
dans l'espace ; la première au contraire rapproche ce qui est
semblable, et cherche les relations constantes pour s'élever
par induction des faits particuliers aux derniers principes, et
redescendre de ceux-ci par déduction aux faits particuliers,
en les expliquant comme des manifestations nécessaires de
ces principes dans des conditions données.
Le langage étant une activité naturelle de notre être psychophysique,
il apporte, comme tout ce qui émane de cet
être, à la psychologie physiologique, son contingent de faits
destinés à servir de base à l'induction. D'autre part, il est
évident qu'il doit attendre de cette même science, en retour
de cet apport, les principes d'explication applicables à ses
phénomènes. S'il en est ainsi, la linguistique théorique
apparaît d'abord comme absorbée dans la psychologie physiologique,
et faisant corps avec elle.
Tel est le cas en effet ; mais cela n'empêche pas qu'il n'y
ait dans le sein de cette science générale des chapitres qui
concernent plus spécialement le langage, et qu'on ne
47puisse même à l'intérieur de la psychologie physiologique
constituer des disciplines entières qui soient exclusivement
linguistiques par leur objet et par leur méthode.
Nous établirons ce que nous venons d'affirmer en examinant
de plus près l'objet même de la linguistique, et pour
cela nous commencerons par le définir.
On peut donner du langage une définition toute générale,
et dire par exemple que c'est l'ensemble des moyens dont un
être psychophysique se sert pour exprimer ses pensées. Cette
définition nous semble correcte en ce qu'elle tient compte du
principe logique qui ordonne de ne définir qu'une chose à
la fois, et pour ce faire, de se servir de termes clairs par
eux-mêmes ou déjà expliqués.
Cette définition en outre ne nous semble ni trop large ni
trop étroite. Elle n'est pas trop étroite, car elle s'applique à
toutes les formes du langage, non pas seulement à la forme
parlée, mais aux gestes, à l'écriture, etc. Elle s'applique aussi
à toutes les pensées indistinctement, aussi bien à celles qui
par leur caractère psychologique dominant sont émotionnelles
(phrases exclamatives) ou volitives (phrases impératives
et désidératives), qu'à celles qui sont purement intellectuelles
(description, narration, jugements généraux). Et
pourtant elle n'est pas trop large non plus, car en se servant
du mot « pensée », elle indique qu'il n'y a pas de langage
sans un facteur intellectuel, si faible soit-il. Les cris qui
n'expriment que l'émotion douloureuse par exemple, ne sont
pas des éléments de langage. Pour qu'il y ait langage, il
faut qu'il y ait réflexion sur soi-même, conscience intellectuelle,
que la douleur qui s'exprime existe comme élément
de pensée. Par le verbe « se servir », la définition donne à
entendre également qu'il s'agit d'une action volontaire. Le
langage ne se confond pas avec le simple mouvement expressif,
entièrement spontané et instinctif. Un chien qui
branle la queue en reconnaissant son maître, use-t-il
d'un langage d'après cette définition ? Il est difficile d'en
48décider, parce qu'on ne sait guère ce qui se passe dans
l'« âme » d'un chien ; mais il est utile de noter dans la définition
la limite idéale où commence le langage. Il faut de la
part du sujet quelque délibération d'exprimer, ou à son défaut,
au moins une conscience claire de la valeur expressive
de l'acte accompli, et un acquiescement à cette expression.
C'est ainsi que le rire en lui-même n'est pas un langage,
bien qu'il n'y ait pas de rire sans pensée ; mais le rire peut
servir de langage dans certaines conditions. « Exprimer »
n'est pas non plus tout à fait synonyme de « faire connaître »,
et il n'y a pas lieu de compter dans le langage tous les
moyens dont on peut se servir pour révéler aux autres ce
que l'on pense. Quand Tarquin le Superbe, en se promenant
dans son jardin, abat sans rien dire les têtes des pavots les
plus élevés, pour faire savoir à son fils comment il doit
traiter les grands de Gabies ; quand quelqu'un retourne une
lettre à un expéditeur sans l'ouvrir, pour marquer qu'il
entend n'avoir plus aucune correspondance avec lui, ce sont
là des actes symboliques, des paraboles en action qui ne sont
plus du domaine de la linguistique. Il n'y a langage que lorsque
un acte relativement simple est associé à l'idée à exprimer,
de telle sorte qu'il en est comme l'équivalent naturel ou
conventionnel, le substitut. Tel est le cas pour nos mots, nos
exclamations et nos gestes les plus familiers : un hochement
de tête, un signe de la main ou un haussement d'épaules.
L'acte symbolique au contraire demande une interprétation,
un travail intellectuel ; c'est une énigme plus ou moins aisément
déchiffrable. Ici encore la limite est flottante ; mais elle
l'est non seulement dans les faits, elle l'est également dans
la définition. L'équivalence entre le signe et la chose à signifier
est plus ou moins directe, plus ou moins immédiate. Il
s'agit ici d'une différence de degré, non d'une différence qualitative.
L'acte symbolique devient un élément de langage
quand il est suffisamment assimilé à l'idée qu'il exprime. C'est
ce qui est arrivé par exemple pour notre coup de chapeau,
geste consacré de la salutation.49
Telle qu'elle est cette définition est utile, et nous aurons à
nous en servir ; mais elle a le grand défaut d'être purement
abstraite, et de ne correspondre à aucune représentation précise ;
par conséquent nous ne saurions l'utiliser pour le but
que nous poursuivons actuellement. Pour montrer dans
quelles conditions l'étude rationnelle du langage se présente
à nous, il est nécessaire de connaître le langage lui-même et
non pas seulement son idée. Avec cette définition nous pourrons
chercher ce qui dans la nature mérite d'être appelé langage,
et le distinguer de tout ce qui n'est pas lui ; mais pour
le moment nous ne le connaissons pas plus que nous ne connaîtrions
la matière par exemple, pour avoir dit que c'est le
substratum des phénomènes perçus par les sens. La connaissance
du langage, comme la connaissance de toutes les autres
choses d'ordre naturel, repose sur l'expérience et sur l'observation,
et nous avons besoin pour notre discussion d'une définition
empirique fondée sur une induction bien faite.
Une saine induction réclame qu'on ne perde jamais complètement
de vue les faits concrets, et que, si on s'élève au-dessus
d'eux, ce ne soit qu'à la faveur de concepts généraux
suffisamment bien établis par des observations ou des hypothèses
vérifiées, comme le sont les molécules, les atomes, les
vibrations de la physique. A défaut de pareils concepts il
vaut mieux ne pas s'élever dans la généralité au point de
perdre contact avec le monde réel. C'est pourquoi, plutôt
que de parler du langage en général, nous nous attacherons
plus spécialement à sa forme la plus importante, à celle qui a
donné lieu au développement le plus riche, et qui est la
mieux connue : nous voulons dire le langage parlé.
Nous allons décrire ce phénomène tel qu'il s'offre à nous
dans ses caractères les plus généraux. La définition que nous
en donnerons ainsi pourra s'appliquer dans une certaine mesure
et avec des modifications appropriées, à d'autres formes
du langage, et sera une contribution plus utile à la connaissance
du langage en général que des spéculations immatérielles
flottant dans le domaine des idées.50
Ce qui nous frappe d'abord quand nous observons le langage
parlé des hommes, c'est, nous l'avons dit dans le chapitre
précédent, son caractère organique ; il a un mécanisme
grammatical qui se compose de conventions fixes par
lesquelles des idées sont associées à certains signes et
à certaines règles grammaticales relatives à la combinaison
de ces signes. Ceci traduit dans le langage de la psychologie
physiologique, se peut exprimer à peu près comme
suit : le langage parlé repose sur un ensemble d'habitudes
en vertu desquelles le sujet parlant associe des idées ou des
groupements d'idées avec des mouvements souvent très
complexes des organes vocaux et avec les perceptions auditives
correspondantes. Dans leur totalité ces habitudes
constituent un instrument qui permet de trouver un
moyen d'expression conventionnelle pour toute pensée
quelle qu'elle soit.
Si nous y regardons de plus près nous verrons en outre
que cet instrument qui permet de fixer la pensée dans un
acte, est non seulement le moyen par lequel les hommes
communiquent entre eux, mais aussi le véhicule de toute
pensée discursive, de telle sorte que le perfectionnement de
l'intelligence chez les êtres doués de langage, est intimement
solidaire du perfectionnement de la langue. D'autre part
nous verrons que ce véhicule de la pensée, en est aussi le
moule, qu'il pèse sur elle et l'asservit à ses formes. Les habitudes
et les règles du langage sont donc en même temps
des habitudes et des règles de la pensée, et l'organisme grammatical
est comme le canal par lequel notre activité intellectuelle
doit passer pour se réaliser.
Cependant, quelque grande que soit l'importance de l'organisme
grammatical dans le langage et dans la vie intellectuelle,
on doit bien reconnaître que les conventions et les
règles de grammaire ne sont pas tout dans le langage. Ce
fait est rendu évident par la simple constatation que la
grammaire dans le parler est constamment violée, et que loin
d'être fixe, elle ne cesse d'évoluer. Le principe de cette évolution
51ne saurait être naturellement dans la règle elle-même ;
une habitude, une disposition acquise, est en soi quelque
chose d'inerte, d'immuable.
Il est d'abord évident que le plus parfait organisme grammatical
ne saurait à lui seul constituer un langage. Il est
seulement à la disposition du sujet parlant, qui en use par
un acte de volonté et sous le contrôle de son intelligence.
Toute parole suppose donc à côté de la disposition à laquelle
elle doit sa forme, l'intervention libre du sujet, sa volonté et
son attention, qui seules la réalisent.
En outre il n'est pas difficile d'observer qu'à côté des éléments
expressifs dont la valeur repose sur une convention
grammaticale, le langage en contient beaucoup d'autres qui
semblent dépendre directement de la libre spontanéité du
sujet. Certains accents, les nuances de l'intonation, l'ordre
des mots dans beaucoup de cas et un grand nombre d'autres
particularités dans nos phrases, sont dictées par une sorte de
nécessité psychologique, et bien qu'en dehors de toute convention
fixe, elles servent à l'intelligence du discours et s'interprètent
directement par l'intuition de leurs causes psychiques.
Mais il faut aller plus loin, et constater que le langage
tel qu'on l'observe, donne lieu encore à bien des phénomènes
qui n'ont aucun rapport direct avec sa valeur expressive,
qui ne sont commandés ni par la grammaire, ni par les
impulsions spontanées de la vie psychique qui cherche à
s'exprimer. Ces phénomènes sont dus simplement à quelque
accident psychologique ou physiologique qui échappe au
contrôle de l'intelligence. Nous n'en signalerons ici qu'un
exemple pour illustrer notre pensée : c'est le phénomène
qui se produit quand on dit d'une personne : « la langue lui
a fourché » parce qu'elle a pris un mot pour un autre ou confondu
les éléments phonétiques de divers mots. Ainsi nous
avons entendu dire : avant-couturière au lieu de avant-courrière
sous l'influence de aventurière. On connaît aussi ce
jeu qui consiste à faire prononcer très rapidement une
suite de mots difficile à articuler, comme : panier, piano,
52piano, panier, pour s'amuser des confusions qui en résultent.
Comme on le voit, le langage parlé nous paraît être la résultante
de plusieurs facteurs. Nous pouvons cependant les
grouper en deux grandes catégories, en opposant à l'élément
relativement fixe, conventionnel ou organisé que nous nommons
élément grammatical, tous les autres que pour le moment
nous désignerons sous l'appellation générale d'éléments
extragrammaticaux.
Examinons maintenant séparément ces deux parties du
langage pour voir quelle place leur revient de droit dans la
psychologie physiologique.
Qu'est-ce que cet organisme grammatical ? Quelle est son
origine et sa raison d'être ? Il est naturellement le produit
d'une adaptation de chaque sujet aux nécessités de la transmission
de la pensée. Un sujet qui apprend à parler, l'acquiert
de son entourage ; il le reçoit de la collectivité. Mais comme
la collectivité n'a existé de tout temps que par ceux qui
la composent, et que toute initiative remonte nécessairement
à un individu particulier, il faut admettre que cette création
collective a été faite de la somme d'apports individuels consacrés
comme bien commun par une sorte de consensus
général. Comment une collectivité peut-elle créer quelque
chose, et comment cette création de la collectivité peut-elle
subsister, évoluer, etc. ? C'est là le problème que s'attache à
résoudre la psychologie collective, ou science des phénomènes
spontanés et naturels d'ordre psychique qui ont pour sujet
un groupe plus ou moins nombreux d'individus vivant en
commun, agissant et réagissant les uns sur les autres. C'est
une sorte de psychologie du second degré. L'étude de l'élément
grammatical dans la langue est donc du ressort de la
psychologie collective.
Quant aux éléments extragrammaticaux, qui ne sont soumis
à aucune règle conventionnelle, ils dépendent directement
de l'activité psychophysiologique de celui qui parle.53
Comme ils n'ont pas de cause en dehors de lui, ils doivent
pouvoir être entièrement expliqués par les lois de la psychologie
physiologique simple ou individuelle.
C'est ainsi que notre linguistique théorique dépend à la
fois de la psychologie individuelle et de la psychologie collective.
Cela nous fait prévoir qu'il y aura lieu de subdiviser
cette science en deux disciplines complémentaires dont l'une
serait incorporée à la psychologie individuelle, et l'autre à la
collective. C'est ce que nous ferons en effet ; mais pour arriver
à une vue claire des relations que nous aurons à établir
entre ces deux parties de la linguistique, ainsi que de celles
qui existent entre chacune d'elles et la science plus générale
à laquelle nous la rapportons, il est nécessaire de présenter
d'abord certaines considérations qui feront l'objet du chapitre
suivant.54
Chapitre V
Le principe d'emboîtement.
Il est un principe généralement admis et pratiqué dans la
classification des sciences naturelles et qu'on nous permettra
de désigner sous le nom de principe d'emboîtement. Il demande
que les diverses sciences s'emboîtent les unes dans les
autres, que les problèmes soient abordés successivement
dans un certain ordre, sériés de manière à ce que la solution
du premier prépare la solution du second en en fournissant
un élément indispensable.
Ce principe s'applique à toutes les sciences et à l'ensemble
des sciences en général. Descartes lui a fait une place dans sa
logique lorsqu'il a dit : « le troisième (précepte est), de conduire
mes pensées, en commençant par les objets les plus
simples et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu
comme par degrés jusqu'à la connaissance des plus composés,
et supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent
point naturellement les uns les autres »110.
Il ne semble guère cependant qu'on se soit encore soucié
de savoir comment ce principe pouvait s'appliquer aux
études de linguistique théorique, et l'absence d'ordonnance
entre les problèmes dans ce domaine nous semble être la
principale cause de la confusion et de l'incertitude qu'on y
55voit régner. C'est parce que ce côté de la question est essentiel
qu'on nous permettra de nous y arrêter ici, et d'étudier
d'un peu près ce principe de l'emboîtement. Nous le montrerons
d'abord en lui-même dans sa justification théorique et
ses règles générales, afin de pouvoir ensuite l'appliquer d'une
façon correcte à l'objet de notre étude.
Les faits concrets dont la science a à fournir l'explication,
nous apparaissent toujours comme étant de nature complexe
et ressortissant à divers ordres à la fois. Il faut donc distinguer
ces divers ordres ; faute de pouvoir le faire, toute science
serait impossible, car on ne résout un problème complexe
qu'en mettant à part chacun des problèmes partiels qu'on y
peut discerner. Mais isoler ne suffit pas, car la nature n'est
pas composée simplement d'une somme de phénomènes d'ordres
divers qui se juxtaposent ou s'entrecroisent ; ils sont au
contraire situés les uns dans les autres.
Tout ordre de faits ou de lois se définit d'abord par lui-même,
comme quelque chose de spécial, sans analogie en dehors
de soi, et ensuite aussi par le milieu où l'induction le
trouve réalisé. C'est justement la tâche de l'induction de connaître
la nature en s'élevant par une série d'abstractions
d'un ordre à l'autre. Elle va du plus particulier au plus général,
et la déduction fait la synthèse en reparcourant la
même série en sens inverse. Elle part de l'ordre le plus général,
du dernier que l'induction ait atteint, et elle reconstruit
la nature en y emboîtant successivement les divers ordres
de phénomènes. Chacun de ces ordres apparaît à son
tour comme un novum, comme quelque chose qui surgit dans
des conditions données, s'y ajoute, mais ne s'explique pas par
ces conditions seules. Vouloir posséder une connaissance rationnelle
d'un ordre de phénomènes en dehors de celle du
milieu dans lequel il est observable, est une entreprise impossible.
Le premier milieu, le plus abstrait, le plus général, celui
avant lequel il n'y a rien, c'est la pensée humaine, ou plutôt
56les formes de sa perception et de son intelligence ; c'est la
raison de la primauté des sciences mathématiques. De là on
descend par degrés vers la réalité de plus en plus complexe.
Ainsi la connaissance d'un être organisé et vivant est obtenue
par la solution d'une série de problèmes d'ordres divers
et subordonnés naturellement les uns aux autres : problème
mathématique, problème mécanique, problème physique,
problème chimique, problème biologique. Dans chacun de
ces ordres successifs on voit apparaître le novum, le facteur
jusqu'alors absent ou caché, qui n'était point nécessaire à
l'ordre précédent, mais qui ne saurait être pensé sans cet
ordre comme milieu. La vie, les affinités chimiques, la matière,
le mouvement, la forme, telles sont ces réalités successives
dans l'ordre de l'induction.
Quelle que soit la raison d'être dernière de cet emboîtement
dans le monde, nous devons l'accepter comme étant un
des postulats de la connaissance scientifique. Il se justifie au
point de vue critique, si l'on considère que la subordination
successive des divers ordres, est le seul moyen par lequel
l'intelligence puisse saisir une chose à la fois dans sa complexité
et dans son unité. La simple coordination n'est pas
un objet de connaissance intellectuelle ; elle n'implique ni
relation ni limitation dans l'esprit.
Y a-t-il un emboîtement réel dans l'ordre constitutif de
la nature ? Y en a-t-il un au sein du principe premier de
toute chose ? N'y en a-t-il point de réel et d'absolu, n'est-ce
pas plutôt nous qui, tant bien que mal, en mettons un dans
les choses afin de les mieux connaître ? Questions de métaphysique
dont nous pouvons nous désintéresser. La science
rationnelle du monde des phénomènes n'ira jamais que
jusque là où ce principe pourra pratiquement être appliqué.
Suivant ce principe, les sciences biologiques, dont nous
n'avons pas l'intention de donner ici un tableau systématique,
comprennent la physiologie de la vie nerveuse dans
57laquelle la psychologie et plus spécialement la psychologie
humaine vient s'emboîter.
Dans cette dernière science nous avons la ressource de
l'introspection. A côté de la connaissance objective que nous
avons des phénomènes de cet ordre, nous pouvons en avoir
une autre, puisée dans l'expérience subjective que nous faisons
nous-mêmes de notre propre vie psychique. Nous pouvons
ainsi sur un point sortir du monde extérieur à nous qu'étudie
la science, et considérer un phénomène par une autre face.
Mais cette science ne change pas pour cela de méthode ; elle
reste comme nous l'avons déjà dit ailleurs, une science du
monde objectif, et ce qui l'intéresse c'est la relation du fait
nouveau d'ordre psychique tel qu'il se manifeste objectivement,
avec les conditions générales de la vie, qui sont le
milieu où il apparaît.
Pour cette science le parallélisme psychophysique est un
postulat, et l'âme est conçue nécessairement comme une fonction
de l'organisme. C'est là purement et simplement une
méthode qui ne préjuge rien sur le fond des choses, et qui a
pour but de fournir la seule explication dont la science soit
capable : la connaissance de certaines relations régulières. De
là le nom de psychophysiologie ou de psychologie physiologique
qui a été donné à cette science. On peut cependant la
nommer plus simplement psychologie, en entendant bien qu'il
s'agit d'une science de la nature établie sur la méthode
scientifique, et non pas de spéculations métaphysiques sur
l'âme et ses facultés.
Cette psychologie est d'abord individuelle, puis collective ;
de l'étude de ce qui ne concerne que les individus, on s'élève
à ce qui concerne les sociétés. Ici encore nous pouvons constater
un emboîtement nécessaire. La société se compose d'individus,
et si la vie commune donne lieu à des phénomènes
particuliers que la vie de l'individu isolé ne connaîtrait pas,
il est pourtant évident que le fait de vivre en société n'apporte
aucun changement essentiel à la nature psychophysique
des êtres en question, et que par conséquent cette nature est
58comme le milieu où va se manifester le phénomène d'ordre
collectif. Il n'y a pas d'autre milieu, puisqu'il n'y a pas d'âme
collective. C'est dans les individus et non pas au-dessus d'eux,
que se produit le nouvel ordre de faits correspondant à un
nouvel ordre de causes.
Il est vrai que quand on passe de la psychologie individuelle
à la psychologie collective, le fait nouveau se présente
dans des conditions toutes spéciales que les sciences précédentes
ne connaissaient pas. Il n'est pas entouré du mystère
qui enveloppe les affinités chimiques de la matière ou la
vie organique quand on les voit apparaître. C'est là un point
sur lequel nous reviendrons, mais qui est ici sans importance.
Il est plus utile de constater que les faits qui ressortissent à
la psychologie collective n'ont plus qu'une relation indirecte
avec la constitution physiologique des individus sujets. Ce
que les hommes possèdent en commun, ce n'est pas un organisme,
mais des pensées, des émotions, des volontés. Nous
parlerons donc simplement d'une psychologie collective, que
nous emboîtons dans la psychologie physiologique des individus
ou plus brièvement psychologie individuelle.
Cette psychologie collective est la dernière des sciences
de la nature, et elle sert de base aux sciences morales qui
viennent s'édifier sur elle. Elle nous montre ce que les sociétés
créent spontanément, non sans le secours des volontés individuelles,
il est vrai, mais cependant en vertu d'un déterminisme
intérieur. Sous l'impulsion de besoins psychiques
également ressentis par tous ses membres, la collectivité travaille
inconsciemment, sans qu'aucune volonté individuelle
intervienne d'une façon plus spéciale. Cependant l'individu
ne reste pas toujours passif ; il n'est pas non plus condamné
à n'être qu'un agent parmi d'autres agents qualitativement
égaux ; il est susceptible de sentir, de vouloir, de penser plus
que ses pairs, et d'exercer par conséquent une influence consciente
sur ses semblables. La meilleure partie des évolutions
et des progrès de l'humanité est due à ce travail des personnalités
59libres, qui ont su penser et vouloir d'une manière originale.
C'est ici un nouvel ordre de choses, et les sciences
qui étudient ce travail dans ses résultats, dans ses principes
et ses lois, nous les réunissons, faute d'une désignation meilleure
sous le titre collectif de sciences morales. Ce sont par
exemple l'histoire et sa philosophie, les sciences sociales et
politiques et tout ce qui concerne la philosophie, l'art et la
religion.
Il est évident que la limite précise entre les sciences de la
nature et les sciences morales ainsi définies n'est pas saisissable ;
la transition se fait insensiblement d'un ordre à
l'autre au fur et à mesure que l'individualité se dégage de la
masse, et l'on pourrait aussi bien appeler la psychologie collective
la première des sciences morales que la dernière des
sciences de la nature.
Pas plus que nous ne saurions donner un tableau systématique
des sciences biologiques, nous ne voulons essayer de
présenter ici le système complet des sciences morales ; nous
voulons seulement remarquer expressément avant de terminer,
que leur relation avec la psychologie collective est bien
celle d'un emboîtement nécessaire.
Les phénomènes qu'étudie la psychologie collective constituent
le milieu dans lequel l'individu apparaît, se développe
et agit. Non seulement il est tout entier façonné par ce
milieu, et il ne s'en dégage dans une certaine mesure que par
un effort, mais son action pour être utile et laisser des traces
doit se conformer aux besoins et aux capacités de ce milieu.
Ce n'est pas seulement l'action sociale et politique qui est
soumise à cette loi ; mais en religion, en art et même en philosophie
il n'y a pas d'isolement complet qui ne soit synonyme
de stérilité. L'action dans tous les domaines ne se conçoit
que dans et par le milieu, et la plus haute forme de
l'action morale, celle qui implique la plus grande somme de
liberté et d'énergie, le don de soi, le sacrifice, n'existe que
dans la solidarité humaine intensément ressentie et volontairement
acceptée.60
C'est ainsi que de son point de départ jusqu'à son terme
extrême la science humaine nous paraît ordonnée suivant un
même principe. Ce qui est vrai dans l'ensemble est vrai aussi
dans le détail, et nous chercherons à montrer comment les deux
disciplines principales qui constituent la linguistique théorique
ainsi que leurs subdivisions, s'emboîtent les unes dans les
autres. Avant de le faire et pour pouvoir procéder avec plus
de sûreté, il sera utile de nous demander à quels caractères
on peut reconnaître que deux sciences sont faites pour être
emboîtées l'une dans l'autre.
Nous en signalerons trois :
1° Les faits dont s'occupe la science qui emboîte doivent
pouvoir être pensés — nous ne disons pas imaginés — en
dehors des faits de la science qui y est emboîtée. Ainsi je
puis penser mon corps sans la vie qui l'anime, penser une
figure géométrique sans sa réalisation matérielle, un individu
sans la collectivité, etc., tandis que l'inverse n'est pas possible.
Il en résulte que les faits du premier ordre peuvent toujours
être abstraits des faits du second. Il n'y a pas de corps vivant
qui ne puisse être étudié au point de vue de la physique ou
de la chimie ; tout corps matériel peut être conçu sous son
aspect purement géométrique, toute société, étudiée dans ses
individus pris isolément, tandis qu'au contraire l'idée des
agents physiques et chimiques n'implique pas celle de la
vie, ni l'idée de la forme, celle de la matière, et ainsi de
suite.
2° Une marque certaine d'emboîtement existe quand la
nature nous offre des faits qui sont attribuables à un certain
ordre indépendamment de tout mélange avec un autre ordre,
tandis qu'au contraire cet autre ordre n'apparaît jamais que
dans une combinaison avec les faits du premier. Ceci n'est
que la transposition dans le concret, dans la nature, du premier
caractère qui ne concerne, lui, que l'aspect intellectuel
des choses. Cependant tandis que le premier caractère est
constant et nécessaire, le second ne se réalise que dans certains
cas. Sa présence prouve avec évidence que le second
61ordre est emboîté dans le premier ; mais en son absence le
premier caractère doit suffire.
Il n'y a pas de pure forme géométrique sans contenu matériel
dans la nature, ni de matière observable qui n'ait des
qualités chimiques à côté de ses qualités physiques ; par
contre il y a des phénomènes qui nous semblent dépendre
uniquement des lois de la matière inerte, d'autres où l'on
peut observer les lois de la vie organique seule, en dehors de
tout facteur psychique, comme chez les plantes. Mais, à défaut
de cette espèce d'abstraction faite par la nature elle-même,
il y a des cas beaucoup plus nombreux où l'abstraction s'impose
par le caractère dominant du phénomène. Parmi les
transformations de la matière, il y en a qui concernent plus
spécialement ses caractères physiques, ainsi la dilatation des
corps sous l'influence de la chaleur et d'une façon générale
tous les phénomènes dont traitent les manuels de physique.
Chez un être organique doué d'un système nerveux, il y a
bien des fonctions qui n'ont qu'un rapport très indirect avec
la vie psychique de cet être, sa nutrition, sa respiration par
exemple, et qui peuvent par conséquent être expliquées en
elles-mêmes, abstraction faite de ce rapport. Si les mouvements
des astres semblent donner lieu à une étude plus mathématique
que physique, c'est qu'ils présentent une telle
régularité que les forces qui les commandent se révèlent dans
leur intensité et dans leur direction à l'analyse mécanique.
La question de savoir quelle est la nature et l'origine de ces
forces est d'un autre ordre ; mais on peut ne pas en tenir
compte.
C'est ainsi que la nature offre elle-même une échelle de
phénomènes où les divers ordres se manifestent dans un état
de simplicité absolue ou relative. Et c'est en résolvant successivement
des problèmes de mathématique, de mécanique,
de physique, etc., tels que la nature leur en proposait, que
les savants se sont élevés peu à peu à la compréhension des
phénomènes complexes ressortissant à plusieurs ordres à la
fois. Il est bien probable que si la nature n'avait offert partout
62que des phénomènes tout à fait complexes, la science
aurait été beaucoup plus lente dans ses progrès, et que l'esprit
humain n'aurait pas été si prompt à découvrir que tout pouvait
se simplifier et se réduire à une combinaison de problèmes
d'ordres divers, convenablement sériés et s'emboîtant
les uns dans les autres.
3° En troisième et dernier lieu il faut remarquer que la
science emboîtée étudie toujours des phénomènes plus complexes
et, le plus souvent aussi, plus concrets, que la science
qui emboîte.
Plus complexes, cela résulte du premier caractère ; plus
concrets, cela est le cas partout où le second caractère ne se
réalise pas d'une manière absolue. Or les cas où il se réalise
d'une manière absolue, sont, à tout prendre, rares. Des
savants ont constaté que la matière inorganique comme les
métaux, possédait des propriétés assimilables à celles de la
vie ; on connaît chez les plantes des traces de vie nerveuse.
Qui sait si la science avec ses observations de plus en plus
pénétrantes, n'arrivera pas à nous montrer que tout est dans
tout, que l'échelle de phénomènes de plus en plus complexes
que la nature semble nous offrir, n'existe que dans l'apparence
superficielle des choses ? Il se peut qu'en réalité l'emboîtement
n'existe jamais que dans l'abstraction, et que tout
phénomène concret ressortisse à tous les ordres à la fois, de
telle sorte qu'on n'atteindrait à la connaissance complète
d'un phénomène quelconque — pour autant que la science
peut y atteindre — qu'en traversant toute la série des ordres
successifs.
En attendant que cela soit établi, on peut observer déjà
dans une foule de cas que telle science nous donne à elle seule
une connaissance théorique insuffisante de ce qui est, et qu'il
faut combiner ses résultats avec ceux des sciences qui lui
succèdent dans l'ordre de l'emboîtement, pour arriver à
mieux comprendre de la réalité concrète. Où est la machine
qui fonctionne en dehors des lois physiques de la pesanteur, du
frottement, de la dilatation des corps sous l'influence de la
63chaleur, etc. ? Et tous ces phénomènes que nous avons mentionnés
plus haut comme étant essentiellement du ressort de
la physique, ils intéressent pourtant la chimie par quelque
coté. L'état moléculaire des corps et leurs affinités sont toujours
modifiés d'une façon parfois inappréciable, mais pourtant
réelle, par la chaleur, la lumière ou l'électricité. Y a-t-il
dans un être psychophysique une fonction physiologique, si
inconsciente qu'elle soit, qui ne puisse être influencée par
des facteurs d'ordre psychique, et qui ne le soit réellement ?
Il en est ainsi tout le long de l'échelle des phénomènes, et
c'est une marque certaine d'emboîtement quand l'apport
d'une science nouvelle est nécessaire pour bien faire comprendre
comment un phénomène dont le principe essentiel,
le facteur principal, est déjà rationnellement connu, se manifeste
pratiquement dans la réalité concrète.
Avons-nous besoin de montrer que ces trois caractères se
trouvent réalisés dans l'emboîtement des deux sciences qui
nous intéressent ici : la psychologie individuelle et la psychologie
collective ? Nous avons déjà dit que l'objet de la première,
l'individu, était pensable en dehors de l'objet de la
seconde, alors que la réciproque n'est pas vraie. Le second
caractère se réalise aussi, puisqu'il y a des phénomènes qui
par leur nature sont du domaine propre de la psychologie
individuelle. Toutes les formes élémentaires de l'activité psychique :
la perception, la représentation, l'aperception et
toutes les réactions d'ordre émotif, intellectuel ou autre que
cet ébranlement provoque dans l'être psychophysique, doivent
être comptées ici. Néanmoins il est évident que chez un
être qui appartient à une collectivité par ses ascendants, qui
s'est développé au milieu de ses semblables et sous leur influence,
tout le contenu de la vie psychique et les actes par
lesquels elle se manifeste, doivent être plus ou moins directement
conditionnés par des facteurs de psychologie collective.
Il en résulte que, si la psychologie individuelle suffit pour
faire la théorie de la vie psychique de l'individu quand on
64ne considère que ses phénomènes généraux, la psychologie
collective est nécessaire pour fournir une explication
rationnelle des phénomènes concrets pris dans leur entière
complexité. C'est donc ici le troisième caractère qui se vérifie
comme les deux premiers.65
Chapitre VI
Division de la Linguistique théorique en deux sciences ressortissant
l'une à la Psychologie individuelle,
l'autre à la Psychologie collective.
Essayons maintenant d'appliquer ce qui vient d'être dit à
l'étude du langage tel que nous l'avons défini. Ce langage
nous a paru résulter de la combinaison de deux ordres de
facteurs : d'une part le facteur grammatical, qui est du ressort,
disions-nous, de la psychologie collective, et d'autre
part les facteurs extragrammaticaux, qui appartiennent au
domaine de la psychologie individuelle.
Si la psychologie collective est emboîtée dans la psychologie
individuelle, il semble tout indiqué d'emboîter l'étude
des faits grammaticaux dans celle des phénomènes d'ordre
extragrammatical, et c'est ce que nous allons faire.
Cependant la chose offre quelque difficulté. Il est en effet
difficile d'abstraire l'élément grammatical du langage pour
ne considérer que les faits extragrammaticaux à l'état pur ;
et la première condition serait, semble-t-il, de connaître
exactement l'élément qu'il s'agit d'abstraire. Les impulsions
spontanées et libres qui agissent dans le langage, le
font à travers un système cérébral façonné par des dispositions
acquises, et l'acte qui en résulte subit de ce fait une
67transformation dont il faudrait connaître la nature et l'étendue.
Nous avons reproché à Wundt d'avoir voulu aborder
l'étude de phénomènes complexes en n'en connaissant qu'un
seul facteur, et d'être comparable au chimiste qui étudierait
les transformations de la matière dans les organismes vivants,
sans s'inquiéter des conditions très spéciales que comportent
la vie. Il y a là une sorte de pétition de principe dont
il est difficile de sortir.
Ce que nous avons dit sur les caractères généraux de tout
bon emboîtement va nous fournir l'issue dont nous avons
besoin. Nous n'avons qu'à nous demander, puisque les éléments
extragrammaticaux ne sont pas toujours facilement
discernables dans le phénomène complexe, si la nature elle-même
ne nous les offre pas quelque part à l'état pur ou du
moins approximativement simple.
Il est évident d'abord que le phénomène grammatical n'apparaît
jamais seul ; et cela est une première marque de la
justesse de cet emboîtement, que nous avons déjà admis sur
l'analogie des sciences psychologiques correspondantes.
On pourrait peut-être bien trouver des phrases parfaitement
correctes au point de vue de la grammaire, qui sont
débitées machinalement et qui semblent offrir le type parfait
du réflexe. Toujours est-il qu'il faut qu'une pensée, une
émotion et un acte de volonté les mettent en mouvement, et
qu'une fois « déclanché », le réflexe suit son cours sous le
contrôle plus ou moins rigoureux de l'attention intelligente.
Même dans les cas pathologiques où une phrase ou un
membre de phrase se dévide automatiquement comme un
rouleau de phonographe, une émotion, une association
d'idées, quelque chose a déterminé le phénomène. Et puis,
quoi qu'on fasse, l'acte de la parole demeure partie intégrante
de la vie psychologique générale du sujet ; on n'a
donc jamais de garantie que des phénomènes psychologiques
qui n'ont directement rien à faire avec la pensée et son expression
grammaticale, ne viennent s'y mêler ; et en particulier,
68puisque toute parole consciente est accompagnée de
phénomènes émotifs et de représentations, si ces émotions ou
ces images ont des correspondants expressifs naturels, il est
impossible qu'ils ne viennent pas s'ajouter en quelque mesure
au langage par le geste, la mimique, l'intonation, etc.
Y a-t-il par contre des phénomènes de langage dont tout
élément d'organisation, toute habitude et toute convention
soient absentes ; un langage sans règles, entièrement extragrammatical ?
En théorie il faut répondre sans hésitation : oui.
Supposez un individu qui éprouve le besoin d'exprimer sa
pensée et qui n'a aucun moyen traditionnel à son service.
J'imagine, par exemple, qu'on vous confie un enfant aveugle
qui ne connaisse aucune des langues que vous parlez. Vous ne
sauriez à vrai dire, ni lui expliquer le théorème de Pythagore,
ni même lui raconter la moindre des choses. Vous n'êtes
pourtant pas pour cela privé de tout moyen de communication
avec lui. Je suppose que vous chercheriez d'abord par la
manière de lui prendre la main et par quelques caresses à
lui faire entendre votre bienveillance à son égard, et puis
vous lui parleriez en comptant bien que les mots qu'il ne
comprend pas auront pourtant par leur inflexion, par la manière
dont ils seront dits, quelque valeur pour lui. Il en est
de même dans tous les cas analogues. L'homme improvise la
mimique, le geste ou les sons qui lui semblent les plus propres
à faire entendre par intuition ce qu'il veut dire. Si le
langage a commencé une fois, cela a dû être de cette façon-là,
à moins que cela n'ait été plutôt lorsqu'un individu qui
cherchait à comprendre la pensée de son semblable, s'est mis
à interpréter les actes expressifs qu'il percevait, en leur attribuant
une valeur de signe, une qualité linguistique qu'ils
n'avaient pas dans l'intention du sujet. Dans l'un et l'autre
cas le langage n'implique aucune convention ; et s'il peut
avoir déjà ses habitudes et ses lois, ce sont des habitudes et
des lois psychologiques fondées sur la constitution des sujets
69parlants, mais non par des règles grammaticales Il n'y a à
côté de la pensée que le moyen naturel d'expression.
Nous appellerons ce langage prégrammatical, et puisqu'on
peut le concevoir comme existant et en comprendre l'idée en
dehors de toute combinaison avec la grammaire, nous voyons
que notre emboîtement est justifié. Cela nous amène à ne
plus opposer simplement deux ordres de facteurs dans la
parole, mais deux formes successives de langage en disant
que l'étude du langage organisé, c'est-à-dire de celui où
l'élément grammatical entre pour quelque chose, s'emboîte
dans l'étude du langage prégrammatical, dont tous les éléments
sont empruntés aux agents de la psychologie individuelle.
Supposez cette première forme du langage parfaitement
connue dans son fonctionnement, et expliquée aussi complètement
que possible dans toutes ses parties, nous connaîtrions
le milieu dans lequel la grammaire, sous l'influence de l'accommodation
réciproque et à la faveur de l'habitude, va paraître
comme un novum et se développer. Comme la matière
est le milieu de la vie organique, le langage prégrammatical
est celui de la grammaire. Les facteurs extragrammaticaux
dont nous avons constaté la présence dans la langue, ne sont
que des agents psychologiques d'ordre strictement individuel
dont l'action continue à se faire sentir en même temps
que celle de la grammaire. Prégrammatical et extragrammatical
ne diffèrent que par l'absence ou la présence d'une
relation avec la grammaire, c'est comme la chimie prise en
dehors de la vie organique ou observée chez elle. La vie en
se manifestant au sein de la matière, ne change rien aux affinités
ou aux propriétés physiques de celle-ci ; elle les fait
seulement servir à ses propres fins. De même, l'être psychophysique
qui se crée ou qui acquiert une grammaire, ne subit
aucune modification essentielle dans sa nature. Toutes
les lois qui pouvaient présider à son langage spontané subsistent ;
elles se réalisent seulement dans des conditions qui
70ont été modifiées par un agent nouveau, dont le principe est
en dehors d'elles.
Mais cet agent n'aurait rien produit non plus, s'il n'avait
pas trouvé ce milieu. La vie se manifeste en faisant servir à
ses fins les propriétés physiques ou chimiques de la matière,
et pas autrement, du moins à notre connaissance. Exactement
de même, la grammaire ne naît et n'existe qu'en vertu des
phénomènes prégrammaticaux qu'elle a su s'asservir ; elle
est comme une déformation particulière du langage prégrammatical.
Puisque l'âme collective qui n'est qu'une abstraction, ne peut
rien créer, tout en grammaire remonte génétiquement à une
création individuelle, c'est-à-dire à un acte prégrammatical
ou extragrammatical, qui se transforme en grammaire à peu
près comme la matière inerte qu'absorbe un être vivant, entre
à son tour dans la vie. Mais les agents prégrammaticaux ne
cessent jamais d'agir ; les phénomènes auxquels ils donnent
lieu se renouvellent constamment. Jamais la grammaire ne
les absorbe tous ou ne suspend définitivement leur effet propre.
Il y en a qu'elle ne saurait remplacer, comme l'attention
et la volonté ; ils jouent un rôle auquel la grammaire ne
peut prétendre. D'autres restent le complément utile d'une
grammaire qui ne donne jamais qu'un correspondant approximatif,
inadéquat de la pensée et de sa vie. Ce sont ces
éléments déjà mentionnés : le geste, la mimique, l'intensité
ou l'inflexion de l'accent, qui tour à tour évoquent des images
et suggèrent des émotions. C'est par eux que la parole
est colorée et vivante. Il y a d'autres facteurs enfin, disions-nous
dans notre définition, qui contrecarrent et troublent le
jeu de la grammaire. La grammaire gouvernée par l'intelligence
et la volonté, se heurte à ces phénomènes inconscients,
à ces accidents d'origine souvent purement physiologique
dont notre organisme imparfait est le théâtre. Elle doit
leur résister, soit en suspendant leur effet par un effort,
soit en y échappant par diverses accomodations ; mais comme
elle est tout entière dans le sujet parlant, elle ne saurait se
71dispenser de rester solidaire de toute cette vie psychophysique
qui l'enveloppe. Qu'on nous permette de continuer la
comparaison commencée plus haut. La vie de la grammaire
dans le milieu prégrammatical peut se mettre en parallèle
avec celle d'un organisme au sein de la matière brute.
L'animal qui n'existe que dans et par cette matière
inorganique, ne s'assimile et ne soumet aux lois de sa vie
qu'une partie restreinte de cette matière. Le reste demeure
son milieu ; il y trouve à la fois les conditions primordiales
de son existence, le sol qui le porte et les substances qui le
nourrissent, et d'autres éléments qui tantôt concourent avec
lui à ses fins, tantôt lui sont contraires, mais auxquels il doit
s'adapter en utilisant les uns et en résistant aux autres.
Il serait absurde, cela va sans dire, de vouloir pousser
cette analogie dans les détails, mais dans son idée essentielle
elle est exacte, et l'emboîtement des sciences de la matière
vivante dans celles de la matière brute, nous fournit une
image assez frappante de la relation qui existe entre les
deux parties de la linguistique.
La première chose qu'il y aurait à faire au sortir de l'étude
du prégrammatical et au moment d'aborder celle du langage
organisé, ce serait de chercher le point exact où cette
nouvelle forme du langage apparaît, en quoi dès sa genèse
elle se distingue de tout ce qui n'est pas elle, et, s'il est possible,
quels sont les agents qui président à cette création. Il
faut tâcher de surprendre le secret de la grammaire, comme
le biologiste saisit dans la cellule le début de la vie organisée ;
humble début en apparence, mais qui contient déjà en virtualité
toute l'évolution future. Une fois ce principe de grammaire
connu, quand on aura saisi et défini ce novum qui
porte en lui le germe de toute l'organisation du langage, on
n'aura plus qu'à suivre son développement dans le milieu
prégrammatical, sans jamais l'en abstraire que provisoirement,
et en distinguant toujours avec soin ce qui vient de
lui de ce qui vient du milieu. C'est la vraie méthode scientifique
et la seule qui permettra d'éviter la confusion et les
72lacunes d'explication que nous avons cru constater chez
Wundt.
Avant de dire ce qui concerne cette partie essentielle de
la linguistique, nous devons examiner dans quelles conditions
la science du prégrammatical se peut aborder en
pratique, et dire quelque chose sur son programme et ses
méthodes.73
Chapitre VII
Programme de la première partie de la Linguistique
théorique, ou Science du Langage affectif.
La première chose que l'on remarque, quand on veut essayer
de se faire une idée de la science du prégrammatical
dont nous avons théoriquement admis l'existence, c'est
que la base sur laquelle elle aurait à s'édifier est trop étroite
pour que l'on puisse s'en contenter.
En effet le langage prégrammatical conforme à notre définition
est difficilement observable à l'état pur. Les mouvements
expressifs dus à l'instinct seulement ne sont pas de
son ressort, parce qu'ils ne constituent pas un langage selon
la définition que nous en avons donnée. Il n'y a peut-être
pas chez un être conscient, d'émotion, de colère, de peur, de
honte ou de désir, sans quelque pensée. Mais cette pensée
est souvent bien imprécise, et les réactions physiologiques
auxquelles ces émotions donnent lieu dans les mouvements
du sang, dans les contractions des muscles, se produisent en
dehors de toute intention d'exprimer ce qu'on pense. D'autre
part, dès que ce désir est réellement présent, il est rare
qu'on ne puisse déjà saisir quelque trace d'habitude et de
convention dans le choix des signes qui sont mis en usage.
Voici en effet ce qui se produit. L'être sujet prend
pour s'exprimer les mouvements qu'il trouve naturellement
associés chez lui et chez ses semblables à ses pensées et
75aux émotions qui les accompagnent ; par exemple un cri
deviendra le signe de la douleur, un poing menaçant
celui de la colère. Le choix qu'on fait de ce signe, la
valeur significative qu'on lui attribue dans la compréhension
ou dans l'expression, ne fait que transformer directement
en habitude intellectuelle, une habitude instinctive fondée
sur la nature psychophysique de l'individu ou de l'espèce.
Du même coup l'habitude prend quelque chose de
plus rigide ; le cri, le geste devenus significatifs adoptent
une forme régulière, ils sont stéréotypés pour ainsi dire et
soustraits par là à l'influence entière des impulsions subjectives ;
ils ont déjà quelque chose de conventionnel dans leur
qualité. Il semble ainsi qu'on ait passé directement et sans
transition par dessus la limite qui sépare l'instinct de la
grammaire.
Il en résulte que le langage prégrammatical pur qui répond
parfaitement à sa définition claire en théorie, est comme
insaisissable dans les faits que la nature nous offre. Nulle
part on n'est bien certain de le rencontrer. Dans tout
langage employé par une collectivité, quelque primitif qu'il
puisse être et quelque imparfaits qu'en soient les moyens,
on trouve déjà certaines règles et les traces d'une accommodation
des individus les uns aux autres. Cette accomodation
peut même précéder le langage proprement dit, en tant
qu'elle a quelquefois pour cause des facteurs psychologiques,
comme l'instinct de l'imitation, en dehors de toute préoccupation
d'exprimer la pensée. Même dans le cas que nous
avons imaginé plus haut, quand nous supposions quelqu'un
qui aurait affaire à une personne aveugle ne parlant pas la
même langue, on trouverait à l'analyse dans le langage
employé, des éléments un peu ou tout à fait conventionnels.
Les attouchements et les flexions de voix peuvent
très bien ne pas devoir toute leur valeur significative
à la pure nature. Un baiser, un serrement de main sont des
actes convenus dans une certaine mesure, puisqu'ils ne sont
pas également pratiqués par tous les peuples.76
Nous en serions donc réduits à chercher les manifestations
du langage prégrammatical dans des actes isolés qui se produisent
de temps en temps, quand les conditions favorables
se trouvent réunies, mais qui n'ont aucune coordination
entre eux et ne forment pas dans leur ensemble un langage.
En voici comme exemple un cas que nous avons observé, et
qui nous semble particulièrement caractéristique :
Un garçon d'environ six ans est en chemin de fer à côté
de son père. A genoux sur la banquette il regarde le paysage
par la fenêtre ouverte. Soudain, passe un express en sens
inverse, et le garçon effrayé recule. « Tu as eu peur » lui dit
son père. L'enfant pour toute réponse passe rapidement la
main devant sa figure en faisant entendre un son sifflant
« Pfft ! » Ce geste correspondait exactement à la représentation
de ce qu'il venait de percevoir, la mimique qui l'accompagnait
exprimait l'admiration et l'étonnement plutôt que la
peur, et le tout voulait dire à peu près : « Je n'ai pas eu
peur ; j'ai été surpris. »
Mais ces manifestations isolées de langage prégrammatical
sont elles-mêmes difficilement utilisables pour la science.
Elles n'ont pas des caractères assez évidents pour que nous
puissions les mettre à part de tout ce qui n'est pas elles.
Nous n'avons pas de procédés d'analyse suffisants pour percevoir
clairement ce qui se cache de facteurs psychologiques
sous chaque phénomène, de telle sorte que, entre ce qui est
purement mouvement instinctif (l'attitude de la colère par
exemple) et ce qui est déjà un langage voulu, impliquant un
élément conventionnel appréciable (comme quand on menace
du doigt, en pensant à un châtiment tout autre qu'une punition
corporelle), il y a tout un domaine intermédiaire où il
est impossible de dire : ici est la limite.
Il faut donc de toute nécessité renoncer à saisir quelque
part le langage prégrammatical pur comme un objet d'observation
et la matière d'une science. Mais à son défaut de ce langage
prégrammatical pur, on peut se contenter du langage
77dans lequel les facteurs prégrammaticaux — ou extragrammaticaux,
car cela revient au même — sont prédominants, et
qui, en conséquence, doit offrir des caractères différents de
celui où au contraire la grammaire est le facteur le plus
actif. Nous avons vu que bien des sciences étudient des
phénomènes dans lesquels leur objet propre apparaît à l'état
relativement pur. Cela suffit pour qu'à la faveur d'une simplification
arbitraire facile à faire, ces sciences arrivent à dégager
les faits qui sont de leur ressort, et à reconnaître leurs
caractères propres.
Le langage tel que nous l'avons défini et tel que nous
l'observons généralement nous est apparu de prime abord
comme quelque chose d'organisé ; il nous a fallu un examen
plus attentif pour reconnaître que les règles du langage
n'étaient pas le langage tout entier. Cela prouve qu'il s'agit
d'un phénomène dans lequel le facteur grammatical prédomine ;
c'est à ce facteur qu'il emprunte son caractère le plus
essentiel. Mais il peut aussi y avoir des manifestations du
langage dans lesquelles cette relation soit renversée ; où les
facteurs extragrammaticaux soient les plus actifs, et en conséquence
les caractères extragrammaticaux, les plus apparents,
tandis que la grammaire ne s'y découvrirait qu'à une analyse
plus minutieuse,
Où trouverons-nous ces formes de langage ? à quoi les reconnaîtrons-nous ?
Pour répondre à ces questions il nous
faut déterminer de plus près le facteur grammatical par opposition
à tous les autres, et déterminer en même temps les
caractères du langage qui dérivent nécessairement de son
action.
Nous avons déjà dit, il est vrai, que tout ce qui est grammatical
est un produit de l'action de la collectivité et porte le
caractère d'une règle conventionnelle. Mais nous n'avons pas
encore ramené ce phénomène général à son principe. Nous
en connaissons l'apparence ; il faut derrière cette apparence
empiriquement constatée, chercher les causes dont elle se déduit
78rationnellement. Il ne suffit pas non plus d'expliquer le
phénomène grammatical en disant qu'il est l'œuvre de la
collectivité, parce que celle-ci n'existant pas par elle-même,
ne peut agir que par les sujets qui la composent. Ces sujets
agissent-ils différemment quand ils créent quelque chose qui
a sa place dans la grammaire, et quand ils créent quelque
chose qui existe à côté d'elle ? Voilà la question posée en ses
vrais termes. De la réponse que nous y donnerons dépendra
toute la déduction qui va suivre.
Cette réponse pour nous ne saurait être douteuse : le langage
prégrammatical, et par conséquent aussi les éléments extragrammaticaux
du langage organisé, sont conditionnés par
les mouvements de la vie affective, par les émotions et les représentations
qui accompagnent la pensée ; tandis que tout ce
qui est grammaire, convention, accomodation à la collectivité
a pour principe un acte intellectuel.
Nous allons essayer de le démontrer. Le langage quel
qu'il soit, apparaît avec l'intelligence ; cela résulte de sa
définition. L'intelligence occupe une position intermédiaire,
nous ferions mieux de dire médiatrice, entre la
vie affective et la vie morale — nous entendons par
ce dernier terme l'ensemble de nos actes arbitraires en
dehors de tout jugement de valeur. L'intelligence transforme
les sensations et les émotions en idées, et l'idée s'emboîte
dans les éléments affectifs dont elle est le produit, sans pourtant
les épuiser. Ce faisant, l'activité intellectuelle distingue
le moi du non-moi ; le monde à sa lumière s'objective, et le
sujet devient conscient de lui-même par opposition à ce qu'il
perçoit en dehors de lui. Le milieu nécessaire à la vie morale
est ainsi créé. Le sujet conscient est capable de concevoir
l'idée d'une action allant de lui au monde extérieur, et l'acte
volontaire s'emboîte à son tour dans les idées qui lui ont
donné naissance, sans jamais non plus les réaliser que partiellement.
Le langage est une des manifestations de l'acte intellectuel.
Tout en lui, comme dans notre pensée, sort de la perception
79et de la vie affective, et tout en lui va à l'action aussi, puisqu'il
est le moyen par excellence par lequel les hommes agissent
les uns sur les autres. Il n'y a donc jamais de langage
sans que l'intelligence entre en jeu, seulement le rôle de
l'intelligence peut être plus ou moins grand ; elle peut exercer
ou ne pas exercer une influence sur le choix du moyen
d'expression.
Le sujet a deux manières de s'exprimer. Ou bien il crée
son signe, ou bien il se sert d'un signe déjà connu dont il se
souvient, et qu'il accepte comme le signe consacré d'une certaine
idée.
Quand il crée son signe, il obéit aux impulsions des mouvements
instinctifs. C'est le langage naturel de l'émotion,
comme le cri de douleur ; à moins que les représentations qui
occupent le sujet parlant ne lui dictent des gestes démonstratifs
ou imitatifs : par exemple la pantomime du petit garçon
dont nous parlions plus haut. Dans tous les cas le sujet
reçoit son langage spontanément de l'inspiration subjective ;
il n'a pas à sortir de lui-même pour en chercher les éléments,
et bien que cela semble paradoxal, on peut dire qu'il est
passif intellectuellement quand il crée. Par sa valeur significative
son langage contient une pensée, mais par tous ses
autres caractères il est un produit de la vie affective.
Il en est tout autrement quand le sujet emploie un signe
qu'il reproduit. Reconnaître ou admettre qu'un geste, qu'un
son déjà observé chez d'autres ou simplement déjà habituel
au sujet parlant, a une valeur significative, cela suppose un
acte intellectuel, une fonction active de celui qui règle ainsi
son langage. A la pensée qu'il exprime, celui qui parle joint
une pensée relative au signe qu'il emploie ; il a une idée suffisamment
claire de la chose qu'il veut dire, et une idée aussi
d'un certain signe. Entre ces deux idées il constate et sanctionne
une association en vertu de laquelle désormais le
signe aura une valeur et la valeur un signe. Par l'effet de ce
même acte intellectuel le signe s'objective. Il est pensé comme
quelque chose qui existe en soi, comme la nature existe en
80elle-même en dehors du sujet. Il n'est plus un phénomène
passager, une modalité accidentelle du sujet qui se trouve
être expressive ; il a désormais une existence propre, il est devenu
l'objet d'une pensée. Il a changé de nature, et à la place
d'un signe nous avons un symbole, c'est-à-dire l'idée d'un
signe associée à une idée de valeur, ce que l'on pourrait représenter
par la formule :
idée a = signe b.
Voilà l'acte primordial dont toute grammaire découle ; nous
aurons à revenir sur ce point, mais nous en savons maintenant
assez pour répondre à la question que nous avons posée
plus haut.
Quels devront être les caractères respectifs d'un langage
strictement prégrammatical, et d'un langage où le facteur
grammatical l'emporte ?
Ces caractères seront naturellement tout opposés.
La première forme du langage obéit sans doute aux lois
psychologiques qui gouvernent l'expression instinctive des
émotions, mais elle reste réfractaire à toute organisation.
Elle n'est à chaque moment, comme nous venons de le dire,
qu'une modalité du sujet. Chacun des signes qu'elle emploie
est expressif en vertu d'une nécessité psychologique, et s'interprète
intuitivement par l'impression qu'il fait sur la sensibilité
ou sur l'imagination de celui qui regarde et écoute.
Ils n'expriment clairement aucune idée, et ils s'alignent dans
le même ordre que les idées qui les provoquent. Ils se juxtaposent
sans que rien fasse comprendre d'une façon directe et
précise les relations logiques qui existent entre eux dans la
pensée. Enfin ce langage, qui est avant tout une fonction du
sujet parlant, est commun à tous les individus doués d'une
même constitution psychophysique. Cependant il porte tout
naturellement chez chaque sujet la marque spéciale de son
originalité, ce qui fait qu'il est à la fois plus général et plus
individuel que le langage organisé.
Dans l'autre forme du langage, nous aurons des symboles
relativement fixes, munis d'une valeur conventionnelle suffisamment
81claire, et constituant dans leur ensemble un organisme
linguistique, propriété commune de plusieurs personnes
qui l'adoptent en vertu d'une accommodation réciproque.
Il n'est pas une fonction, mais une création, une disposition
acquise, et il ne devient intelligible qu'à la suite d'une
initiation intellectuelle.
Tous ces caractères se déduisent rigoureusement du phénomène
primordial tel que nous l'avons décrit. Entre objectiver
l'idée d'un signe et s'accommoder avec ses semblables
pour adopter un signe commun à tous, il n'y a qu'un pas, et
ce pas est nécessairement franchi. Quand le signe est reçu et
non créé, l'entente se fait toute seule au sein de la communauté
par l'effet d'un déterminisme inconscient. Ces signes
reçus ou symboles sont fixes en vertu de l'acte intellectuel
qui consacre à la fois leur qualité et leur valeur. Existant en
idée en dehors des réalisations concrètes qui se produisent
dans la parole, ils ont une forme stéréotypée moyenne, normale,
dont les mots de la langue ne sont que des reproductions
plus ou moins parfaites. Etant fixes, ils sont nécessairement
dans une certaine mesure conventionnels, et ils peuvent
l'être tout à fait ; c'est l'association mentale et non
l'intuition psychologique qui consacre leur valeur. Ainsi le
terme semi-conventionnel, bien qu'imitatif de cri-cri, est l'expression
reçue d'une certaine idée ; mais cette idée est représentée
tout aussi clairement par ces mots entièrement conventionnels :
le chant du grillon. Enfin avec ces symboles fixes
il est possible que certaines règles, certaines habitudes de
pensées, liées à des habitudes de langage s'établissent. Rien
de semblable ne serait possible dans un parler où tout est
fluide, où rien n'échappe aux fantaisies de l'inspiration
spontanée. Il est possible également d'exprimer au moyen
des symboles des idées abstraites, qui en elles-mêmes n'offriraient
aucune prise à l'émotion ou à l'imagination, de créer
des particules pour exprimer les relations logiques que la
phrase implique. C'est ainsi que la grammaire tout entière
devient possible là où le facteur intellectuel est prédominant.82
Cette grammaire, nous le répétons, ne supprime pas tout ce
qui peut émaner des mouvements de la vie affective. Au
contraire elle admet, elle réclame cette collaboration ; mais
la prédominance de l'activité intellectuelle se traduit en
ceci que les autres impulsions psychologiques n'ont pas le
pouvoir de désorganiser la grammaire, laquelle subsiste, évolue
et progresse au service de l'intelligence humaine, souveraine
maîtresse du langage organisé.
Ces deux types de langage que nous avons théoriquement
déduits de leurs principes respectifs, se mélangent dans la
réalité, et dans la mesure où dans la production de la parole
le facteur affectif ou le facteur intellectuel l'emporte, on
obtient un parler qui se rapproche plus ou moins de l'un des
deux extrêmes. La réalité nous offre donc une série graduée
de types intermédiaires ; c'est une question de degré simplement.
Mais les formes du langage qui réalisent dans une mesure
suffisante le premier type, peuvent donner lieu à une
étude par laquelle on surprendra dans un état de simplicité
relative le mécanisme des phénomènes d'ordre prégrammatical.
Ces formes du langage qui reçoivent du facteur affectif
le caractère dominant de toutes leurs manifestations, peuvent
être réunies sous le nom générique de langage affectif, qui
s'oppose au langage intellectuel ou comme nous préférons
l'appeler, au langage organisé proprement dit.
C'est donc ce langage affectif qui s'offre à nous comme
étant le premier objet des études de linguistique théorique.
Nous allons en énumérer quelques-unes des formes principales
et les plus connues, en montrant qu'elles portent en
effet à divers degrés tous les caractères du phénomène prégrammatical.
Le langage des animaux constitue plutôt un phénomène
intermédiaire entre ce qui n'est pas encore langage et ce qui
83commence à pouvoir porter ce titre, parce qu'il y a une pensée
et un effort pour l'exprimer. Les cris des animaux ont des
formes fixes, variant d'une espèce à l'autre ; ce ne sont pourtant
pas des symboles, des signes convenus comme ceux de
la grammaire, mais des habitudes instinctives acquises au
même titre que tous les autres caractères physiques et psychologiques
de la race. Elles expriment quelque émotion
simple, ou même l'émotion en général ; quelques animaux
ont deux ou trois sortes de cris correspondant à deux ou
trois dispositions psychiques, la colère, la peur, l'amour, etc.
L'usage de ces cris est une fonction qui ne s'accompagne
d'aucun effort intellectuel. La poule qui glousse ne pense
guère plus que la sauterelle, qui en frottant ses cuisses contre
les nervures de ses ailes, fait entendre son chant strident
dans l'herbe.
Il n'en est pas tout à fait de même chez les animaux plus
intelligents, chez ceux en particulier dont les fonctions
vocales sont très développées, comme le chien domestique
qui a sans doute subi l'influence de l'homme dont il imite les
intonations de voix. Chez lui les trois formes principales de
la voix (grognement, aboi et gémissement) prennent toutes
sortes de nuances et se combinent entre elles et avec la pantomime,
pour exprimer toutes les variations successives de la
vie affective. C'est là un type presque parfait du langage affectif,
pour autant que cette émotion est intelligente, et qu'elle
cherche à se communiquer. Or on ne peut douter que cette
condition ne se réalise souvent. Quand un chien vient chercher
du secours pour son maître, victime de quelque
accident dans un lieu désert, et qu'il réussit à se faire suivre,
il y a bien chez lui l'analogue de ce que nous appelons pensée
et désir de se faire comprendre. Seulement ce n'est
qu'avec peine qu'il réussit à faire entendre à peu près ce
qu'il désire ; il faut le deviner par intuition, et on n'y réussit
pas toujours. C'est un langage qui manque totalement d'organisation
et de clarté, comme tout langage vraiment affectif.
On voit bien que ce chien est agité et inquiet ; mais ce
84qui l'agite, ce qui l'inquiète, il est incapable de l'exprimer
autrement que par quelques gestes démonstratifs, comme
celui qui consisterait à se tourner dans la direction où il
désire qu'on le suive.
Parmi les formes du langage humain, le meilleur exemple
de parler affectif est sans doute le premier langage des enfants.
Leurs cris, leurs pleurs et leurs vagissements expressifs
sont un langage. Il est évident que le cri naît souvent
spontanément de la douleur, ainsi que les larmes, et qu'il y
a surtout dans le tout premier âge des vagissements que
n'accompagne aucune pensée. Mais le cri est provoqué aussi
par la colère, et par la colère qui veut s'exprimer. Quant aux
pleurs, tout le monde sait que les bébés s'en servent comme
d'un langage très compréhensible et très efficace ; ils en savent
la valeur. Tel enfant parfaitement tranquille, se met
à pleurer dès qu'il voit quelqu'un dans son voisinage.
C'est sa manière de demander qu'on s'occupe de lui. Quand
l'enfant est de bonne humeur au contraire, il devient
expansif et éprouve le besoin de manifester au dehors ce
qu'il ressent ; il le fait par des balbutiements, des éclats de
voix plus ou moins articulés, des gestes. Toute sa vie psychique
se traduit en une activité qui en reflète fidèlement les
mouvements. C'est la vie affective qui s'exprime spontanément,
mais en même temps ce sont des linéaments de pensée ;
et au fur et à mesure que l'intelligence s'ouvre, que les idées
se précisent, et que l'enfant conçoit une notion claire des
êtres qui l'entourent et qui lui parlent, le besoin de communiquer
cette pensée devient plus impérieux. Cela se lit dans
les regards de l'enfant, dans ses gestes démonstratifs, dans
les inflexions de sa voix. Entre lui et ceux qui s'amusent avec
lui s'engage une véritable conversation. Seulement on pourrait
dire du langage qu'il emploie à peu près ce que nous
venons de dire des aboiements du chien : si l'on se rend très
bien compte de ce qu'est l'humeur du bébé, on en est réduit
à deviner les petites pensées qui s'agitent dans sa tête.85
Ce langage des tout jeunes enfants représenterait le langage
affectif à peu près pur, si ceux-ci n'étaient pas dès
l'abord sous l'influence du parler qu'ils entendent, lequel
introduit immédiatement un élément étranger et factice dans
leur langage. Dans ses vagissements déjà il reproduit par
pur instinct d'imitation des syllabes entendues ; plus tard il
lui arrive aussi de copier avec une fidélité comique les inflexions,
les rythmes des phrases qu'il entend autour de lui.
Bientôt il commence à parler en se servant de nos mots et en
y attachant un sens analogue à celui que nous leur donnons.
Il n'est pourtant pas pour cela entré de plain pied dans le
domaine du langage organisé. C'est au contraire ici qu'on
peut faire la plus belle étude de langage affectif, et par conséquent
prégrammatical, en voyant justement ce que nos
langues deviennent dans ces petits cerveaux, et le caractère
qu'ils leur impriment en les adoptant pour la première
fois.
Ce sont les caractères du parler affectif.
Les enfants adoptent quelque chose de notre lexique bien
avant d'adopter notre syntaxe. Ils ont quelques-uns de nos
mots, mais les phrases, ils les forment à leur manière. — Nous
ne parlons naturellement pas du cas où ils adoptent une
phrase entière pour un mot sans l'analyser en ses parties,
comme le « s'il te plaît » qu'on leur enseigne à dire. — Cette
manière de former les phrases, c'est celle de la nature, elle
est directement commandée par les impulsions psychologiques.
Les idées qui ont un certain degré d'intensité s'expriment
dans l'ordre même où elles se succèdent. Quant au
lexique lui-même, il porte encore beaucoup des caractères
propres aux signes du langage prégrammatical. L'enfant préfère
ce qui est expressif ; il aime les exclamations, les onomatopées,
les redoublements : « patatras » est pour lui un véritable
prédicat, et « wawa » un substantif. Bien des éléments
de notre langage, gestes ou cris, qui nous semblent de simples
auxiliaires de la parole et dont nous nous servons sans
y penser, prennent pour eux une importance particulière
86justement à cause de leur valeur expressive intrinsèque : un
haussement d'épaule, un geste de la main, une exclamation,
sont à leurs yeux des mots plus clairs, plus faciles, plus
utiles que nos expressions conventionnelles qu'ils saisissent
mal et apprennent difficilement. C'est ainsi qu'un enfant se
servait régulièrement de l'interjection : « hou hou ! » dont
nous usons pour héler toutes les fois qu'il voulait attirer l'attention
sur lui, appeler pour montrer ou dire quelque chose.
D'ailleurs ce langage des enfants a sans cesse besoin d'être
complété par l'apport des signes spontanés qui se créent au
gré de l'inspiration du moment, des gestes et de la mimique.
Une petite fille désire boire son lait toute seule : elle écarte
du geste la main qui lui présente la soucoupe. Un petit garçon
convoite un objet placé hors de sa portée : il le montre
obstinément du doigt, en faisant entendre une vibration
des cordes vocales accompagnée de coups de glotte qui indique
clairement la tension et le désir. On peut mettre ici
le « Pfft ! » du gamin qui avait vu passer l'express. L'idée à
exprimer était à la fois trop intense et trop complexe pour
qu'il pût trouver des mots. L'inspiration subjective y a subvenu.
Ce sont là quelques exemples pris sur le vif, qu'il serait
facile de multiplier indéfiniment. Les classer, les analyser, et
montrer quels sont les caractères dominants de ce langage,
par opposition à celui que l'enfant acquerra plus tard, voilà
une des tâches de la linguistique théorique en ce qui concerne
le langage affectif.
Aller plus loin et surprendre les premiers débuts de la
syntaxe dans le langage enfantin, ce serait entrer déjà dans
le domaine de la grammaire. C'est pour cela aussi que nous
nous demandons s'il y a parmi les langues parlées chez les
peuples les moins cultivés, des formes de langage dont
l'étude puisse ressortir à cette partie de la linguistique. Elles
sont toutes douées déjà de quelque syntaxe, si simple qu'elle
soit. Cela n'empêche pas naturellement qu'elles ne portent
les caractères du langage affectif à un beaucoup plus haut
87degré que nos langues, et que de leur comparaison avec des
formes de langage mieux organisées, il ne puisse résulter
quelque chose d'intéressant et d'utile.
Le langage par gestes fournit aussi de précieux éléments à
l'étude du langage affectif. Dans bien des cas il est improvisé,
et il est plus que nos mots, semble-t-il, sous l'influence
directe des sujets parlants qui inventent ou modifient les signes
dont ils usent, au gré de l'émotion ou de la représentation
dominante. Cependant cette forme de langage, surtout
quand elle devient comme chez les sourds-muets le
seul substitut possible de la pensée, est susceptible d'une
certaine organisation grammaticale et constitue un type intermédiaire
entre les deux extrêmes. Elle serait alors plutôt
assimilable aux langues dont nous venons de parler. Il est
intéressant pourtant de noter que Wundt en étudiant les
principales formes connues du langage des gestes, en est
arrivé à cette conclusion, que ce langage possède pour toute
syntaxe un ordre régulier des membres logiques de la phrase
(sujet, attribut, objet, verbe), et que cet ordre répond à la
nécessité psychologique 111. Le même auteur remarque que
presque tous les langages par gestes sont aisément compréhensibles
d'une collectivité à l'autre 212. Si tel est vraiment
le cas, on peut dire que par ces caractères du moins, ces formes
du langage appartiennent au type affectif.
Plus spécifiquement affectif est le langage des gestes quand
il accompagne un discours parlé. Dispensé d'avoir une syntaxe
et une signification claire par lui-même, puisque la parole
s'en charge, il appartient presque tout entier à cette
partie du langage qui traduit le mouvement et la vie des
émotions successives. Il contient des éléments purement instinctifs,
des gestes inconscients qui ne signifient quelque
chose qu'à notre insu, quand ils ne sont pas tout à fait dépourvus
de sens comme de simples tics. Il contient aussi des
88éléments conventionnels, des gestes convenus, symboliques ;
nous en avons déjà cité des exemples. Mais entre ces deux
catégories de gestes, il y en a une autre beaucoup plus nombreuse,
celle des gestes expressifs et spontanés, qui constitue
un véritable langage prégrammatical ; et l'ensemble du phénomène
en porte tous les caractères. Il est vrai que c'est un
langage incomplet.
Un autre objet d'étude pour la linguistique théorique du
langage affectif, c'est l'expression des émotions vives qui chez
les sujets doués d'un langage organisé, suspendent le jeu normal
des dispositions linguistiques et les font revenir tout
naturellement au langage spontané. La simple constatation
de la ressemblance qu'il y a entre le langage des émotions
au sein d'un langage d'ailleurs réglé grammaticalement, et
le langage primitif des enfants ou des peuples sauvages qui
ne sont pas encore en possession d'une grammaire un peu
perfectionnée, ne manque pas d'être instructive. Une étude
complète sur la manière dont nous exprimons nos émotions
dans notre parler n'est pas encore possible, parce que cela
supposerait déjà une connaissance exacte du langage organisé ;
mais on peut cependant noter les caractères les plus
frappants du phénomène, et remarquer ce qui se passe partout
où se produit une invasion intense des motifs affectifs
dans le discours.
Or que voyons-nous ? La syntaxe se simplifie. Nos phrases
exclamatives n'ont plus de subordination, ni de prédication.
Nous nous récrions, nous témoignons notre enthousiasme ou
notre irritation par de simples phrases attributives comme :
Quel admirable spectacle ! Le vilain personnage ! etc. Bientôt
les phrases ne se réduisent plus qu'à un mot : Misère ! bravo !
etc. Si l'idée à exprimer est compliquée, au lieu d'une phrase
organisée on a une juxtaposition de mots alignés sans aucune
syntaxe : Moi, mentir ! l'impertinent ! menteur lui-même ! et
ainsi de suite.
La qualité des mots employés n'est pas moins remarquable.
89Non seulement par leur intensité d'intonation ils reviennent
spontanément au cri de la nature, mais ils s'en rapprochent
aussi souvent par leur qualité d'articulation. Nos mots
spécifiquement exclamatifs : ah ! oh ! fi ! ouf ! aïe ! etc., sont
certainement conventionnels puisqu'ils ont une forme fixe
que nos lexiques enregistrent ; ils sont cependant assimilables
à des cris spontanés. S'ils le sont encore, tandis que tout
le reste dans le langage est devenu conventionnel, c'est à l'influence
prépondérante du facteur affectif dans l'emploi de
ces mots qu'on le doit. On pourrait faire d'ailleurs une remarque
analogue au sujet de la plupart de nos gestes symboliques ;
l'influence du facteur affectif, et en particulier
d'une représentation vive, n'a guère cessé d'agir sur eux ; de
là vient qu'ils sont rarement entièrement conventionnels, et
que quelque chose de leur valeur se peut la plupart du
temps, aisément deviner. Quand on lève les épaules, c'est
comme pour rejeter un fardeau ; quand on secoue la tête en
signe de dénégation, il semble qu'on veuille se débarrasser de
quelque chose, et si l'on menace du doigt, on pense toujours
un peu à la férule du maître d'école.
Plus l'émotion devient intense, plus ces caractères s'accentuent,
plus la grammaire et la convention s'effacent. Plus
aussi le langage s'individualise, et l'on peut bien dire que si
dans l'expression des idées générales, des pensées qui nous
sont en elles-mêmes indifférentes, tout le monde parle à peu
près le même langage, c'est dans la manière de s'exclamer et
de traduire les émotions fortes que les individus trahissent
leur originalité.
Dans toutes ces formes de langage, l'action prépondérante
du facteur affectif se fait sentir par un dernier caractère que
nous voulons encore relever. C'est que le signe mis en œuvre,
en partie naturel parce qu'il est expressif par lui-même,
en partie conventionnel parce qu'il a une forme relativement
fixe, tend à perdre ce qu'il a de grammatical. L'émotion
constituant plus encore que l'idée son contenu, c'est à l'émotion
90surtout qu'il obéit, et devenu un réflexe de notre sensibilité,
il s'assimile bientôt à un pur acte instinctif. Prenez le
cri de aïe ! par exemple. C'est un mot fixe dans sa forme, et
par conséquent conventionnel. Il exprime une pensée : je
souffre ; mais il peut facilement devenir l'expression habituelle
de la souffrance à un certain degré d'intensité ni trop
faible ni trop fort. Il sera proféré sans que l'intelligence et la
volonté interviennent, et simple réflexe émotif, il ne différera
plus en rien du cri de la nature. Sans doute il en diffère par
son origine, car l'un est naturel, et l'autre est acquis ; mais
une fois l'existence de cette disposition admise, c'est le
même processus psychologique qui provoque ce cri conventionnel
et le cri spontané.
On voit donc que le langage affectif, dans la mesure où il
obéit aux impulsions du sentiment plutôt qu'à celles de l'intelligence,
a une tendance à rétrograder vers les formes inférieures
de la vie psychique. Le langage devient instinct. Cela
est tout naturel d'ailleurs, le langage purement affectif ou
prégrammatical est, comme nous le disions en commençant,
insaisissable, c'est une forme transitoire et comme instable
de l'activité psychique ; s'il ne progresse pas vers l'organisation
grammaticale, il faut qu'il retombe au contraire vers le
pur mécanisme psychophysiologique.
Nous n'avons pas à esquisser ici le programme complet de
cette science du langage affectif dont nous venons d'énumérer
quelques-uns des chapitres. L'étude de ces formes du langage
se rattache tout naturellement à celle des mouvements
instinctifs (Ausdrucksbewegungen de Wundt) dont elles sont
issues, et à celle des phénomènes essentiels de la vie psychique,
qui s'accompagnent de réactions physiologiques et de mouvements
spontanés.
Cette science fait partie intégrante de la psychologie individuelle.
Il faut qu'elle consente à faire abstraction pour le
91moment, par une simplification arbitraire, de ce que certains
signes peuvent avoir de conventionnel, à se désintéresser de la
question des origines, des étymologies et des évolutions, que
seule la psychologie collective peut connaître, et à ne considérer
que la disposition acquise. Il y a là un domaine à réserver,
des problèmes qu'il faut laisser sans solution en se
contentant de savoir qu'ils se posent. Cette réserve faite,
les phénomènes qui devront être étudiés, ces faits empruntés
au langage des enfants, au langage gesticulé, au langage des
émotions fortes, contribueront pour leur part à la connaissance
de la vie psychophysiologique de l'individu isolé. Ils
auront leur place aussi bien dans l'induction générale qui
recherche les principes, que dans la déduction par laquelle
ils sont expliqués autant qu'ils peuvent l'être. Il n'est aucune
science qui prétende fournir une explication complète et adéquate
de la nature, il faut toujours admettre qu'il y a dans le
phénomène quelque chose qui ressortit à une science ultérieure,
ou même qui est en soi irréductible à toute connaissance.
Cette science du langage affectif est accessible aux psychologues,
qui sans changer de méthode, peuvent en aborder
tous les problèmes principaux et l'ont déjà fait avec succès.
Nous n'en voulons qu'une preuve toute pratique. Lisez les
chapitres que Wundt consacre aux mouvements expressifs,
au langage par gestes, au parler des enfants, à tous ces sujets
en un mot 113, et vous verrez que sauf réserves toujours possibles,
vous les trouverez lumineux et de tous points satisfaisants
pour ceux qui veulent sous la direction d'un maître
s'initier à la connaissance de cet ordre de faits. On n'y
éprouve point ce que nous avons ressenti en étudiant le
reste de l'ouvrage ; là où l'on se heurte au problème grammatical,
au langage organisé, il nous a toujours semblé que
les problèmes étaient à demi posés et à demi résolus.92
Nous avons essayé de justifier cette impression ailleurs. Il
nous reste à dire comment selon nous on pourrait s'y prendre
pour faire mieux. Nous allons maintenant aborder la partie
de la linguistique théorique qui se rattache à la psychologie
collective.93
Chapitre VIII
La Psychologie collective et sa méthode.
La science du langage organisé appartient tout entière à la
psychologie collective malgré le caractère complexe de son
objet et la présence des facteurs extragrammaticaux à côté
de l'élément grammatical. Comme tout ce qui concerne la vie
organique est du ressort de la biologie, malgré la place qu'y
occupent certains phénomènes plus spécialement mécaniques,
physiques ou chimiques, de même dans le langage organisé
tout doit être étudié par la science à laquelle appartient en
propre le problème grammatical.
La vie s'assimile pour ainsi dire ces phénomènes physiques
ou chimiques ; elle ne les supprime pas, mais elle les fait servir
à ses fins d'une manière ou d'une autre (p. 70 sv.). Il n'en
est pas autrement ici ; tout ce qui à un titre quelconque entre
dans le langage organisé, se subordonne à la fin supérieure
de cette forme de l'activité humaine : la création et le perfectionnement
de l'instrument grammatical au service de la
pensée. Le phénomène total et toutes ses parties ne peuvent
donc être compris rationnellement que dans leur rapport
avec la réalisation plus ou moins parfaite de ce but.
L'élément prégrammatical pris à l'état pur, n'est pas susceptible
de progrès. Il peut évoluer si l'organisme du sujet
se transforme dans ses caractères physiques ou psychiques ;
mais il n'a pas d'évolution propre. La grammaire au contraire,
95sous l'impulsion des motifs intellectuels, tend de son
propre mouvement vers une adaptation plus complète de ses
procédés aux besoins de la pensée. C'est la vie et le progrès
du langage qu'il s'agit d'expliquer. Les éléments extra-grammaticaux
sont tous au sein d'un parler où dominent les facteurs
intellectuels, dans une certaine relation avec la grammaire
et avec son évolution possible. Connaître cette relation,
voilà ce qui importe, et c'est un problème qui par ses données
appartient à la psychologie collective.
Puisque nous entrons ici dans la psychologie collective,
arrêtons-nous un instant à considérer cette science dans son
ensemble, en nous attachant à montrer quel est son domaine
et quelle est sa méthode. De même que nous avons
essayé de situer la linguistique théorique et en particulier
l'étude du langage affectif dans l'ensemble des sciences, il
sera bon de faire voir quelle place la science théorique du
langage organisé occupe dans le sein de la doctrine plus
générale à laquelle elle se rattache.
Wundt a donné comme sous-titre à la vaste étude qu'il a
entreprise sur la « Völkerpsychologie » les trois mots : « le
langage, le mythe et la coutume. » C'est bien là l'indication
assez complète des objets qui sont proposés à cette science,
pourvu qu'on prenne chacun de ces termes dans son sens le
plus étendu.
Nous avons vu quelle est la définition la plus large du langage.
Le mythe c'est également plus que la mythologie ; c'est
tout élément de croyance que l'on reçoit sous l'influence des
idées ambiantes ; c'est la « Welt- und Lebensanschauung » qui
règne dans un milieu. Le mythe ainsi compris tient d'un
côté au langage, qui dans ses créations est le véhicule et parfois
l'agent conservateur de ces idées communes ; d'autre part
il tient à la coutume, qui elle aussi, donne un corps aux
croyances dans des rites, des habitudes, etc. La coutume doit
être entendue, cela va sans dire, dans un sens très compréhensif ;
il y a des coutumes d'ordre moral, des coutumes
96d'ordre esthétique, d'ordre religieux ou simplement d'ordre
utilitaire. Il faut compter parmi les coutumes non seulement
les usages de la « civilité puérile et honnête, » mais les rites
religieux, les prescriptions de la morale régnante, le code de
l'honneur, les institutions sociales, les principes d'éducation,
les règles du goût et de la mode, les genres littéraires, etc.,
pour autant que toutes ces choses sont dues à l'activité
spontanée de la collectivité et que l'individu les subit plus
qu'il ne les détermine ; car c'est là, nous le rappelons, la
limite qui sépare la psychologie collective des sciences morales.
Ce n'est pas une science de droit, qui nous dise ce qui devrait
exister dans chacun de ces domaines, mais une science
du « donné », qui explique tout ce qui parmi les phénomènes
observables ou connaissables, rentre sous la définition de son
objet.
Quant à la méthode de la psychologie collective, il y a une
remarque importante à faire, c'est qu'elle est par essence une
science déductive. Expliquons-nous.
L'agent des phénomènes de psychologie collective n'est que
la somme des agents qui produisent isolément les phénomènes
de psychologie individuelle (p. 53). Les conditions extérieures
varient seules quand on passe d'un ordre dans l'autre ;
les mêmes sujets déterminés par ces conditions nouvelles vont
agir d'une façon différente. Ce sont les nécessités de la vie en
commun, le désir de comprendre et d'être compris qui fait
faire à l'homme cet effort intellectuel d'où va naître la grammaire.
Ce qui est vrai pour le langage doit l'être aussi pour
toutes les autres manifestations de psychologie collective.
La nature ici n'apporte rien de neuf ; son apport est déjà
parfaitement connu, si nous connaissons bien chaque individu
isolé. C'est de leur sensibilité, de leur intelligence, de
leur sens esthétique ou moral, que va sortir, provoqué par
certaines conditions spéciales, le phénomène d'un ordre nouveau.97
Quand un novum apparaissait dans la nature sous la forme
de matière, d'affinité, de vie organique, etc., c'était un mystère
qui ne se définissait que par lui-même, et que l'induction
ne pouvait saisir qu'en établissant ses relations constantes
avec son milieu. Quand la vie consciente, la vie de la sensibilité,
surgit dans les organismes vivants, il en est de
même, à cette différence près que ce mystère nouveau nous
est connaissable par l'analogie de notre expérience subjective.
C'est une perception immédiate qui n'est pas une explication.
Il en est autrement quand on constate pour la première
fois le phénomène nouveau et caractéristique de la psychologie
collective. Prenons de nouveau notre exemple dans le
domaine du langage, qui nous est plus familier : un signe
naturel devient pour un sujet parlant le correspondant objectif
d'une idée relativement bien définie, en d'autres termes
un symbole est créé. C'est, nous l'avons dit, le principe de la
grammaire, donc de toute création collective dans l'ordre du
langage et nous avons expliqué comment cela se passe. Si notre
analyse a été juste, si les notions dont nous avons fait usage
étaient vraiment scientifiques, c'est-à-dire conformes à la
vérité, le phénomène n'a plus rien de mystérieux pour nous,
ou du moins il n'est pas plus mystérieux qu'un phénomène
quelconque de psychologie individuelle. Il n'y a point d'inconnue
nouvelle dans ce problème. Nous n'avons donc pas à
découvrir et à délimiter le principe nouveau par induction.
Il est fait d'éléments que nous connaissons, nous avons en
main toutes les données nécessaires, et nous pouvons de ces
données déduire par le seul raisonnement ce qui devra ou
pourra se produire.
Connaissant le principe de la grammaire, je puis, si je le
veux, en construire a priori un système plus ou moins parfait,
et sachant comment fonctionne l'organisme psychophysiologique
de l'homme, je pourrai me rendre suffisamment
compte de la manière dont un sujet parlant pourrait utiliser
cette grammaire.98
Est-ce à dire que la psychologie collective doive être une
science purement aprioristique, et qu'en particulier l'observation
des faits n'y doive tenir aucune place ? Non,
sans doute. Ici comme dans toute science déductive le
contrôle constant des faits est indispensable. S'ils ne se plient
pas aux prévisions de la théorie, c'est que celle-ci pèche par
quelque côté ; en outre on peut dire que les faits sont des
solutions de problèmes sous la forme concrète de résultats
acquis ; à la science de trouver l'explication de ces faits et de
montrer que ce qui est, devait être. Mais en provoquant et en
contrôlant les spéculations de la science, les faits dans cet
ordre de chose ne leur fournissent aucun principe nouveau,
rien qui ne doive être déjà parfaitement connu par les sciences
qui précèdent la psychologie collective dans l'ordre de l'emboîtement.
Cette science à côté de l'explication rationnelle des
phénomènes de son ordre, ne peut apporter que la suprême
consécration des lois établies par la psychologie individuelle.
L'importance de l'étude des faits pour être de nature un
peu différente que dans d'autres sciences, n'est en rien diminuée,
nous tenons à le répéter. Il y a par exemple une sociologie
aprioristique à la Rousseau qui a fait son temps, et qui
a été remplacée par une étude plus respectueuse de la vérité
historique. A supposer même que notre intellect soit assez
puissant pour embrasser des synthèses aussi complexes que
celles de la nature, et calculer par la seule rigueur de ses déductions
tout ce qui doit dériver de principes censés connus,
ce serait là un effort inutile, puisque la science n'existe que
pour la connaissance du monde, et que sa tâche essentielle est
de suivre pas à pas la réalité en l'expliquant.
La différence entre la psychologie collective et les autres
sciences de la nature est donc plutôt théorique que pratique.
Comme ces dernières elle se base sur les faits, mais tout dans
son domaine se rapporte à des principes déjà connus pour
celui qui a étudié l'homme. Il en est de même pour toutes les
sciences qui viendront s'emboîter en elle. Cette différence
entre ce qui précède et ce qui suit la psychologie collective
99dans l'ordre de l'emboîtement général marque le passage des
sciences naturelles aux sciences morales.
Ce caractère déductif de la science qui nous occupe a une
conséquence importante au point de vue de la méthode à
suivre. On peut faire des études de psychologie collective
sans en embrasser tout le domaine à la fois. Dans l'induction
il faut de toute nécessité avoir une base aussi large
que possible. Toutes les parties de la science dont on recherche
les principes, doivent être également prises en considération,
faute de quoi les résultats resteront toujours précaires, car
les faits négligés peuvent venir leur apporter un démenti
inattendu. La déduction au contraire, peut se concentrer sur
un seul problème pourvu qu'il soit bien posé. L'étude de la
psychologie collective en ce qui concerne l'expression de la
pensée, ou la croyance, ou les institutions sociales, etc., représente
autant de sciences distinctes. Elles se complètent l'une
l'autre et peuvent s'éclairer réciproquement par certaines
analogies, sur bien des points elles sont contiguës et même
solidaires, mais elles ne sont cependant pas indissolublement
liées ; elles constituent chacune un problème. Ces problèmes
ont des données communes, mais ils ont aussi des données
particulières et ils peuvent être résolus chacun sur ses données
à lui, indépendamment de la solution des problèmes
voisins.
Il y a donc à l'intérieur de la psychologie collective une
science linguistique, qui est la science même du langage
organisé et qui ne se confond avec rien d'autre. Mais on peut
aller plus loin et dire que rien ne nous empêche de nous attacher
à un problème plus particulier, de choisir dans l'ensemble
des faits linguistiques un groupe bien défini par ses conditions
— par exemple les manifestations du langage articulé — , et
d'en chercher l'explication rationnelle sur la base des principes
particuliers à cette forme du langage, et sous le contrôle
constant des faits.100
C'est ainsi que nous revenons à notre objet plus spécial, et
que désormais nous n'aurons plus en vue que le langage
parlé tel que nous l'avons défini dans un chapitre précédent.
La science théorique du langage organisé dont nous allons
parler, s'appliquera donc à sa forme articulée, et nous
la considérons comme une partie autonome de la psychologie
collective. Il est évident que si l'on pouvait arriver à résoudre
d'une façon satisfaisante ses principaux problèmes, toutes les
autres branches de la linguistique en retireraient indirectement
le plus grand bénéfice.101
Chapitre IX
Deuxième partie de la Linguistique théorique,
ou Science du Langage organisé sous sa forme parlée.
Principes de subdivision.
Le problème essentiel de la linguistique théorique du langage
parlé, c'est le problème grammatical (p. 95). Ce problème
doit être résolu déductivement sous le contrôle des faits, en
partant d'une connaissance exacte de ses données. Quelles
sont les données du problème grammatical dans le langage
articulé ?
Nous connaissons d'abord son milieu. C'est le langage prégrammatical
étudié dans les manifestations du langage affectif ;
c'est d'une manière plus générale l'activité psychophysique
d'un être supposé connu dans sa constitution et dans
les lois qui président à sa vie.
Nous savons aussi quelle est la matière dont notre parler
grammatical est fait. Nous avons dit qu'il était une déformation
spéciale du langage prégrammatical lui-même. Dans le cas
particulier cette déformation s'attache à ses éléments articulés,
que nous sommes censés connaître parfaitement dans leurs qualités
générales. L'agent qui préside à cette création, ne nous
est pas non plus inconnu. C'est la collectivité, qui n'est pas
autre chose, que la somme des sujets individuels dont
elle est formée (p. 53, p. 58). Chacun de ces sujets collabore
à l'œuvre commune non seulement par son activité
103créatrice, mais aussi par sa capacité à recevoir, à adopter, à
s'accommoder à ses voisins. C'est donc l'ensemble des impulsions
données et subies par les divers sujets agissant les uns
sur les autres, qui est la cause efficiente du langage organisé.
Nous pouvons dire également quelle est la cause finale de
la grammaire, c'est la fin même de tout langage : la transmission
de la pensée, en prenant ce dernier mot dans son
sens le plus compréhensif, le désir ressenti par l'homme de
communiquer ce qui est en lui de vie consciente, et celui de
percevoir aussi ce que ses semblables sentent, pensent et
veulent.
Quel est l'instrument dont cet agent se sert, quelle est la
forme de l'activité psychique qui est spécialement mise en
œuvre dans la réalisation de cette fin ? Nous l'avons dit aussi :
c'est l'intelligence. La grammaire s'organise et vit quand les
facteurs individuels deviennent prépondérants. Le langage
affectif a déjà une certaine régularité dans ses moyens d'expression
en ce qui concerne les idées ; mais il faut faire un
pas de plus et avoir des formes constantes correspondant aux
diverses opérations de l'esprit ; il faut pouvoir formuler un
jugement, exprimer des relations logiques. La règle suprême
d'une grammaire qui s'organise et qui évolue, c'est la logique.
Seulement ce mot prête à l'équivoque. On entend généralement,
et avec raison, par ce terme de logique, une
science entièrement théorique qui cherche à fixer sous leur
forme la plus pure et la plus abstraite, les relations fondamentales
de la pensée. C'est une science exacte, sœur des
mathématiques. Nous pourrions dire — continuant l'analogie
qui nous est familière entre les sciences de la nature et les
sciences du langage — que la logique grammaticale est à la
logique philosophique, ce que les formes et les mouvements
que nous voyons autour de nous, sont aux formes et aux mouvements
de la géométrie et de la mécanique. La grammaire
est une logique pratique et appliquée. Elle ne contient pas
uniquement la logique, comme d'aucuns l'ont cru, mais elle
la contient et elle ne peut pas pécher contre ses lois. Cette
104dernière affirmation souffre des exceptions si on examine la
grammaire dans ses détails et ses accidents, mais si on la
prend dans son ensemble et dans ce qu'elle a de constant, on
est en droit de l'admettre comme un principe.
La grammaire se développe peu à peu, elle se perfectionne
sous l'impulsion de l'intelligence qui cherche comme à tâtons
parmi les moyens d'expression dont elle dispose, ceux qui
répondent le mieux à ses fins. Quand le langage a trouvé un
moyen qui lui suffit pratiquement, et qui répond aux exigences
de l'esprit en fait de rigueur logique, que lui importe
la théorie ? Cependant, comme il vise toujours à une expression
plus adéquate de la pensée, les lois abstraites de la logique,
non pas clairement connues mais senties, restent le
grand facteur d'évolution et de progrès dans le langage.
Telles sont donc les données du problème. Il n'y a plus
qu'à voir comment les faits constatés par la science empirique
du langage s'en peuvent déduire rationnellement. On
pourrait penser d'abord qu'il suffit de prendre les choses
dans un ordre génétique, c'est-à-dire de montrer premièrement
comment se produisent les premiers débuts de la grammaire,
quels ils sont, et comment par l'action continue des
mêmes facteurs qui lui ont donné naissance, cette grammaire,
au sein du milieu prégrammatical qui l'enveloppe,
évolue, s'enrichit et se perfectionne.
Cette méthode est nécessaire et nous lui ferons la place
qui lui revient ; mais avant de nous mettre à l'œuvre pour
tenter de résoudre un problème aussi complexe, il serait bon
de voir s'il ne doit pas se subdiviser en un certain nombre
de problèmes plus simples. Cela aussi est de bonne méthode ;
au lieu d'affronter toutes les difficultés à la fois, il vaut
mieux se demander s'il n'y en a pas une qui puisse être
résolue indépendamment des autres, et dont la solution
apporte un facteur nécessaire pour bien poser et bien résoudre
une autre partie du problème général. En d'autres termes
105il faut chercher à appliquer ici le principe d'emboîtement.
Le phénomène à étudier est complexe, et il nous semble indispensable
de le soumettre d'abord à une analyse préliminaire.
L'observation des faits nous servira ici de guide et de
contrôle. Nous rappelons donc ici la définition empirique du
langage articulé que nous avons donnée plus haut (p. 51 sv.).
Nous y trouvons les principes d'une double subdivision en
deux problèmes complémentaires.
La première de ces subdivisions consiste à distinguer
l'étude rationnelle des états de langage de celle des évolutions
de langage ; la seconde consiste à considérer à part l'élément
conventionnel du langage, et les valeurs ou la forme de pensée
qui se réalise dans ces conventions.
Sur ces deux points la science du langage organisé diffère
de celle du langage affectif, qui ne connaît pas de principe de
division correspondant. Comme elle néglige ce qu'il peut y
avoir de relativement conventionnel dans les signes dont
elle s'occupe, elle considère le signe comme adéquat par lui-même
à sa valeur, et ne pouvant pas donner lieu par conséquent
à une évolution grammaticale.
Mais il faut nous expliquer et justifier ces deux subdivisions.
Nous disons d'abord qu'il y a lieu de distinguer entre une
science théorique des états, et une science théorique des évolutions
du langage organisé.
Ce qui caractérise le langage organisé, c'est cet ensemble
d'habitudes qui constituent la grammaire. Ces
habitudes, qui la plupart sont collectives, mais qui parfois
aussi sont spéciales à un individu, ont une existence
concrète dans le cerveau et dans tout l'organisme des sujets
parlants. En vertu du parallélisme psychophysique il faut
admettre que ces dispositions acquises y sont enregistrées de
106quelque manière, en sorte qu'on peut considérer chacun de
ces organismes, le mien par exemple, comme impliquant à
chaque instant un état grammatical plus ou moins bien défini.
On peut dire aussi que la grammaire collective, qui n'est
que la somme des traits communs à un grand nombre de
grammaires individuelles, a par l'intermédiaire de ces organismes,
une existence abstraite mais pourtant réelle, au
même titre que l'espèce cheval, ou l'espèce chien existent par
les individus de ces espèces.
On a donc le droit de considérer des états grammaticaux
comme un objet de science. Un état de langage s'explique
rationnellement comme résultant de la combinaison des
deux facteurs que nous avons signalés dans tout langage organisé :
l'état grammatical, c'est-à-dire les dispositions acquises,
et les facteurs extragrammaticaux, c'est-à-dire les
impulsions spontanées dues à la constitution psychophysique
du sujet. Ces derniers facteurs étant censés déjà étudiés
et connus, il n'y a plus pour obtenir une connaissance
scientifique complète de l'état de langage, qu'à expliquer
rationnellement l'état grammatical qui y est contenu.
Comment cet état grammatical s'expliquera-t-il ? Il reflète
sans doute les dispositions psychiques et physiologiques de
l'organisme dans lequel il se réalise. Ainsi il est évident que
je n'emploierai dans ma langue que les sons émissibles par
mes organes vocaux, et que ma syntaxe correspondra à
ma manière de penser ; elle peut être abstraite, purement intellectuelle,
ou trahir une grande activité de l'imagination ;
elle peut être analytique ou synthétique, préférer les phrases
courtes et précises qui se succèdent, ou les vastes constructions
qui réunissent beaucoup de pensées dans un seul
agencement syntactique. Ce qui est vrai des individus et de
leur parler, est vrai aussi des races et de leur grammaire
collective. Une langue nous renseigne sur les caractères psychologiques
et parfois aussi sur les caractères physiologiques
d'un peuple. Il y a donc là un principe d'explication ; mais il
n'est pas suffisant, car la grammaire est bien loin de dériver
107directement et entièrement des dispositions congénitales de
l'individu qui se l'est acquise.
La grammaire en bonne partie vient du dehors. L'individu
la reçoit en apprenant à parler ; il ne la crée pas. La même
personne placée dans un autre milieu acquerra d'autres habitudes
grammaticales, et tel étant né en Chine parle fort
bien le chinois, qui aurait tout aussi bien appris à s'exprimer
en allemand, s'il avait été transporté à temps en terre
germanique. Il n'est pas nécessaire d'ailleurs d'avoir des facultés
transcendantes pour se familiariser un peu avec plusieurs
langues de types assez divers. Ce fait d'expérience banale,
nous montre assez clairement que tout n'est pas dit
quand on a montré la correspondance qu'il y a entre les dispositions
naturelles du sujet parlant et son langage.
Tout état grammatical a des causes historiques. L'individu
trouve en naissant le langage de son entourage qui s'impose
à lui. Il se l'assimile dans la mesure où ses capacités physiques
et psychiques le lui permettent, et il devient à son tour
un agent propagateur de la grammaire qu'il s'est acquise.
Cependant l'expérience nous enseigne aussi que cette grammaire
qui se transmet d'individu à individu, ne reste jamais
longtemps identique à elle-même. Nous la voyons se transformer
dans le cours du temps, de telle sorte que chaque état
grammatical collectif ou individuel nous apparaît comme un
moment au cours de cette évolution.
Cette évolution a des lois sans doute, et le parler dont je me
sers aujourd'hui est dérivé en quelque manière de celui dont
je me servais hier et que j'ai entendu autour de moi ; celui-ci
à son tour est dérivé de celui qui était en usage plus anciennement,
et ainsi de suite on peut d'époque en époque remonter
jusqu'aux premières origines du langage. Connaître les
lois de cette filiation, savoir quelles sont les causes qui peuvent
agir sur le langage dans les individus et au sein de la
collectivité, pour le transformer, et savoir comment ces causes
agissent, c'est avoir la clef qui nous permettra d'expliquer
complètement tous les états grammaticaux, et de dire
108pourquoi tel individu ou peuple en tel moment, use de tel
langage. Tout dans sa grammaire pourra être ramené à sa
cause historique, aussi bien ce qui persiste semblable à soi-même
que ce qui est le produit d'une évolution.
L'étiologie du langage organisé se subdivise donc en deux
parties.
Dans la première nous considérons seulement le sujet parlant
isolé, et dans un moment donné. Si c'est une collectivité,
nous pouvons l'assimiler à un individu représentant le type
moyen de cette collectivité et porteur de sa grammaire générale.
Nous expliquons alors son état grammatical comme un
mode possible de son activité psychophysiologique. Il faut
montrer qu'étant donné ce sujet, les manifestations de son
langage organisé sont conformes à toutes les lois de la physiologie,
de la psychologie et de la logique. Au-dessus de
toutes ces explications particulières applicables à des états
de langage donnés, il y a la science générale qui en résume
tous les principes et nous enseigne ce qui est possible en
fait de langage humain ; c'est la science théorique des états
du langage organisé. Les explications qu'elle permet de fournir
sont nécessaires mais incomplètes.
Dans la seconde partie de notre tâche, nous plaçons au
contraire l'individu (ou la collectivité considérée comme un
individu) dans le temps et dans son milieu. L'individu réceptif
et actif à la fois n'est plus qu'un agent au milieu de
beaucoup d'autres facteurs, et nous expliquons son langage
historiquement selon toutes les lois qui président au devenir
des langues humaines. Alors chacun des moments de l'évolution
du langage nous apparaît comme nécessaire au milieu
d'une succession continue de phénomènes dont nous nous
appliquons à connaître les causes. Cette explication-là est
complète, et la science qui en coordonne tous les principes,
est la science théorique des évolutions du langage.
En second lieu, disions-nous, il convient de distinguer dans
l'étude du langage organisé la convention d'avec la pensée qui
109se revêt de cette convention. Ce principe de subdivision est de
la plus haute importance ; il demande pour être bien compris
un effort d'abstraction dont l'utilité ne paraît peut-être pas
évidente au premier abord. Cependant une fois qu'on a pris
la peine de le faire, il apporte beaucoup de clarté dans bien
des questions, et il ne tarde pas à devenir familier à l'esprit.
Nous nous y arrêterons donc un peu longuement. C'est un
point sur lequel règne généralement une grande confusion,
et nous voulons essayer de remplacer cette confusion par de
la lumière.
Nous ne disons pas qu'il faut séparer le phénomène physiologique
du phénomène psychique ; le principe du parallélisme
nous l'interdit. Nous ne distinguons pas non plus ce
qui est implicite de ce qui est explicite dans le langage.
Nous avons expliqué ailleurs la valeur de ces termes, et nous
avons reproché à Wundt d'avoir cru pouvoir faire cette distinction
(p. 33 sv.). On ne peut pas dans l'analyse de la parole
séparer le contenant, c'est-à-dire la forme, le procédé, du
contenu, c'est-à-dire de la valeur. Il y a solidarité entre ces
deux aspects du phénomène. Le parallélisme psychophysiologique
demeure un principe absolu et nous présente une
seule chose dont nous voyons les deux faces. La pensée sans
sa forme et la forme sans sa pensée n'intéressent plus la linguistique.
Ce qui resterait après cette opération d'analyse ne
serait rien pour elle ; l'objet même de son étude serait détruit.
Mais si la forme et la valeur sont inséparables et ne constituent
aux yeux du linguiste qu'une seule et même chose,
on peut opposer cette chose à un autre élément de langage
dont la nature et le rôle sont entièrement différents : nous
voulons parler des sons, des éléments articulatoires, de la
matière en un mot dans laquelle cette forme se réalise.
Toute la difficulté réside au fond dans l'emploi que l'on fait
de ce mot « forme » auquel on donne sans s'en douter et au
hasard deux sens parfaitement contraires. On dit qu'un mot
latin comme civibus est une forme. Qu'entend-on par là ?110
Considère-t-on sa structure, l'agencement de ses parties significatives ?
veut-on dire que c'est un thème substantif muni
d'un suffixe casuel ? ou s'attache-t-on à la qualité matérielle
de ce thème, de ce suffixe, ou même du mot dans son entier ?
Dans ce dernier sens ni le thème, ni le suffixe, ni le mot entier
n'ont de forme ; ils n'ont que des sons.
Nous entendons par « forme » quelque chose qui est au langage
concret dans l'ordre de la pensée, l'analogue de ce que
les qualités géométriques d'un objet sont à cet objet dans
l'ordre de la perception.
Analysée dans ses éléments, cette forme se compose avant
tout des idées dont dispose le sujet parlant. Ces idées plus
ou moins claires sont faites de vastes associations de représentations,
associées à leur tour avec des représentations de
symboles correspondants : ainsi les idées que nous mettons
sous les mots cheval ou maison. Le symbole c'est l'idée, et
l'idée c'est le symbole ; il y a solidarité entre eux dans la pensée,
et chacune de ces associations est un élément formatif à
la fois dans l'intelligence (Weltanschauung) et dans la grammaire.
La conformité de la pensée avec la langue repose sur
cette identité foncière de leurs éléments respectifs.
Il n'en est pas moins vrai que cette forme se réalise par
l'intermédiaire de signes conventionnels, et qu'on peut la
distinguer de la qualité matérielle, contingente, dont ces signes
sont faits.
Il n'y a aucune relation nécessaire, aucune identité entre
l'idée de l'animal solipède que chacun connaît, et les deux
syllabes du vocable che-val avec lequel cette idée est associée.
En pratique ce monde des idées qui est le substitut du monde
extérieur, ne saurait exister dans l'intelligence sans un lexique
correspondant, comprenant des mots d'une qualité matérielle
quelconque mais suffisamment différenciés entre eux. En
théorie cependant, on peut concevoir cette forme de la pensée
qui est en même temps une forme de la grammaire, en dehors
du lexique particulier dans lequel elle se réalise. On
111peut supposer un autre lexique, comprenant tout autant de
vocables également différenciés, mais absolument différents
de ceux qui se trouvent être en usage. Au lieu de cheval
rien n'empêche d'imaginer une autre combinaison de signes
articulatoires, ou même de n'en imaginer aucune et de penser
seulement un symbole algébrique, un a ou un x qui serait le
substitut abstrait et général du signe quelconque dans lequel
cette idée se réalise.
Nous distinguons donc entre l'aspect matériel, concret et
conventionnel du lexique, et son aspect abstrait ou algébrique,
sa forme en un mot.
Mais la forme du langage n'est pas tout entière dans le
lexique. Aux idées viennent s'ajouter certaines déterminations
logiques et psychologiques qui correspondent aux divers
rôles qu'elles peuvent jouer dans la pensée. Ces déterminations
s'attachent aux mots de la phrase afin de leur donner
leur valeur de relation et de changer de simples idées en des
fragments de pensée discursive.
Les procédés extragrammaticaux expriment ces déterminations
d'une façon obscure. L'ordre des idées, leur intensité
relative, leur coefficient émotionnel se révèlent directement
par l'ordonnance des mots, par leur accent et par leur intonation,
dans la mesure bien entendu, où ces choses sont soumises
sans l'intermédiaire d'aucune règle grammaticale aux
seules lois de la psychologie individuelle. Par là on peut deviner
quelle est la valeur logique et psychologique qui revient
à chacune des parties de la phrase. Mais il s'agit d'une intuition
vague, et ce procédé pour s'exprimer et pour comprendre
manque absolument de précision. C'est par des moyens grammaticaux
usuels, connus et compris de chacun au même titre
que les mots du lexique, que ces déterminations syntactiques
s'expriment clairement.
Que devons-nous penser de ces procédés et de ce qu'ils expriment,
au point de vue spécial qui nous occupe ?
Les déterminations que ces procédés expriment sont, cela va
112sans dire, un des éléments de la forme de la pensée. Qu'il
s'agisse de classes de mots qui sont des catégories syntactiques
(verbe, substantif, adjectif, adverbe, préposition, etc.) ou des
déterminations afférentes à chacune d'elles (temps, voix,
mode, personne, nombre, genre, les diverses déterminations
par l'article, la préposition, la conjonction, etc.), ce sont là
non seulement les moules de la phrase, mais aussi ceux de la
pensée. C'est par eux que toute notre activité intellectuelle
se formule à elle-même et s'exprime. Pratiquement, nous ne
connaissons pas d'autre logique que celle de notre langage,
et quand nous raisonnons, nous ne faisons autre chose que
d'appliquer ses catégories et ses déterminations à l'objet de
notre pensée. Nous faisons sans doute cette opération de grammaire
sous le contrôle attentif de notre intelligence qui se
sert de cet instrument, et n'y est point absolument asservie ;
il n'en est pas moins vrai que c'est la langue avec ses règles
qui nous fournit la forme dans laquelle nous faisons entrer
toute l'opération intellectuelle.
On pourrait dire que cette forme est conventionnelle, puisqu'elle
n'est pas nécessaire en soi de la même façon que les
catégories de la logique abstraite. On fera remarquer que nos
catégories et nos déterminations grammaticales varient d'une
langue à l'autre et dans l'intérieur d'une même langue au
cours de l'évolution ; comme le Chinois et l'Allemand profèrent
d'autres sons, ils ont d'autres déterminations syntactiques.
On en conclura que ce sont des cadres factices arbitrairement
créés pour la pensée, et que leur valeur repose
sur une convention.
Si cet argument était valable, il s'appliquerait aussi
au lexique et à sa forme telle que nous venons de la définir.
Le lexique allemand et le lexique chinois ne se recouvrent ni
dans leur forme ni dans leurs sons ; ils sont constitués non
seulement par d'autres mots, mais aussi par d'autres idées.
Cela prouve-t-il que le choix des idées soit conventionnel
comme le choix des sons ? D'ailleurs on voit bien que ces
systèmes syntactiques ne sont pas complètement arbitraires,
113puisque dans certaines parties ils se recouvrent avec
les catégories nécessaires de la logique (substantif, adjectif,
etc.).
Il ne s'agit pas de savoir ce qui est nécessaire pour celui
qui regarde les choses du dehors, d'une manière désintéressée,
mais ce qui est nécessaire pour celui qui veut penser à
l'aide de sa propre grammaire. Son lexique, avons-nous
vu, est un des éléments constitutifs de la pensée. On
n'en peut pas changer la forme sans changer la pensée elle-même ;
tandis qu'on en peut changer la qualité matérielle
sans que la pensée soit directement mise en cause. Ce que
nous disons de cette forme du lexique, se peut dire à plus juste
titre de la forme intellectuelle de la syntaxe, de l'ensemble
des catégories et déterminations qu'elle implique. Pour chaque
individu qui a appris à penser à travers une langue, le
système syntactique de cette langue est devenu sa pensée
elle-même, et on ne saurait l'appeler conventionnel, puisque
la convention suppose le rapprochement arbitraire de deux
choses qui ne s'appellent pas nécessairement l'une l'autre
— ainsi les deux syllabes che-val et l'idée qu'elles recouvrent
pour nous — tandis qu'ici il y a identité entre les
deux termes : la pensée et la grammaire.
Reste à savoir ce qu'il nous faut penser de ces procédés qui
servent à exprimer ces diverses déterminations. Nous l'avons
déjà dit (p. 34 sv.), nous nous refusons à les séparer de la
valeur qu'ils ont en propre. Eux aussi font partie de la forme
de la pensée et n'ont rien de conventionnel. Cependant pour
mieux faire voir comment nous l'entendons, il sera bon
d'examiner les choses d'un peu plus près.
Regardons ces procédés en eux-mêmes. Ils sont de diverses
natures. Ce sont, pour les classer sous quelques chefs principaux,
tantôt des mots spéciaux auxquels un rôle syntactique
a été attribué, tantôt des règles de composition, de dérivation,
de flexion, d'accord ou d'ordonnance, tantôt des combinaisons
diverses de ces différents procédés. Formulons une
114de ces règles, une des plus simples, par exemple la règle de
composition qui régit l'emploi de la particule que en latin.
Que, nous dit-on, est enclitique et se place immédiatement
après son substantif : Senatus popolusque romanus. Nous
remarquons aussitôt qu'on peut ici de nouveau distinguer
deux choses : d'abord la nature du procédé, sa forme grammaticale
(l'emploi d'une particule enclitique) ; et ensuite la
qualité matérielle des éléments de phrase intéressés dans la
règle (le son particulier du que).
Or nous disons qu'il faut distinguer ces deux éléments
dans toutes les règles. Cela est facile pour ce qui concerne
les règles de composition, de dérivation, de flexion, qui toutes
parlent de l'emploi d'un certain mot, d'un certain suffixe,
d'une certaine désinence. Quant aux règles relatives à
l'usage qu'il faut faire d'un mot qui exprime une détermination
ou une relation syntactique (la négation en grec ou en
latin par exemple, un mot interrogatif, etc.) il est clair également
que là aussi il y a un élément matériel : la qualité de ce
mot, qui entre comme donnée dans la règle.
On voit moins nettement quel rôle le symbole joue dans les
règles d'ordonnance, qui régissent l'ordre relatif de certains
mots simplement d'après leur valeur et non d'après leur
qualité matérielle — par exemple celle qui prescrit de mettre
en français le substantif sujet avant le verbe et le substantif
régime direct après : Paul bat Jean. On pourrait définir ces
règles au point de vue psychologique en disant que ce sont
des habitudes de la pensée, des dispositions mentales artificielles.
Elles prennent une régularité grammaticale quand
d'une manière ou d'une autre, dans un état de langage donné,
elles se trouvent être nécessaires à l'intelligence du discours.
Elles n'impliquent directement aucune détermination de
qualité matérielle. La distinction entre Paul et Jean est purement
dans l'idée, sans que ce qu'on appelle couramment
la forme du mot, c'est-à-dire sa valeur phonique, y soit pour
rien. On doit cependant remarquer d'abord qu'au sein de
nos langues organisées ces habitudes ont été acquises dans
115leur connexion avec certaines formes grammaticales (nous
regrettons d'être obligé d'employer ce mot « forme » en
lui donnant un sens entièrement opposé à celui qu'il devrait
avoir ; nous ferions mieux de dire : certains symboles) ;
dans le cas particulier cela a pu être l'ancienne forme
du cas sujet en vieux français ou celle du pronom conjoint.
Parce que il bat constitue un groupe composé régulier,
on en conclut analogiquement à la régularité de Paul bat,
l'enfant bat, etc. Le symbole peut donc avoir été à un certain
moment un facteur nécessaire à la création d'une règle d'ordonnance,
mais on doit aller plus loin et reconnaître qu'il est
presque toujours nécessaire à sa conservation. Nos règles
d'ordonnance n'existent que par leur connexion avec d'autres
règles grammaticales qui elles, s'appuient directement sur
des symboles. Paul bat Jean est certainement solidaire de
Jean est battu par Paul et la distinction entre ces deux
phrases présuppose la distinction de l'actif et du passif et la
connaissance d'une certaine préposition par. Ce sont là des
choses qui sont fondées sur certains caractères matériels
des mots, c'est-à-dire sur des conventions, sur des symboles.
On peut faire les mêmes constatations à propos des règles
d'ordonnance si strictes qui régissent la place du verbe en
allemand. Le verbe allemand existe sans doute en vertu de
son sens, mais aussi en vertu de sa forme matérielle ; il faut
faire entrer dans sa définition l'ensemble complexe des caractères
de flexion qui lui sont propres, et qui le différencient
des autres parties du discours. Ce serait par conséquent une
illusion de croire que les données de la règle soient d'ordre
purement intellectuel.
En grammaire la loi d'ordonnance peut donc comme toutes
les autres lois avoir besoin de symboles, il lui faut
des points d'appui matériels. Or tout ce qui concerne la
qualité phonique des éléments en jeu est naturellement conventionnel.
Nous pourrions répéter ici ce que nous avons dit
à propos des mots du lexique : il n'y a aucune relation nécessaire,
116aucune identité entre le son de ces éléments et l'idée
qu'ils représentent, entre le que du latin, par exemple, et le
sens conjonctionnel qui y est joint. On peut très bien considérer
le procédé et sa valeur en dehors des sons qui servent à
le réaliser. Le génitif singulier de dominus serait domino et
son ablatif par contre domini, qu'il n'y aurait rien d'essentiel
de changé ni dans le système des déterminations que le
latin exprime par sa grammaire, ni dans la nature des procédés
que cette langue met en jeu pour exprimer ces déterminations.
Tout procédé grammatical peut donc par abstraction
être considéré algébriquement en dehors de toute
détermination phonologique spéciale.
Mais une fois cette abstraction faite et l'élément vraiment
conventionnel éliminé, ce qui reste du procédé, son mécanisme,
fait partie, sinon de la logique, en tous cas de la psychologie
du langage. Il est un des éléments qualitatifs de la pensée,
et ne saurait être modifié sans que la pensée elle-même
fût modifiée du même coup. La pensée n'existe que par lui et
en lui ; c'est ce que nous avons déjà essayé de dire, quand nous
avons blâmé Wundt d'avoir voulu les disjoindre (p. 33 sv.).
Nous y revenons ici, et pour plus de clarté nous illustrons
notre pensée par un exemple emprunté aux langues qui nous
sont familières. Celui que Wundt nous a fourni — l'expression
de la personne du verbe par l'adjonction d'une particule
assimilable tantôt au pronom personnel, tantôt à l'adjectif
possessif (porter-moi et mon porter), avait l'inconvénient d'être
en dehors de nos habitudes linguistiques.
Il est évident qu'au point de vue strictement logique,
le génitif attributif représente une seule idée de quelque
manière qu'on l'exprime. Il n'en est pas de même au point
de vue psychologique ; nous allons voir qu'elle se présente
tout différemment suivant le procédé qui est mis en œuvre.
Ces procédés sont divers : il y a l'ordonnance comme dans
beaucoup de langues primitives 114, il y a la composition (ainsi
117dans l'allemand Kirchturm), la flexion (Karl's Hut) et la
préposition (le chapeau de Charles) ; ce sont du moins les
principaux procédés. Examinons rapidement ce que chacun
d'eux représente au point de vue psychologique.
Quand l'ordonnance seule peut faire d'un substantif un
attribut, comme dans le schéma : chapeau Charles pour dire :
le chapeau de Charles, cela prouve que l'esprit rapporte indistinctement
tout nom à la catégorie de la substance ou à la
catégorie de l'attribut, et que cette distinction logique n'est
encore sentie qu'à la faveur d'une différence d'aspect psychologique ;
une des idées nominales apparaît comme principale,
l'autre comme subordonnée dans l'ordre de l'imagination ;
c'est le chapeau qui fait penser à Charles, et non inversement,
et ceci se traduit en vertu d'une habitude psychologique par
l'antéposition ou par la postposition du terme subordonné
suivant ce que veut la règle d'ordonnance.
Dans la composition ce sens attributif n'appartient plus à
la classe tout entière du nom, mais quelques-uns de ses représentants
l'ont gardé ou l'ont pris dans certaines combinaisons
synthétiques que le lexique enregistre. Les mots allemands :
comme Kirchturm, Dampfschiff en sont des exemples ;
cependant la règle sur laquelle ils sont fondés ressemble beaucoup
à une règle d'ordonnance à cause de la grande liberté
qu'on a de former d'autres composés sur leur analogie. Nous
aimons mieux citer ici des mots français comme :chèvrefeuille,
Fête-Dieu. Bien que le terme attributif soit dans ce dernier
mot dérivé d'un génitif latin (Festa Deum pour Dei), cela est
indifférent pour l'analyse psychologique de la valeur actuelle
de ces mots.
Ni dans le premier cas ni dans le second, le génitif n'a
encore d'expression propre. Il existe psychologiquement,
mais son idée n'est pas encore formée, parce qu'elle n'a
trouvé encore aucun signe qui lui servît à prendre nettement
conscience d'elle-même. Il en est autrement dans la flexion.
La langue qui s'en sert représente par quelque chose, par un
suffixe, cette transformation du substantif sujet ou régime en
118un substantif attribut. En même temps, dans nos langues à
flexions casuelles, ce substantif attribut se distingue de l'adjectif
et de l'apposition. Il y a là tout un mécanisme grammatical :
par les associations que l'emploi d'une forme de
génitif évoque, on pense à une personne ou à une chose possédant
en elle-même tous les caractères de la substance, mais
prêtant à une autre substance une détermination de qualité
par la relation qui existe entre elles.
Quand enfin l'expression du génitif est analytique, nous
avons alors affaire à une idée claire et distincte qui n'existe
plus seulement dans son union avec un substantif, mais pour
elle-même dans sa catégorie logique confondue avec une
catégorie grammaticale (la préposition) ; et la détermination
grammaticale va se ranger parmi les autres idées consignées
déjà dans le lexique à la faveur du signe individuel
propre à chacune.
C'est un chapitre de psychologie grammaticale trop peu
étudié et qui nous ouvrirait les yeux sur la vraie relation
entre la parole et la pensée, que celui qui traiterait de la
forme psychologique de la pensée manifestée dans le langage,
et en particulier de la relation d'identité qui existe entre le
procédé grammatical et l'acte de pensée auquel il correspond.
Le procédé fondamental du lexique, c'est le symbole suivant
la formule :
idée a = signe b ;
c'est de lui aussi, comme nous l'avons indiqué plus haut
(p. 82), que dérive toute grammaire. Or le symbole fait
partie lui aussi, comme les procédés plus compliqués de
la syntaxe, de la pensée elle-même dont il est une des
formes nécessaires. Si l'action prépondérante de l'intelligence
a pour premier effet de créer le signe conventionnel
et fixe, c'est que ce signe lui est absolument indispensable.
Il est son produit naturel, l'expression même de
cette action. En dehors de l'idée d'un signe, l'idée abstraite
119(toutes les idées le sont à des degrés divers) n'a pour support
que des représentations concrètes qui sont impropres aux
combinaisons de la pensée. Il faut quelque chose de général
et d'abstrait comme l'idée elle-même, pour servir à la pensée.
Le symbole fournit seul cet instrument nécessaire, et
c'est autour de symboles que les impressions et souvenirs
peuvent se grouper en associations suffisamment solides pour
constituer des idées claires.
Remarquez d'ailleurs qu'il y a là de nouveau identité psychologique
absolue entre la chose à exprimer et l'acte par
lequel elle s'exprime. Ce n'est pas arbitrairement que l'intelligence
se sert de ce procédé pour devenir consciente de son
contenu d'idées ; c'est en vertu d'un déterminisme interne
qui est fondé sur la nature des choses. L'acte psychologique
par lequel je deviens conscient d'une idée, et celui par lequel
je reconnais ou crois reconnaître le signe de cette idée dans
un acte qui me semble y être lié chez les autres ou chez moi,
sont absolument de même nature. Dans l'un et l'autre cas il
y a perception, représentation, comparaison, abstraction, assimilation,
choix enfin, détermination de la volonté qui s'arrête
à un parti. Tous ceux qui se rendent compte de la manière
dont une idée naît, devront avouer que l'adoption d'un symbole
est un phénomène absolument semblable. Le symbole est
d'ailleurs non pas un signe concret et passager, mais suivant
ce que nous avons dit l'idée d'un signe, et ces mots font
assez entendre qu'il y a identité psychologique entre ce qui
sert à exprimer et ce qui doit être exprimé.
Résumons cette longue discussion en disant qu'il y a identité
absolue entre la pensée et la grammaire, que l'on considère
son lexique, ses procédés grammaticaux dans leur valeur ou
leur mécanisme, ou encore son procédé fondamental qui est
l'emploi de symboles pour les idées. Nous avons constaté qu'il
n'y a en grammaire convention, c'est-à-dire choix arbitraire,
que là où il s'agit de déterminer la qualité matérielle des mots
120et des signes qui sont nécessaires au lexique et au mécanisme
grammatical.
On ne manquera pas ici de nous faire une objection et de
nous reprocher de croire ou d'avoir l'air de croire que la
grammaire est toujours le correspondant exact de la pensée,
et que dans le flux de la parole le mécanisme grammatical et
le mécanisme psychologique marchent dans un parallélisme
parfait. Bien des faits montrent que tel n'est pas le cas. Les
évolutions mêmes de la grammaire nous font voir que ce parallélisme
est sans cesse troublé, et qu'il y a souvent antagonisme
et non pas accord entre les mouvements réels de la
pensée et l'expression que nous leur donnons sous l'influence
d'habitudes grammaticales.
Il nous serait difficile de répondre à cette objection, si
nous n'avions pas déjà mis dans sa vraie lumière la relation
fondamentale de la grammaire et de la pensée, en disant
que le langage grammatical n'existe pas par lui-même,
mais qu'il est toujours enveloppé et comme noyé dans le langage
prégrammatical et affectif. C'est dire que la pensée est
toujours plus riche que la grammaire, et que par conséquent
il ne saurait être question d'un parallélisme réel. La grammaire
est insuffisante et inadéquate pour exprimer tout ce
que l'activité psychologique met en mouvement d'émotions,
de représentations et d'idées. On peut comparer la pensée à
une ombre projetée qui se compose d'un noyau parfaitement
dessiné et d'une pénombre plus ou moins grande tout autour.
Le noyau, ce sont les pensées claires qui vont trouver
leur expression correcte dans la grammaire ; la pénombre
représente des choses plus pressenties que pensées, de vagues
associations, des concepts en gestation, des mouvements émotifs
qui ne se traduisent pas en idées bien définies. Plus le
facteur émotif domine, plus l'attention intellectuelle est faible,
plus il y a de chance pour que tout cela provoque des impulsions
psychophysiologiques intenses, qui non seulement se
donneront libre carrière à côté des impulsions grammaticales,
121mais qui feront irruption dans leur domaine et viendront en
troubler l'action. Cela n'empêche pas que toute forme grammaticale
ne corresponde au moins virtuellement à une forme
de la pensée et à un acte psychologique, et que cet acte qui a
présidé à sa formation, ne se reproduise avec plus ou moins de
netteté toutes les fois que cette forme est mise en usage. Toute
grammaire prise dans sa forme abstraite est le correspondant
adéquat de ce qui est organisé en système psychologique et
logique dans la pensée du sujet parlant. Bien parler et bien
penser est une même chose :
Ce que l'on conçoit bien s'exprime clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément ;
et, en vertu du même principe, ce qui est bien dit se comprend
d'autant mieux que le système grammatical mis en
usage est plus parfait.
L'évolution de la grammaire, bien loin de contredire à ce
parallélisme de la pensée claire et de l'organisation grammaticale
de nos phrases, en constitue au contraire la preuve la
meilleure. Elle résulte tout entière de l'effort inconscient
mais réel que fait l'homme vers une adaptation plus complète
de la grammaire aux mouvements de sa vie psychique dans
la parole. Si les procédés grammaticaux se modifient, ce n'est
pas pour éloigner la grammaire de la pensée, mais au contraire
pour conformer celle-ci à celle-là.
Nous admettons donc qu'il y a une forme abstraite du langage
organisé qui est la forme même de la pensée, et qu'il y
a des sons conventionnels par lesquels cette forme abstraite
se réalise, comme une forme géométrique se réalise dans une
matière quelconque. A ces deux parties du langage correspondent
deux sciences rationnelles que nous appellerons la
morphologie générale et la science des sons.
Cette morphologie générale peut être considérée aussi bien
au point de vue des états qu'au point de vue des évolutions,
122c'est pourquoi il y aura une morphologie statique et une morphologie
évolutive. Il en est de même de la science des sons ;
elle se subdivise en deux disciplines que nous appellerons
phonologie quand il s'agit des états de langage, et phonétique
quand il s'agit des transformations de sons 115.
C'est ainsi que de notre double principe de subdivision on
peut conclure à l'existence de quatre disciplines qui embrassent
dans leur ensemble le domaine tout entier de la linguistique
théorique du langage organisé sous la forme articulée.
Mais il ne suffit pas d'énumérer ces quatre disciplines ; il
faut faire voir exactement quelles sont leurs relations, et comment
ces divisions peuvent servir à construire un système
bien agencé dans lequel les divers problèmes sont abordés
chacun à leur tour dans un ordre de succession naturelle.
Pour cela il y a deux questions à résoudre.
Chacun de nos principes de division établit une distinction
entre deux moitiés de la science du langage organisé,
et chacune de ces moitiés se compose de deux disciplines
qui offrent un caractère commun. D'après le premier
principe nous avons d'une part les disciplines qui concernent
les états (morphologie statique et phonologie), d'autre
part celles qui concernent les évolutions (morphologie évolutive
et phonétique). D'après le second principe les groupes
respectifs sont au contraire les sciences de la forme d'une
part (les deux morphologies), les sciences des sons d'autre
part (phonologie et phonétique). Il faut donc savoir d'abord
comment le principe d'emboîtement s'applique dans chacune
de ces divisions de notre science en deux parties. Faut-il
traiter ce qui concerne les états avant ce qui concerne les
123évolutions, ou inversement ? La science des sons s'emboîte-t-elle
dans celle de la forme, ou au contraire ? Mais il faut ensuite
savoir encore lequel de ces deux principes de subdivision
doit être subordonné à l'autre. De la réponse à ces
questions dépend évidemment l'ordonnance que nous établirons
entre les diverses disciplines dont se compose notre
science théorique du langage organisé.
Dans les chapitres suivants nous aborderons les questions
d'emboîtement. Ici nous voulons traiter encore rapidement
la question de subordination.
La distinction entre les états et les évolutions (I) est dans
l'ordre de la pensée. L'une de ces sciences ne nous fournit
qu'une explication incomplète de son objet, l'autre est nécessaire
pour que l'explication devienne complète (p. 109).
La distinction entre la forme et les sons (II) est dans l'ordre
de la nature ; forme et sons sont les éléments constitutifs du
langage. L'emboîtement entre les deux sciences qui y correspondent,
consiste donc à considérer d'abord un de ces
éléments seul, puis l'autre dans son union avec le premier.
Nous avons donc d'abord un objet incomplet, puis un objet
complet.
Si nous subordonnons le principe de subdivision I au principe
II, nous obtiendrons nos quatre disciplines, qui nous
fourniront successivement :
II.
pour un objet incomplet, I
une expl. incompl. (1re discipline.)
une expl. complète (2me ")
pour un objet complet, I
une expl. incompl. (3me ")
une expl. complète (4me ")
Avec la subordination inverse nous aurons au contraire :
I.
une explic. incomplète, II
d'un objet incompl. (1re discipline.)
d'un objet complet (2me ")
une explic. complète, II
d'un objet incompl. (3me ")
d'un objet complet (4me ")
Ces deux ordonnances peuvent à première vue sembler
également bonnes. Tel n'est pas le cas pourtant. La science
ayant pour fin l'explication de la nature, doit se tenir aussi
124près que possible de son objet d'étude et ne spéculer dans
l'abstrait qu'autant qu'elle ne peut pas faire autrement. Il
vaut donc mieux choisir la seconde ordonnance qui nous
amène plus rapidement à considérer les phénomènes du langage
dans leur réalité concrète (deuxième discipline). Il ne
sera pas difficile de les considérer de nouveau dans la discipline
suivante sous leur aspect abstrait ; tandis que dans
l'autre ordonnance, la seconde discipline, celle qui aurait à
fournir l'explication complète d'un objet abstrait, insaisissable,
offrirait des difficultés peut-être insurmontables.
Nous choisissons donc de subordonner la subdivision entre
les formes et les sons à celle qu'il faut établir entre les états
et les évolutions.
Nous ne nous cachons pas que nos lecteurs trouveront cette
démonstration bien abstraite et peut-être creuse. Pour le moment,
il ne nous est pas possible d'en offrir une autre. Qu'ils
veuillent bien y revenir après avoir lu tout ce travail, et
quand ils pourront mettre des notions plus concrètes sous
les termes généraux dont nous avons dû nous servir, ils nous
comprendront mieux. En attendant nous allons examiner les
questions d'emboîtement et établir l'ordonnance et le programme
de la linguistique théorique du langage organisé,
en subordonnant nos subdivisions d'après l'ordre que nous
venons de choisir. Si nous arrivons par ce moyen à analyser
le problème complexe qui se pose à nous, en une série de
problèmes se succédant naturellement, d'une façon claire
et facile pour la pensée, nous aurons par là apporté une démonstration
pratique en faveur du principe d'ordonnance
que nous avons adopté.125
Chapitre X
Emboîtement des disciplines évolutives dans les disciplines
statiques.
Nous avons dit que les disciplines relatives aux états de
langage (phonologie et morphologie statique) fournissaient
une explication partielle, nécessaire mais insuffisante à elle
seule, de leur objet. Elles nous font voir dans tout état grammatical
et dans le langage qui en résulte, un mode possible
d'activité psychologique chez le sujet parlant, que ce sujet
soit un individu ou une collectivité assimilée à un individu.
Les disciplines relatives aux évolutions (phonétique et morphologie
évolutive) nous donnent au contraire une explication
complète en faisant voir quelles sont les causes qui à un
moment donné, chez tel individu ou au sein de telle collectivité,
ont contribué à faire naître tel phénomène de linguistique ;
tout apparaît alors comme nécessaire, comme un moment
au sein d'une évolution gouvernée par des lois.
De là on pourrait conclure sans autre à l'ordre de succession
qui doit exister entre ces deux sortes de disciplines. Il est
tout naturel que l'explication complète fasse suite à l'explication
incomplète. Dans l'ordre inverse on aurait le droit
de demander à quoi peut servir une science insuffisante
après que la science suffisante a déjà été présentée. Il nous
reste cependant à voir qu'il ne s'agit pas là d'une simple succession,
mais que les résultats des disciplines statiques, tout
127insuffisants qu'ils sont en eux-mêmes, sont nécessaires pour
que les disciplines évolutives puissent établir les leurs, que
l'état de langage est le milieu qui doit être connu pour comprendre
l'évolution de langage qui va s'y produire, en d'autres
termes, que la science des évolutions s'emboîte dans la
science des états.
Nous pouvons le faire voir d'abord par une considération
de simple bon sens : c'est que pour comprendre une évolution,
il faut d'abord connaître ce qui évolue. Une évolution, c'est le
passage d'un état dans un autre ; l'idée de l'évolution est
donc nécessairement liée à l'idée de certains états ; si cette
dernière idée n'est pas claire, la première ne pourra être que
confuse. Ceci s'applique à la grammaire comme à toute autre
chose. Vous me dites : voici un son qui évolue ; tout naturellement
je demande ce qu'est ce son — non seulement quelle
est sa qualité matérielle, mais quelles sont ses conditions
d'existence dans la grammaire, c'est-à-dire parmi toutes les
dispositions acquises du sujet parlant. Il en est de même si
l'on me parle d'un point de morphologie qui se transforme,
d'un mot dont le sens évolue, d'une règle de syntaxe qui tombe
en désuétude (nous rappelons que nous employons le mot de
morphologie dans un sens très vaste ; tout ce qui concerne
la forme abstraite du langage : lexique, flexions et syntaxe
est de son ressort). On ne peut pas montrer ce qu'il advient
des divers éléments du langage au cours de l'évolution,
sans commencer par les définir, par connaître à fond leur
nature. Ces définitions, ce sont les sciences statiques qui les
fournissent.
En dehors de cette connaissance on pourra bien noter en
observant ce qui se passe dans la vie du langage, les apparences
superficielles de l'évolution, pressentir ici et là, un peu
au hasard, quelque loi ; mais on risque toujours de laisser
échapper l'élément essentiel, de ne pas voir ce qui constitue
le fond, la définition précise du phénomène. Comment pourrais-je
comprendre et faire comprendre la modification qu'un
128ingénieur a apportée à une machine, si je n'ai pas commencé
par me rendre compte du fonctionnement primitif de la machine
et du but que l'ingénieur a poursuivi en en changeant
quelques pièces ? Toute personne initiée dirait en entendant
mes prétendues explications, que je ne suis pas au fait et que
je ne dis pas ce qu'il faudrait. Ainsi arrivera-t-il en linguistique,
si l'on n'emboîte pas la science des évolutions dans
la science des états.
A cette considération de bon sens on peut sans peine ajouter
une démonstration théorique et montrer que les conditions
constantes d'un emboîtement correct (p. 61 sv.) sont ici
parfaitement réalisées.
Nous venons de le dire : l'évolution ne peut être pensée
sans les états dont elle implique l'idée, tandis qu'au contraire
un état de langage peut fort bien être pensé, abstraction
faite de l'évolution dont il est un des moments. C'est le premier
caractère.
Il est vrai que le second caractère ne se vérifie pas sous sa
forme absolue. Il n'y a nulle part un état de langage qui ne
soit qu'un pur état, quelque chose de véritablement immobile.
Par contre, si l'on prend la grammaire dans ses grands traits, et
si l'on ne considère pas des espaces de temps trop longs, on
trouvera facilement des systèmes ou des fragments de systèmes
qui, pris chez un individu ou dans une collectivité, présenteront
un caractère de stabilité relative suffisant pour qu'on
puisse y voir un phénomène approximativement fixe, dans
lequel les facteurs de transformation peuvent être provisoirement
négligés. Que font la plupart des grammaires, si ce n'est
de décrire de semblables états ?
Enfin, et c'est le troisième caractère, l'objet de la science
des évolutions est plus près de la réalité concrète que l'objet
de la science des états.
Il est difficile, pour ainsi dire impossible, de définir un état
grammatical donné dans toute sa complexité, d'énumérer
toutes les dispositions, toutes les associations d'idées qui le
129constituent ; mais à supposer même que cela se puisse faire
et qu'à cet égard la science recouvre exactement son objet
concret, encore le fausserait-elle par le simple fait qu'elle le
considère en dehors du temps. Il est là, défini par ses parties
et par les relations qui doivent exister entre elles ; il existe à
l'état d'idée, immobile, immuable, ou animé par le savant qui
en examine le fonctionnement, d'une vie artificielle, comme
une machine de démonstration.
Aussitôt que nous rentrons dans le temps nous retrouvons
la réalité complète et la vraie vie. Le fait grammatical n'existe
plus à l'état de disposition, mais en acte. Nous pouvons le
suivre dans son devenir à travers l'organisme psychophysique
du sujet, et hors du sujet dans ses répercussions chez
ceux qui le perçoivent. C'est dans ces répercussions, qui font
de chaque individu un agent de l'évolution linguistique collective,
que la grammaire par des procédés dont nous dirons
plus loin quelque chose, naît, grandit et se perfectionne.
Seule la science qui nous donne de ce phénomène une explication
suffisante, l'examine tel qu'il est, dans sa pleine réalité
concrète.130
Chapitre XI
Emboîtement de la Phonologie dans la Morphologie
statique.
Nous entreprenons maintenant de chercher si les disciplines
concernant les procédés doivent être emboîtées dans
celles qui concernent les sons, ou si c'est l'ordre inverse qui
s'impose.
Pour répondre à cette question, nous examinerons séparément
la partie statique et la partie évolutive de la linguistique
théorique. Les différences essentielles que nous venons de
constater entre ces deux sortes de disciplines, nous invitent à
diviser ainsi le problème. Traiter en même temps des deux
morphologies pour les comparer d'un seul coup aux deux
sciences des sons, ce serait faire une comparaison dont chacun
des termes serait double. Ce que les disciplines unies dans
un même groupe ont de divers, l'emporte ici sur ce qu'elles
ont de commun, et si nous voulons poser les questions sous
une forme claire et pratique, sans complication inutile, nous
ferons mieux de distinguer ; notre marche pour être plus
lente n'en sera que plus sûre.
Nous commençons naturellement par les disciplines des
états de langage, et nous opposons la morphologie statique à
la phonologie.
Quand on se demande laquelle de ces deux sciences doit
être emboîtée dans l'autre, il semble d'abord naturel de répondre
131que la morphologie doit suivre la phonologie et par
conséquent s'emboîter en elle. Tel est l'usage, justifié d'ailleurs,
dans les exposés de grammaire descriptive. On commence
par dire quels sont les sons dont une langue dispose
avant d'en présenter le système grammatical. On peut facilement
être induit à étendre cette manière de procéder à la
science théorique sous prétexte que les sons étant la matière
dont la langue est construite, il convient de connaître
d'abord cette matière, ses qualités, ses lois, parce que la
construction linguistique va être conditionnée par elle.
Cette manière de voir contient un élément de vérité, cela
est évident, et la suite de notre exposé fera voir en quoi cet
élément consiste ; mais elle contient aussi une part d'erreur :
la conclusion n'est pas exacte, et la raison en est, que les
sons du langage ne sont pas assimilables à une matière
brute.
Nous affirmons au contraire que la science des sons doit
s'emboîter dans la science des formes et des procédés, et
que la morphologie du langage (dans le sens étendu que
nous donnons à ce terme) est nécessaire pour comprendre ce
que les sons articulés deviennent quand ils sont mis au
service de la parole.
La vue erronnée que nous combattons, repose sur la confusion
de deux choses très distinctes : la science de la
voix comme phénomène physique et physiologique, et la
phonologie ou étude des sons du langage organisé. La première
de ces sciences fait partie de la connaissance
générale de l'homme au simple point de vue de l'histoire
naturelle, et elle trouve déjà sa place dans la psychologie
physiologique individuelle, quand il s'agit d'expliquer les
mouvements expressifs et le langage prégrammatical. Cela
est antérieur à tout langage organisé. La phonologie au contraire
ne trouve son objet que là où le langage grammatical
existe ; et nous disons que dans le phénomène grammatical,
l'étude de son aspect morphologique abstrait doit précéder
l'étude de son aspect phonologique concret.132
Si les lois générales de l'emboîtement sont applicables ici
— et elles doivent l'être — cette conclusion nous est déjà
imposée par ce que nous venons de dire : l'étude du concret,
s'emboîte dans l'étude de l'abstrait. C'est ce que nous avons
appelé le troisième caractère de toute subordination correcte
entre deux sciences. Il n'est pas difficile de montrer que le
premier caractère est aussi parfaitement constatable ici.
Il est évident que le facteur formel de la langue, l'idée
générale des procédés mis en œuvre, se peut fort bien concevoir
abstraction faite des sons conventionnels qui servent
de support matériel à ce mécanisme. Nous l'avons montré en
définissant l'objet de cette morphologie grammaticale (p. 111
sv.). Nous avons assimilé déjà cette science à une espèce
d'algèbre, et nous dirons bientôt plus exactement dans quelle
mesure cette assimilation se justifie. Ce que nous avons déjà
dit suffit pour affirmer que de même que la forme, le nombre
et le mouvement peuvent être pensés par les mathématiciens
en dehors de toutes les applications particulières qu'ils trouvent
dans la nature, de même la grammaire peut être pensée
dans sa forme sans que la qualité des sons mis en œuvre
soit prise en considération.
On dira probablement que la réciproque est vraie, et que
l'aspect phonologique du phénomène grammatical peut tout
aussi bien être pensé abstraction faite des procédés de grammaire.
Le son d'une phrase, ses articulations, avec leur intonation,
leur rythme et toutes ses qualités matérielles, ne peut-il
pas être un objet d'étude sans que le sens de la phrase entre
en ligne de compte ? C'est ce que nous nions. Ceux qui parlent
ainsi confondent la phonologie théorique avec l'acoustique
et la physiologie de la voix. Les sons d'une phrase sans
leur sens, ne constituent qu'un bruit, un phénomène inintelligible
et inexplicable. Tandis que le phénomène morphologique
est intelligible en lui-même, dans son abstraction
pure, à peu près comme une formule algébrique, le phénomène
phonologique n'est jamais explicable que dans sa relation
133avec la fin suprême du langage : l'expression de la pensée.
Le phénomène phonologique, c'est-à-dire cette organisation
spéciale des sons dont nous nous servons, n'est là
que pour permettre à la grammaire — qui est d'abord une
forme de la pensée — de se réaliser en actes. L'acte existe
pour la pensée et non inversement.
En dernière analyse la phonologie est aussi une science
qui nous renseigne sur un procédé d'expression ; seulement
il ne s'agit plus de la combinaison abstraite de symboles
quelconques, mais de la formation de symboles concrets au
moyen d'actes d'un ordre déterminé. Pour que ces symboles
soient aptes à jouer leur rôle dans le système du langage, il
faut qu'ils remplissent certaines conditions, et ces conditions
ont leur principe naturellement aussi bien dans la nature
abstraite du langage qui doit s'exprimer, que dans l'organisme
psychologique et physiologique du sujet parlant.
C'est ainsi que la phonologie se base à la fois sur la connaissance
de la voix et sur celle de la forme du langage,
c'est-à-dire sur la morphologie statique dont elle est une
discipline complémentaire. La morphologie statique fondée
elle-même sur certaines notions de psychologie et de logique
que nous déterminerons ailleurs plus exactement, et qui sont
empruntées à la psychologie individuelle, n'a aucun besoin
de la phonologie pour exister.
Il faut avouer cependant qu'il y a un caractère de l'emboîtement
qu'on ne saurait trouver ici. C'est celui qui n'est
pas indispensable, le second. La nature ne nous offre nulle
part un phénomène morphologique pur. Forme et sons restent
inséparables en grammaire. La réalité n'offre pas plus
l'un sans l'autre qu'on ne saurait constater dans la nature
un nombre, une figure ou un mouvement sans une substance
qui les manifeste. Il faut renoncer a priori à découvrir quelque
phénomène qui puisse être attribué à l'ordre morphologique
seul, soit d'une manière absolue, soit par son caractère
prédominant. Mais nous savons qu'à défaut de cette marque de
l'emboîtement, les deux autres sont parfaitement suffisantes.134
Chapitre XII
Programme de la Science du Langage organisé
sous sa forme parlée.
Partie statique.
Nous aurions maintenant à examiner si, conformément à
l'analogie de ce que nous venons d'établir pour les disciplines
statiques, il faut, quand il s'agit des évolutions du langage,
emboîter aussi l'étude des sons dans celle des formes,
la phonétique dans la morphologie évolutive.
Mais cette question est beaucoup plus complexe, elle soulève
une série de discussions de la plus haute importance, et
il est nécessaire pour pouvoir l'aborder avec l'ampleur et la
clarté suffisantes, que nous apprenions d'abord à bien connaître
les choses dont nous aurons à parler. En un mot, il faut
nous mettre en face de cet « objet complet » de la linguistique
théorique du langage organisé, que les disciplines statiques
nous permettent déjà de connaître dans sa définition, si
ce n'est dans sa vie.
Ce que nous avons de mieux à faire pour arriver à cette
connaissance, c'est de tracer le programme de la première
partie de notre science. Nous allons essayer de montrer comment
dans l'ordre d'emboîtement que nous venons de justifier,
tous les problèmes concernant l'explication rationnelle
du langage organisé considéré au point de vue statique,
s'échelonnent suivant une progression naturelle du
135plus simple au plus complexe. Ce sera à la fois fournir une
démonstration pratique de la valeur de cet emboîtement et
préparer les discussions ultérieures en apprenant à en mieux
connaître l'objet.
Il ne s'agit ici, bien entendu, que d'un programme. Nous
n'avons point l'intention de traiter à fond les matières que
nous allons aborder, comme on pourrait le faire dans des ouvrages
spéciaux. Nous ne dirons que ce qui est nécessaire
pour faire voir comment les problèmes essentiels se posent, et
par quelles méthodes on peut les résoudre. Pas plus dans
ces pages que dans celles que nous consacrerons ailleurs à la
linguistique théorique des évolutions et à son programme, il
ne faut chercher autre chose qu'une simple esquisse.
Si la phonologie s'emboîte dans la morphologie statique, et
si cette dernière, en tant que discipline relative aux états de
langage doit précéder la science évolutive correspondante, il
en résulte que la morphologie statique est la première partie
de la science du langage organisé que l'on doive aborder au
sortir de la science du prégrammatical, c'est-à-dire qu'elle
fait une suite naturelle à l'étude du langage affectif. La morphologie
statique s'élève sur cette discipline initiale de la
linguistique théorique, comme la première assise de la science
supérieure à laquelle elle appartient. Leur relation est celle
d'un contact direct et immédiat.
Où s'opère ce contact, et comment ce passage d'une science
à l'autre s'effectue-t-il ?
Pour répondre à cette question nous n'avons qu'à récapituler
des choses que nous avons déjà eu l'occasion de dire.
Nous avons vu que l'homme qui parle au sein d'une collectivité
et qui fait un effort d'intelligence pour comprendre et
pour être compris, en vient tout naturellement à remplacer
les signes instinctifs du langage prégrammatical par des
136symboles, c'est-à-dire par des idées de signes associées à certaines
idées. C'est sur ces symboles seulement que l'accommodation
des individus les uns aux autres peut se faire, et
le symbole dont la formule psychologique est :
idée a = signe b,
nous a paru être à la fois la première et la plus simple des
créations grammaticales. Cette création se déduit naturellement
et facilement des données du problème du langage organisé
telles que nous les avons énumérées au début d'un
chapitre précédent (ch. IX).
Cependant la morphologie statique n'a pas à s'occuper de
savoir par quel processus psychologique le symbole apparaît.
C'est là une question de genèse, par conséquent une question
d'évolution. La déduction qu'elle opère n'est pas génétique,
mais spéculative et d'ordre purement théorique. La
science du langage prégrammatical lui fournit la notion et
la définition du signe ; la morphologie statique se contente
de les combiner avec une nouvelle donnée : la prédominance
du facteur intellectuel dans l'emploi du signe, et elle arrive
tout naturellement au signe pensé, c'est-à-dire au symbole.
Le symbole, ou si l'on aime mieux, l'emploi du symbole
dans l'expression ou la compréhension est une fonction du
sujet parlant que la morphologie statique a à définir, à décrire
dans son idée générale au point de vue psychologique
et logique.
Tel est le point de départ de cette discipline linguistique.
Il vaut la peine de s'y arrêter un instant.
Nous avons fait remarquer plus haut (p. 82) que ce symbole
porte à lui seul tous les caractères essentiels de la grammaire :
il est fixe et conventionnel, et c'est lui qui permet l'accommodation
réciproque, l'expression des idées abstraites et
l'établissement des règles fixes. Cette constatation déjà intéressante
prend toute sa portée quand on se rend compte
que non seulement tous ces caractères de la grammaire sont
virtuellement réalisés dans le symbole, mais qu'il ne se réalisent
jamais qu'en lui et que par lui.137
Cela se déduit de ce que nous avons dit, lorsque nous
affirmions ailleurs (p. 120) qu'il y a identité entre le symbole
et l'idée elle-même. Le langage, expression de la pensée,
est par définition un acte, ou plutôt une succession
d'actes. Pour qu'il soit adéquat aux idées dont la pensée
claire et discursive se compose, il faut que les actes dont il
est la somme, soient pensés, c'est-à-dire conventionnels, il faut
qu'ils soient des symboles ou des parties de symboles.
Si l'on peut déduire la grammaire et le langage intellectuel
de la formule :
signe a = idée b,
on peut réciproquement du langage intellectuel pris dans sa
définition, conclure au symbole et à lui seul. Il est la grammaire
en puissance ; il est, pour nous exprimer par une analogie
à laquelle nos lecteurs ont déjà été préparés, la cellule
grammaticale.
Nous allons essayer de montrer qu'il ne s'agit pas là d'une
expression imagée plus ingénieuse que réfléchie, mais que
l'analogie peut se poursuivre sur une série de points essentiels.
Une cellule contient en virtualité toutes les puissances de
la vie et constitue même à elle seule un être organisé dans
le milieu où la vie se manifeste. Il en est exactement de
même du symbole qui sous sa forme la plus simple, peut au
sein du langage prégrammatical — milieu de toute grammaire
— jouer le rôle d'une phrase. Quand un enfant prononce
le seul mot : papa avec une certaine intonation, en
l'accompagnant d'un geste, ou d'une mimique expressive,
chacun comprend — avec l'aide des circonstances qui facilitent
l'interprétation — la pensée que l'enfant a voulu exprimer.
Ce sera par exemple : voilà papa ou : je veux que
papa vienne, ou : c'est le portrait de papa, ou : c'est la canne de
papa, ou autre chose encore. Voilà le symbole-phrase que
nous assimilons à la cellule, organisme complet.
L'idée n'existe que comme élément de pensée. L'unité dans
138le langage, c'est la phrase ; les éléments de la phrase n'ont de
valeur qu'à titre de parties de cette unité. Mais la forme la plus
simple de la phrase, c'est un seul symbole qui exprime la
pensée en énonçant son idée essentielle ou psychologiquement
dominante. C'est là une vérité connue, si l'on veut,
mais dont il nous semble que personne n'a encore tiré les
conséquences qu'elle comporte. En elle se concilient la théorie
moderne qui veut que la phrase prime le mot, et la théorie
ancienne qui veut que les mots soient ajoutés les uns
aux autres pour former la phrase. En fait, sauf cas très exceptionnels,
on ne voit pas le mot naître par la segmentation
d'une phrase en parties auxquelles un sens serait respectivement
attribué ; mais on voit tous les jours des phrases se
grossir, s'allonger par l'adjonction de mots nouveaux. Il est
parfaitement vrai que le mot avec sa valeur grammaticale, est
le produit d'une analyse ; il est non moins vrai cependant
que toute phrase constitue une synthèse. La conciliation de
ces deux vérités qui semblent contradictoires, est très facile,
une fois qu'on admet l'existence d'un symbole isolé qui est à
la fois idée et pensée, symbole et phrase.
De même que le seul mot papa peut indiquer toutes sortes
de pensées dans lesquelles l'idée du père de l'enfant joue le
rôle principal, le mot dodo représentera toutes sortes de pensées
dont le sommeil est l'élément dominant. Rapprochez ces
deux symboles-phrases dans une synthèse suivant l'ordre
de succession qui correspond à celui des idées, et dites par
exemple : papa dodo pour dire : papa dort et vous avez créé
la première phrase proprement dite. Maintenant analysez cet
ensemble, et vous trouverez dans le mot papa la substance,
le sujet de la déclaration, et dans le mot dodo l'attribut ou le
prédicat, suivant que l'idée correspondante est conçue sous
l'aspect de la qualité ou de l'action. Vous avez créé ainsi les
premières déterminations grammaticales, qui n'attendent plus
que quelque symbole matériel pour se fixer dans la grammaire
et dans la pensée. Le groupe de ces deux mots ainsi
juxtaposés, est devenu une construction, une syntaxe, suivant
139le sens étymologique de ces mots. C'est une opération absolument
semblable à celle qui se produit dans un stade plus
avancé de l'évolution linguistique, quand deux phrases coordonnées
se transforment à la suite d'une opération de synthèse
et d'analyse, en une seule phrase formée de deux propositions
dont l'une est principale et l'autre subordonnée 116.
L'analyse crée le mot en tant que fragment de phrase
grammaticalement déterminé, mais la phrase naît par synthèse ;
et les éléments dont elle se forme à l'origine, sont
des symboles qui, à titre de symboles-phrases, existent à l'état
isolé comme des organismes complets, vivant de leur propre
vie.
Tout ceci est une digression, comme le lecteur s'en sera
aperçu. Nous nous sommes laissé entraîner dans le domaine
des sciences évolutives, et nous l'avons fait pour montrer
que notre conception du symbole-phrase apporte de la clarté
dans une question controversée, et qu'elle est un des chaînons
essentiels de la déduction en linguistique théorique.
Nous savons maintenant que ce symbole-phrase, cette cellule
de grammaire, peut exister à l'état isolé, et nous savons
en outre que les phrases de nos langues, comme les organismes
végétaux ou animaux plus compliqués, sont du moins
dans le début — car nous n'avons rien dit de plus, — des
agglomérations de ces cellules ou de ces symboles-phrases.
C'est ici que l'analogie devient plus frappante encore.
Les savants nous affirment que la cellule vivante en se
spécialisant, dans des organismes de plus en plus compliqués,
140à certaines fonctions restreintes, se modifie dans une large
mesure, et n'a souvent plus qu'une ressemblance lointaine et
difficile à percevoir avec la cellule primitive autonome. Il en
sera exactement de même en grammaire. Notre organisme
grammatical est et ne peut être qu'un organisme de symboles,
c'est-à-dire d'idées portées par des éléments matériels qui
en sont les signes convenus ; mais il suffit d'avoir analysé
quelque phrase dans ses éléments significatifs pour savoir
qu'ils sont étrangement enchevêtrés et de nature souvent
bien compliquée. Quand on a coupé une phrase en mots,
tout n'est pas fait ; ces mots sont eux-mêmes des organismes
complexes. Ils impliquent tous les éléments que nous avons
énumérés ailleurs, de flexion, de dérivation, de composition ;
ils sont également composés entre eux à des degrés divers et
groupés en locutions ; il y a des attaches subtiles qui relient
les différents mots ou leurs parties suivant les règles de l'accord
et suivant qu'ils « régissent » ou « sont régis », comme
s'expriment les règles de grammaire. En outre, quand on a
décomposé un mot ou une locution en ses caractères significatifs,
on s'aperçoit bientôt que le même élément peut cumuler
diverses valeurs, qu'une même terminaison par
exemple, qui n'est pas analysable en parties significatives,
représente pourtant la synthèse de plusieurs idées ; ainsi le
suffixe du génitif pluriel latin -orum, qui implique une idée
de cas et de nombre, sans parler de la détermination de
genre. Inversement la même idée est exprimée par l'ensemble
de divers éléments parfois hétérogènes, disséminés
dans le mot ou dans la phrase ; dans nous allons, la première
personne du pluriel est marquée à la fois par le pronom et
par la désinence du verbe ; c'est là un cas très simple d'un
phénomène qui peut atteindre un beaucoup plus grand degré
de complexité. Qu'on considère aussi le tableau des flexions
avec leurs types parallèles (les cinq déclinaisons du latin),
leur mélange de procédés divers (formes analytiques et
formes synthétiques, par exemple dans la flexion de l'article
français : le, du, au à côté de : la, de la, à la, ou dans le verbe
141français : je fais, je faisais, je ferai à côté de : j'ai fait, etc.),
enfin leurs déconcertantes irrégularités. Nos phrases sont
tout autre chose que des alignements de symboles simples,
et pourtant elles ne sont faites dans leur partie grammaticale
que de symboles. Le symbole en devenant partie de phrase
a subi dans son aspect extérieur, sinon dans sa nature profonde,
une complète transformation. Comme la cellule, il s'est
adapté à son rôle.
Ceci étant, le problème que doit résoudre la morphologie
statique semble pouvoir se formuler en ces termes : comment
peut-on, par des symboles de l'ordre articulatoire (dans le cas
plus spécial que nous considérons), construire quelque chose
dont la suite et la forme correspondent à la suite et à la forme
de la pensée ?
Ce problème ainsi formulé suppose d'abord pour être résolu
une connaissance exacte du symbole. Nous nous sommes déjà
arrêté sur l'étude de cet élément du langage ; mais nous
sommes bien loin d'en avoir dit tout ce que l'on en pourrait
dire. Il est évident que le symbole étant la cellule du langage
organisé, l'élément primordial de toute construction grammaticale,
il importe de connaître à fond sa nature et tous ses caractères
pour comprendre la nature et les caractères de la
grammaire elle-même. Bien des problèmes qu'on se pose relativement
au langage grammatical, apparaîtraient plus
simples, si on se les posait à propos du symbole qui est son
principe. D'ailleurs cette étude est déjà faite dans une certaine
mesure par les psychologues qui ont cherché à définir
le mot. Nous avons vu que Wundt consacre des pages intéressantes
à cette question, et qu'il donne en particulier
un schéma détaillé des associations dont le mot, selon lui,
se constitue 117. Mais cette étude n'est pas épuisée par là,
on pourrait écrire peut-être un premier et intéressant chapitre
142de psychologie collective sous ce titre : la symbolique. Il
y a en effet d'autres symboles que ceux de la linguistique ;
preuve en soit le blason. On trouve des symboles à tous les degrés :
les uns tiennent de très près encore aux signes naturels,
comme nous l'avons vu à propos du langage affectif, d'autres
au contraire impliquent l'idée d'une pensée tout à fait claire
et souvent compliquée. Ce sont ces derniers qu'on désigne
sous ce nom dans le langage courant : la balance de la justice,
le rameau d'olivier de la paix, etc. Cette symbolique est
à la base des diverses parties de la psychologie collective,
aussi bien de celles qui concernent les croyances et les coutumes,
que de celles qui étudient le langage organisé sous ses
diverses formes.
Une fois la connaissance du symbole articulé acquise, la
morphologie statique peut se construire par voie de déduction.
On nous objectera peut-être que poser le problème de
la sorte, c'est glisser de l'ordre des sciences statiques dans
celui des sciences évolutives, parce que les diverses combinaisons
possibles entre les symboles se déduisent les unes des
autres dans un ordre naturel de succession qui va du plus
simple au plus complexe. C'est ainsi que plus haut nous
avons passé du symbole-phrase à la phrase simple, composée
de deux symboles juxtaposés. Les divers procédés, les diverses
spécialisations et déformations des symboles s'expliquent
génétiquement les unes par les autres, et par conséquent la
morphologie statique pour s'édifier elle-même, devra se transformer
en un tableau de l'évolution morphologique dans ses
traits généraux. Cette objection n'est cependant pas valable,
parce que, s'il est vrai que les déductions de la morphologie
statique établissent un ordre naturel de succession entre divers
procédés de langage (par exemple la dérivation procède
de la composition), elle ne considère que le rapport logique
de ces procédés entre eux, elle aide bien à comprendre comment
on passe de l'un à l'autre, mais elle n'a pas elle-même à
le dire. Quand nous avons plus haut décrit le passage du
143symbole-phrase à la phrase à deux termes, nous sommes sortis
de la morphologie statique, parce que sans entrer dans le
détail, nous avons cependant indiqué par quel phénomène psychologique
s'opérait cette innovation grammaticale. La morphologie
statique n'a pas autre chose à faire qu'à comparer
les deux procédés d'expression en définissant d'abord le plus
simple et ensuite le plus complexe. En décrivant des possibilités
en fait de mécanismes grammaticaux, elle fait voir aussi
des possibilités d'évolution. De tel mécanisme on passera facilement
à tel autre tout voisin. Mais comment, en vertu de
quelles lois ? Cela est en dehors de son domaine.
Cette science abstraite et déductive, nous l'avons déjà comparée
à l'algèbre. Elle construit avec des symboles des équivalents
de pensée, et c'est là essentiellement un problème de
logique. Mais il s'agit, bien entendu, d'une logique pratique
(p. 104 sv.) et qui dépend des formes et des conditions de la vie
psychologique tout entière. Nous ne sortons pas de ce milieu
prégrammatical dans le sein duquel toute grammaire est
située, et nous restons dans la nature avec laquelle nous
n'avons pas le droit de perdre le contact. Ce n'est pas aux
mathématiques pures, spéculant sur des relations parfaitement
abstraites, que nous devrions assimiler cette science, mais plutôt
à la mécanique physique ou céleste qui nous montre la
nature obéissant à ces lois abstraites. Le jeu des forces qui
mettent en mouvement la matière, produisent des effets que le
mathématicien analyse ; il en est de même ici : tout effort de
l'intelligence humaine pour exprimer sa pensée par des signes,
crée quelque chose dont le logicien doit pouvoir rendre
compte.
L'analogie n'est pourtant pas complète ; en effet les lois
mathématiques comme formes de la perception précèdent la
nature qui vient s'emboîter en elles ; tandis que les lois de la
logique, considérées dans leur application au langage et du
point de vue de la science de la nature, s'ajoutent à la vie
psychologique et s'emboîtent au contraire en elle comme
dans leur milieu.144
Ce qui malgré cela donne à cette étude le caractère d'une
science déductive aprioristique, c'est que, grâce à notre expérience
subjective des phénomènes qu'elle veut analyser et
expliquer rationnellement, nous avons une expérience immédiate
de ce qui est psychologiquement possible et logiquement
correct. Il y a là le même caractère d'évidence que l'on
trouve dans une démonstration mathématique. L'idée d'un
procédé syntactique — par exemple de celui qui est représenté
par le pronom relatif — nous est aussi intelligible
qu'une construction géométrique ou qu'une opération algébrique.
Nous n'avons pas besoin pour en concevoir la notion
et pour l'analyser, de chercher hors de nous une expérimentation
empirique. Les lois mêmes de notre pensée et de notre
être nous renseignent pleinement.
Il est vrai que l'on court le danger, dans cette recherche
du possible en fait de grammaire, de se laisser influencer
par ses habitudes propres, et de déclarer logique et nécessaire
une chose qui n'est que psychologiquement possible,
parce que l'usage en a fait pour nous une seconde nature
— ainsi la position du sujet devant le verbe — , ou au
contraire de trouver illogique et psychologiquement irréalisable
une chose parfaitement justifiée mais qui choque nos
habitudes — par exemple l'absence du verbe et de la catégorie
prédicative dans une grammaire.
Pour remédier à cet inconvénient il y a deux moyens dont
le linguiste devra faire usage et qui se complètent l'un l'autre.
Le premier, c'est de s'efforcer de penser en tout scientifiquement,
et d'aller prendre les choses assez haut dans leur principe
pour être dégagé des conceptions irraisonnées, des
préjugés de toute sorte. Le second, c'est de se mettre à l'école
de ceux qui parlent des langues extrêmement différentes des
nôtres au point de vue de la structure syntactique, des langues
qui correspondent à un type psychologique très éloigné
de celui auquel nous sommes habitués. L'étude du parler
des enfants et des illettrés, celle de toutes les fautes de grammaire
et des solécismes, quand elle est faite à un point de
145vue strictement psychologique, peut aussi grandement contribuer
à nous ouvrir la compréhension en morphologie.
Dans cette partie comme dans toutes les autres, la linguistique
théorique a un très grand besoin d'être contrôlée par
les faits et de leur demander des suggestions. Ce n'est pas
que les principes posés ne suffisent à la déduction, c'est parce
que nos habitudes personnelles et les limites de nos capacités
intellectuelles nous voilent une bonne partie de ce qui peut
se déduire de ces principes. Les faits nous ouvrent les yeux
et corrigent nos erreurs.
Cette manière de poser le problème de la morphologie
statique nous permet de répondre clairement à une question
que nous avons déjà effleurée. Quand nous avons parlé de
l'emboîtement de la science des sons dans la morphologie,
nous avons dit que ce n'étaient pas les sons qui conditionnaient
la forme abstraite et les procédés du langage (p. 132),
mais le contraire. Il ne faut pas confondre, disions-nous,
l'acoustique et la physiologie de la voix avec la phonologie
ou la phonétique. Celles-là précèdent la morphologie dans
l'ordonnance générale des sciences, tandis que celles-ci lui
succèdent. La physiologie de la voix est nécessaire à la science
du langage affectif, et il peut bien sembler en effet qu'avant
d'aborder l'étude de l'organisme morphologique du langage
articulé, il soit utile de connaître la fonction physiologique
à laquelle cet organisme va emprunter ses symboles. S'il en
est ainsi nous aboutissons à cette conclusion, qui semble
d'abord peu satisfaisante, que la voix conditionne la morphologie
grammaticale et que la morphologie grammaticale
conditionne la voix. Cette conclusion est pourtant juste, il
suffit de distinguer.
L'homme qui apprend à parler ne modifie pas sa voix ; la
fonction reste la même, seulement elle subit une éducation,
elle se plie à certaines habitudes, et c'est là ce dont la phonologie
a à rendre compte. En quoi alors la voix — cette
fonction qui reste immuable — conditionne-t-elle l'organisme
146morphologique de la grammaire ? Elle pourrait le faire de
deux façons : d'abord par sa forme, ensuite par sa qualité.
Nous entendons le mot « forme » ici encore dans son sens
philosophique. La forme de la voix consiste à se manifester
sur une seule ligne et dans le temps ; elle ne permet que des
actes successifs. Le langage qui se sert de la voix est à cet
égard dans de tout autres conditions que le langage dessiné
par exemple ; et il est évident que la morphologie statique
étant avant tout une science formelle, la forme de la matière
à mettre en œuvre va conditionner toutes ses déductions.
Il en est des diverses espèces de langages organisés, comme
des diverses formes de l'art : le sculpteur travaille dans l'espace
sur trois dimensions ; le peintre n'en a que deux à sa
disposition, mais il a le secours de la perspective et de la
couleur, le musicien opère avec des combinaisons harmoniques
qui se succèdent dans le temps. Chacun tire de ces données
primordiales les lois fondamentales de son art. La grammaire
de même est assujettie à une forme.
Reste la qualité de la matière à mettre en œuvre, c'est-à-dire
les ressources que la voix peut offrir pour former des
symboles. On ne dessine pas au fusain comme à la plume, on
ne façonne pas le marbre comme la cire. L'artiste doit se
conformer aux exigences de la matière qu'il met en œuvre ;
encore faut-il que cette matière soit utilisable. Le meilleur
compositeur ne fera presque rien d'un instrument de musique
trop fruste, et un sculpteur sera bien embarrassé
de faire un chef-d'œuvre avec une mauvaise pierre rebelle
au ciseau. Il y a par exemple entre le geste et la voix
comme instruments de langage, une première différence
qui est formelle. Le geste permet la production simultanée
de plusieurs signes et leur combinaison dans l'espace.
On incline la tête sur la main gauche posée à plat, et l'on
ferme les yeux pour indiquer le sommeil, en même temps la
main droite montre la terre : le tout doit exprimer l'idée de
la mort. C'est un genre de composés dont le langage articulé
n'est pas susceptible ; chez lui, le signe est toujours isolé et
147porte dans un seul acte toutes ses qualités : le timbre, le ton,
l'intensité, la rapidité. C'est peut-être même cette absence de
ressources naturelles qui force le langage parlé à s'organiser
grammaticalement d'une façon plus parfaite que le langage
des gestes. Par contre l'articulation offre pour cette organisation
de merveilleuses ressources : la rapidité des actes vocaux,
leur grande variété qualitative, et aussi leur plasticité
grâce à laquelle ils reçoivent spontanément l'empreinte des
impulsions psychologiques qui commandent leur émission ou
qui les accompagnent.
Ce dernier caractère cependant concerne les évolutions.
Pour la statique il suffit de savoir que les symboles vocaux
dans leur variété qualitative et dans la rapidité de leur succession
répondent à toutes les exigences de la pensée humaine.
Avec ces données et sous le contrôle des faits, cette
science peut, dans la forme imposée au langage articulé, établir
ses formules grammaticales.
Dire à quoi l'on arrive dans ce travail, ce serait traiter à
fond l'objet de cette science, que nous avons voulu seulement
définir en lui marquant sa place parmi les disciplines de la
linguistique.
Nous nous bornons à rappeler que le principe d'explication
rationnelle que cette science fournit pour l'intelligence du
phénomène linguistique, est la conformité de la grammaire
aux dispositions psychologiques du sujet parlant. L'homme
ne peut créer ou adopter en fait de grammaire que ce qui
répond aux tendances constantes de son activité psychique.
A cet égard, la science générale du possible peut se proposer
successivement divers objets qui sont entre eux aussi
dans une certaine relation d'emboîtement. Elle ne considérera
d'abord que les traits les plus généraux du langage
chez l'homme, et se demandera ce qu'ils doivent ou peuvent
être, en ne tenant compte que des caractères qui sont communs
à toute l'humanité. Un tel objet est assez vague. La
science deviendra plus précise et se rapprochera des faits en
148considérant non plus l'homme en général, mais des groupes
ethniques, ou pour mieux dire (puisqu'il ne s'agit pas d'une
science empirique comme l'ethnographie), des types psychiques
possibles, et en faisant voir les types grammaticaux qui
y correspondent. En particulier il convient de bien noter la
corrélation qu'il y a entre le développement intellectuel et le
perfectionnement du système grammatical.
Le dernier objet, le plus précis et le plus concret c'est le
langage individuel. Il y a une grammaire pour chaque sujet
parlant ; elle est faite de ce que l'individu a su s'assimiler de
la grammaire des autres et de ce qu'il y a mis lui-même
d'original. Les traits spéciaux que chacun imprime à l'organisation
de son langage sont naturellement conformes à ses
tendances mentales particulières. Il y aurait de curieuses
études à faire sur ce que devient un langage très perfectionné
dans la bouche d'une personne d'intelligence inférieure,
ou sur les transformations qu'une grammaire d'un
type donné subit en passant par un cerveau déjà façonné par
un autre type. Peut-être pourra-t-on aussi par cette étude
ramener avec plus de précision qu'on ne l'a fait jusqu'ici,
certaines particularités de style — celles qui touchent à la
grammaire — à des particularités psychologiques et fournir
ainsi une contribution à la critique littéraire. On pourrait
écrire aussi une pathologie grammaticale, car il est évident
que si un individu est atteint de telle ou telle affection mentale,
on en doit trouver la trace dans la forme de sa grammaire.
A tous ses degrés, la morphologie statique n'explique le
phénomène grammatical qu'en le situant dans le milieu prégrammatical
dans lequel il se manifeste et par lequel seulement
il peut exister. Le langage de l'homme en général, de
la race ou de l'individu, apparaîtra alors comme la mise en
œuvre de procédés grammaticaux adaptés aux dispositions
du sujet parlant, et qui viennent s'ajouter aux facultés expressives
de ce même sujet. Le langage concret de chacun
à chaque moment est expliqué — dans sa forme pour le moment —
149comme étant la résultante d'une impulsion psychique,
d'un acte d'intelligence et de volonté se manifestant à
la fois au travers de ses dispositions naturelles et de ses dispositions
linguistiques acquises.
Ce que la morphologie statique fait pour la forme du langage,
la phonologie doit le faire pour ses éléments matériels,
pour sa convention, afin que le langage concret tout entier
soit rationnellemeut expliqué.
Les sons pour servir utilement aux fins du langage organisé,
doivent être soumis à certaines conditions qui ont leur
raison d'être à la fois dans le mécanisme grammatical au service
duquel ils sont mis, et dans la nature des sujets psychophysiques
dont le langage est une fonction (p. 134).
La principale, peut-être la seule condition, c'est que ces
sons par leur articulation et par leurs autres caractères, soient
facilement reconnaissables. Pour cela il ne faut pas avoir des
sons quelconques, mais des sons connus d'avance et bien différenciés
les uns des autres. Cette condition se déduit de l'idée
même du symbole considéré sous son aspect matériel. C'est
en effet du symbole, de la cellule du langage organisé, qu'il
convient de partir dans cette étude comme dans celle de la
morphologie statique.
Les symboles du langage doivent être aperçus et assimilés
à leur idée (puisque le symbole est l'idée d'un signe) ; en
dehors de cet acte intellectuel il n'y a pas de compréhension
possible du signe conventionnel, partant, pas de langage organisé.
En conséquence, ce qui importe, c'est moins sa qualité
intrinsèque que sa relation avec tous les autres symboles,
les caractères qui permettent à la fois de le différencier
d'avec tout ce qui n'est pas lui, et de l'assimiler avec tout ce
qui lui est grammaticalement identique. Sa qualité matérielle
doit permettre cette double opération. Pour cela, il faut
qu'on puisse l'analyser en éléments phonologiques d'une
150qualité bien définie ; et pour que ces qualités soient bien définies,
il faut qu'elles existent non pas dans des actes concrets,
passagers, mais en idée, comme les symboles eux-mêmes. Il
serait impraticable que ces idées de sons fussent en nombre
trop élevé, variant d'un mot à l'autre. Nos mots seraient alors
phonologiquement à peu près ce que les mots chinois sont au
point de vue graphique ; chacun existerait pour lui-même,
ne ressemblant à rien. Il faut au contraire qu'ils soient composés
d'éléments communs en nombre restreint, et qu'ils diffèrent
les uns des autres moins par la qualité que par la combinaison
de ces éléments.
Chaque langue suppose un système phonologique, c'est-à-dire
une collection d'idées ou si l'on aime mieux, de représentations
de sons. Ce système phonologique fait partie de
sa grammaire ; il correspond à une disposition physiologique
acquise.
L'existence de ce système est un procédé grammatical d'un
ordre particulier, mais analogue à bien des égards à tous
les autres procédés. En dernière analyse, ce système est
porteur de toute pensée dans le langage, puisque les symboles
n'existent et n'ont de caractère propre que par
son secours. Il constitue lui aussi une « forme » dans le sens
où nous avons entendu ce terme, car on peut concevoir le
système phonologique sous son aspect algébrique et remplacer
les trente, cinquante ou cent éléments qui le composent
dans une langue donnée, par autant de symboles généraux
qui fixent leur individualité, mais non pas leur caractère
matériel.
Il y a là un problème intermédiaire entre la morphologie
et la phonologie. La première tâche de cette dernière science
est de justifier l'existence du système phonologique, et c'est
traiter un problème de morphologie, puisque ce système n'est
autre chose qu'un procédé grammatical pour l'utilisation de
la voix, un des éléments formels du langage considéré comme
ensemble de dispositions psychologiques.
Une fois la connaissance de ce procédé acquise, on peut
151aborder la phonologie proprement dite, qui en tant que
science rationnelle, aura à nous montrer ce qui est possible
en fait de système phonologique.
La connaissance de la voix humaine nous montre que les
sons que nous employons peuvent être caractérisés par leur
timbre qui dépend de l'articulation, par leur accent ou intensité
d'émission, par leur ton musical, et par leur quantité. De
ces quatre caractères, le premier est de beaucoup le plus important
à cause des ressources variées qu'il offre. Le son est donc
caractérisé surtout par son articulation, et l'on peut considérer
les autres caractères comme des qualités qui viennent s'y ajouter.
Un « a 118 » peut-être plus ou moins accentué, bas ou haut,
bref ou long.
La phonologie proprement dite devra donc en premier
lieu nous dire ce qui est possible en fait d'articulations
dans le système phonologique d'une langue. Pour cela, elle
se basera sur les données fournies par la physiologie de la
voix et de l'ouïe. Pour qu'un son existe, il faut non seulement
qu'on puisse l'articuler correctement, mais aussi et surtout
que l'oreille en le percevant puisse bien le différencier.
Sans doute, c'est là une affaire d'éducation, mais dans ce domaine
aussi le possible a des limites. Chacune de nos langues
a son système d'articulations qui est à la parole prononcée à
peu près ce que l'alphabet est à la parole écrite. Nous avons
en français par exemple, un certain nombre de voyelles, un
certain nombre de consonnes, parmi lesquelles tant de labiales,
tant de dentales, etc.
L'articulation des sons n'est d'ailleurs pas complètement
décrite quand on a dit comment un « a » ou un « f » se prononcent
à l'état isolé. Dans le langage ces sons sont enchaînés
les uns aux autres dans une rapide succession ; la combinaison
152des éléments vocaliques et des consonnes fait des syllabes, qui
constituent des mots, des groupes de mots, des phrases.
Chaque articulation a un caractère spécial suivant la manière
dont elle est située ; elle doit quelque chose à sa relation
avec les articulations voisines ; sa position au commencement,
au centre ou à la fin d'une syllabe, la nature des éléments
qui la précèdent ou le suivent immédiatement, tout exerce
sur elle une influence. Le « p » de pas « pa » ne s'articule
pas comme celui de hanap « anap » le « k » de qui « ki »
n'est pas identique à celui de comme « kɔm » et un « s »
dans le groupe « ast », ainsi dans pasteur, où il s'appuie sur
une consonne muette, n'est pas le même que le « s » qui se
trouve dans assez « asẹ », placé entre deux voyelles.
La phonologie théorique basée sur la physiologie et tenant
compte de toutes les conditions de l'articulation, nous fournira
donc le nécessaire pour décrire les systèmes phonologiques
et leur emploi dans le langage, comme autant de modes
possibles de l'activité des sujets parlants. Jusque-là cette étude,
bien que partant d'un principe fondamental emprunté à la morphologie,
peut sembler tout devoir dans ses développements à
la physiologie seule, et on ne voit pas encore bien clairement
pourquoi il serait indispensable de se livrer à des recherches
approfondies de morphologie statique avant d'aborder cette
science. Mais nous sommes loin d'avoir pénétré encore bien
avant dans la connaissance des phénomènes de phonologie ;
nous n'avons vu que leur aspect physiologique et purement matériel ;
pour peu qu'on examine la réalité concrète, on voit que
tout est par surcroît subordonné aux conditions de la vie du
langage, et par conséquent à des motifs d'ordre psychique
relatifs à la valeur expressive des symboles mis en œuvre.
Les articulations par exemple sont plus ou moins nettes
suivant l'importance qu'elles ont pour la compréhension des
symboles, et suivant l'attention plus ou moins grande qui
préside à leur émission. Nous reviendrons plus loin sur ce
fait qui a des conséquences en phonétique, mais qui dans son
153principe est phonologique et concerne la mise en œuvre des
éléments d'articulation au service de la parole vivante. Parmi
les phénomènes de même ordre, il faut signaler tous ceux qui
concernent ce qu'on appelle d'un terme général emprunté
à la grammaire indoue, le sandhi. Il s'agit de la manière
dont on articule le dernier élément d'un mot sous l'influence
du premier élément du mot suivant : si par exemple en prononçant
ces mots : une grande table j'assimile le « d » de grande
au « t » de table : « yn grɑ̃t tablə », c'est un phénomène de
sandhi. Les faits de cet ordre sont beaucoup plus importants
qu'on ne se l'imagine ; ils ont des conséquences innombrables
dans l'évolution phonétique des sons et dans les destinées des
mots en ce qui concerne la qualité matérielle de leurs finales ;
en particulier tout ce qu'on désigne couramment sous le nom
de liaison en est dérivé. Or le sandhi est directement conditionné
par la morphologie des phrases. En effet l'influence
du premier élément phonique d'un mot sur le dernier élément
du mot précédent est en raison directe de l'union qui
existe entre ces mots, et cette union est d'autant plus intime
que les mots sont par leur sens plus unis dans la pensée.
Sans faire ici un exposé théorique qui serait du ressort de
la morphologie statique, on peut dire que les mots dont
nos phrases sont formées, sont plus ou moins unis, soudés
les uns aux autres ; ils sont composés entre eux à tous les
degrés, depuis la synthèse complète qui les fait paraître
comme deux parties du même mot (ainsi en français afin de =
à fin de), jusqu' à l'union la moins consistante, pratiquement
égale à zéro, en passant par divers degrés intermédiaires.
Et ce que nous disons des mots, se peut dire d'une façon générale
des éléments significatifs, des symboles dont nos mots sont
formés. Il y a un sandhi intérieur, comme on le voit par les
règles de la dérivation indoue. Nos articulations sont ainsi
constamment, quoique en général imperceptiblement, déterminées
par des conditions morphologiques. Et l'importance
de ces faits qui peuvent sembler parfois trop subtils pour
retenir l'attention, éclate, nous le répétons, quand on voit les
154conséquences qu'ils ont dans le domaine des évolutions de
langage. Renoncer à connaître ceux-là, c'est renoncer à expliquer
ceux-ci.
Mais pour fournir une explication complète de ce que sont
nos articulations dans le langage, la phonologie devra aller
plus loin et montrer encore comment elles sont soumises à
l'influence de toutes les impulsions extragrammaticales. La
définition même du système phonologique montre que chacun
des éléments qui les composent, par exemple le « a » ou le « f » du
français, n'existe que comme un type, une idée, et que chaque
fois qu'on articule ces phonèmes, on ne fait que réaliser ce
type d'une manière individuelle et plus ou moins parfaite. Il
y a non seulement des différences individuelles, mais il y a
surtout une certaine liberté de modifier le son dans des
limites données. Il faut que l'assimilation du phonème à son
type et par conséquent l'intelligence du symbole dont il fait
partie, restent possibles. Dans ces limites les impulsions extragrammaticales
se donnent libre carrière, et quand le contrôle
de l'intelligence vient à manquer par défaut d'attention ou
à la suite d'une invasion des facteurs affectifs, ces limites
sont facilement franchies, et l'articulation se corrompt, devient
indistincte ou se modifie dans le sens où l'impulsion
spontanée la pousse. Il y a là aussi des phénomènes à étudier
qui ont des conséquences importantes en phonétique. Ces
phénomènes, plus et autant que les précédents, ne se comprennent
que si, avant d'étudier les sons du langage, on a
appris à connaître sa forme, c'est-à-dire la relation qui existe
entre lui et la pensée qu'il exprime.
Ce que nous venons de dire de l'articulation, peut se dire
également des trois autres caractères des sons parlés, l'accent,
le ton et la quantité. Seulement étant donné le rôle relativement
moins important qu'ils jouent dans la grammaire, on
fera bien peut-être de suivre un ordre inverse, de les considérer
d'abord comme des moyens d'expression extragrammaticaux,
155qui accompagnent l'expression grammaticale par
des symboles articulés, et de faire voir ensuite comment ils
peuvent à leur tour être englobés à quelque titre dans le système
phonologique d'une langue.
Nous indiquerons brièvement ce que nous entendons par
là, en disant quelques mots sur l'accent. Le rôle le plus naturel
à l'accent, c'est d'obéir aux impulsions spontanées et de
donner à chaque partie de la phrase une intensité psychologique
correspondant à celle qui lui revient naturellement.
On peut donc l'étudier à ce point de vue, et d'ailleurs cet
accent purement rhétorique n'est complètement absent d'aucune
langue.
Mais il faut constater ensuite que, comme tout signe naturel,
il lui arrive de devenir conscient de sa valeur propre
et de prendre à ce titre un rôle régulier dans la grammaire.
Tous les mots qui sont susceptibles d'avoir un accent propre
ont alors un accent fixe, soit qu'il se place sur l'élément radical
et significatif comme en germanique, et dans ce cas il sert
à distinguer cet élément de ses suffixes ou de ses préfixes,
soit qu'il ait comme en latin une place relative au nombre
et à la quantité des syllabes du mot ; c'est alors un accent
synthétique qui consacre au contraire l'unité du vocable qui
le porte. Cet accent qui sert aussi à distinguer parmi les mots
groupés en locutions plus ou moins intimement soudées, ce
qui est principal de ce qui est enclitique, est un phénomène
complémentaire de la morphologie, et ne se comprend pas
sans elle.
Quand l'allemand distingue August (le mois d'août) de
August (Auguste), c'est une différenciation toute conventionnelle,
quelle qu'en soit l'origine. La place de l'accent est
devenue un caractère matériel du mot au même titre que sa
qualité phonique 119. Nous disons : la place de l'accent, car ce
156caractère est relatif au mot total. L'intensité dans l'émission
de la voix garde en ceci sa valeur psychologique que l'accent
reste une qualité du mot, qui doit en avoir un et n'en peut
avoir qu'un seul. Pour que l'accent devienne un élément du
système phonologique comme les autres, il faudrait qu'il
appartînt uniquement au phonème qui le porte, à peu près
comme l'aspiration à la consonne qu'elle accompagne, et qu'on
puisse librement en faire usage ou s'en passer dans la construction
des symboles. L'accent répugne à perdre à ce point
son caractère propre. Il n'en est pas de même des autres
qualités des sons, et c'est un fait bien connu que la quantité
peut devenir un facteur important du système phonologique
d'une langue.
Mais nous ne voulons pas nous attarder à traiter des sujets
sur lesquels nous ne pouvons émettre que quelques vues générales.
Nous dirons seulement en terminant que la phonologie
théorique après avoir traité de ces divers caractères des sons
parlés et de leur emploi au service de la grammaire, devra aussi
étudier les relations qui existent entre ces caractères ; comment
par exemple l'intensité ou la longueur d'un son peut exercer
une influence sur son articulation. S'il y a là des correspondances
naturelles, physiologiquement justifiées, il y en a aussi
d'autres qui ne reposent que sur des habitudes acquises, et
dont l'existence constitue un phénomène grammatical. La
connaissance de ces relations sera fort utile au moment où il
faudra aborder l'étude des évolutions phonétiques.
La phonologie comme la morphologie en rendant compte
de ce qui est possible, peut avoir en vue ou bien le problème
général qui se pose relativement à l'humanité, ou bien les
problèmes plus spéciaux qui concernent certains types psychiques
ou physiques, ou même les individus avec leurs dispositions
157particulières. Ici aussi il y aurait des lois de correspondance
à établir.
La correspondance physiologique est directe et évidente.
La qualité des éléments vocaux dont un sujet se sert, dépend
naturellement de son organisme vocal et auditif ; une collectivité
aura un système phonologique adapté à son type
physique. Peut-on établir aussi une certaine relation de
cause à effet entre le système phonologique et les tendances
psychiques du sujet ? Si elle existe, elle est naturellement
beaucoup plus complexe et plus subtile. Nous pensons néanmoins
qu'on est en droit d'en supposer une. Le système peut
être plus ou moins riche, suivant que les individus sont plus
ou moins capables de différencier un grand nombre d'éléments,
et que leurs tendances les portent vers la variété ou
vers la monotonie. Le système phonologique peut faire entrer
en ligne de compte et dans des proportions diverses les caractères
que nous avons énumérés plus haut. Il n'est pas psychologiquement
indifférent qu'un groupe ethnique adopte l'accent
d'intensité et un autre l'accent musical, qu'une langue
ait réglé grammaticalement la quantité de ses voyelles, tandis
que l'autre ne l'a pas fait entrer dans son système phonologique.
La qualité des articulations employées peut aussi être
déterminée par des motifs psychiques. Telle langue emploie
de préférence des voyelles claires, comme l'italien, telle autre
multiplie les consonnes et assourdit volontiers l'élément vocalique
de ses syllabes, comme l'allemand. Pourquoi ? Est-ce
une illusion de penser que cela correspond à la différence
psychique qu'on constate entre ces deux peuples ; l'un vivant
en dehors de lui-même, aimant la couleur et tout ce qui
frappe les sens ; l'autre attaché davantage à l'aspect intellectuel
et subjectif des choses ? Que ces deux types psychiques
soient à leur tour déterminés par les conditions de la vie, le
climat, la nature ambiante, cela ne change rien à la chose.
Si notre hypothèse est vraie, le fait phonologique a un aspect
mental. Resterait à faire voir comment ; car la simple intuition
d'une correspondance ne suffit pas à la science ; elle la
158commence, mais pour que la science soit achevée il faut que
cette correspondance soit ramenée à ses lois.
Il ne faut pas oublier cependant que les règles phonologiques
sont conventionnelles ; elles existent de par la tradition,
de telle sorte qu'il serait faux de conclure immédiatement et
sans appel de la qualité des sons employés au type psychique
de l'individu ou même de la collectivité qui parle. Cependant
lorsqu'une convention est devenue régnante en phonologie —
par exemple lorsque l'accent d'intensité s'est fixé d'une certaine
façon — , cela a été la plupart du temps, pour ne pas
dire toujours, l'effet d'une impulsion interne, et en gros la
nature du système phonologique employé par une collectivité
nous renseignera, par quelques-uns de ses caractères
du moins, sur les dispositions psychiques de cette collectivité.
La relation de correspondance n'est pas immédiate
comme en morphologie. Il y a identité entre la forme de
la pensée et celle de la grammaire ; quand la forme de la
pensée tend à se modifier, elle entraîne après elle la forme de
la grammaire. Le type psychique d'un individu se trahit nécessairement
dans sa morphologie individuelle ; il ne se dévoile
pas si directement dans les sons qu'il emploie ; car il
s'agit là de l'élément conventionnel du langage, et la divergence
entre l'acte psychique et l'acte matériel ne nuit pas à
l'expression et à la compréhension de la pensée.
Par contre les dispositions psychiques qui tendraient à
modifier le système phonologique se font sentir immédiatement
sur les sons, sur leur articulation et leurs autres caractères,
en tant qu'ils peuvent être modifiés par les facteurs
extragrammaticaux. C'est dans ce domaine plus restreint
qu'on étudiera avec fruit l'influence des impulsions psychologiques
sur les sons du langage. Par cette étude on fournira
du même coup l'explication rationnelle de toutes les
manifestations concrètes du langage relativement à leur
qualité matérielle. On y verra comme en morphologie la
résultante d'un facteur grammatical — le système phonologique
— et des facteurs extragrammaticaux ; et en même
159temps on aura obtenu toutes les données nécessaires pour
entreprendre d'expliquer les évolutions des sons.
C'est ainsi qu'en morphologie comme en phonologie, nous
sommes arrivés au seuil des sciences évolutives. En parcourant
le programme des sciences statiques, nous avons en outre
donné une description générale de l'objet de ces sciences.
Nous connaissons dans leurs principaux caractères ces états
de langage que les disciplines ultérieures vont nous montrer
entraînés par leur vie même dans un mouvement de transformation
constante.
Avant de passer à ce nouveau sujet nous ferons une dernière
remarque. Nos lecteurs nous demanderont peut-être
en quoi les sciences statiques que nous venons de décrire se
rattachent à la psychologie collective. Nous avons sans cesse
fait appel à la logique, à la psychologie individuelle, à la
physiologie ; mais rien encore ne nous a fait prendre contact
avec cet agent collectif, ces actions et ces réactions des individus
les uns sur les autres, qui est l'objet spécial de la psychologie
collective.
Il est certain qu'il en est ainsi ; la linguistique statique se
rattache à la psychologie collective par son objet, mais non
par sa méthode. Le langage organisé est un produit de cet
agent collectif ; toute discipline qui a la grammaire pour
objet, se rapporte donc à la psychologie collective. Mais la
morphologie statique et la phonologie sont incapables à elles
seules de fournir une explication complète des phénomènes
qu'elles étudient. Cette incapacité vient justement du fait
qu'en éliminant dans l'étude de son objet les relations dans
le temps, elles éliminent cet agent collectif lui-même. En abordant
l'étude de la genèse et ses évolutions de la langue, nous
retrouvons cet objet sous un aspect plus complet et plus
vrai ; nous entrons définitivement dans la psychologie collective,
et nous aurons désormais à nous servir de ses méthodes.160
Chapitre XIII
Emboîtement de la Phonétique dans la
Morphologie évolutive.
Avant d'exposer le programme de la linguistique évolutive,
nous devons examiner si le principe d'emboîtement appliqué
aux disciplines statiques est également correct ici, et
si par conséquent on doit mettre la morphologie évolutive
avant la phonétique.
L'analogie le réclame, et il semble que nous pourrions
nous contenter de répéter ce que nous avons dit dans l'avant-dernier
chapitre, en y apportant quelques modifications appropriées.
Mais il n'en est pas ainsi. La justification de ce
principe d'emboîtement soulève des discussions importantes.
Nous rencontrons sur notre chemin une série d'objections,
et nous ne saurions y répondre sans traiter divers problèmes
aussi à fond que possible. Nous sommes donc obligé de consacrer
de nombreuses pages à cette question préliminaire.
On pourrait établir l'emboîtement de la phonétique dans
la morphologie évolutive en montrant qu'il est une simple
conséquence logique de ce que nous avons dit au sujet des
sciences statiques correspondantes. Si toute forme grammaticale
est assimilable à une formule algébrique composée de
termes dont la qualité est conventionelle, il semble bien que
le remplacement d'une formule par une autre puisse se faire
en tous cas se comprendre, sans que la qualité des termes
161employés entre en ligne de compte. En outre, si la phonologie
a pour règle suprême de servir aux fins du langage dans les
formes prescrites par la morphologie, il paraît évident que
les changements phonologiques doivent se subordonner aux
changements morphologiques.
Mais cette déduction abstraite a besoin d'être confirmée
par un examen plus minutieux des phénomènes d'évolution
linguistique tels que la nature nous les offre. Nous pourrons
voir si les caractères constants de l'emboîtement s'y présentent.
Il va sans dire que l'évolution de la langue considérée sous
son aspect phonétique, constitue un phénomène plus concret
que l'évolution morphologique, c'est-à-dire celle des valeurs
et des procédés. Le troisième caractère de l'emboîtement se
constate donc sans peine. Ce sont les deux premiers qui sont
plus difficiles à établir. Il semble en effet que l'évolution
phonétique puisse exister en dehors de toute évolution morphologique,
qu'elle puisse être intelligible sans elle, et que
par conséquent tout notre échafaudage théorique soit ici en
défaut. Il est évident par exemple qu'une transformation phonétique
comme celle du « l » du vieux français, qui, en fin de
syllabe et devant consonne, a donné un « u » diphtongué avec
l'élément vocalique précédent (vx fr. talpe > fr. mod. taupe),
il est évident, disons-nous, qu'une telle transformation n'est
pas nécessairement liée à une transformation dans quelque
règle de syntaxe. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce
n'est qu'une apparence, qui se dissipe quand on regarde au
fond des choses. Nous disons que la transformation morphologique
est autonome, peut exister seule et est parfaitement
intelligible sans l'intervention d'aucun facteur phonétique,
tandis que tout phénomène d'ordre phonétique considéré
dans son ensemble et dans ses causes, tout ce qui contribue
à modifier les éléments conventionnels de la grammaire, réclame
pour être rationnellement expliqué, l'intervention de
motifs d'ordre morphologique.162
Notre démonstration se divisera naturellement en deux
parties distinctes. Dans l'une nous considérerons les évolutions
morphologiques, dans l'autre, celles qui concernent les
sons.
Première partie : Les Evolutions morphologiques.
Relativement aux évolutions morphologiques, nous prétendons
que non seulement elles se comprennent sans l'intervention
de facteurs d'ordre phonétique, mais que même il est
impossible de concevoir que dans leur principe elles soient
accompagnées de quelque modification des sons. Par définition,
elles se produisent quand les sons ne changent pas.
Comment se crée un nouveau procédé grammatical ? De
toutes pièces, d'une manière raisonnée et arbitraire ? Non,
sans doute. Ceux qui parlent veulent être compris, et pour
cela ils s'en tiennent toujours à des procédés d'expression
qui leur semblent intelligibles, c'est-à-dire déjà admis par
la collectivité, grammaticalement existants — nous faisons
abstraction ici des procédés extragrammaticaux, dont l'emploi
et l'intelligence reposent sur un autre principe. Si les
individus possèdent dans leur grammaire propre des éléments
particuliers, des traits spéciaux qui sont étrangers
à la collectivité, c'est toujours à leur insu. Quant à inventer
spontanément quelque chose de conventionnel, cela se peut
à la rigueur en lexicologie ; on invente et on propose un mot,
parce qu'on l'accompagne d'une définition quand on s'en
sert pour la première fois ; mais en syntaxe, cela n'est pas faisable.
Il en résulte que dans la règle, toute innovation en ce
qui concerne la « forme » du langage est soumise à ce qu'on
pourrait nommer la loi de création inconsciente.
Cette création ne peut pas exister quand le sujet est actif,
et qu'il met en œuvre dans la parole les moyens dont il dispose.
Là le sujet ne peut qu'obéir aux dispositions acquises
qui constituent sa grammaire, tout en cédant aux impulsions
163affectives du langage spontané. Si sa pensée est forte et originale,
son parler en portera les traces ; mais tous les éléments
en seront pourtant empruntés à l'une ou à l'autre de
ces deux sources, et c'est dans leur combinaison que l'originalité
se fera sentir. Ce qui serait création pure, innovation
dans l'ordre de la convention grammaticale, choquerait celui
qui parle le tout premier. Il s'empresserait de s'en corriger
lui-même, comme d'une erreur qui obscurcit le sens de ses
paroles.
La création inconsciente peut par contre fort bien exister
quand le sujet est passif, ou du moins croit l'être, dans la
compréhension. Cette passivité n'est que relative ; le sujet
écoutant intervient avec son intelligence pour analyser ce
qu'il écoute et attribuer à chaque partie sa valeur significative.
Il faut non seulement qu'il perçoive les symboles, mais
aussi qu'il les aperçoive, qu'il les discerne et les assimile à
leur idée grammaticale. Est-on bien sûr que le résultat de
cette analyse correspondra toujours à ce qui aura été pensé
par le sujet parlant, que la « forme » qu'on attribuera à
chacune de ses phrases, sera justement celle qu'elles auront
eue dans sa conscience intellectuelle ? A supposer même que
le sens total de ce qui a été compris corresponde exactement
au sens total de ce qui a été dit — ce qui n'est pas nécessairement
le cas — il peut y avoir une différence plus ou moins
grande dans la valeur attribuée à chaque partie, et si cette
différence d'attribution porte sur des idées de relation, il
faudra généralement qu'une ou plusieurs autres transformations
complémentaires viennent rétablir l'équilibre logique
de la phrase.
Du moment que l'analyse que l'on fait d'une phrase, n'est
pas nécessairement conforme à la synthèse qui lui a donné
naissance, tous les éléments de ladite phrase, quelles que soient
leur nature et leur origine, peuvent être appelés à se voir
attribuer un rôle grammatical. Des éléments phonologiques,
des fragments de symboles qui n'avaient à leur origine aucune
valeur propre, des relations d'ordonnance, des sons et
164des accents qui étaient dus à l'action inconsciente des impulsions
extragrammaticales, toutes ces choses peuvent être
prises pour les symboles convenus de certaines valeurs ; et
ces valeurs, ce sont celles que contient implicitement l'idée
totale, telle que l'auditeur la comprend, et non pas celles
que son interlocuteur a exprimées par ses propres moyens
grammaticaux.
Remarquez en outre que pour attribuer à un signe une
valeur grammaticale, pour y voir un symbole, il n'est pas
nécessaire que ce symbole existe déjà dans ma grammaire à
moi. Je crée en attribuant à celui que j'entends, la grammaire
dont je crois reconnaître les éléments dans sa parole ;
c'est un phénomène d'intuition, et cette grammaire, qui au
fond est de mon invention, je l'adopte pour moi-même en me
basant sur l'autorité de la personne à laquelle je l'ai gratuitement
attribuée. Je me dis : puisqu'un tel parle comme cela,
c'est donc ainsi qu'« on » parle.
Voici quelques exemples qui nous permettront de montrer
comment la chose se passe.
Notre locution française : il ferait beau voir signifiait à
l'origine quelque chose comme : cela ferait un beau spectacle ;
voir y joue le rôle d'un substantif, et beau est son adjectif.
Un jour, quelqu'un qui l'a entendue l'a analysée autrement et
y a vu l'emploi d'un verbe impersonnel faire beau, dont le
sujet logique voir reprenait sa valeur verbale et était représenté
par il. Ce quelqu'un n'a pas cru faire du nouveau,
et pourtant il a été, sinon le seul, du moins le premier initiateur
d'une transformation syntactique aujourd'hui, pensons-nous,
généralement admise.
En vieux français on disait également : de part le roi, et
l'on entendait par là : de la part du roi ; l'absence de l'article
devant le mot part et l'emploi du cas régime le roi dans le
sens du génitif sont entièrement conformes au vieil usage.
A partir d'un certain moment, et sans changer de sens global,
cette locution a été analysée et interprétée tout autrement :
165de part est devenu de par, préposition composée comme
dedans ou dessous, et le roi est devenu le substantif régi par
cette préposition.
Dans d'autres cas c'est un seul mot de la phrase qui change
de valeur, sans que sa relation logique avec les autres termes
en soit modifiée. Quand une personne en entendant dire :
ils étaient à table, comprend qu'on veut exprimer par là
l'idée de : ils prenaient leur repas, elle est amenée à attribuer
au mot table un sens qu'il n'avait peut-être pas encore pour
elle. C'est une innovation morphologique dans le domaine
du lexique (nous rappelons que selon nous le lexique est le
premier élément de la forme du langage, p. 111). La relation
entre la forme de la phrase et la pensée globale a été transformée ;
un élément de cette pensée qui n'était point directement
exprimé, l'idée du repas, a trouvé son symbole.
C'est au contraire un élément extragrammatical qui est
transformé en symbole, lorsqu'un auditeur a pensé que
la position réciproque des deux mots : viens-tu ? était le signe
caractéristique de l'interrogation. A l'origine, ces deux termes
s'ordonnaient au gré de l'impulsion du sujet parlant, et
c'était pour des motifs dont la psychologie individuelle pourrait
rendre compte — peut-être la mise en évidence du sujet,
qui dans cette ordonnance porte un accent propre — , que
dans le plus grand nombre de cas, le pronom était mis après
le verbe dans l'interrogation. On comprend qu'on en soit
venu à voir dans ces deux mots juxtaposés un composé à
valeur spécifiquement interrogative. Désormais une nouvelle
règle de grammaire était née.
Le phénomène est plus curieux et plus complexe encore
quand il s'agit de la troisième personne du singulier. On a
des preuves — nous les indiquerons plus loin — que dans la
forme : vient-il ? ce n'est pas seulement la postposition du
pronom qui constitue le symbole de l'interrogation, mais la
syllabe -t-il tout entière, qui joue le rôle d'une sorte de
suffixe de flexion. On voit que ce nouveau suffixe est formé
non seulement du pronom mais encore d'un élément phonologique,
166le t, qui se trouve ainsi englobé par contact dans
un nouveau symbole auquel il était à l'origine parfaitement
étranger.
Ces exemples sont schématiques, parce que nous ne pouvons
entre l'état ancien et l'état nouveau que reconstituer
par hypothèse ce qui a dû se passer, et concentrer ce phénomène
d'évolution dans un seul fait hypothétique et complet,
alors que dans la réalité il a été fait d'une multitude de phénomènes
moins complets, moins nettement définis, mais qui
ont tous concouru à la même fin. En pratique, il faut renoncer
à reconstituer historiquement le début et le développement
d'une transformation de ce genre ; il faut s'en tenir à des
schémas comme ceux que nous avons présentés, et qui sont
parfaitement suffisants pour la compréhension rationnelle.
Ceci étant, nous constatons que c'est la même phrase tantôt
prononcée, tantôt entendue, mais toujours identique
comme qualité de son, d'intonation, etc., qui a été conçue
d'une manière par l'un et analysée différemment par l'autre.
Il ferait beau voir, de part le roi, ils étaient à table, viens-tu ?
vient-il ? n'ont été changés en rien extérieurement ; ces
phrases n'ont fait que passer de la bouche d'un sujet parlant
à l'oreille d'un auditeur, et cependant la forme n'est
plus la même ; le nombre, la valeur des symboles et leurs
relations avec les parties de la pensée totale, ont été modifiés.
On voit donc bien que dans son principe, la transformation
morphologique se fait sans que l'élément matériel de la phrase
subisse aucun changement. Qu'en est-il dans la suite ? Car
nous avons ici le point de départ de l'évolution, mais non pas
l'évolution tout entière. Il est facile de se représenter comment
l'évolution grammaticale qui s'impose à la collectivité,
naît de ces variations individuelles dans l'analyse des phrases.
Les symboles ou les règles qu'un homme a ainsi créés en pensant
les trouver dans le langage de son semblable, sont naturellement
adoptés par lui au même titre que toutes les autres
parties de la grammaire. Ils prennent place parmi les dispositions
167grammaticales de cet homme, et celui-ci à son tour en
fera usage en parlant.
C'est par l'emploi qu'il en fera, que leur existence se manifestera
et deviendra objectivement sensible. Par exemple,
pour continuer notre démonstration schématique, celui qui a
conçu il ferait beau voir à la nouvelle manière, ne dira pas :
il ferait bel être à la montagne, comme il dit : un bel être, un
bel esprit, etc., mais : il ferait beau être à la montagne, ou même
plus simplement : il ferait beau à la montagne, l'adjectif
beau n'ayant en effet plus aucun besoin de s'appuyer sur un
infinitif employé substantivement. La même personne se laissant
diriger par l'analogie de certaines locutions impersonnelles
comme il est beau, qui se construisent avec l'infinitif
précédé par la préposition de (il est beau de mourir pour sa
patrie), en viendra facilement à dire : il ferait beau de voir
que… et ainsi de suite. De part devenu de par change aussi
un peu de sens et d'emploi, car on tend naturellement à en
faire un synonyme de par, et l'on dira par exemple : de par
la force des choses, de par la tradition, pour dire : par la
force des choses, en vertu de la tradition.
Quand on donne à table le sens de repas, on n'a aucun
scrupule à dire : faire des excès de table, avoir une bonne table,
etc. On reconnaît l'existence réelle du suffixe -t-il, dont nous
avons parlé à propos de vient-il ? par le fait qu'on a créé la
forme aime-t-il ? qui a supplanté le plus ancien et plus correct
aime-il ? Dans le peuple on a même attribué à ce suffixe
une valeur interrogative, abstraction faite de toute détermination
de personne ou de nombre ; on entend des choses
comme : j'ai-ti soif ? nous avons-ti bu ? On connaît aussi
notre locution : voilà-t-il pas ?
C'est ainsi que chacun trahit dans son langage les règles
de sa morphologie et par conséquent les propose aux autres.
Naturellement sur bien des points les grammaires individuelles
se contrarient. Il y a des cas où les particularités
contradictoires peuvent subsister les unes à côté des autres ;
elles ne gênent pas la compréhension réciproque. Mais il y
168en a d'autres où il est nécessaire qu'une accommodation se
fasse. Si un individu se trouve seul en opposition avec la collectivité
tout entière, il sentira bientôt qu'il est loin de
compte, et tout naturellement il se corrigera lui-même et
rentrera dans le rang. Mais s'il arrive au contraire qu'à la
faveur des circonstances, la même création surgisse coup sur
coup et de toutes parts, alors les initiatives individuelles, au
lieu de se heurter à l'inertie collective, s'entr'aident, s'appuient
et se renforcent mutuellement, et finissent par l'emporter
sur toutes les résistances : la règle, la forme nouvelle
s'impose au langage.
Tout ce travail se fait inconsciemment. Psychologiquement
parlant, il s'agit d'associations qui se forment et d'autres qui
se désagrègent sous l'influence d'associations plus fortes. A
côté des idées claires dont nous disposons, nous en avons
une quantité qui sont comme des ébauches d'idées. Celles-ci
reposent sur de vagues associations qui sont combattues par
d'autres ; mais dans certaines conditions elles peuvent à un
moment donné se préciser, devenir claires. Ce qui est vrai
pour nos idées en général, l'est aussi pour la grammaire ;
chaque symbole est une idée grammaticale, et de même qu'il
y a un domaine obscur d'idées en formations, des « limbes
de la pensée », il y a aussi dans les dispositions cérébrales
acquises de chacun des « limbes de la grammaire », des idées
grammaticales embryonnaires qui ne demandent qu'à naître.
Les analyses nouvelles que nous faisons des phrases entendues,
ne font le plus souvent que rendre actuelles et claires
des associations déjà existantes dans une certaine mesure,
mais qui n'attendaient que l'occasion pour s'affirmer. Si j'analyse
par exemple la locution : il ferait beau voir comme nous
l'avons dit, c'est qu'elle me fait penser à il est beau de
mourir, etc., et peut-être aussi à il fait beau pour dire :
il fait beau temps. Tous ces cas joints ensemble m'ont préparé
à voir dans le groupe il fait beau un verbe impersonnel.
Il est évident aussi que grâce au grand nombre de cas où
169pour des raisons purement psychologiques, l'interrogation
était exprimée avec inversion du sujet, une association latente
se créait spontanément entre cette forme et ce sens, et
qu'il fallait fort peu de chose pour transformer cette association
spontanée en une association grammaticale faisant
règle de langage.
Cette transformation se produit d'abord dans l'analyse des
phrases, puis elle se fixe, s'objective par l'emploi que l'on fait
de la nouvelle règle dans le parler individuel, et c'est là, par
le heurt et la concurrence qu'elle est mise à l'épreuve, et que
l'on voit si elle est capable de s'imposer à la collectivité.
Tel est le mécanisme de l'évolution morphologique ; reste
à dire quel en est le principe directeur. Ce principe ne saurait
être autre chose qu'une adaptation de plus en plus
étroite du système morphologique à la fin intellectuelle du
langage, et de son type, de ses caractères, au type psychique
de la collectivité qui s'en sert, et dont le langage doit suivre
les évolutions et les progrès dans l'ordre mental. Nous avons
dit et répété que la morphologie est la forme même de la
pensée, qui n'en connaît pas d'autres. Mais la pensée, qui est
un acte souvent très complexe de l'être psychologique tout
entier, ne se laisse pas enfermer complètement dans les
formes que lui fournit le système grammatical. Ce système
est souvent imparfait au point de vue logique, et les besoins
de l'intelligence auxquels il ne donne pas satisfaction, subsistent
à côté de lui à l'état de tendances. Il est surtout incapable
de traduire tout le contenu de la vie psychique avec
ses modes divers infiniment variés et complexes. Tout cela
s'exprime d'une façon spontanée, mais sans précision, par
les facteurs extragrammaticaux, et tend, comme tout le
reste, à trouver son expression constante, claire, grammaticale.
La puissance par laquelle l'homme a dû un jour
créer son langage, est sans cesse active, et tout ce qui vit en
lui travaille à se fixer, à devenir conscient dans un symbole.
Parmi les milliers d'associations vagues qui se font et se
170défont en lui par l'exercice de la parole, dans ces limbes de
l'intelligence et de la grammaire dont nous avons parlé, il
s'attache naturellement de préférence à celles qui répondent
aux besoins les plus ressentis de son intelligence ou de sa
vie affective. Toutes celles qui acquerront assez de force pour
entrer dans les grammaires individuelles par la porte que
nous avons dite, seront des associations qui répondent de
quelque manière aux tendances psychologiques de l'individu ;
et celles qui entrant dans l'usage, triomphent de toutes les
concurrences et s'imposent aux collectivités, obtiennent ce
succès parce qu'il y a une correspondance intime et directe
entre la forme de la pensée qu'elles réalisent et les tendances
psychiques de la collectivité qui les adoptent. Par exemple
la transformation que nous avons citée de de part le roi en
de par le roi, n'est qu'un épisode spécial au sein d'une
transformation plus générale. La langue obéissant à une impulsion
d'ordre intellectuel, a évolué vers l'analytisme, l'article
est devenu l'accompagnement obligé de tout substantif,
et le génitif exprimé par de a subsisté seul. L'habitude a
conservé longtemps, il est vrai, et conserve encore des
manières de parler contraires à ces nouvelles règles, mais la
langue opère à leur égard un travail continu bien que lent, de
réduction ou d'élimination dont nous ne pouvons étudier
tous les procédés. Nous en constatons ici un cas : une locution
dont la structure ne répondait plus aux habitudes syntactiques
de la langue, a reçu par une sorte de jeu de mot, de
malentendu, une interprétation nouvelle. Il en est ainsi dans
tous les cas ; aucune de ces transformations ne se fait au
hasard. L'ensemble de toutes celles qui s'imposent à l'usage
constitue le perfectionnement, l'évolution de la langue.
La structure morphologique d'une phrase prise dans sa
forme abstraite se comprend directement, nous le savons,
comme l'expression d'une forme de la pensée. Si l'on se rend
compte maintenant du manque de correspondance qu'il peut
y avoir entre cette forme de pensée que la grammaire impose
et le véritable contenu de la vie psychique, si l'on a
171l'idée enfin de l'autre structure possible qui serait mieux
adaptée à ce qui tend à s'exprimer, on aura la clef des évolutions
morphologiques. Et ce que nous disons ici d'une
phrase, on peut l'appliquer aussi au système tout entier de
la langue qui doit évoluer au fur et à mesure qu'il a à répondre
à de nouveaux besoins, à de nouvelles tendances.
C'est donc une science de la forme qui existe en dehors de
la qualité des sons, et qui en est entièrement indépendante.
Ce n'est pourtant pas à dire que la pensée modifie la grammaire
à son gré, que les formes nouvelles naissent spontanément
et sans être conditionnées autrement que par le
besoin auquel elles ont à répondre, et que, ce besoin existant,
elles doivent surgir immédiatement. Non, les impulsions
psychiques qui commandent l'évolution morphologique, ne
jouissent que d'une liberté restreinte ; mais cela n'en est
pas moins une liberté, parce qu'elles ne peuvent pas être
comprimées et que tôt ou tard elles doivent l'emporter.
L'évolution morphologique ne leur obéit pas toujours immédiatement,
mais au moins n'obéit-elle jamais qu'à elles.
Les tendances psychiques qui surgissent n'ont, disons-nous,
qu'une liberté restreinte de se traduire dans des formes
nouvelles. Cela ressort de tout ce que nous venons d'exposer.
Une phrase construite grammaticalement d'après une certaine
règle, est analysée d'après une règle nouvelle ; encore
faut-il qu'elle s'y prête, que ses éléments puissent donner
lieu à ces associations encore vagues qui, à son occasion,
vont surgir plus clairement devant la conscience et s'imposer
à l'esprit. L'évolution emprunte par conséquent tous ses éléments
à la langue même qu'il s'agit de transformer. On peut
dire, si l'on veut, que la langue actuelle est la cause matérielle
de l'évolution de demain. Aucun phénomène de transformation
morphologique ne se produit autrement qu'à la faveur
d'une circonstance favorable. C'est l'occasion qui la produit,
elle ne naît pas spontanément. Cela découle directement du
principe de création inconsciente exposé plus haut.172
Remarquons cependant que dans le langage actuel, ce qui
conditionne l'évolution morphologique, ce sont d'une part
ses éléments extragrammaticaux et d'autre part sa « forme »
grammaticale. On peut ici encore faire entièrement abstraction
de la qualité matérielle des sons conventionnels qui sont
en jeu. Il est évident que si la phrase : il ferait beau voir,
avait été composée de mots entièrement différents de son,
mais identiques de valeur, la transformation aurait pu tout
aussi bien se produire, et que la qualité phonologique du
suffixe t-il dont nous avons raconté les destinées, n'importe
nullement à l'affaire. Seulement il faut avoir bien soin d'entendre
ce terme de « forme » dans son sens le plus vaste, et
d'y faire entrer toutes les associations d'idées, même les plus
subtiles, qui existent à quelque titre dans le cerveau des sujets
parlants et entendants. Nous avons vu, en effet, que ces associations
vagues, parfois impondérables, sont les matériaux
dont sont faites toutes les innovations grammaticales. C'est
ainsi qu'il faut considérer comme un élément de la « forme »
du langage, la ressemblance existant en français entre les
deux mots part et par, ressemblance qui est la cause d'une
association d'idées, et par conséquent d'une assimilation
possible.
Prenons un autre exemple : le pluriel grec βιβλία signifiant
« la collection des livres sacrés », a donné un féminin singulier
latin : Biblia, dont toutes les langues modernes ont
hérité : la Bible, die Bibel, etc. Ce changement, qui d'ailleurs
est commandé par un motif psychique — l'idée de l'unité
des livres sacrés prenant le pas sur celle de leur diversité — ,
s'est fait à la faveur de l'association naturelle que crée entre
le neutre pluriel et le féminin singulier l'identité de
leurs désinences 120. Cela a été l'occasion favorable grâce à laquelle
l'idée prédominante a trouvé son expression.173
Or nous disons que de telles associations, qu'il s'agisse des
deux mots part et par ou des deux désinences de flexion en
-ă, peuvent fort bien être pensées en dehors de la qualité
matérielle des sons qui leur servent de point d'appui. C'eût
été par exemple dans le dernier cas un « o » ou un « i » plutôt
qu'un « a », que le phénomène psychologique et grammatical
n'en aurait été aucunement changé. Ce qui nous intéresse, c'est
uniquement l'identité ou la ressemblance des termes en présence,
et les conséquences que cet état de chose comporte
dans la pensée des sujets parlants. Et cela, disons-nous, fait
partie de la « forme » du langage ; ce n'est pas un élément
matériel, mais un élément psychique de la parole.
La science historique et descriptive, quand elle voudra
rendre compte des évolutions qu'elle enregistre, aura à montrer
dans chaque cas, comment l'état acquis du langage a
fourni l'occasion propice à la transformation morphologique ;
mais ce sont les données empruntées à la science théorique
de la forme, qui permettront de définir l'ancien état de chose,
de montrer en quoi il était insuffisant, de faire voir en outre
quel était le procédé grammatical qui devait mieux répondre
aux besoins de ceux qui parlaient, et de dire enfin comment
et par quelles opérations psychologiques ce nouveau
procédé grammatical a été substitué à l'ancien à la faveur de
l'occasion propice.
Les opérations psychologiques qui entrent en ligne de
compte dans ces phénomènes d'évolution, ne sont pas infiniment
174variées. Les lois de l'activité psychique et les conditions
d'existence du langage organisé étant connues, on en peut
conclure, sous le contrôle de l'observation, aux formes typiques
et aux procédés essentiels qui régissent toute transformation
morphologique. Dans un autre chapitre nous dirons
quelque chose du programme de cette science. Ici, nous avons
voulu seulement montrer que les phénomènes de l'évolution
morphologique n'ont pas de causes ni de lois en dehors de ce
qui constitue la forme du langage, et que par conséquent ils
étaient indépendants de l'évolution phonétique. Ils existent
en dehors d'elle et sont intelligibles sans elle.
Cette autonomie des évolutions morphologiques a été souvent
mise en doute. On a prétendu qu'elles recevaient leur
loi de certaines transformations d'ordre phonétique. De nombreux
linguistes ont affirmé qu'il y avait des changements
survenus dans la syntaxe dont la cause devait être cherchée
dans les lois qui règlent l'évolutions des sons. Par l'effet de ces
lois, les éléments caractéristiques des mots ont été effacés, et
l'on a été obligé de créer de nouveaux procédés d'expression
pour remplacer les anciens devenus inefficaces. Nous verrons
bientôt ce qu'il faut penser de ces lois phonétiques, dont l'action
est représentée comme obéissant à un déterminisme fatal.
Nous constatons seulement que présenter les choses
comme ci-dessus, c'est faire une hypothèse absolument contraire
à notre principe de la création inconsciente. Peut-on
se représenter ce que cela veut dire, quand on affirme que la
langue crée un procédé syntactique pour en remplacer un
autre tombé en désuétude ? Cela suppose l'idée claire d'une
lacune laissée par quelque chose qui aurait existé et qui
n'existerait plus, et une délibération sur les moyens de combler
cette lacune, deux choses absolument en dehors de
toute vraisemblance psychologique.
Mais les faits eux-mêmes protestent contre de telles théories.
175Ce sont là des explications hâtives et superficielles qui
n'expliquent rien du tout. Ceux qui les ont données seraient
arrivés à des conclusions diamétralement opposées, s'ils
avaient examiné les choses d'assez près, comme nous allons le
montrer par un exemple.
On a dit que la loi de la chute des finales non accentuées
a causé l'effacement des flexions nominales en roman, et que
celui-ci a provoqué la création de nouveaux moyens syntactiques :
l'emploi de certaines prépositions et la position fixe
attribuée au sujet et au régime relativement au verbe.
Or, pour ce qui concerne l'usage des prépositions, chacun
sait qu'il est bien antérieur à la chute de la flexion. Les prépositions
sont déjà en usage en latin classique, et leur emploi se
combine avec celui des cas ; seulement dans le latin populaire
l'emploi de celles qui devaient remplacer les cas se généralise
peu à peu. On a dit de patre à côté patris, ad filium à côté
de filio, in tempore à côté de tempore. Cela suppose que la
flexion comme système de forme existait encore parfaitement,
seulement son rôle était réduit à celui d'une doublure assez
inutile de la préposition, qui exprimait clairement à elle
seule la relation casuelle. Aussi en vint-on bientôt à construire
toutes les prépositions avec un seul et même cas,
le plus souvent avec l'accusatif. Il fut un temps où l'on
pouvait entendre de patrem à côté de patre, cum patrem et
cum patre, etc. C'est l'époque où les demi-lettrés qui imitent
les auteurs classiques, confondent toutes les formes casuelles,
et font indifféremment des génitifs, des accusatifs ou des
ablatifs absolus 121. Longtemps avant que le souvenir des divers
cas obliques du latin ait disparu, leur valeur propre
était oubliée. Leur rôle avait été pris entièrement par la
préposition, et c'est leur inutilité, le fait qu'ils constituaient
pour la grammaire une complication superflue, qui a entraîné
leur disparition 222.176
De tous les cas obliques l'accusatif seul subsista donc, et le
roman n'eut plus qu'une déclinaison à deux cas : nominatif
ou cas sujet, accusatif ou cas régime. Mais cette déclinaison
rudimentaire devait disparaître, elle aussi. L'existence des
deux cas permettait de distinguer le sujet du régime direct
dans des phrases ou l'un et l'autre étaient représentés par
un substantif ; c'était un procédé un peu compliqué, car la
flexion n'était rien moins que régulière et logique dans ses
formes. Les langues romanes l'ont remplacé par un autre
beaucoup plus facile et plus clair, qui consiste à mettre le
sujet devant le verbe et le régime après.
Comment cette transformation s'est-elle opérée ? On
peut en étudier l'histoire d'une façon très précise en français,
le remplacement d'un procédé par l'autre s'étant produit
en pleine période littéraire, au XIVe siècle. On voit
s'établir à une époque très ancienne la règle d'après laquelle
le verbe se met à la seconde place ; puis entre les deux ordres
possibles : régime, verbe, sujet et sujet, verbe, régime, on
remarque que la langue, après avoir eu d'abord une préférence
très accentuée pour le premier ordre, passe insensiblement au
second, qui devient enfin usuel dans la grande majorité des
cas. Cette transformation se fait sans que la flexion du nom
soit en cause. Joinville, qui écrit au seuil du XIVe siècle et
qui décline ses substantifs correctement, ne met le régime
devant le verbe que dans le 11 % des cas, suivant une statistique.
C'est dire que l'ordre inverse est déjà devenu presque
régulier. Après lui se produit très rapidement la décadence
de la flexion, qui se constate dans les ouvrages de l'époque,
d'abord par un emploi arbitraire des formes du cas sujet et
du cas régime, sans souci de leur valeur, puis par l'élimination
de la forme du nominatif au profit de celle de l'accusatif.
Naturellement nous ne pouvons observer directement le
phénomène que dans la langue écrite, mais il n'en reste pas
moins clairement établi qu'au moment où la flexion a disparu,
son substitut était déjà trouvé. Les auteurs auront par tradition
littéraire conservé plus longtemps que le peuple des
177formes fléchies dont ils ne comprenaient pas la valeur ; à
cela près on peut conclure de leur usage à celui du parler populaire,
et admettre que le cas sujet a commencé à disparaître
à partir du moment où son utilité n'a plus été ressentie.
Pourquoi l'usage s'est-il attaché au nouveau procédé,
l'ordonnance, plutôt qu'à l'ancien, la flexion ? Evidemment
parce qu'il y avait au point de vue logique un grand avantage
à préférer un procédé simple, uniforme, et d'ailleurs
dans beaucoup de cas, psychologiquement justifié, à un autre
purement conventionnel et compliqué dans son application.
La pensée n'a rien perdu à être débarrassée du soin de fléchir
le cas sujet et le cas régime suivant des règles un peu incohérentes
et parfois incertaines. Le progrès morphologique
est assez évident pour qu'il suffise à expliquer l'évolution.
Remarquons d'ailleurs qu'il est impossible de soutenir que les
causes phonétiques aient pu être déterminantes, quand on
voit que la langue au même moment où elle laissait disparaître
la distinction du nominatif et de l'accusatif, conservait
celle du singulier et du pluriel. Les romanistes savent bien
que la distinction phonique entre le nominatif singulier li rois
et l'accusatif pluriel le roi n'était à aucun égard moins nette
que celle entre l'accusatif singulier le roi et l'accusatif pluriel
les rois ; si l'« s » final était caduc dans ces formes, c'était au
même degré ; et à défaut de ce suffixe, l'article constituait
dans l'un et l'autre cas une marque caractéristique parfaitement
suffisante. Si donc ces deux formes : li rois et les rois
ont eu des destinées absolument différentes, c'est que leurs
conditions d'existence au point de vue de la morphologie
étaient tout autres ; l'une était nécessaire et l'autre ne
l'était pas 123.
On dira peut-être que si les évolutions phonétiques ne
commandent pas les évolutions morphologiques, elles y aident
du moins et contribuent parfois à les fixer ; que, dans le cas
qui nous occupe, l'affaiblissement du suffixe « s » par lequel les
178deux cas étaient différenciés, a forcé les sujets parlants ou
entendants à porter davantage leur attention sur l'ordonnance
et à lui attribuer une valeur grammaticale ; que ce « s »
ayant complètement disparu plus tard (il ne l'est pas encore
tout à fait d'ailleurs, puisqu'il subsiste dans la liaison), il a
rendu tout retour à l'ancien procédé impossible. Même sous
cette forme atténuée, nous ne pouvons concéder cette mainmise
de la phonétique sur la morphologie. En fait rien ne nous
indique qu'au XIIIe ou au XIVe siècle l'« s » final ait subi un
affaiblissement notable et général ; mais nous affirmons que
ce phonème n'a pu s'affaiblir, s'il l'a fait, que dans la mesure
où il était déjà morphologiquement indifférent.
Voici un autre exemple pour illustrer le même cas. Les
latins ont composé deux mots au vocatif en un seul nom
propre et disent Jupĭter là où les Grecs disent Ζεῦ πάτερ.
L'effet de cette composition a été que l'élément correspondant
au α grec, portant désormais un accent très faible a
pu se changer — suivant une règle phonétique d'application
générale — en un « i », et l'on pourrait dire que ce son « i »
étant devenu la marque de la composition, l'a fixée et l'a
rendue irrévocable. Par lui l'entière analogie entre le second
élément du mot composé et le mot păter, qui est son correspondant
latin à l'état isolé, est rompue ; il n'y a plus assimilation
complète de ce côté, et par conséquent il y aura unité
d'autant plus étroite à l'intérieur du mot Jupĭter.
Nous prétendons au contraire que la transformation phonétique
« a » > « i » n'a pu se faire que parce que la transformation
morphologique, la composition des deux éléments
dans l'esprit de ceux qui parlaient, était définitivement acquise.
Qu'on nous comprenne bien, nous ne disons pas que le
phénomène « a »>« i » est le produit phonétique d'une cause
morphologique ; les transformations de ce genre ont des causes
multiples, difficilement définissables, que nous essayerons
de déterminer plus loin. Nous disons seulement qu'aussi longtemps
que cette composition n'était pas chose faite dans
l'ordre intellectuel, l'analogie du mot păter devait résister à
179toute transformation phonétique dans le second terme du
mot composé, à l'exception, bien entendu, de celles qui auraient
atteint en même temps le motpăter lui-même. Nous
dirons plus loin quelques mots de cette puissance de l'analogie.
Tous ceux qui connaissent ses effets, savent que ce n'est
pas une légère déviation phonétique qui peut lui faire obstacle,
et qu'aussi longtemps qu'il y a pour un sujet parlant
une assimilation réelle entre le mot păter et le second élément
de Jupĭter, aucune puissance au monde ne peut l'empêcher
de donner à cet élément la qualité de son qui lui revient
de droit, et de la rétablir s'il y a lieu. Si on ne le fait
pas, c'est que l'assimilation est oubliée en faveur de la valeur
synthétique du nouveau composé. La composition est donc
chose faite, et la transformation phonétique n'y ajoute rien.
Ce qu'on peut dire seulement, c'est que le changement
acquis fait partie désormais de la cause matérielle de l'évolution
syntactique, et qu'il rend l'assimilation plus difficile, si
quelque sujet était tenté de la recréer par l'effet d'une association
d'idées.
Dans le phénomène que nous venons de décrire, une transformation
morphologique permet l'apparition d'un fait dans
l'ordre des sons. C'est tout simplement l'inverse de ce qui se
produit lorsqu'une transformation phonétique en se réalisant,
crée les conditions matérielles nécessaires pour une évolution
de syntaxe qui désormais peut se produire : ainsi quand la
chute du « t » final dans le substantif part vient rendre possible
son assimilation avec la proposition par. Dans un cas comme
dans l'autre, le premier phénomène ne fait que permettre le
suivant, et n'a aucune influence déterminante sur lui. Mais
tandis que le phénomène morphologique, qu'il vienne en premier
ou en second lieu, se comprend par lui-même et obéit à
des causes déterminantes d'ordre morphologique parfaitement
intelligibles, le phénomène phonétique, quelle que soit sa
situation vis-à-vis du fait morphologique auquel il paraît lié,
est déterminé par un ensemble de causes très difficiles à
discerner, et parmi lesquelles les motifs d'ordre morphologique
180entrent en ligne de compte comme nous essayerons de
l'établir.
En effet, la question générale posée en ses vrais termes est
celle-ci : est-ce qu'un sujet parlant peut perdre le contrôle
sur son langage et laisser la forme matérielle des symboles
qu'il emploie, se corrompre au point que le mécanisme grammatical
en souffre, et que la compréhension de son discours
en soit compromise ; en d'autres termes, les variations phonétiques
individuelles qu'on peut relever dans son langage, les
subit-il, ou bien les laisse-t-il passer comme étant indifférentes ?
Et puis une fois ces variations individuelles données,
variations compatibles avec les conceptions morphologiques
du sujet parlant, vont-elles imposer à la communauté
des conceptions morphologiques équivalentes, ou n'ont-elles
pas besoin plutôt d'être adoptées par elle, en vertu d'une certaine
harmonie, sinon dans les dispositions acquises, du
moins dans les tendances, entre celui qui parle et ceux
qui écoutent ? Nous admettons qu'un sujet parlant n'est jamais
forcé de subir une évolution phonétique en dépit des
exigences de sa grammaire, et que toute transformation de
cet ordre a besoin d'être adoptée par la collectivité, qui ne
choisit que ce qui est utile à la fin suprême du langage, l'expression
de la pensée, ou du moins ce qui est compatible
avec elle.
C'est une question de principe. Est-il possible d'admettre
que l'intelligence puisse abdiquer ses droits sur la grammaire ?
Nous avons bien reconnu que l'intelligence ne peut
modeler le langage dans lequel elle est elle-même comme emprisonnée,
que peu à peu, à la faveur de circonstances propices,
mais que ce langage, considéré dans sa forme grammaticale,
puisse dépendre d'autres causes que de ce qui concerne son
adaptation à la forme de la pensée, nous le nions, parce que
ce serait ouvrir la porte à tous les facteurs de désagrégation
qui agissent sur un organisme grammatical, et c'est renoncer
à comprendre comment la parole est et demeure au
service de la pensée. C'est la pensée qui l'a fait naître, c'est
181la pensée qui l'a fait vivre, et à travers toutes ses évolutions
morphologiques elle reste un fidèle miroir de la vie psychique
qu'elle recouvre. Cela suffirait à prouver que seules les causes
intellectuelles sont déterminantes au cours de cette évolution.
Nous nous résumons. L'évolution morphologique dans son
phénomène initial — le sujet entendant analyse une phrase
d'une façon qui n'est pas conforme aux intentions du sujet
parlant — , existe en dehors de toute évolution phonétique.
Dans ses principes directeurs et ses causes déterminantes, elle
est pensable à elle seule, et compréhensible par les seules lois
de l'adaptation de la forme du langage à celle de la pensée.
Bien qu'ayant sa cause matérielle dans le langage concret,
elle ne s'intéresse qu'à sa forme abstraite et est aussi indépendante
que la morphologie statique de la qualité conventionnelle
des sons mis en œuvre. Quand elle apparaît dans
l'histoire accompagnée de certaines transformations de sons,
elle n'en demeure pas moins autonome, et loin d'en recevoir
des lois, c'est elle qui les permet ou les favorise.
C'est dire que la discipline linguistique qui s'occupe de ces
phénomènes a toutes les qualités désirables pour être superordonnée
à celle qui, quittant l'abstrait pour le concret, traite
de la substance matérielle du langage et veut expliquer l'évolution
des sons. Mais notre démonstration qui s'est attachée
à faire voir les vrais caractères de l'évolution morphologique,
doit être complétée par une contre-partie où nous examinerons
ce qui concerne la phonétique, afin de voir s'il est vrai
que les phénomènes de son ressort ne peuvent être bien compris
qu'en les considérant comme emboîtés dans les phénomènes
d'ordre morphologique.
Deuxième partie : Les Evolutions phonétiques.
On comprend sous le nom de transformations phonétiques
bien des choses assez diverses, et nous nous voyons forcé,
182pour traiter ce sujet, de nous attarder un peu à des distinctions.
Il y a deux sortes de transformations de sons qu'il convient
de ne pas confondre : les transformations brusques, et
les transformations lentes. Dans la réalité qui n'offre guère
que des phénomènes complexes, ces deux sortes de transformations
se mélangent, et il peut sembler qu'il y ait entre ces
deux formes de l'évolution phonétique une transition graduelle
qui permet de les réunir dans une unité supérieure.
Tel n'est pourtant pas le cas, ce sont deux ordres de phénomènes
parfaitement distincts, comme il est facile de le montrer
en remontant à leurs principes respectifs.
Les transformations brusques ne changent rien aux lois
phonologiques reçues dans la forme de langage où elles apparaissent.
Un élément phonologique dans un mot est remplacé,
pour des causes que nous aurons à voir, par un autre
élément phonologique emprunté, comme le premier, au système
reçu. On disait par exemple volontiers en français
moyen toussir, nous préférons dire tousser ; une forme a
« i », l'autre a un « e ». Ce sont deux éléments connus du système
phonologique de la langue. L'italien a emprunté le mot
gréco-latin melancholia en lui donnant la forme malinconia ;
ce n'est pas qu'il lui ait été impossible de garder une forme plus
correcte, rien ne l'empêchait de dire melancolia, et il le dit
aussi en effet ; mais il lui a plu pour certaines raisons de
remplacer « e » par « a », « a » par « i » et « l » par « n ». Il
arrive aussi qu'un élément phonologique disparaisse d'un
mot. Le vieux français disait : je parol(e), nous disons : je parle ;
et le bas latin flēbilĕ(m) a été remplacé de bonne heure par
*fēbilĕm qui a donné notre mot faible. Au contraire il arrive
aussi qu'un son, consonne ou voyelle, apparaisse là où il n'y
avait rien ; le vieux français offre par exemple les formes
successives : fortece (lat. fortĭcia), fortrece et forterece (mod.
forteresse). Dans aucun de ces cas il n'y a quelque chose de
changé au système phonologique de la langue. Le système
183est en lui-même intact, c'est seulement l'emploi qu'on en fait
qui varie, et ce sont les mots qu'on transforme. L'assimilation
de leurs parties aux types articulatoires admis, se fait autrement,
mais elle se fait sur un système de types qui n'a pas
changé.
Quand il y a transformation lente, ce sont au contraire les
types du système admis qui se transforment peu à peu en
glissant pour ainsi dire, à travers une série d'étapes de
transition vers des articulations différentes. Le mot dont
les éléments ont été ainsi transformés n'a jamais été changé,
puisque la relation normale de ses divers éléments avec les
types correspondants du système phonologique n'a pas été
brisée ; mais ce sont les types qui ont varié.
Prenez par exemple le mot latin classique dēbēre, en faisant
pour le moment abstraction de la finale « e » non accentuée,
vous trouvez un mot français correspondant devoir
« devwàr » où chaque élément du mot latin se retrouve, bien
que sous une forme plus ou moins modifiée : le « d » et le
« r » sont restés à peu près semblables à eux-mêmes, le premier
« e » est devenu un « a », le second, une diphtongue
ascendante « wà », le « b » a donné un son fricatif labiodental
« v » ; mais le mot en lui-même, en dehors de cette évolution
de ses parties constitutives, n'a subi aucun changement.
Si chacun des éléments du système phonologique se modifiait
d'une seule manière, et donnait comme résultat final un
nouveau phonème différent de tout ce qui d'autre part
peut avoir été introduit dans le système, il y aurait entre
deux formes du même mot pris dans deux états successifs
d'un même langage, une sorte de correspondance très simple
de partie à partie, et l'identité formelle des deux symboles
transparaîtrait à travers leurs différences de qualité matérielle.
En réalité, cette correspondance est voilée par le fait
qu'au cours de l'évolution un même phonème, un même
type se scinde en deux phonèmes distincts suivant les diverses
conditions de relation où il se trouve. Nous avons
184dit à propos de la phonologie ce qu'étaient ces conditions de
relation, et nous en voyons ici l'importance. Dans notre mot
dēbēre, les deux « e » ont eu des destinées très différentes
parce qu'ils étaient diversement accentués. Celui qui n'avait
que l'accent faible de la première syllabe est devenu un « ə »,
l'autre, qui était porteur de l'accent principal, a donné un
son diphtongué écrit ei puis oi en vieux français du XIIe siècle
qui, à travers toute une série de prononciations intermédiaires
(« ei », « ɔi », « ɔɛ », « wɛ » etc.), aboutit à notre
« wà ». Tous les « b » du latin classique n'ont pas donné un
« v » en français, mais bien tous les « b » entre deux voyelles,
c'est-à-dire tous ceux qui existaient dans certaines conditions
articulatoires favorables à cette transformation. Les autres
« b » se conservent avec une égale régularité. Fabam donne
fêve, cŭbare > couver, hībernum >, hiver, etc. ; mais barbam
est devenu barbe, ŭmbram, > ombre, abbatem >, vx fr. abet,
fr. mod. abbé.
Cette différenciation de ce qui a été identique au début, se
fait non seulement par des conservations et des transformations
divergentes, mais aussi par des disparitions. Ainsi le
« d » de dēbēre qui se conserve régulièrement au commencement
du mot et après consonne (dūrum > dur, ŭndam
> onde), s'efface entre deux voyelles, comme on le voit dans
les mots vĭdēre > vx fr. veeir, veoir, fr. mod. voir, nūdam >
nue, etc. Les cas semblables sont très nombreux surtout à
la fin des mots ; ainsi en passant du latin en français on voit
disparaître toutes les voyelles non accentuées en dernière
syllabe sauf le « a » — tel le « e » final de dēbēre qui n'a pas
de correspondant dans le mot devoir — , et la grande majorité
aussi des consonnes finales latines ou romanes.
Non seulement il arrive que le même élément ait des destinées
très diverses suivant ses conditions de relation, mais
on voit aussi des unités phoniques être remplacées par des
dualités, ou des dualités se fondre dans une unité. Ainsi en
bas latin un « s » initial devant consonne développe devant lui
un « i » puis un « ẹ », scūtūm donne escu en vieux français ;
185inversement un groupe latin « al » tel qu'on le trouve encore
au XIe siècle dans le mot mals (lat. malos) donne plus tard devant
consonne d'abord une diphtongue « au », puis un son
simple écrit au mais prononcé o fermé les maux, « lɛ mọ ».
Toutes ces différenciations et créations nouvelles auraient
pour effet de multiplier beaucoup les types du système phonologique
qui en naîtrait, si une des tendances constantes de
l'évolution phonétique n'était d'assimiler tous les éléments
d'origine diverses qui se rapprochent les uns des autres par
leur articulation. Le « b » ou le « e » long du latin ont pu donner
diverses choses ; mais en compensation le « v » ou le
« wa » du français représentent aussi plusieurs éléments phonologiques
du latin qui sont venus par divers chemins se
confondre dans une nouvelle unité. A côté de devoir < dēbēre,
nous rencontrons lever < lĕvare et neveu < nĕpōtēm dont les
v ne sont pas moins régulièrement dérivés du v ou du p latin.
De même dans tēctum > toit, strĭctum > étroit, nĭgrum
> noir, glōriam < gloire, crŭcem > croix, nauseam > noise
nous avons des oi « wà » d'origine assez diverses et pourtant
identiques relativement au système phonologique de la langue
moderne. C'est ainsi que les systèmes phonologiques se
simplifient par assimilation en même temps qu'ils se compliquent
par différenciation, et que généralement le système
dérivé ne présente ni beaucoup plus ni beaucoup moins de
types que celui dont il est issu.
Ce qu'il importe de noter, c'est qu'au cours de cette évolution
des types phonologiques, les mots changent beaucoup
d'aspect sans que jamais la relation de leurs éléments avec
le système phonologique soit arbitrairement troublée. Il ne
se produit à aucun moment de ces substitutions brusques
comme celles que l'on observe dans le premier genre de
transformations. Les mots changent parce que le système sur
lequel ils s'appuient évolue.
Examinons maintenant ces deux espèces de transformations
que nous venons de décrire, pour essayer de déterminer,
186si possible, leurs causes respectives, et pour les analyser
au double point de vue grammatical et psychologique 124.
En ce qui concerne les changements brusques, nous sommes
obligé de distinguer encore. Les uns reposent sur des associations
d'idées, et les autres sont dus à des inductions de sons.
Nous ne nous occuperons d'abord que des premiers.
Parmi ceux-ci il y en a que l'on appelle à bon droit analogiques.
Ils sont dus à une opération intellectuelle qui peut se
comparer au calcul d'une quatrième proportionnelle.
On disait anciennement en français : je treuve, nous trouvons,
en faisant alterner eu « ø » et ou « u » comme nous le
faisons encore dans quelques verbes. Cependant sur l'analogie
des verbes plus nombreux où la voyelle du radical reste partout
identique, on a construit des formes nouvelles : je treuve,
nous treuvons, et inversement je trouve, nous trouvons. On
les rencontre toutes au XVIIe siècle, mais l'usage s'est arrêté
aux dernières, sans doute parce que les radicaux en « u »
étaient dès l'origine les plus nombreux et les plus employés
(l'infinitif, les participes, l'imparfait et d'une façon
générale toutes les formes qui ont une désinence accentuée,
187ont toujours eu le son « u » dans le radical). On peut donc
construire la proportion suivante :
nous poussons, passons, etc. / je pousse, passe, etc.
=
nous trouvons / je trouve (4e prop. remplaçant : je treuve).
Le remplacement de toussir (latin tŭssire) par tousser en
est aussi un exemple. Ce dernier verbe est formé sur le
substantif la toux, d'après le type très fréquent de dérivation :
le souffle, souffler ; le chant, chanter ; ou mieux : la marche,
marcher ; la bave, baver, etc.
Mais il y a d'autres transformations brusques, dues également
à des associations d'idées, que l'on pourrait appeler paralogiques
pour réunir sous une seule dénomination toutes
les variétés que les linguistes en ont décrites. On les trouve
énumérées dans les traités de phonétique à côté de l'analogie,
sous les noms de : abrègements, contamination, étymologie populaire,
etc. Elles s'expliquent toutes également par les associations
d'idées auxquelles donnent lieu les mots et leurs
diverses parties, avec ceci de particulier seulement que ces
associations sont fortuites et nullement justifiées historiquement.
Si par exemple j'abrège photographie en photo, cela vient
de ce que le sens entier du mot est associé à ces deux premières
syllabes, de telle sorte que je puis facilement me passer
de la terminaison -graphie, qui est embarrassante et
d'ailleurs banale.
Il arrive aussi que les idées évoquées par deux mots distincts
sont si étroitement liées qu'elles se confondent, et qu'il
se produit à la suite de cette confusion une assimilation plus
ou moins complète des deux symboles eux-mêmes. C'est ainsi
que notre mot français haut, dérivé d'ailleurs du latin altum,
contient en vieux français une aspiration initiale « h » qui provient
de la contamination du mot latin par le mot germanique
hoch (v. h. all. hauh), et cette contamination s'explique
d'autant mieux que le « h » avait une valeur expressive
188intrinsèque, une nuance d'emphase qui pouvait la faire passer
pour un élément essentiel du symbole exprimant l'idée
de hauteur — comparez nos mots français hérisser, hideux,
héros qui contiennent tous une aspirée paralogique. Le mot
provigner, dérivé du substantif provain (lat. propagĭnem),
est dû peut-être à l'influence du mot vigne (lat. vīneam) ; dans
ce cas la contamination confine à l'étymologie populaire, dont
le nom même est assez significatif pour qu'il se passe de commentaire.
On dit choucroûte et non soucroute, à cause de la
fausse dérivation que l'on fait de ce mot, en y voyant un
composé de chou et de croûte, alors qu'il n'est que la forme
francisée de l'allemand Sauerkraut ; on a remplacé cordouanier
(de Cordoue et cordouan) par cordonnier, comme si ce mot
dérivait de cordon ; il est inutile de multiplier les exemples.
Ces phénomènes de paralogie se présentent sous d'autres
formes encore, mais nous n'avons pas besoin de les énumérer
toutes. Ce ne sont que des variétés à l'intérieur d'un ordre
de faits dont le principe essentiel ne varie pas.
Qu'avons-nous à dire de ces changements brusques analogiques
ou paralogiques ? La réponse n'est pas difficile après
tout ce que nous avons vu : leur principe est morphologique.
Ils ne se comprennent que par le fonctionnement du langage
comme expression de la pensée, et contribuent pour leur part
à cette adaptation de la forme grammaticale au contenu psychologique
de la pensée à exprimer.
L'analogie ne représente pas autre chose que l'application
d'une règle plus générale qui vient corriger une règle plus
particulière, ou plutôt en suspendre l'effet. C'est un acte de
bonne logique ; aussi joue-t-elle un rôle considérable dans
l'évolution de la syntaxe. Par elle les procédés grammaticaux,
qui se sont développés un peu au hasard au cours de l'évolution,
et qui satisfont tant bien que mal à des fins pratiques,
tendent à devenir rationnels. En particulier elle contribue
sans cesse à simplifier les cadres de la flexion et à en effacer
les irrégularités gênantes, que ces irrégularités soient originelles
189ou qu'elles se soient produites par l'effet des évolutions
phonétiques. C'est ainsi que la flexion du pronom possessif
sous sa forme accentuée : mien, mienne, tien, tienne, sien,
sienne et leurs pluriels, présentent une flexion simple et régulière
qui est tout entière dérivée par analogie de la seule
forme mien (lat. mĕum), tandis que les formes qui seraient
dérivées des formes latines correspondantes (meos, meam, etc.)
par l'effet des évolutions lentes de leurs phonèmes respectifs,
auraient été fort disparates ; quelques-unes existent encore
en vieux français (moie = *mēam pour mĕam, tuen = *tŏum
pour tŭum, etc.).
Les transformations paralogiques sont contradictoires aux
règles fondées sur les relations historiques des symboles entre
eux ; elles reposent sur des méprises. Elles consistent à rapprocher
des choses qui n'ont eu jusqu'alors rien à faire ensemble,
et à les assimiler plus ou moins complètement. Elles
n'en constituent pas moins une adaptation du langage à la
pensée, puisque l'association d'idées qui leur donne naissance,
pour n'être pas justifiée au point de vue de l'histoire, existe
pourtant réellement dans l'esprit de celui qui parle. Elles
sont le produit de ces vagues tendances dont nous avons
parlé (p. 169), à faire toutes sortes d'associations entre les divers
éléments de la parole et de la pensée au gré des rapprochements
fortuits qui existent entre eux. De temps en temps
ces associations vagues trouvent une occasion de se préciser
en se traduisant dans l'expression. Souvent aussi, comme
toute autre transformation d'ordre morphologique et par le
même processus, elles arrivent à s'imposer au langage collectif,
et désormais les associations qui ont présidé à leur apparition
première, sont fixées dans le langage et persistent à
la faveur de la création nouvelle. Ces associations factices ne
se distinguent des autres qu'à l'analyse historique ; dans le
langage actuel elles ont les unes et les autres une valeur
équivalente. On peut dans ce sens fort bien dire que provigner
vient de vigne ou que cordonnier vient de cordon, comme
bourgeonner vient de bourgeon et sabotier de sabot.190
C'est encore là une de ces transformations morphologiques
qui ont leur point de départ, leur cause matérielle dans l'état
donné de la langue. Personne n'aurait imaginé de donner
un « h » à altum, si le mot hauh n'avait existé simultanément
dans plusieurs esprits. On n'aurait pas non plus placé le
même phonème devant le mot héros, si son orthographe n'en
avait donné l'occasion. C'était un hasard qu'entre le régulier
provaigner et vigne, entre cordouanier et cordon, etc., il y
eût une analogie de prononciation qui amorçait un rapprochement
plus complet. Mais le principe de ces associations
fortuitement nées et des phénomènes qui ont suivi, est purement
intellectuel. Il y a d'autres mots qui se ressemblent
bien davantage et qui ne se sont jamais contaminés, parce
que leurs valeurs respectives répugnaient à toute confusion.
Ici, comme dans tous les phénomènes morphologiques, ce
qui nous intéresse dans le rapprochement de provaigner
et de vigne, de cordouanier et de cordon, c'est leur ressemblance,
mais non pas la qualité particulière des consonnes
ou des voyelles qui concourent à cette ressemblance. La
transformation peut être comprise sous son aspect abstrait,
dans sa formule algébrique. Il est vrai que dans la transformation
de héros sans aspiration « ẹrọ » en héros avec un
h aspiré « hẹrọ », de altum, en un vieux français halt, la
qualité spécifique du « h » entre en ligne de compte dans
l'hypothèse que nous avons faite ; mais c'est en vertu de sa
valeur expressive propre. Nous sommes ici dans le domaine
du prégrammatical et du langage affectif. Ce qu'il importe
de noter, c'est que l'élément conventionnel dans les symboles
est parfaitement indifférent.
En quoi ces transformations diffèrent-elles donc des autres
transformations morphologiques dont nous avons parlé plus
haut ? En rien au fond. La différence n'est qu'apparente ;
elle est tout entière dans la relation de ce phénomène avec
cette unité linguistique assez mal définie qu'on est convenu
d'appeler le mot. Supposez que le groupe je suis venu soit en
vertu d'une composition plus étroite de ses parties, considéré
191comme un seul mot (comme qui dirait : je suivenu), et que
quelqu'un sur le modèle de j'ai couru, qui serait lui aussi un
seul mot (j'aicouru), s'avisât de dire j'ai venu (j'aivenu),
certaines gens considéreraient ce changement comme faisant
partie de l'évolution phonétique, et n'étant pas du ressort
de la syntaxe. — Qui pourrait sérieusement y penser ? nous
demande-t-on. — Tous ceux qui traitent sous le titre de phonétique
des transformations lentes et des transformations
brusques des sons, et qui opposent cette partie de la linguistique
dans son ensemble à la morphologie et à la syntaxe ;
c'est-à-dire à peu près tous les grammairiens, à supposer
qu'ils se souciassent d'être conséquents avec leurs principes.
Si au lieu de considérer le mot, on considère le symbole,
et qu'on appelle symbole en général tout élément de phrase,
si minime soit-il, porteur d'une valeur et donnant lieu par
conséquent à des associations d'idées, on verra que dans tous
les cas l'évolution morphologique ne consiste qu'à percevoir
certains symboles, à leur attribuer à tort ou à raison certaines
valeurs, et à en faire ensuite un emploi approprié dans
la phrase.
Pour celui qui a changé provaigner en provigner, l'élément
radical de ce mot était identique au symbole qui sert de radical
aux mots : vigne, vignoble, vigneron. Cette identité était si
évidente qu'on peut admettre sans risquer de se tromper
beaucoup, que l'ouïe a dans ce travail de transformation, précédé
la parole, et qu'avant de dire provigner la personne en
question avait cru l'entendre. Ici, comme dans tout phénomène
de transformation morphologique, l'aperception des phrases
que l'on entend est influencée par les dispositions que l'on a
à associer plus ou moins étroitement divers éléments de langage.
Les transformations paralogiques sortent, elles aussi,
de ce que nous avons appelé les limbes de la grammaire
(p. 169).Quant au mot haut, il n'est pas téméraire d'admettre
qu'il y a eu à un moment donné pour certaines personnes
deux formes simultanées : *alto (m) (nous écrivons ce mot sous
la forme hypothétique du latin vulgaire) et*halto (m). Ce dernier
192mot participait de la valeur expressive du germanique
hauh et représentait une idée plus énergique. Le « h » à lui seul
était donc un symbole, ou si l'on aime mieux un facteur
expressif d'ordre extragrammatical ; c'était un de ces éléments
semi-conventionnels dont le langage affectif est si
riche. Nous observons chez nous-mêmes encore quelque chose
d'analogue relativement au mot héros, dont nous faisons
volontiers entendre le « h » quand nous voulons donner de la
force à l'expression. Plus tard la forme *halto(m) a supplanté
la forme *alto(m), justement parce qu'elle était plus expressive.
Nous concluons de cet exposé que les transformations
brusques paralogiques et analogiques doivent être considérées
de plein droit comme des phénomènes d'évolution morphologique.
Elles appartiennent à la science de la forme du
langage et de ses procédés, et nous n'aurions rien eu à en
dire ici, si l'on n'avait pas l'habitude de les confondre avec
les phénomènes proprement phonétiques que nous allons
aborder maintenant.
En passant à l'étude des transformations brusques qui
sont dues à des inductions de sons — sans égard à leur valeur
significative — , nous entrons dans un tout autre domaine où
la morphologie n'a directement rien à voir. Et cependant on
ne saurait comprendre les phénomènes de cet ordre tels
qu'ils se manifestent dans le langage, sans faire intervenir
des considérations d'ordre morphologique. C'est ce que nous
allons essayer de montrer.
D'abord il faut placer ces transformations dans leur milieu.
Elles se produisent au cours de la parole et ont toujours
pour cause une certaine rupture entre le parallélisme normal
de la pensée et de son expression grammaticale. Souvent
un élément phonologique, au lieu d'être simplement articulé
193à sa place et de disparaître ensuite, intervient trop tôt dans
le discours, se manifeste ou tend à se manifester avant son
tour, ou au contraire, après avoir paru, subsiste à l'état de
souvenir et exerce une influence troublante sur la parole,
alors qu'il aurait dû être entièrement effacé.
Ce sont là des phénomènes dont les psychologues rendent
aisément compte. La parole est composée d'une série d'actes
successifs qui demandent chacun qu'une période de préparation
les précède, et qui laissent après eux dans l'organisme
une certaine résonnance. S'il s'agissait de purs réflexes, ce
jeu pourrait s'accomplir à la faveur de l'habitude avec une
parfaite virtuosité, d'après un mécanisme impeccable. Mais
l'intervention même de l'intelligence et les mille éléments
imprévus qui surgissent dans la conscience, troublent sans
cesse le fonctionnement régulier de la parole. Il y a des préparations
qui se font trop vite, des résonnances trop prolongées,
des négligences, des distractions, des hésitations. La
parole est en ceci semblable à toutes les activités conscientes
de l'homme. Il en résulte que les sons qui viennent d'être
émis et ceux qui vont l'être prennent parfois une telle place
dans la conscience de celui qui parle, qu'ils influencent l'articulation
du moment. Si ces dits sons ne se substituent pas
à ceux qui devraient être articulés, du moins ils exercent sur
eux une action d'induction, et cette action est plus ou moins
forte, non seulement d'après les dispositions psychologiques
du sujet parlant, mais aussi suivant les affinités naturelles
des éléments phonologiques entre eux.
Cette influence inductrice que nous n'avons pas à étudier
ici dans le détail se ramène à deux formes fondamentales :
l'assimilation, par laquelle le son inducteur et le son induit
deviennent plus semblables ou se confondent 125, et la dissimilation,
194qui au contraire produit une différenciation plus marquée
entre les deux sons. Ces deux effets peuvent être tantôt
progressifs (le son inducteur agit sur ce qui suit dans le
discours), tantôt régressifs (le son inducteur agit par avance
sur ce qui le précède). L'induction a lieu le plus souvent par
contact immédiat, mais elle peut aussi se produire à distance
par dessus plusieurs autres articulations qui, elles, ne
subissent aucune influence inductrice. Ce sont là des
faits trop connus de tous ceux qui ont étudié tant soit peu de
linguistique pour que nous les décrivions plus longuement ;
nous renvoyons aux ouvrages spéciaux. Wundt leur a consacré
des pages très intéressantes dans son ouvrage 126. Ici nous
en donnerons un seul exemple qui servira à la démonstration
que nous avons à faire. Il s'agit d'une assimilation régressive
à distance : le vieux français disait cercher « sɛrʃẹr », forme
régulièrement dérivée d'un mot latin cĭrcāre ; nous l'avons
transformée en chercher « ʃerʃẹ » ; il y a eu induction du ch
« ʃ » sur le c « s » précédent.
Il s'agit bien là, nous le constatons d'abord, d'une transformation
brusque, et c'est un type phonologique connu (c
qui équivaut au s dur « s ») qui a été remplacé par un autre
type également admis (ch signe graphique pour une sifflante
cérébrale dure « ʃ »), exactement comme le « i » de toussir s'est
vu substituer le « ẹ » de tousser ou comme le « ɛ » de provaigner
dérivé de provain a été remplacé par un « i ». Seulement
ici la valeur des sons en jeu comme symboles grammaticaux
n'est nullement en cause. Il s'agit d'un phénomène d'ordre
psychologique sans doute, puisque c'est le « ʃ » qui a agi sur
l'articulation de ce qui aurait dû être « s » ; mais il n'y a rien
là d'intellectuel, car cette influence n'a pu se produire que
parce que le contrôle de l'intelligence et de la volonté sur le
mécanisme de la parole s'est trouvé en défaut. Il semble
195donc qu'on puisse aborder son étude immédiatement au sortir
de la morphologie statique et de la phonologie. Ici, c'est
justement la qualité du son qui importe, puisque ces deux
phénomènes « s » et « ʃ » ont une affinité naturelle qui facilite
l'assimilation. En quoi l'évolution morphologique pourrait-elle
être intéressée à ce que l'induction se produise ou
ne se produise pas ?
Et pourtant elle y est intéressée, bien que cela ne semble
pas évident à première vue. Pour le comprendre, il convient
de se représenter que l'évolution morphologique ne consiste
pas seulement à créer de nouvelles formes de langage mieux
adaptées que les anciennes à l'expression de la pensée, mais
que les mêmes forces et les mêmes lois qui provoquent et
gouvernent ces créations, agissent aussi quand il s'agit de
conserver les formes nécessaires. Il y a des impulsions psychologiques
d'un ordre inférieur qui travaillent à la désorganisation
du langage. Celles dont nous venons de parler
sont du nombre, et sans l'effort continuel de l'attention et
de l'intelligence, elles auraient bientôt fait d'enlever toute
efficacité à la parole.
Nous avons dit ailleurs que création et évolution ne sont
qu'une seule et même chose (p. 44, p. 137) ; à ces deux termes
il faut en ajouter un troisième, et dire que la création, la conservation
et l'évolution ne sont que trois aspects d'une seule
et même activité. Il peut sembler paradoxal de réunir deux
termes contradictoires comme l'évolution et la conservation.
Tel serait le cas si conservation était synonyme d'inertie ;
mais quand elle suppose une résistance, un effort pour ne
pas laisser perdre ce qui a été créé, il est évident qu'elle est
congénère à toutes les puissances actives qui se manifestent
dans le devenir du phénomène, et qu'elle concourt avec elles
au même but. Tel est le cas dans le langage. L'effort de l'intelligence
humaine qui le crée et le fait évoluer, est nécessaire
aussi pour que le langage acquis ne perde rien de sa
valeur expressive. Cette activité conservatrice des facteurs
196intellectuels est la condition indispensable de tout progrès.
Si ce qui a été créé en fait de procédés grammaticaux
et de formes de langage était irrémédiablement voué à
la destruction lente par les impulsions inintelligentes de
notre être inférieur, l'évolution se réduirait à une recréation
perpétuelle ; ce serait un piétinement sur place.
Cette vérité comprise met l'étude dont nous nous occupons
dans sa vraie lumière. Il faut concéder sans doute que le
phénomène d'induction pris en lui-même est explicable par
les seules lois de la psychologie physiologique individuelle, et
n'a rien d'intellectuel et de morphologique, au contraire ;
mais outre qu'il se produit dans le langage organisé et à l'occasion
de son fonctionnement, il convient de considérer encore
que les effets qu'il produit sur la grammaire, ne se peuvent
comprendre que si l'on tient compte de cette résistance conservatrice
dont nous venons de parler. Il faut les étudier
dans leur relation avec ces puissances psychiques qui créent,
qui font vivre et évoluer l'organisme grammatical. Le phénomène
d'induction est d'un certain ordre, mais le phénomème
grammatical qui en résulte, est d'un autre ordre. Il en est de
ceci à peu près comme de la phonologie. L'articulation, le phénomène
vocal, sa relation avec les centres nerveux qui le commandent
sont des fonctions physiologiques et psychologiques
qui prises à elles seules n'ont rien à faire avec la grammaire ;
mais la science qui nous dit ce que deviennent ces fonctions
quand elles sont mises au service du langage, est une science
grammaticale, qui a besoin d'être emboîtée dans la morphologie
statique.
Nous dirions volontiers, pour employer un terme qui rattache
notre exposé actuel avec ce que nous avons dit sur
l'emboîtement des sciences en général, que la résistance de
l'intelligence à la désagrégation morphologique du langage est
le milieu dans lequel se produisent les phénomènes d'induction.
Rien ne passe, rien n'entre dans le langage individuel
ou collectif à titre durable, rien ne devient élément de grammaire
que ce que l'intelligence autorise.197
De nous cerchons on a fait nous cherchons ; pourquoi de
serre chaude « sɛrʃọd » n'a-t-on pas fait une cherre chaude
« ʃɛrʃẹọd » ? Mille fois cette erreur de prononciation s'est produite
sans doute, et pourtant jamais la langue ne l'a adoptée.
C'est parce qu'on s'est toujours souvenu de la valeur du premier
élément de ce groupe de deux mots : serre chaude, et que
son association avec tous les autres emplois de ce mot serre,
dans les cas où il n'était pas sous l'influence assimilatrice
d'un ch « ʃ », sa qualité de symbole en un mot, l'a empêché
de se corrompre dans sa forme matérielle. Le jour où ces deux
mots n'en formeront plus qu'un, et qu'en vertu d'une composition
étroite ses éléments constitutifs se seront désolidarisés
de ce qui leur est originairement identique dans le reste
du langage, rien ne s'opposera plus à ce que l'assimilation se
produise.
On voit comment nous rencontrons ici un fait presque
identique à ceux que nous avons constatés en analysant psychologiquement
l'analogie et la paralogie. Nous avons vu en
nous occupant de ces phénomènes, des associations d'idées
qui provoquent des changements dans l'aspect matériel de
certains mots ; en étudiant les inductions de sons, il faut
tenir compte des associations d'idées qui s'opposent à de
pareils changements. La cause première du phénomène, l'induction,
est phonétique ; aussi sommes-nous bien dans la
science des sons du langage. Mais le phénomène lui-même est
conditionné morphologiquement ; aussi emboîtons-nous cette
étude dans celle de la forme du langage et de ses procédés.
Ceci dit, nous pouvons enfin aborder les transformations
lentes qui constituent la partie essentielle de l'évolution phonétique.
Montrer qu'elles ne peuvent être utilement étudiées
que lorsqu'on y fait intervenir des conditions d'ordre morphologique,
c'est la partie la plus importante mais aussi la
plus délicate de notre tâche.198
Les linguistes ont été frappés par le caractère de régulalarité
avec lequel ces évolutions se produisent, et ils ont été
tentés de leur attribuer une valeur égale à celle des lois de la
nature. L'analogie était séduisante, et on arrivait facilement
à faire de ces lois un des éléments du déterminisme universel.
Nous avons vu plus haut (p. 184) les transformations
que chacun des phonèmes composant le mot dēbēre a subies.
Ces transformations sont les mêmes pour tous les éléments
phonologiques identiques de qualité et de relation, en un
lieu et en un temps donnés, dans quelque mot qu'ils se
trouvent. Chacune d'elles obéit donc à une règle ou à une loi
et c'est la tâche de la phonétique empirique d'énumérer les
lois qui ont agi en un temps donné à l'intérieur d'une certaine
collectivité linguistique. On lira par exemple dans un
ouvrage de phonétique traitant des origines de notre français,
qu'un « d » initial se conserve (exemples : dūrum > dur,
dĭgĭtum > doigt, etc.) ; qu'un « e » classique bref ou long ainsi
que le « i » sous l'accent secondaire (accent qui se trouve sur
la première syllabe du mot quand elle ne porte pas l'accent
principal) donnent en syllabe ouverte le son de l' e muet
(exemples : sĕrēnum > serein, nĕpōtem > neveu, mĭnāciam
> menace, vĕnire > venir, etc.) ; et ainsi de suite. Nous
avons déjà vu la règle relative au « b » intervocalique, et il
est inutile de continuer cet exposé pour chacun des éléments
du mot dēbēre > devoir. Si sur quelque point l'histoire de
la langue offre des infractions à ces règles, la phonétique a
pour tâche de les signaler, et si possible, de les expliquer ;
on dira par exemple que nous croyons (lat. *crēd-ŭmus) pour
nos créons, forme attendue et qui existe d'ailleurs en vieux
français, est une création de l'analogie sur je croi(s), tu
crois, lesquels sont réguliers, etc.
On s'est donc souvent représenté que c'étaient là des lois
d'origine mystérieuse, mais fatales comme la chute des corps
pesants. L'évolution du langage dans ses sons serait due à
l'intervention de ces lois combinée avec les phénomènes de
transformation brusque dont nous avons parlé plus haut.
Tandis que ces dernières ont des causes d'ordre psychique,
199celles qui sont dues aux lois phonétiques se produiraient
spontanément, en vertu de je ne sais quelle force latente
soustraite au contrôle et à l'influence de l'esprit humain.
Dans cette conception le terme de loi phonétique ne voudrait
pas dire : loi qui règle les transformations des sons, mais : loi
qui provient des sons.
Si tel était le cas, non seulement ces lois pourraient être
étudiées en elles-mêmes, mais encore elles constitueraient
un milieu dans lequel les lois de la morphologie évolutive,
le principe intellectuel du langage, devrait produire ses effets
tant bien que mal. Ce serait quelque chose d'un ordre
inférieur, à mettre sur le même plan que la physiologie de la
voix par exemple, et l'ordre de l'emboîtement devrait être
renversé.
Nous avons essayé de montrer plus haut que cela n'est pas
nécessaire, et qu'on n'est jamais forcé d'admettre qu'une loi
phonétique ait ainsi imposé ses conditions à la forme intellectuelle
du langage. Il nous reste à faire voir que ces lois
phonétiques, bien loin d'être autonomes, sont toujours conditionnées
dans une certaine mesure par les exigences de la
morphologie et n'existent même que pour elle.
On peut d'abord dire que cette cause inconnue, d'un ordre
spécial, qui forcerait les sons à évoluer dans une certaine direction,
est tellement mystérieuse qu'on serait en droit de
mettre son existence en doute jusqu'à preuve du contraire.
Que peut-il bien y avoir dans le second « e » de dēbēre qui
devait fatalement l'amener dans le cours du temps à devenir
un « ei », puis un « ɔi », puis un « wà » ou dans son « b » qui
le force à s'affaiblir en « v » ? On a de la peine à se l'imaginer,
d'autant plus que ces lois sont sujettes à varier
suivant les lieux.
Ces divergences sont même la cause principale des différences
entre les langues. L'italien devere (dovere qui existe aussi,
est une création paralogique sur potere) diffère du français
devoir, parce que les divers éléments du mot latin ont évolué
200d'une autre façon en Toscane que dans l'Ile-de-France. En
quoi la situation géographique pourrait-elle influencer la qualité
intrinsèque d'un phonème et sa puissance virtuelle d'évolution ?
Dira-t-on qu'il en faut chercher la cause, non dans le son
lui-même, mais dans l'organisme de ceux qui parlent, et que
ce sont les gosiers français, italiens, catalans, espagnols qui
à un moment donné étaient disposés de telle façon que ces
évolutions ont dû se produire ? C'est une solution à laquelle
les phonéticiens ont parfois eu recours. Mais rien ne nous
force à admettre qu'il en soit ainsi, aussi longtemps que les
physiologistes ne nous auront pas montré cette cause et expliqué
pourquoi et comment elle intervient. En attendant elle
n'existe qu'à l'état de notion vague et hypothétique, et sa seule
raison d'être, c'est qu'elle comble une lacune de notre connaissance.
Or c'est une faute contre la bonne méthode que
de se contenter d'une explication pareille avant d'avoir épuisé
toutes les autres ressources, et il nous semble qu'à la réflexion
nous pouvons découvrir d'autres principes d'explication parfaitement
suffisants.
L'étiologie des évolutions phonétiques régulières nous apparaît
comme excessivement complexe et très difficile à déterminer
d'une façon satisfaisante dans chaque cas particulier,
et cependant parfaitement claire et rationnelle dans ses
principaux facteurs. Voici la manière dont, selon nous, le
problème pourra être résolu.
Les sons n'évoluent pas par eux-mêmes, mais ce sont les
sujets parlants qui les font évoluer, et le point de départ de ces
évolutions doit être cherché, non pas dans une certaine disposition
spéciale des organes qui aurait pour résultat de
provoquer l'assourdissement d'un e ou tel autre effet spécial,
mais simplement dans ces innombrables et le plus souvent insaisissables
variations que chaque sujet parlant fait subir
aux phonèmes qu'il emploie au cours de la parole.
Nous avons vu que le phonème n'existe réellement qu'à
201titre d'idée ou de représentation. C'est un type moyen auquel
on assimile tout ce que l'on entend, et auquel on se conforme
plus ou moins exactement dans l'articulation réelle
(p. 155). Les sons varient donc, ils oscillent autour du type,
tantôt dans un sens, tantôt dans un autre. Leur qualité, leur
tonalité, leur quantité subissent des modifications dont l'importance
n'est limitée que par les exigences du langage. Il
faut qu'il reste intelligible, il faut donc que les phonèmes
gardent suffisamment leurs caractères différentiels pour que
les symboles qu'ils composent soient reconnaissables. Cette
limite imposée à ces variations constitue une première intervention
de la morphologie dans les évolutions phonétiques.
Mais allons plus loin, et demandons-nous quelles sont les
causes plus générales de ces variations. Ces causes sont diverses,
et nous allons énumérer celles qui nous semblent les
plus importantes.
On pourrait dire d'abord que le type phonologique existant
seulement comme moyenne des articulations qui se produisent
dans la parole concrète, ne porte en lui-même aucune garantie
de stabilité. Mais c'est là une cause purement négative
qui ne suffit pas ; en voici de plus positives.
Il faut se souvenir en premier lieu que le langage grammatical
et par conséquent le système (p. 155) phonologique
ne s'emploient jamais qu'à l'intérieur du langage extragrammatical,
et que chaque phonème est dans la parole vivante,
comme cette parole elle-même, une résultante. A côté de sa
qualité grammaticale, il a une qualité extragrammaticale
d'ordre affectif ; sa prononciation est plus ou moins rapide,
plus ou moins nette. Voilà encore un phénomène qui n'est
intelligible qu'en prenant la parole dans sa relation avec la
pensée et non pas seulement dans son aspect physiologique.
Cette collaboration des impulsions extragrammaticales dans
l'émission des sons provoque certaines variations d'une façon
directe et immédiate, mais elle peut en provoquer d'autres
qui sont le contre-coup des premières. On peut prononcer le
« a » du mot âme avec plus ou moins d'intensité et plus ou
202moins longuement suivant l'effet rhétorique que l'on veut
produire, mais cela risque d'entraîner à l'insu de celui qui
parle, d'autres modifications relatives à son articulation ou
à sa modulation. Il y a des relations naturelles ou acquises
entre les diverses qualités d'un même son. Nous en avons fait
mention à propos de la phonologie statique (p. 157).
Parmi les autres influences qui peuvent contribuer à faire
varier les sons, nous signalons très spécialement les inductions
exercées par les sons voisins. Moins l'attention sera
éveillée, plus ces phénomènes pourront se produire facilement.
Il y a là un domaine où les évolutions lentes et les
évolutions brusques se touchent sans se confondre. Nous
avons vu comment une induction peut fausser l'assimilation
du phonème à son type, et faire prononcer par exemple
ch « ʃ » au lieu de c « s » à cause d'un ch «ʃ» suivant dont
l'idée est déjà présente à l'esprit, et pour l'articulation duquel
les organes sont déjà disposés. Mais cette même influence
sans aller aussi loin, peut simplement rendre cette assimilation
moins exacte et faire prononcer seulement un « s » qui
s'éloignera un peu du type normal pour s'approcher d'autant
de celui du « ʃ ». Celui qui parle et celui qui exécute
ne s'en seront peut-être pas doutés, l'un et l'autre auront cru
articuler et percevoir un « s » bien authentique — c'est en
cela justement que les deux cas diffèrent très nettement — et
cependant il s'est produit quelque chose d'anormal. Il est de
fait qu'un grand nombre de lois phonétiques ont pour cause
physiologique des assimilations ou des dissimilations de sons
voisins. Si le « b » de dēbēre s'affaiblit et devient sonore « v »
entre deux voyelles, c'est évidemment qu'il s'assimile à leur
nature. Si un « s » initial devant une consonne développe une
voyelle (nous avons vu plus haut : lat. scūtum > vx fr. escu),
c'est au contraire un effet de dissimilation : la première consonne
se distingue nettement de la seconde en formant syllabe
pour elle seule. Ces lois phonétiques ont pour origine les
nombreuses inductions de sons qui se produisent au cours
de notre langage sans que nous nous en doutions, et les
203variations à peine perceptibles qui en résultent. Leur relation
avec la morphologie est exactement la même que celle des
transformations brusques dont nous avons parlé plus haut 127.
Nous venons de voir qu'un facteur psychologique capable
de provoquer une transformation brusque, peut si son effet
n'est pas entier, produire simplement une variation plus ou
moins grande, en tous cas inconsciente dans le phonème sur
lequel son effet se fait sentir. Si cela est vrai de l'induction
des sons, il n'y a aucune raison pour que cela ne le soit pas
de l'analogie et de la paralogie. L'induction est alors produite
par un son qui n'est ni dans le mot ni dans la phrase,
mais qui existe à quelque titre dans la conscience du sujet
parlant, en vertu d'une association d'idées. Supposez que
je veuille dire Octave « ɔctɑv » pour désigner l'empereur
romain, et qu'au moment d'énoncer ce nom propre, celui
d'Auguste « ọgyst », plus usité, se présente à mon esprit,
le premier élément phonique du mot que j'articulerai risque
de ne pas être un « ɔ » bien caractérisé, et de se teinter
du « ọ » fermé d'Auguste, s'il n'en prend pas tout à fait la
couleur. On peut constater ainsi que le ou « u » du participe
couvant se prononce quelquefois un peu plus longuement
que celui du substantif le couvent ; cela est dû évidemment
à l'influence de certaines formes du verbe couver, comme
elle couve, où ce son a la quantité longue. Voici encore un
204autre exemple : on dit en français : un ami « ynàmi » en
liant et en prononçant un comme le féminin une, mais
on dit tout autrement : un parent « œ̃pàrã ». Dans ces
deux cas l'article est prononcé de deux manières très différentes,
et cette différence est historiquement parfaitement
justifiée. Or l'analogie a fait rétablir la prononciation « œ̃ »
dans tous les cas. Sur le modèle de un parent on peut aussi
dire un ami en faisant seulement la liaison du n « œ̃nami ».
Mais il est facile d'observer qu'au courant de la parole on
n'articule pas toujours nettement l'une des deux formes
possibles, celle avec « y » ou celle avec « œ̃ », mais que ces
deux formes se présentant à la fois à l'esprit, c'est généralement
un « y » plus ou moins assimilé à un « œ̃ » qui
est prononcé.
Toutes ces causes de variations, jusqu'ici énumérées, impliquent
l'intervention d'un facteur psychique. Nous ne
nions pas qu'il puisse y avoir aussi des variations dues uniquement
à quelque disposition physique durable ou passagère.
Pour prétendre une chose pareille, il faudrait n'avoir
jamais été affligé d'un rhume de cerveau. Mais l'existence
de telles variations ne contredit en rien notre thèse, car il ne
s'est encore agi que des oscillations des phonèmes autour
de leur type, et pas encore de l'évolution de ces types qui en
dérive. Nous ne sommes qu'au point de départ, et quand il
faudrait avouer que toutes les oscillations seraient dues à des
causes physiques, cela ne prouverait pas encore que l'évolution
ne soit pas conditionnée morphologiquement.
Avant d'aller plus loin, il nous faut cependant mentionner
une dernière cause de variations qui est d'une nature toute
particulière. Elle n'est pas physique, puisqu'il s'agit d'une
disposition acquise des organes ; elle n'est pas psychique non
plus de la même manière que les autres, puisqu'elle ne réside
pas dans la relation qu'il y a entre la parole et la pensée.
Nous voulons parler de l'influence que les diverses langues
exercent les unes sur les autres quand elles entrent en contact.
Il est évident qu'un même individu ne peut parler deux
205langues, se servir donc de deux systèmes phonologiques,
sans qu'une influence aille du système qui lui est le plus
habituel, à l'autre système pour le corrompre par une assimilation
plus ou moins complète. C'est un fait d'observation
si banale qu'il est inutile de s'y arrêter. L'effet en sens
inverse n'est pas non plus exclu, et quand quelqu'un a appris
dès son enfance deux langues qui lui sont devenues également
familières, il peut, il doit y avoir là aussi une influence
réciproque des habitudes de prononciation d'une
langue sur l'autre. Cette cause se distingue des autres aussi
par ses effets ; elle tend naturellement à modifier d'une façon
constante et toujours la même, les phonèmes dont se sert une
personne. Elle est à cet égard assimilable à un défaut de
prononciation incurable. Une habitude ancrée vaut une disposition
physiologique. Tel individu ne peut pas prononcer
le « Ʒ » qui se trouve dans le français joli « Ʒɔli », parce que
son palais est mal conformé, tel autre parce qu'il n'a
jamais appris à articuler ce son ; pratiquement, des deux
côtés l'impossibilité est égale.
Cette cause, comme toutes les autres, jette dans la circulation
une quantité d'articulations approximatives et fautives.
Le langage concret, la parole telle qu'on l'entend autour de
soi et telle qu'on la pratique, en fourmille. Que va-t-il en résulter,
comment l'évolution phonétique en sortira-t-elle ?
Voilà le problème que nous avons maintenant à résoudre.
Prenons un exemple. Le latin nĕpōtem a vu son « p », par
un effet d'assimilation que nous avons expliqué, devenir légèrement
sonore comme les voyelles qui le précèdent et le suivent,
il s'est rapproché du « b », puis il est devenu tout à fait
un « b », enfin l'assimilation continuant, par un phénomène
analogue à celui qui a transformé le « b » de dēbēre devoir, il est
arrivé jusqu'au « v » (vx fr. nevot, fr. mod. neveu). Chaque pas
en avant dans cette direction, chaque assimilation plus complète
a été d'abord un fait individuel, généralement isolé,
fortuit, une simple oscillation contrebalancée peut-être par
206d'autres en sens inverse, et qui semblait ne pas devoir laisser
de trace dans le langage. Deux questions se posent alors. La
première est de savoir comment ce fait isolé ou individuel a
pu devenir un fait constant, général, quelque chose que la
collectivité s'est appropriée ; la seconde, c'est de se rendre
compte pourquoi ce qui dans la plupart des cas ne concernait
que la forme d'un mot, est devenu une loi phonétique relative
à un élément phonologique dans quelque mot qu'il se
présente. Or ces deux questions sont étroitement connexes.
Il va sans dire qu'une modification quelconque du langage
admis, qu'il s'agisse d'un point de morphologie ou d'un fait
d'ordre phonologique, ne peut se produire que par l'action
de cet agent collectif, de cette adaptation réciproque qui est
nécessaire pour toute création grammaticale. Une variation
phonétique, comme une création lexicologique ou une nouvelle
règle de syntaxe, est par le simple fait qu'elle se produit,
proposée par le sujet parlant à l'imitation de ceux qui l'écoutent.
Mais dans le milieu collectif elle se heurte à des résistances
qui la plupart du temps, étouffent dans son début
toute innovation, et ramènent l'initiateur lui-même à l'usage
admis par tous. D'autres fois au contraire, elle est appuyée,
par un concours de circonstances qui la favorisent aux dépens
de l'usage ou aux dépens d'autres variations concurrentes.
Suivant que les forces qui tendent dans une direction
ou dans une autre sont plus ou moins puissantes dans
une collectivité donnée, l'évolution se fait ou ne se fait pas, et
elle se fait dans un sens plutôt que dans l'autre. C'est une
question d'équilibre entre les forces en présence.
Mais pour que l'évolution puisse s'accomplir, il y a une condition
essentielle ; et c'est là que nous touchons à notre seconde
question. Il faut que la variation phonétique ne se produise
pas seulement dans un mot isolé, mais qu'elle apparaisse
identique dans tous les mots quels qu'ils soient, où se trouve
le même élément phonologique. En d'autres termes, il ne
peut y avoir de changements phonétiques que sous la
forme de règles d'une application générale. Pourquoi ? Pour
207une raison bien simple, c'est que cette régularité est la condition
essentielle de la conservation du système phonologique,
et que l'existence de ce système étant nécessaire à la
compréhension du langage, l'intelligence humaine résiste
inconsciemment, par voie de choix et d'une manière très
efficace, à tout ce qui pourrait compromettre cette compréhension.
Supposons pour un instant que chaque mot évolue quant
à sa qualité matérielle pour son propre compte et sans égard
aux autres. Il est évident que leurs éléments ne trouvant point
de types auxquels s'assimiler, les mots eux-mêmes ne seraient
plus saisissables. Il ne suffit pas de dire que toutes ces évolutions
particulières aboutiraient de nouveau aux types phonologiques
d'un nouveau système ; que tel « a » deviendrait
« e », et tel autre dans des conditions identiques deviendrait
« o », et qu'en fin de compte on aurait deux mots constituant
chacun un symbole parfaitement perceptible ; il faut
tenir compte des étapes intermédiaires. Que deviendrait le
système phonologique d'une langue dont tous les « a » évolueraient
simultanément et indépendamment dans diverses
directions ? Il n'y aurait plus que des nuances, le système
phonologique se perdrait par sa complexité.
C'est pour cela que nous n'admettons que deux sortes de
transformations phonétiques parfaitement distinctes en théorie
et en pratique : la transformation brusque et la transformation
lente.
Si le mot femier du vieux français (lat. fĭmārium dérivé
de fĭmus) donne à un certain moment fumier par l'assimilation
du « ǝ » aux labiales voisines, ce « ǝ » qui est devenu
« y », a passé sans doute à travers beaucoup de variations, et
a occupé alternativement toutes les positions intermédiaires
entre le « ǝ » et « y », mais à chaque moment, pour l'auditeur
comme pour celui qui parlait, il a été assimilé soit au « ǝ »
du mot femelle, qui se trouve dans les mêmes conditions, soit
au « y » du mot fumée. C'est probablement même la contamination
de ce dernier mot qui a fait pencher la balance en
208faveur de la seconde assimilation maintenant définitive. Il
n'en est pas de même de la diphtongue oi du mot devoir par
exemple qui a passé, du XIIIe siècle à nos jours, à travers
une série de variations pour aboutir à sa qualité actuelle
« wà ». A chacune des étapes l'assimilation a été différente ;
nous avons énuméré ailleurs (p. 185) quelques-unes des
qualités successives qui ont été attribuées à cet élément
phonique. Cela n'a pu se faire que parce que le type tout
entier subissait la même transformation dans tous les cas
où il était réclamé par la convention grammaticale, que ce
soit dans le mot devoir, dans le mot toile (lat. tēlam), dans
le mot croire (lat. crēdere) ou tout autre.
Dans l'un et l'autre cas, par deux procédés différents,
l'intégrité du système phonologique est sauvegardée. D'ailleurs,
si le mécanisme des transformations brusques n'est pas
difficile à comprendre, il n'est pas malaisé non plus de se
rendre compte comment ces évolutions lentes et régulières
des types phonologiques se produisent.
Le symbole ne se fixe et ne se reconnaît que par son analyse
en des éléments phonologiques connus. Tout élément
articulatoire dans le langage n'existe que par son assimilation
à un type. Quand donc à l'intérieur d'un mot un élément
articulatoire se modifie, de deux choses l'une : ou il se
conformera au type et reviendra à sa forme première, ou
bien il faudra de toute nécessité que ce soit le type qui varie
et qui se conforme à lui ; mais alors il entraînera dans son
évolution toutes les autres réalisations de ce même type dans
tous les autres mots. Et cela arrivera toutes les fois que les
forces qui poussent à cette transformation seront plus grandes
que celles qui y résistent.
Nous disions plus haut que les facteurs qui font osciller
les phonèmes autour de leurs types, et qui par là donnent
le branle aux évolutions phonétiques, sont dans bien des cas
des facteurs psychiques ; nous sommes arrivés maintenant à
un nouveau résultat beaucoup plus important : nous avons
209reconnu que c'est un acte intellectuel, une intervention de la
volonté de se faire comprendre et de comprendre, qui donne
à l'évolution phonétique cette régularité qui est sa loi suprême.
C'est là un phénomène conservateur, comme celui dont
nous avons parlé à propos des transformations brusques dues
aux inductions de sons, quelque chose de congénère à ces
puissances qui créent le langage pour le mettre au service de
la pensée, et qui le font évoluer pour l'y adapter toujours
mieux. Si dans cette intervention spéciale elles ne produisent
pas un progrès, du moins empêchent-elles la décomposition.
Comme la phonologie s'emboîte dans la morphologie statique,
parce qu'elle rend compte du procédé grammatical auquel
les articulations doivent se soumettre pour servir aux
fins du langage organisé, de même, la phonétique s'emboîte
dans la morphologie évolutive, parce qu'elle nous dit comment
ce procédé est sauvegardé vis-à-vis des forces multiples
qui, dans le fonctionnement du langage, tendent à le compromettre.
Il n'y aurait plus qu'une dernière question à se poser.
celle de savoir quel est le principe directeur de cette évolution.
Nous avons dit qu'elle cède aux forces dont l'action est
prépondérante, et qu'une variation l'emporte et s'impose
au langage, quand elle est au bénéfice de certaines circonstances
favorables. Quelles sont ces circonstances favorables ?
Qu'est-ce qui fait que certaines forces sont prédominantes ?
On peut donner à cette question une réponse générale. Si
nous avons eu raison de parler ailleurs à propos de la phonologie,
d'une certaine correspondance psychique et physique
entre les dispositions des sujets parlants et le système
phonologique qu'ils emploient, il est évident que l'évolution
aura toujours pour effet naturel de produire une adaptation
de plus en plus parfaite, et de faire suivre au système
210phonologique une marche parallèle aux évolutions d'ordre
physique ou mental auxquelles la collectivité serait soumise.
Mais cette réponse toute générale est insuffisante sous
cette forme et demanderait à être développée. Nous y reviendrons
lorsque dans notre prochain chapitre nous esquisserons
le programme de la phonétique théorique. Ici, nous
pouvons nous contenter des résultats déjà acquis.
En effet, si ce que nous avons dit sur les causes et les conditions
psychologiques de l'évolution phonétique est exact,
nous avons établi que rien ne peut se produire dans cet ordre
de faits, que ce qui est au bénéfice d'un certain acquiescement
de l'esprit humain. Il faut qu'il y ait consentement,
approbation ; et la règle suprême qui dirige l'esprit dans
cette opération, c'est la loi même du langage : la préoccupation
de comprendre et d'être compris. Tout ce qui serait directement
contraire à cette fin, rencontrerait, par ce fait
même, une résistance irréductible. C'est dire que la « forme » de
la pensée, qui est la pensée elle-même, ne se laissera pas
dicter des lois par je ne sais quelles impulsions instinctives
surgissant dans les fonctions de la voix ou de l'ouïe, mais
qu'au contraire tout ce qui concerne l'émission des sons
conventionnels dans lesquels la forme de la pensée se réalise,
est subordonné aux exigences de cette forme. C'est cela
même que nous tenions à établir.
Nous terminerons par une dernière remarque qui servira
à confirmer ce que nous venons de dire, et peut-être aussi à
expliquer plus entièrement notre pensée.
Il semble que nous pouvons mieux comprendre les vraies
relations qui existent entre les diverses espèces de transformations
phonétiques, maintenant que nous les avons subordonnées
toutes également à l'action prépondérante de l'intelligence.
Ces diverses formes de l'évolution des sons nous
apparaissent désormais comme susceptibles d'entrer en
211concurrence et de l'emporter les unes sur les autres avec des
succès divers, suivant que la fin pratique du langage y trouve
son compte.
On ne peut nulle part observer mieux cette concurrence
des diverses transformations phonétiques que dans nos langues
modernes, qui comme le français, nous offrent par leur littérature
et par toutes sortes de documents, des témoignages
très abondants sur ce qu'a été leur vie pendant plusieurs
siècles de suite. On n'y voit point du tout les lois phonétiques
régulières s'appliquer avec cette précision, cette fatalité qui
serait le propre d'un phénomène naturel échappant au contrôle
des individus. Les grammairiens ou les divers auteurs
ont souvent des opinions divergentes sur la prononciation de
tel ou tel phonème en général ou de tel ou tel mot, et l'on
sent très bien que si l'usage finit par s'attacher à l'une ou
l'autre des alternatives en présence, il y a eu un moment où
l'hésitation était permise, et que là toutes sortes de motifs
ont pu intervenir pour déterminer la préférence. Les divers
individus suivant leur âge, suivant leur lieu d'origine ou
leur degré de culture, présentent des types de prononciations
diverses, et l'histoire de la langue montre nettement que
ce n'est pas toujours la prononciation la plus récente, ni
toujours la plus populaire qui l'emporte. Preuve que celui
qui parle a le pouvoir de contrôler et de choisir les sons qu'il
emploie. L'observation du langage actuel, tel qu'on l'entend
parler autour de soi, en offrirait des exemples nombreux,
surtout dans les villes où les diverses prononciations dialectales
se heurtent entre elles, et sont toutes ensemble en lutte
contre les influences de purisme qui nous viennent de l'école,
du théâtre et de la chaire. C'est ainsi qu'on peut entendre
à Genève et ailleurs la terminaison -ée, qui se trouve par
exemple dans le participe passé féminin, prononcée de
trois façons au moins : la prononciation du terroir et plus
ancienne est « ẹj », avec un son mouillé à la fin ; la prononciation
importée de Paris fait entendre un simple « ẹ »
comme si le e muet n'existait pas, et une prononciation
212intermédiaire fort répandue qui a l'avantage de n'être ni trop
dialectale ni trop entachée de purisme, consiste à dire « ẹ: »
avec un e fermé final sensiblement prolongé.
Il arrive souvent aussi qu'une influence intellectuelle, une
association d'idée, une préoccupation savante d'étymologie ou
d'orthographe, ou simplement le souci de conserver à un
symbole sa forme pleine bien caractérisée, suspende dans
un cas particulier, à l'égard d'un mot, l'application d'une
loi phonétique d'ailleurs admise. Il suffit pour cela que l'élément
phonologique qui évolue dans certaines conditions, persiste
dans d'autres sous son ancienne forme, de telle sorte que
le mot qui le conserve en dépit de la loi, trouve encore dans
le système phonologique le type auquel ce son doit être
assimilé. L'analogie ou la paralogie — si l'on nous permet ce
terme — font le reste. Il y a là une combinaison particulière
du jeu des évolutions lentes et des transformations brusques.
Les exemples abondent. On sait qu'en français la plupart des
consonnes finales sont tombées. C'est le cas du « r » après
le « e » ; nous disons : chanter, officier, premier sans « r »
« ∫ãtẹ, ɔfisjẹ, prǝmjẹ ». Cependant les monosyllabes mer,
fier, cher « mɛr, fjɛr, ∫rε» l'ont gardé, et la conservation du
« r » a même provoqué une transformation dans la qualité du
« e » qui s'est ouvert. On dit de même amer « amɛr » peut-être
par un effet de paralogie à cause d'une association avec
l'idée de mer. Le « r » avait également une tendance à disparaître
après le « i ». Les grammairiens du XVIIe siècle nous
disent que les infinitifs en -ir étaient traités comme ceux en
er, on disait volontiers finir sans « r » : « fini » comme « ∫ãtẹ ».
Si cet « r » a été restauré dans l'usage, cela serait dû, à en
croire certains témoignages du temps 128, au peuple qui, sur
l'analogie des verbes de la quatrième conjugaison comme dire,
conduire « dirǝ, kɔ̃dɥirǝ », aurait formé : finire, mourire,
« finirǝ, murirǝ ». Comme la grande majorité des mots en
213ir sont en français des infinitifs, l'intervention de ce phénomène
analogique a suspendu entièrement l'effet d'une loi
phonétique ; -ir final s'est conservé au lieu de donner « i »
et les substantifs l'avenir, le désir etc., s'y sont conformés.
Si l'on considère des faits de ce genre-là, on n'a pas de
peine à admettre que des motifs d'ordre morphologique, le
souci par exemple de conserver intactes certaines désinences
indispensables, aient pu intervenir non seulement pour suspendre
partiellement l'effet d'une loi phonétique, mais aussi
pour l'empêcher même de se produire ; et nous en revenons
à notre conclusion en disant que rien en fait d'évolution de
sons ne peut se passer, qui fasse un tort réel à la « forme »
du langage et c'est-à-dire à l'expression de la pensée. Toutes
les modifications durables qui atteignent les phénomènes
d'une langue, sont pratiquement conciliables avec les exigences
de la morphologie, et quand quelque chose est
détruit en fait de procédé grammatical par les transformations
que les symboles subissent dans leur qualité matérielle,
c'est que le procédé en question était caduc et déjà
remplacé.214
Chapitre XIV
Programme de la Science du Langage organisé
sous sa forme parlée.
Partie évolutive.
Nous avons à dire maintenant comment sur la base déjà
acquise — psychologie individuelle, science du langage affectif
et linguistique théorique statique — et en nous conformant
au principe d'emboîtement qui vient d'être établi,
on peut élever le système des disciplines évolutives, en en
sériant les problèmes d'après un enchaînement naturel qui
nous amène par degrés à une solution complète des problèmes
les plus compliqués.
Si nous y réussissons, nous aurons tracé le programme entier
de la linguistique théorique.
Nous avons vu que la morphologie statique devait commencer
par la définition et l'étude du symbole que nous
avons appelé la cellule du langage organisé. Si nous appliquons
ici le principe connu d'après lequel la genèse et l'évolution
sont dans leur essence une seule et même chose, nous
en conclurons que la première tâche qui s'impose à la morphologie
évolutive, consiste à étudier la genèse du symbole.
Analyser ce phénomène au point de vue de la psychologie,
215ce sera pour cette science apprendre à connaître tous les éléments
primordiaux de ses déductions ultérieures.
La morphologie évolutive se rattache par là tout naturellement
à la science du prégrammatical qui traite de la
genèse du signe, et à la linguistique statique qui nous donne
la définition du symbole aussi bien au point de vue de sa
forme abstraite qu'au point de vue de sa qualité matérielle.
Il va sans dire que la science que nous étudierons d'abord,
étant une science de la forme, s'attachera au premier de ces
points de vue, et ne s'occupera que du symbole pris dans sa
définition algébrique :
idée a = signe b.
C'est ici qu'on peut appliquer une division en trois chapitres
préconisée dernièrement par un auteur 129, qui voudrait
qu'on classât tous les problèmes de linguistique sous les rubriques
suivantes : Ontogénèse, Phylontogénèse et Phylogénèse.
On nous excusera d'adopter au moins provisoirement
ces noms un peu rébarbatifs ; ils nous seront commodes dans
notre exposé pour résumer des notions qui d'ailleurs nous
sont en bonne partie déjà familières. L'ontogénèse traite des
faits ou des actes qui ont toutes leurs causes dans un être
isolé, dans le sujet parlant ; la phylontogénèse parle de ce qui
se produit quand le sujet isolé subit l'influence d'un ou de
plusieurs autres sujets parlants ; la phylogénèse nous parle
enfin de ce qui résulte de l'activité collective de plusieurs
sujets agissant et réagissant les uns sur les autres.
Le signe spontané est, nous le savons, un produit de l'individu
seulement. Le problème qu'il pose appartient donc à
l'ontogénèse, et toute la science du langage affectif,
telle que nous l'avons définie, ne sort pas de ce domaine.216
Comment le symbole apparaît-il pour la première fois ?
Evidemment en vertu d'une création inconsciente semblable
à celles qui se trouvent à l'origine de toutes les évolutions
morphologiques. C'est en s'appliquant à comprendre le langage
des autres, et en interprétant les signes naturels prégrammaticaux
dont ils se servent, que l'individu en est venu
pour la première fois à voir dans certains sons ou dans certains
gestes le correspondant objectif et constant de certaines
idées. Le signe se transforme en symbole ; la grammaire naît.
Ici nous voyons un sujet isolé influencé par plusieurs autres
sujets ; nous sommes dans le domaine de la phylontogénèse.
Mais nous n'avons expliqué encore que la genèse des symboles
adoptés par un individu. Il nous reste à savoir comment
ils deviennent la propriété commune de la collectivité à la
suite d'un accord, d'une accommodation réciproque ; et comment
à la faveur de cet accord, les symboles acquièrent
définitivement ce caractère de fixité qui fait d'eux les
substituts d'idées claires, propres à servir à la communication
entre les intelligences.
Il est évident qu'il y a là deux problèmes solidaires. Le
symbole qui entre dans l'usage collectif, trouve dans cet
usage une garantie efficace de sa fixité. Un symbole qui
n'appartiendrait qu'à un individu, pourrait évoluer et disparaître
sans que rien s'y opposât en dehors de l'individu sujet ;
encore cette opposition ne saurait-elle être bien efficace.
Si un individu tient à ses habitudes, il est aussi toujours disposé
à les modifier par l'effet d'impulsions nouvelles. Le
symbole qui est connu et utilisé de tous, ne peut au contraire
ni être modifié, ni être oublié par un individu sans que le
langage des autres n'y résiste. Ce qui est bien commun est
par là même, sinon immuable, du moins difficile à transformer.
D'autre part, un symbole employé par un individu
aura d'autant plus de chances d'être adopté par d'autres
et d'entrer dans l'usage général, qu'il sera plus constant
dans sa forme et mieux défini dans sa valeur, qu'il
répondra mieux à la définition théorique du symbole.217
Comment ces phénomènes se produisent-ils ? Dans la concurrence
qui naît au sein du parler commun entre toutes les
grammaires individuelles. La grammaire collective est à la
fois une résultante et une moyenne. Inutile de répéter ici à
propos des symboles ce que nous avons dit dans le chapitre
précédent à propos des évolutions morphologiques. C'est ici
qu'après avoir étudié une série de disciplines préliminaires,
nous entrons enfin dans la phylogénèse, c'est-à-dire dans la
psychologie collective ; et nous le faisons en posant le problème
spécial de cette science — celui qui concerne l'explication
rationnelle de toute création spontanée dont le sujet est
une collectivité — relativement au langage et dans ses termes
les plus simples possibles.
En apprenant par quelle succession de phénomènes psychologiques
un symbole a pu naître, être conçu d'abord par
un sujet particulier qui a cru le trouver dans le langage
d'autrui, puis employé par lui et enfin admis par la collectivité
qui le fixe en l'adoptant, nous aurons compris en même
temps comment ce symbole peut évoluer dans sa valeur. En
effet cette fixation du symbole n'est jamais que relative et
n'est à aucun moment quelque chose d'acquis définitivement.
Depuis le moment où le symbole est vaguement conçu dans
un cerveau à la suite d'une ébauche d'acte intellectuel, jusqu'à
celui où, après une très longue destinée, il disparaîtra du
langage humain sans laisser de trace, cédant sa place aux
concurrents qui ont surgi sur sa route, le symbole est constamment
resté dans la circulation. Ceux qui en ont fait usage
l'ont reçu du dehors et proposé à d'autres dans une succession
de phénomènes de phylontogénèse et de phylogénèse
analogues à ceux qui avaient présidé à sa naissance. Chaque
fois que ce symbole a été employé et qu'il a dû être admis
par un autre, il a pu se produire un de ces actes de création
inconsciente qui fait que le symbole tel qu'il a été compris et
adopté, n'est pas tout à fait identique au symbole dont le
sujet parlant s'était servi ; et chacune de ces modifications
individuelles lancée dans la circulation a été proposée à la
218collectivité qui l'a repoussée ou admise, comme elle repousse
ou admet un symbole naissant.
Si donc nous avons la clef de la genèse du symbole, et que
nous soyons capables de l'expliquer rationnellement, nous
aurons aussi celle de ses destinées et de ses évolutions.
Bien plus, nous aurons celle des évolutions morphologiques
en général, puisque, comme nous avons essayé de le montrer,
toute la morphologie se résout en un système plus ou moins
compliqué de symboles.
Il faut cependant distinguer et ne pas vouloir aller trop
vite. La règle à suivre, c'est de n'aborder que des problèmes
simples, et cela au fur et à mesure qu'on a les données nécessaires
pour ne laisser subsister qu'une inconnue dans la question
qu'on se propose. En vertu de cette règle, la morphologie
évolutive doit commencer à étudier le symbole dans sa
genèse et son évolution en tant seulement qu'il se présente
comme un symbole simple et complet, en dehors de toute
complication morphologique.
Ce symbole nous l'avons comparé à une cellule primitive,
à un organisme rudimentaire qui se suffit à lui-même et qui
porte déjà en virtualité tous les caractères essentiels de la
vie. Il existe dans le langage, et nous l'avons appelé le symbole-phrase
(p. 138). Nous avons parlé plus haut de ce degré
de l'évolution linguistique que l'on observe principalement
chez les enfants d'un certain âge, quand ils font leurs premiers
essais de langage intellectuel et qu'ils s'expriment par
symboles isolés. A travers leur langage spontané fait de cris,
de gestes et de jeux de physionomie, les quelques mots ou
les gestes conventionnels qu'ils ont appris, apparaissent égrenés
et porteurs chacun non seulement d'une idée mais aussi
d'une pensée : un jugement, une volition ou une émotion qui
veut s'exprimer. Il y a là un beau champ d'observations et
d'études. On verrait en examinant de près ces phénomènes
comment l'enfant acquiert un symbole, quelle valeur il y
ajoute et comment cette valeur se modifie avec l'expérience
219et le développement intellectuel. Malheureusement le langage
des enfants constitue un cas trop particulier pour qu'on
puisse y étudier la genèse et l'évolution du symbole-phrase
sans que rien d'étranger ne vienne s'y mêler. L'enfant est
constamment sous l'influence du parler des grandes personnes.
Il ne peut pas faire de création grammaticale vraiment
autonome. Le véritable objet de cette première étude ce serait
le parler d'une collectivité d'enfants abandonnés à eux-mêmes
et demeurant longtemps au degré intellectuel qui correspond
à cette grammaire rudimentaire et presque amorphe.
C'est là un objet imaginaire que la nature n'offre nulle
part à notre observation. Mais que la réalité nous fournisse
ou ne nous fournisse pas l'objet qui correspond exactement
à cette symbolique évolutive que nous mettons comme première
discipline des évolutions du langage, cela n'ôte rien à
son droit d'exister. Nombreuses sont les sciences dont l'objet
doit être abstrait de la réalité et qui ne peuvent se constituer
que grâce à une simplification arbitraire de l'objet réel
qu'offre la nature. De solides déductions psychologiques
appuyées et contrôlées par l'observation des faits où le phénomène
de symbolique évolutive se manifeste à l'état relativement
pur, voilà la base nécessaire et suffisante de cette
première discipline.
Les résultats et les méthodes de la symbolique évolutive
ne peuvent s'appliquer directement à nos phrases grammaticales
que lorsque c'est leur sens total qui est en jeu, quand
la phrase elle-même évolue comme un symbole isolé. C'est le
cas principalement avec ces petites phrases de forme interrogative,
désidérative ou elliptique le plus souvent, qui sont
employées comme interjections dans le discours familier.
Je vous crois est une simple affirmation, à qui le dites-vous ?
une simple question, qui servent l'une et l'autre à confirmer
avec un peu d'emphase ce qui vient d'être dit. Que dites-vous
là ? peut exprimer l'étonnement ou l'indignation. Il
s'agit au fond de l'emploi figuré de certains procédés syntactiques
qui perdent leur sens propre pour prendre un
220sens dérivé conforme à l'ensemble de la phrase et à la situation.
On le voit bien par l'exemple du si hypothétique qui
sert à menacer : si tu le touches… ! à exprimer la crainte :
s'il faisait un faux pas… ! ou une idée plaisante : si nous
lui faisions une niche… ! etc. Quelques-unes de ces phrases
deviennent des moyens d'expression constants, si bien
qu'on ne se soucie plus guère de leur sens primitif. Tel est
le cas pour notre locution : s'il vous plaît, dont l'emploi serait
souvent ironique, si elle n'était pas l'expression obligée
d'une certaine politesse. Voilà une phrase qui a subi une
transformation de valeur tout à fait complète et assimilable
à celle qui affecte un symbole-phrase.
Quand il s'agit d'étudier l'évolution que peuvent subir dans
leur sens les symboles qui sont agencés entre eux comme
parties constitutives d'une phrase, le problème est plus complexe.
Ces symboles existent dans des conditions toutes particulières.
Nous avons comparé nos phrases à des organismes
vivants dans lesquels chaque symbole a été spécialisé et déformé
en vertu de cette spécialisation, comme les cellules le
sont dans la plante ou dans l'animal (pp. 140 sv.). De même que
dans l'être organisé, chaque cellule est conditionnée dans sa
forme et sa fonction par toutes les autres dont elle n'est que
le complément, de même, dans la phrase, chaque symbole
n'existe que dans sa relation avec les autres symboles et porte
des caractères de forme (nous entendons ici la forme abstraite)
et de valeur conformes à cette relation. Il y a solidarité
entre les diverses parties de la phrase, et l'évolution des
valeurs de ces parties ne peut se faire en dehors de cette solidarité.
Il n'est plus possible de considérer ici le symbole qui
évolue comme quelque chose d'isolé, d'autonome. C'est une
partie d'un tout, inséparable de ce tout avec lequel il fait
corps, et quand il évolue, cette évolution a des causes et des
conséquences dans le reste de la phrase.
Quelque complexe que soit ce nouveau problème, nous en
connaissons cependant déjà toutes les données. Nous le poserons
221dans ses vrais termes, si nous combinons les méthodes
de la symbolique évolutive avec les résultats de la morphologie
statique. Par cette dernière science nous avons appris
non seulement ce que sont, mais surtout ce que peuvent être
ces parties constitutives de la phrase grammaticale et les
conditions de leur existence dans le langage concret. La symbolique
évolutive nous prêtera ses analyses psychologiques ;
c'est elle qui nous a enseigné comment tout ce qui naît et évolue
en grammaire se résout rationnellement en trois phases
correspondant à trois ordres successifs de conditions, et que
pour la commodité nous représentons par ces trois vocables :
ontogenèse, phylontogénèse, phylogénèse.
Ici encore la genèse et l'évolution se confondent, et la morphologie
évolutive se laissant guider par les déductions logiques
de la morphologie statique, aura à montrer comment les
symboles isolés se sont transformés en fragments de phrases,
et comment de degré en degré sur l'échelle des procédés syntactiques
de plus en plus parfaits, ces symboles ont marché
vers une spécialisation plus complète. Par là elle montrera
du même coup comment ces symboles nouveaux dans ces
conditions déterminées par une morphologie plus complexe,
restent des créations d'une fixité toute relative et sujettes à
évoluer par l'effet des mêmes forces qui les ont fait naître.
La théorie des évolutions de sens à l'intérieur des phrases
organisées est l'objet propre d'une science bien connue qui a
déjà donné lieu à de nombreux travaux soit de la part des
historiens de la langue, soit de la part des psychologues.
Nous voulons parler de la Sémantique appelée aussi Sémasiologie.
Les linguistes, lassés de rechercher des lois phonétiques et
se rendant bien compte que cela n'était encore que l'écorce
du langage, ont cherché à pénétrer plus avant dans l'intimité
de sa vie, et l'ont fait généralement en étudiant la « vie
des mots ». Les faits qui s'observent dans ce domaine sont
d'ailleurs bien propres à piquer la curiosité du chercheur et
222à provoquer la sagacité des explications. Les psychologues
ont suivi, et nous avons vu que Wundt a consacré l'avant-dernier
chapitre de son livre à ce sujet.
Mais c'est assigner un rôle trop étroit à la sémantique que
de borner son domaine à l'étude des transformations de sens
des mots. Le mot est une entité complexe et mal définie, et la
phrase, nous le savons, se décompose en dernière analyse non
en mots, mais en symboles. Les transformations de valeur des
symboles, voilà l'objet réel de la sémantique, et ce problème
résolu, c'est la solution aussi de tout le problème de la morphologie
évolutive, parce que si nos phrases ne sont expressives
qu'en tant qu'elles sont des agencements de symboles, il
est évident que toute évolution morphologique se peut ramener
à un nombre plus ou moins grand d'évolutions sémantiques
portant sur les divers symboles qui entrent en ligne de
compte.
Nous nous sommes servi dans le chapitre précédent d'un
certain nombre d'exemples pour montrer comment se produisait
une évolution morphologique : il ferait beau voir, de
par le roi, viens-tu ? ils sont à table, et nous avons constaté
que ces groupes de symboles, tout en gardant le même sens
global, avaient changé dans la valeur de leurs parties ; des
symboles anciens n'avaient plus la même valeur, et des symboles
nouveaux étaient apparus ; ce sont là autant de phénomènes
sémantiques.
Cependant la sémantique n'épuise pas absolument le problème
de la morphologie évolutive. Dans les exemples ci-dessus
les symboles n'ont pas seulement changé de valeur, mais
ils ont aussi changé de relations entre eux. Prenez par
exemple l'adjectif beau dans il ferait beau voir, qui a passé du
sens de cela ferait un beau spectacle à celui de il serait beau
de voir. Si je le considère à lui tout seul, je puis dire qu'il a
perdu sa qualité d'adjectif pour devenir quelque chose d'autre
que nous ne nous attarderons pas à déterminer. Mais je puis
aussi le considérer dans sa relation, et dire qu'il n'est plus
attribut de voir, mais qu'il est devenu avec le verbe faire,
223partie intégrante du prédicat. Il s'est donc détaché de voir
pour s'attacher à faire ; l'agencement de la phrase a été
modifié. A côté du changement ou des changements de valeur,
il y a donc le changement syntactique. La sémantique a besoin
d'être complétée par la syntaxe évolutive. Dans leur ensemble
ces deux disciplines constituent la morphologie évolutive
générale.
Il est évident que le problème était simple quand il s'agissait
du symbole-phrase. Dans la symbolique évolutive, symbole
et phrase ne faisaient qu'un et évoluaient du même
coup. Rien encore n'était venu dissocier leur unité primitive.
Quand cette dissociation se sera produite, le problème aura
désormais deux faces suivant qu'on le posera à propos du
symbole ou à propos de la phrase. Le symbole change de valeur ;
la phrase, en principe, garde sa valeur mais change de
structure. Quand au contraire, c'est la phrase qui change de
valeur sans modifier sa structure, nous retrouvons un problème
analogue à ceux de la symbolique évolutive. C'est ce
que nous avons dit plus haut. S'il arrive parfois que les deux
phénomènes se trouvent combinés, qu'une phrase change à la
fois de valeur totale et de structure, c'est un fait complexe à
analyser en deux faits distincts, dont le premier — le changement
de valeur — ressortit à la symbolique évolutive, et
le second, qui y est emboîté — le changement de structure,
— à la morphologie évolutive générale.
Si maintenant nous considérons cette morphologie évolutive
et ses deux parties : la sémantique et la syntaxe, la question
importante qui se pose, c'est de savoir quelle relation
existe entre le problème sémantique et le problème syntactique.
Ceux qui se sont occupés de sémantique ne semblent guère
avoir pensé à cette question, et cela bien à tort. La cause
en est sans doute qu'ils n'ont pas compris l'intime solidarité
de ces deux ordres de problèmes, et cela est en relation avec
le fait qu'ils ont abordé la sémantique sous un angle trop
224étroit en étudiant les destinées des mots et non pas celles des
symboles.
Il est cependant évident qu'on trace ainsi à la sémantique
des limites arbitraires et mal définies. Vous étudiez l'histoire
d'un substantif comme travail par exemple, qui vient du
nom d'un ancien supplice (trĭpalium « le supplice des trois
pieux »), celle d'un verbe comme ravir qui sous ses deux acceptions
dérive du latin rapĕre, celle d'une préposition comme
chez qui bien que dérivée du latin casā, « dans la maison de »
a pris un sens plus étendu : chez les Grecs il n'y avait point
de théocratie ; j'ai lu chez quelque auteur, etc. Vous allez plus
loin, et vous nous dites quelles acceptions ont eues au cours
du temps, des mots comme de, à ou que, et quels rôles ils ont
par conséquent joué ; mais pourquoi vous arrêter là, et n'est-ce
pas un problème analogue à résoudre par les mêmes méthodes,
que de nous renseigner sur la valeur expressive d'un
cas comme le génitif ou le datif, ou sur celle d'un temps ou
d'un mode de verbe ? Une fois ceci admis — et nous ne
voyons pas comment on pourrait ne pas l'admettre — , on
s'aperçoit de quelle manière nos règles de syntaxe et la sémantique
sont solidaires ; on découvre cette relation étroite
et constante qu'il y a aussi bien au point de vue statique
qu'au point de vue évolutif entre la valeur expressive des
éléments de la phrase et sa structure, et l'on se trouve en
face de la question que nous venons de poser.
La première réponse qu'on est tenté de faire à cette question,
c'est de dire qu'il faut distinguer dans chaque mot entre
ce qui dans le mot est idée de représentation, contenu matériel
pour les sens, et ce qui est idée de relation ; entre ce que le
symbole vaut pour lui-même et ce qu'il vaut par rapport aux
autres symboles. Prenons par exemple le mot cheval, il y a
dans sa valeur un élément qui s'adresse à l'imagination, une
représentation générale qui apparaît devant les yeux, puis
il y a sa qualité de substantif qui n'est qu'une forme intellectuelle ;
la même représentation se trouve dans l'adjectif chevalin
225et également, bien que compliquée d'éléments nouveaux,
dans le verbe chevaucher et dans la locution adverbiale
à cheval ; cependant la forme logique est toute différente. On
dirait alors qu'il y a une transformation sémantique quand,
en partant du sens originel de cheval, on arrive à dire : un remède
de cheval pour dire un remède très violent, ou : un moteur
de dix chevaux, en prenant ce substantif pour désigner
une unité arbitraire de force ; que par contre la transformation
serait d'ordre syntactique, quand la forme logique est
touchée ; à défaut d'exemple concernant ce substantif cheval,
nous citons l'emploi du substantif pris adjectivement tel
qu'on le trouve avec beaucoup d'autres noms d'animaux :
« Le plus âne des trois n'est pas celui qu'on pense. »
Cela semble très facile en théorie, mais la grammaire ne
connaît pas cette distinction-là. L'étude de la morphologie
statique le montrerait clairement. Nous devons nous borner
ici à de courtes indications qui justifieront ce que nous venons
d'avancer, sans épuiser le sujet.
Nous constatons d'abord que si l'on veut distinger les diverses
sortes de valeur, il n'en a pas deux, mais trois. A côté
des idées de représentation qui ont leur origine dans ce que
les sens fournissent, et des idées de relation qui sont d'ordre
intellectuel, viennent se placer d'autres idées que nous appelons
modales (p. 35), et qui correspondent aux diverses catégories
de la volonté. Les idées modales sont tout entières
dans l'attitude prise par le sujet à l'égard de l'objet auquel
il pense : ainsi le doute, l'affirmation réservée, la concession,
l'interrogation, le souhait, l'ordre catégorique, etc. en sont
des exemples.
Ceci accordé, il faut remarquer que la structure des phrases
dépend dans chaque langue essentiellement des distinctions
de classes établies entre les mots, et que la classe de mot se
reconnaît grâce à un ensemble plus ou moins compliqué de
règles de dérivation, flexion, composition 130, etc. Il est tout à
226fait exceptionnel en effet, qu'une classe existe en vertu d'un
symbole spécial qui en soit l'expression unique et constante,
comme le suffixe -ment des adverbes qualificatifs du français
(naturelle-ment, complète-ment) ; dans l'immense majorité des
cas, c'est l'ensemble des règles auxquelles un mot est soumis
dans la phrase qui le fait attribuer avec certitude à sa classe 131.
Toute la syntaxe est donc dans les règles, et comme toutes
les règles, même celles de l'ordonnance, impliquent ainsi que
nous l'avons montré (pp. 115 sv.), l'emploi d'un ou de plusieurs
symboles, la syntaxe elle-même repose sur les symboles.
Or ceux-ci — et c'est là que nous voulions en venir — quelle
que soit leur nature, expriment indistinctement des idées des
trois espèces ci-dessus désignées, comme il est facile de le faire
voir par quelques exemples.227
Prenons d'abord la flexion. Quand elle sert à marquer la
différence du masculin et du féminin, elle correspond évidemment
à une idée de représentation : marquis, marquise ;
cuisinier, cuisinière ; paon, paonne ; aîné, aînée.
On nous affirme que la distinction des genres remonte
à celle qui existait à l'origine entre deux degrés de dignité,
celle d'un plus ou moins grand respect. C'était donc
là une différence modale. Mais il y a plus, quand on voit
l'usage que nous en faisons maintenant en disant : un
beau palais, une belle maison, nous devons avouer que cette
différence dans la forme de l'adjectif ne correspond à aucune
idée, et que certains symboles n'ont qu'une valeur purement
grammaticale.
Un impératif comme viens, un subjonctif désidératif comme
vienne (ton règne vienne), représentent la flexion mise
au service d'une idée modale. Quant à la flexion servant à
exprimer des idées de relation, il ne serait pas difficile d'en
multiplier les exemples : les cas, les personnes, les temps, la
distinction de l'actif et du passif, de l'adjectif et de l'adverbe,
pour autant que la flexion les représente, peuvent être
cités ici.
Nous pouvons faire exactement la même démonstration
pour ce qui concerne les règles de composition. On enseigne
qu'en français les noms géographiques de fleuves, de pays,
de montagnes, se composent avec l'article : la France, la
Seine, le Mont-Blanc ; mais que les noms de villes n'ont pas
besoin de cette particule : Paris, Genève. Voilà une différence
de syntaxe qui repose uniquement sur une idée de
représentation matérielle. La règle de la construction interrogative :
viens-tu ? Pierre viendra-t-il ? etc., correspond
au contraire à une idée modale, tandis que celle qui
régit la place des pronoms conjoints régimes ou sujets :
je te le donne, je le lui donne, nous nous amusons, etc., a
pour base des distinctions d'ordre purement logique concernant
les relations qui existent entre les termes en présence.228
Si donc nous ramenons la syntaxe à ses éléments primordiaux,
nous devons avouer qu'elle est loin d'être fondée uniquement
sur des distinctions d'ordre logique.
D'autre part, on peut dire aussi que le lexique non plus
n'est pas basé seulement sur des idées de représentation,
comme il faudrait l'admettre pour que la distinction entre
l'élément représentation et l'élément relation dans la valeur
du mot, fût correcte. Si on élimine du mot tout ce qui est
d'ordre syntactique, tout ce qui concourt à la détermination
de sa classe et de son rôle grammatical, on obtient un radical
qui exprime l'idée commune à tous les mots de la même
famille. Or ces radicaux représentent eux aussi des idées
de tout ordre. Le plus grand nombre correspondent à des
représentations d'objet contingents comme : cheval, chevalin,
chevaucher ; la marche, marcher, marcheur, marche ! Mais il
y en a aussi qui expriment des idées modales : peur, épeuré,
faire peur, de peur de ; désir, désirer, désireux, ou des relations
logiques : cause, causalité, causer, à cause de, etc. 132.
De quelque côté que nous nous tournions, nous nous trouvons
donc dans l'impossibilité de distinguer le mot et la syntaxe,
comme si c'étaient là deux ordres de faits correspondant
à deux ordres d'idées.
Selon nous la vraie définition de ce qui est sémantique
par opposition à ce qui est syntactique, est beaucoup plus
229simple et repose sur un principe empirique. La différence
gît non pas dans ce qui est exprimé, mais dans le procédé.
Quand on a affaire avec le procédé fondamental de toute
expression grammaticale sous sa forme la plus simple selon
la formule :
Symbole a = valeur b,
c'est un fait d'expression dont les variations, en ce qui
concerne le second terme, ressortissent à la sémantique.
Quand on a affaire à un procédé plus compliqué, dans lequel
la valeur est déterminée non pas seulement par le symbole,
mais aussi par une règle relative à l'agencement de ce
symbole avec d'autres, alors on est dans le domaine de la
syntaxe, parce que ce symbole et sa règle constituent un fait
syntactique. Ainsi tout ce qui est du ressort de la flexion est
d'ordre syntactique, parce que les suffixes mis en œuvre n'ont
aucune valeur en dehors de leur emploi conforme aux paradigmes
de la grammaire.
Et nous ajoutons ceci, c'est que le langage a une tendance
dans son perfectionnement à se créer des procédés d'expression
syntactique pour les idées les plus générales, pour celles
qui dans la pensée sont d'une application constante et donnent
lieu à des alternatives qui reviennent sans cesse : masculin
— féminin, doute — certitude, passé — présent — futur,
sujet — régime. Ces idées-là, qui ont d'ailleurs aussi leur expression
lexicologique, sont à la base de toutes les règles de
syntaxe, de telle sorte que si l'on voulait absolument distinguer
les valeurs syntactiques des valeurs sémantiques, il faudrait
en chercher le critère dans le caractère très variable
de la plus ou moins grande généralité.
Remarquons maintenant que la définition que nous venons
de donner du fait sémantique et du fait syntactique implique
un emboîtement. Le fait sémantique est représenté par
la formule :
(I) Symbole a — valeur b230
Le fait syntactique pourrait l'être d'une façon toute générale
comme suit :
(II) Symbole a (sous certaines conditions d'agencement avec
d'autres symboles a′, a″, etc.) = valeur b,
Il est évident que la première formule constitue un fait
intelligible (sinon génétiquement explicable) par lui-même.
La seconde formule de même, mais elle peut s'analyser en
deux éléments. Le premier est une formule sémantique, qui
s'en abstrait sans peine si l'on néglige pour un moment le
contenu de la parenthèse ; on obtient alors :
(III) Symbole a = valeur b,
formule incomplète, qui n'est pas entièrement vraie, mais
qui est tout aussi intelligible que la formule I. L'autre élément,
c'est la parenthèse qui vient s'y ajouter, et les conditions
d'agencement nécessaires au symbole a pour qu'il ait sa
valeur b. Il est bien évident que ces conditions n'ont ni raison
d'exister, ni sens en dehors de la formule sémantique à laquelle
elles s'appliquent. Et ce que nous disons là du simple
fait à l'état statique, s'applique de même à toute création ou
transformation de même ordre.
Quand un symbole naît, change de sens, ou meurt, c'est
un phénomène relativement simple, qui a, nous l'avons dit,
dans nos phrases organisées, des causes en dehors de lui, mais
qui peut bien se concevoir abstraction faite de ces causes. Le
symbole a valait b, maintenant il vaut b' : voilà un fait absolument
défini et parfaitement pensable. Quand au contraire
une règle de syntaxe naît, quand un agencement de symboles
devient indispensable pour l'expression d'une idée, il faut
de toute nécessité qu'il y ait eu ou création de symbole, ou
modification du sens des symboles mis en œuvre. Sans cela à
quoi la règle servirait-elle ? Si les symboles restent tous
identiques à eux-mêmes, l'agencement est une pure superfluité ;
lui-même n'est qu'une chose abstraite, une forme
vide, incapable d'avoir une valeur expressive ; c'est le symbole
231dans telle ou telle disposition qui prend une certaine
valeur, aussi le phénomène ne serait-il pas concevable si l'on
voulait faire abstraction de la transformation sémantique.
Prenons un exemple pour illustrer cette démonstration, qui
sera concluante dès qu'elle s'appuyera sur quelque chose de
concret. Un cas excessivement simple nous suffira : la création
de la forme interrogative du verbe : viens-tu ? Tu postposé
au verbe est devenu la marque de l'interrogation
pour la seconde personne du singulier. Dire que c'est
la postposition seule qui porte cette nouvelle valeur, c'est ne
rien dire d'intelligible. Le symbole tu a réellement pris un
nouveau sens, puisque si nous disons par exemple : viens toi
ou viens Paul, ces groupes n'ont pas pour nous de valeur
interrogative. Preuve en soit encore ce qui s'est passé pour le
pronom de la troisième personne, lequel en faveur de ce nouveau
rôle qui lui était échu, est sorti de son rôle primitif et
s'emploie avec un adverbe démonstratif dans : voilà-t-il pas, et
avec un verbe à la première personne dans : j'ai-ti soif ?
(p. 168). Il y a donc un premier changement sémantique : tu,
simple pronom, est devenu pronom interrogatif. Seulement
cette nouvelle valeur de tu est conditionnée par sa position
relativement au verbe qu'il régit, et c'est cela qui constitue la
création syntactique, fait accessoire et secondaire qui ne peut
exister, et même être pensé, que dans sa liaison avec le premier.
Si tu n'avait pas ce sens nouveau, la postposition à elle
seule serait incapable de rien exprimer.
Quand deux ordres de phénomènes sont emboîtés l'un dans
l'autre, les faits du premier ordre, nous le savons, sont concevables
par eux-mêmes, et ceux du second au contraire ne
peuvent être pensés que comme impliquant un fait de premier
ordre. Ce sont là les premier et troisième caractères de
l'emboîtement. Nous voyons qu'ils se constatent très évidemment
quand on compare la sémantique avec la syntaxe évolutive
qui y est emboîtée.
Il y a un second caractère de l'emboîtement qui ne se réalise
pas partout, mais qui en donne une démonstration expérimentale
232là où on peut le constater. Il consiste, on s'en souvient,
en ce que la nature elle-même fournit des faits du
premier ordre existant en dehors de toute combinaison avec
l'ordre subordonné. Ce caractère se rencontre-t-il ici ? Y a-t-il
dans notre langage organisé des changements de valeur
qui atteignent certains symboles sans que la syntaxe, l'agencement,
la morphologie abstraite de la phrase en ce qui concerne
la relation des symboles entre eux, en reçoive un contrecoup ?
Nous pensons que oui, et la démonstration, tout expérimentale,
n'est pas difficile à faire.
Quand des mots appartenant aux quatre grandes catégories
grammaticales (verbe, substantif, adjectif, adverbe qualificatif)
changent de valeur, sans que leur catégorie, leur rôle
grammatical en soit modifié, cette transformation n'affecte
en rien l'agencement syntactique de la phrase. Comparez
par exemple les trois phrases suivantes où le verbe marcher
est employé dans trois sens divers : le petit enfant marche bien,
l'élève marche bien, la montre marche bien. On voit qu'à l'exception
du verbe marcher, tous les symboles qui sont communs
aux trois phrases se présentent dans les trois cas identiques
à eux-mêmes. C'est là donc un phénomène strictement
sémantique, et c'est à étudier des faits de ce genre que se
sont attachés généralement ceux qui ont traité de cette
science. A regarder les choses de plus près on doit remarquer
qu'au fond ce n'est pas le mot qui a changé de sens, mais
uniquement le symbole qui lui sert de radical. Tout ce qui
en lui exprime son rôle verbal n'est pas modifié ; par contre
la transformation de sens qui a atteint ce radical, s'est plus
ou moins propagée à tous les mots de la même famille ; on
dit : cette montre a une bonne marche ; la marche de la classe
est satisfaisante.
On peut aussi observer des transformations de valeurs
analogues, c'est-à-dire purement sémantiques, chez toute
espèce de symbole quel qu'il soit : les parties constitutives
des mots, les affixes de dérivation ou de flexion y sont sujets,
de même que les petits mots des classes qu'on réunit sous
233les noms généraux de pronoms et de particules. Supposez par
exemple qu'un génitif qui a exprimé la provenance arrive à
signifier la possession ; qu'il soit représenté par une forme de
flexion ou par une préposition, la valeur de ce symbole aura
été modifiée, mais non pas sa syntaxe. La valeur du génitif a
été transformée ou élargie exactement comme celle du verbe
marcher, par des actes psychologiques que nous connaissons,
à l'occasion de certains cas favorables, comme lorsqu'on dit :
pueri hujus viri, les enfants de cet homme, ce qui se peut
interpréter comme : les enfants qui sont nés de cet homme, et
les enfants qui appartiennent à cet homme. Le fait est syntactique,
dans un certain sens, puisque c'est un procédé d'expression
syntactique qui a changé de valeur ; mais le procédé
reste le même, et le phénomène d'évolution n'ayant rien
touché à l'agencement des symboles, est parfaitement assimilable
à celui qui affecte la valeur du radical d'un verbe ou
d'un substantif.
Les groupes de mots également sont susceptibles de modifications
sémantiques, pour ne rien dire des phrases entières
dont il a été question plus haut (p. 220). Dans l'exemple : ils
sont à table pris dans le sens de : ils sont à dîner, c'est le
groupe à table qui a changé tout entier de valeur, à preuve
que si on veut l'analyser dans ses parties, on s'aperçoit que
chacun de ses éléments a subi dans son sens une transformation
complémentaire, et que la somme de ces transformations
équivaut au phénomène total. On le voit en traduisant
cette phrase en allemand : sie sind am Tische, sie sind beim
Essen ; la préposition purement locative a pris une valeur
temporelle.
Mais ce qu'il y a d'intéressant à remarquer quand on étudie
la manière dont les langues évoluent, c'est que beaucoup
de ces transformations sémantiques, sans effet sur la syntaxe
au début, ont eu plus tard des conséquences inattendues dans
ce domaine. Il vaut la peine de nous arrêter un peu sur ce
234point qui touche à la question très intéressante des relations
historiques de ces deux ordres de faits.
En vieux français le mot correspondant au latin homo
était employé pour indiquer un sujet indéterminé, un
homme quelconque : Cinquante piez i poet hom mesurer dit la
Chanson de Roland (v. 3167, éd. Gauthier). C'est une transformation
de sens analogue à celles que nous avons vues plus
haut relatives au génitif et au verbe marcher ; la valeur du
mot a été à peine élargie. Cet agencement de phrases est
d'ailleurs parfaitement conforme à toutes les règles alors en
usage, puisqu'un substantif sans article avait justement cette
valeur de un quelconque qui est attribuée ici au mot hom 133:
Hom qui la vait repairier ne s'en poet, lisons-nous ailleurs dans
le même texte (v. 292) ; c'est exactement le même emploi du
même mot. Où commence la transformation syntactique ?
C'est quand, en vertu de cette nouvelle valeur, ce mot se
désolidarise de sa classe originelle et se soumet à des règles
d'agencement qui sont identiques à celles d'un pronom
comme il ou nous. Nous ne disons rien de sa forme orthographique
ou phonétique qui n'est qu'une conséquence secondaire
du fait morphologique, mais nous voyons directement
la transformation syntactique opérée en comparant les
deux phrases ci-dessus avec leur traduction en français moderne :
on peut bien y mesurer cinquante pieds et un homme
qui y va, ne peut en revenir.
Il fut un moment où des règles nouvelles s'établirent relativement
à l'emploi des substantifs. D'abord tous les substantifs
indéterminés commencèrent à être accompagnés de
235l'article un ; puis la distinction du cas sujet et du cas régime
fut oubliée, et on se mit à employer indistinctement dans
tous les cas la forme du cas régime home ou homme au lieu
de hom. Ce mot subit l'effet de toutes ces règles nouvelles
dans la seconde phrase ; mais dans la première, grâce à une
assimilation de ce mot avec un pronom personnel, assimilation
que l'agencement de la phrase permettait, il échappa à
ces innovations, et il conserva et sa forme de cas sujet et sa
syntaxe sans article. C'est à ce moment-là que l'évolution sémantique
a eu des conséquences dans l'ordre de la syntaxe.
C'est un exemple parmi beaucoup d'autres, et la constatation
que nous faisons là, est en parfait accord avec l'opinion
émise plus haut, qu'aucune idée n'est spécifiquement syntactique,
mais que toutes les idées dont la pensée se compose,
sont susceptibles de devenir l'occasion d'une règle de syntaxe,
pourvu qu'elles possèdent un degré suffisant de généralité.
Quand une valeur nouvelle est attribuée à un symbole
par l'effet d'une transformation purement sémantique, on
n'a aucune garantie qu'on n'en viendra pas d'une manière
ou d'une autre à conditionner cette valeur en la rattachant à
un certain agencement syntactique ; et les chances pour que
ce phénomène ultérieur et secondaire se produise, seront particulièrement
grandes quand l'évolution sémantique aura
eu pour effet d'élargir et de généraliser le sens primitif du
symbole en question.
C'est ce qui est arrivé pour le mot homo dans le cas que
nous venons d'étudier. Quand, en vieux français, le mot pas
a perdu son sens propre pour prendre celui de petite mesure,
petite quantité, pouvait-on prévoir que le système de la négation
en serait entièrement changé ? Ce fut pourtant le cas,
parce que ce mot dans cette nouvelle acception a été très
étroitement composé avec le mot ne, et que ce composé ne…
pas a subi une évolution sémantique spéciale à la suite
de laquelle il est devenu l'équivalent ordinaire de la
négation absolue. Ensuite pas lui-même a été considéré
comme un adverbe de négation et a été employé comme tel.236
L'évolution morphologique du langage nous apparaît donc
faite, sinon entièrement du moins en grande partie, d'évolutions
sémantiques qui sont suivies — non pas toutes mais
quelques-unes — de conséquences syntactiques à plus ou
moins longue échéance. Nous disons que ces phénomènes
constituent une partie au moins de l'évolution morphologique.
Pour affirmer que toutes les évolutions de cet ordre se
font de cette manière-là, il faudrait que toute création syntactique
se composât non seulement de deux éléments : l'un
sémantique qu'on en peut abstraire, et l'autre proprement
syntactique qui se combine avec lui, mais aussi de deux moments
successifs correspondant à ces deux éléments ; que
dans viens-tu par exemple devenant l'interrogatif viens-tu ?
d'abord tu changeât de sens, et qu'ensuite seulement cette
nouvelle valeur fût liée à une certaine condition. Cela ne
nous semble pas devoir être admis ; tu n'a pris sa valeur
nouvelle que dans les limites prescrites par la règle, et ici la
création sémantique et la création syntactique nous apparaissent
comme simultanées.
Même dans le cas où la transformation de syntaxe semble
venir simplement s'ajouter à celle de valeur, le phénomène
est en réalité un peu plus complexe. Prenons par exemple
celui du pronom on qui, nous l'avons vu, n'a guère changé
de sens depuis le vieux français où il était un véritable
substantif ; il n'en est pas moins clair qu'au moment où l'assimilation
au pronom personnel s'est produite, il y a eu autre
chose qu'un phénomène grammatical, mais que ce mot, se
dissociant d'avec le substantif, a représenté désormais pour
l'imagination et la pensée quelque chose de beaucoup plus
indéterminé qu'auparavant. Nous n'hésitons pas à dire : on
ne perd pas son temps dans une fourmilière, en entendant
par « on » des fourmis. Nous admettons donc que les transformations
sémantiques dont nous avons parlé plus haut, ne
font que préparer la transformation syntactique ultérieure,
mais que cette dernière, conformément à la définition que
nous en avons donnée, a à la fois un aspect sémantique et un
237aspect syntactique. L'évolution de valeur commencée depuis
longtemps, s'y achève pour ainsi dire, en aboutissant à un
procédé d'expression générale. Tel est le cas pour on, tel est
le cas pour pas et pour toutes les autres créations du même
genre.
A défaut d'une priorité chronologique dans l'évolution,
l'élément sémantique a cependant toujours une priorité psychologique.
Nous avons vu qu'il est concevable à lui seul,
sans que l'élément de syntaxe qui l'accompagne entre en
ligne de compte, alors que la réciproque n'est pas vraie. Nous
l'avons démontré d'une façon abstraite et au point de vue de
la grammaire. On peut le montrer aussi par l'analyse psychologique,
comme nous allons essayer de le faire pour terminer
ce qui concerne cette importante question des relations
de la sémantique et de la syntaxe.
La structure d'une phrase est quelque chose d'abstrait,
quelque chose qui pour le sujet parlant ou entendant n'existe
que par son contenu, comme les formes géométriques et les
nombres n'existent pour nos sens que par les objets concrets
qui les réalisent. On ne pense pas une structure grammaticale ;
on pense des idées qui sont entre elles dans des relations
logiques et grammaticales. Le grand procédé de l'expression
linguistique consiste à faire rentrer toutes les idées
dans les catégories de l'imagination, et à matérialiser ainsi
la pensée, à ramener ce qui est abstrait et insaisissable en
lui-même à la forme de ce qui est perceptible et imaginable.
Un objet (substantif), son action (le verbe) et les attributs ou
qualités respectives de ces deux formes de l'existence (l'adjectif
et l'adverbe), voilà les quatre grandes classes de la
grammaire, qui sont en même temps quatre catégories de
l'imagination.
Si je dis : le vent secoue violemment les grands arbres, ou
l'ouvrier peint en bleu la muraille blanche, chacun des mots
de ces phrases (en faisant abstraction des articles et des prépositions
qu'on peut considérer comme incorporés à leur substantif)
238évoque quelque chose devant mes yeux, parle à mon
imagination. Si je forme maintenant une autre phrase absolument
identique au point de vue grammatical, mais dont aucun
terme ne corresponde directement à une perception des
sens, comme : l'envie dénigre lâchement les bonnes intentions,
je m'aperçois que les idées abstraites que cette phrase fait
défiler devant l'esprit et met en relation les unes avec les
autres dans une pensée, ont été traitées exactement comme
les idées plus concrètes énoncées plus haut. L'envie et les intentions
sont des substances comme le vent et l'arbre, l'ouvrier
et la muraille, et on leur attribue de la même façon
une action et des qualités. Les idées de toute espèce à tous
les degrés d'abstraction, sont traitées de la même manière.
Ici, il n'y a ni limite ni distinction ; et c'est justement la
puissance du langage humain que de tout pouvoir incarner
dans un symbole, et d'objectiver la pensée comme il objective
le spectacle du monde.
Développer ce point serait la tâche de la symbolique évolutive ;
il nous intéresse ici par les déductions qu'on en
peut tirer. Toutes les catégories grammaticales en dehors
et à côté des quatre grandes classes de mots, toutes
les déterminations qui sont à la base de nos flexions et de
nos règles syntactiques, n'existent que par leurs relations
avec les quatre catégories fondamentales ; elles les expriment,
elles les encadrent, elles sont mises à leur service. Demandons-nous
maintenant ce qui doit arriver quand j'entends
une phrase et que je cherche à la comprendre — nous savons
que c'est là le moment où toutes les transformations morphologiques
commencent à se produire — . J'y chercherai naturellement
des symboles ou des groupes de symboles qui
suscitent en mon esprit des représentations dominantes au
point de vue psychologique. Ce seront des substantifs ou des
verbes avec leurs attributs ; ce sont là des points d'appui de la
pensée. Les images dont j'aurai trouvé ou cru trouver l'expression
claire, celles qui auront été évoquées devant mes yeux,
influenceront naturellement la compréhension de tout le reste
239dans la phrase. Je chercherai ensuite dans les autres symboles
les éléments nécessaires pour unir ces images en un tout bien
agencé au point de vue de la logique et de mes habitudes
grammaticales. Si j'ai fait quelque part une erreur dans cette
attribution de valeur, et si cette erreur n'est pas indifférente,
il faudra, ou bien que je m'aperçoive de mon erreur, ou bien
que je corrige d'une façon complémentaire les autres valeurs
(voyez l'exemple : ils sont à table p. 234) et que je torde même
la structure grammaticale de la phrase, telle qu'elle avait été
pensée par celui qui parlait, pour la mettre d'accord avec
ma conception à moi. En un mot, l'aperception des symboles
dans l'intelligence des phrases, porte d'abord sur leur valeur
psychologique de représentation, et indirectement seulement
sur leur rôle logique et grammatical. Dans la phrase souvent
citée : il ferait beau voir, il s'agit avant tout de savoir si l'infinitif
évoque une idée de représentation dominante, comme
le ferait le mot spectacle par exemple, dont le mot beau
puisse être l'attribut, ou si l'imagination se porte de préférence
sur le mot beau en lui donnant une valeur prédicative.
Le premier qui a interprété les mots : habeo receptam
epistolam dans le sens actuel de j'ai reçu une lettre, a vu
surgir à l'occasion du mot receptam l'image de l'action de
recevoir plus nette que celle de l'action exprimée par habeo ;
de là la valeur prédicative qu'il lui a attribuée, et le changement
qui s'est en conséquence produit dans la relation logique
et grammaticale des termes en présence.
Avant de comprendre nos phrases et de les analyser, nous
les voyons et nous les sentons ; c'est l'ordre normal pour tout
ce qui entre dans notre conscience intellectuelle. Ce sont les
réactions qu'elles font naître spontanément dans notre être
affectif et dans notre imagination, qui provoquent l'aperception
et par conséquent la dirigent dans une grande mesure.
Ce n'est pas à dire en effet que l'intelligence soit purement
passive, tel n'est pas son rôle. Elle contrôle et corrige jusqu'à
un certain point cet apport de représentations et d'émotions
que les réactions spontanées de l'être affectif lui fournissent.240
Elle choisit, élimine ce qui n'est pas assimilable. Si
par exemple un homonyme comme ver, verre ou vers « vɛr »
provoque trois sortes de représentations disparates, elle s'attache
par l'attention à celle qui convient dans la pensée, et
repousse les autres dans l'ombre. C'est par l'attention aussi
qu'elle considère avec plus d'intensité les éléments qui sont
vraiment essentiels : les substances, les prédicats et leurs attributs ;
c'est par là qu'elle dirige l'évolution syntactique et
sémantique d'une façon conforme à ses fins.
On sait qu'à l'origine beaucoup de prépositions étaient des
adverbes qui se sont détachés du verbe pour s'attacher au
substantif. L'homérique βλεφάρων ἄπο δάρκυον ἧκεν, cité par
Bréal dans son Essai de Sémantique 134 devait à une époque
plus ou moins ancienne être analysé comme suit : βλεφάρων
(de ses paupières) ἄπο (dehors) ἧκεν (elle jeta, laissa échapper)
δάρκυον (une larme) ou : βλεφάρων (de ses paupières) ἄπο
ἧκεν (elle laissa échapper dehors, tomber) δάρκυον (une larme)
ἄπο était adverbe et caractérisait l'action de ἧκεν, et le génitif
du substantif βλέφαρον exprimait à lui seul l'éloignement,
la provenance. Cette phrase avait en dehors du sujet sous-entendu,
quatre éléments dont chacun représentait à l'origine
quelque chose de distinct et de net pour l'imagination :
les deux substantifs régimes : les paupières et la larme,
et puis le verbe et son adverbe, qui sont à peu près dans
la même relation qu'un substantif et son adjectif ; ἄπο (au
dehors) représente comme adverbe une qualité toute spéciale
et concrète de l'action. L'intervention plus efficace de l'intelligence
due au progrès intellectuel, provoque plus tard des
différences dans l'intensité de l'aperception. Les deux substantifs
et le verbe restent ce qu'ils sont : les éléments constitutifs
de la pensée, tandis que l'idée adverbiale se subordonne,
soit en s'unissant au verbe pour se composer avec lui (ἀφῆκεν,
elle rejeta, laissa tomber), soit en se rapprochant du substantif
avec le génitif duquel il semble concourir pour exprimer
241une relation dans l'espace (ἀπὸ βλεφάρων, hors des paupières).
Remarquons que ce symbole qui, à l'origine, avait une valeur
de représentation très caractérisée, n'a plus, quand il est
composé avec le verbe, de valeur que par rapport à lui, il
correspond à une modification de son idée ; tandis que devenu
préposition et joint au substantif dans le groupe ἀπὸ
βλεφάρων, il ne dit plus rien du tout à l'imagination ; il n'est
plus qu'une notion intellectuelle sans correspondant concret
possible, à cause de l'absence de l'idée verbale dont il est
l'attribut naturel.
Nous voyons donc comment, sous l'influence du facteur
intellectuel, l'attention et l'imaginaiion se sont détournées de
cette particule pour la rejeter parmi les éléments de grammaire
qui n'évoquent rien par eux-mêmes, mais qui servent
à l'agencement grammatical des idées. C'est à peu près ce
qui s'est passé aussi pour le mot pas et pour le mot hom qui
ont été vidés de toute valeur de représentation. Mais cela
serait interpréter ces faits d'une façon contraire à toute
bonne psychologie d'imaginer que ces symboles dans l'aperception
ont d'abord reçu un rôle grammatical, et qu'ensuite
on leur a attribué une valeur conforme à ce rôle ; c'est au
contraire la valeur qu'ils ont eue, soit au point de vue de
l'intensité, soit au point de vue de la qualité, dans la conscience
du sujet entendant, qui a déterminé comme conséquence
le rôle grammatical qui leur est échu.
Nous résumons ce long exposé. Le phénomène sémantique
existe souvent seul ; dans bien des cas cependant il est un
acheminement, une préparation à un phénomène d'évolution
syntactique. Toutefois l'évolution syntactique quand elle se
produit, implique toujours un nouveau phénomène sémantique ;
mais il faut remarquer que dans ce fait complexe le
facteur sémantique est le facteur déterminant, car c'est lui
qui a la priorité psychologique. C'est ainsi que nous résolvons
la question des relations entre la sémantique et la syntaxe, et
nous pensons avoir montré qu'à tous égards celle-ci est emboîtée
dans celle-là.242
Nous avons tracé plus haut le programme complet de ces
deux sciences théoriques, quand nous avons dit que le problème
des origines se confondait avec le problème de l'évolution ;
il suffirait de combiner les méthodes de la symbolique
évolutive avec les résultats de la morphologie statique pour
expliquer la création des divers procédés et des principaux
types morphologiques. On verrait naître ainsi successivement
après les plus frustes combinaisons de symboles juxtaposés,
la composition, la dérivation, la flexion, les procédés analytiques,
ainsi que toutes les combinaisons possibles de ces divers
instruments grammaticaux.
Plus la syntaxe évolue et se complique, plus les données
du problème sémantique se compliquent aussi, sans cependant
que les principes fondamentaux en soient modifiés.
On peut pourtant fort bien en théorie imaginer une sémantique
évolutive indépendante de la syntaxe évolutive. Il
suffit que cette science emprunte les éléments de ses problèmes
à la morphologie statique qui est connue, et que, sans
se demander comment les agencements nouveaux résultent
des changements de valeur, elle pose uniquement la question
de savoir de quelle manière dans un milieu grammatical
donné, dans un de ces états de langage que la science statique
fait connaître, la valeur des symboles peut évoluer. A cette
science viendrait se joindre ensuite la syntaxe évolutive qui
résoudrait à son tour le problème négligé ; elle montrerait les
états syntactiques procédant les uns des autres par l'effet de
phénomènes psychologiques et grammaticaux plus complexes
que ceux de la sémantique pure, et achèverait la tâche de
la morphologie évolutive.
En pratique il sera peut-être plus simple de ne pas dissocier
les deux disciplines. Le linguiste psychologue en possession
d'une méthode parfaitement sûre pour aborder et résoudre
lés questions de sémantique, pourra s'attaquer au problème
général de la genèse des syntaxes, et quand de
déduction en déduction, guidé par l'observation des faits, il
aura résolu tous les problèmes essentiels, il aura fourni des
243types d'analyses psychologiques et grammaticales qui seront
plus ou moins directement applicables à tous les cas que l'histoire
des langues peut présenter.
Nous en avons assez dit sur la sémantique pour faire voir
qu'elle doit être la marche à suivre dans l'étude de ses problèmes,
qu'il s'agisse des questions générales que se pose la
science théorique, ou des cas spéciaux qu'examine la science
des faits en expliquant les cas concrets de l'histoire. Mais avant
de quitter ce sujet, il nous reste à montrer quelles conséquences
découlent des vues que nous avons énoncées, relativement
à la méthode à appliquer dans les recherches de
syntaxe évolutive.
Toute évolution de syntaxe a pour cause une transformation
ou une création sémantique autonome — c'est-à-dire
qui n'est pas seulement l'effet secondaire d'une autre transformation
ou création sémantique, car alors cette dernière
serait la vraie cause. La première chose à faire sera donc de
bien déterminer dans sa forme abstraite et dans sa valeur, le
symbole qui subit cette transformation ou qui apparaît ; la
seconde sera d'expliquer ce phénomène sémantique ; la dernière
d'en montrer les conséquences en syntaxe. Ceci fait, il
faut naturellement considérer encore ce que le nouveau principe
de syntaxe, créé et admis d'abord par un individu, va
devenir dans la concurrence du langage collectif. On doit
peser soigneusement les circonstances qui peuvent entraver
ou favoriser son admission par la généralité des sujets parlants,
et pour cela il importe de porter son attention sur les
relations du nouveau procédé d'expression avec tout ce qui
dans la grammaire ou en dehors d'elle est en concurrence
avec lui. C'est ainsi que l'histoire des évolutions syntactiques
se ramène souvent à l'histoire d'un symbole et de ses concurrents.
Cette méthode des concurrences doit d'ailleurs s'appliquer
aussi à la sémantique.
Il ne faut pas confondre tout à fait le symbole avec ce que
nous avons appelé l'élément syntactique de flexion dans un
244travail où nous avons justement essayé de réaliser quelque
chose de ce programme 135. L'élément syntactique est un ensemble
de symboles dont les valeurs sont, au moins dans une
de leurs parties, exactement équivalentes ; la flexion les groupe
en une unité supérieure, et elles donnent lieu par conséquent
à des règles syntactiques communes. Tel est le passé
défini en français, qui a des symboles divers d'une voix à
l'autre, d'une personne à l'autre, d'une conjugaison à l'autre,
d'un verbe irrégulier à l'autre ; et tel est par conséquent
aussi l'imparfait du subjonctif qui en dérive, et dont nous
nous sommes occupés dans ledit travail. Ce serait à la morphologie
de définir et d'expliquer, mieux que nous ne pouvons
le faire ici en passant, l'élément syntactique de flexion ; il
correspond à ce qu'on appelle communément une forme grammaticale,
mais en tant qu'elle est employée avec une certaine
valeur, dans un certain rôle bien distinct des autres rôles
qui peuvent d'ailleurs lui échoir. Nous avons considéré l'imparfait
du subjonctif dans la seule expression du mode irréel
dans l'hypothèse. C'est un legs que le français a reçu du latin,
mais que le français a laissé tomber en désuétude. Nous lui
avons opposé successivement tous les concurrents auxquels il
a eu affaire, aussi bien ceux qui existaient déjà en latin (le
mode indicatif, qui n'exprime l'irréel qu'en vertu d'un procédé
extragrammatical, et le subjonctif présent), que ceux qui ont
surgi ultérieurement à la suite de phénomènes de sémantique
que nous avons essayé d'expliquer (le conditionnel et l'imparfait
indicatif, puis dans l'expression du passé, le temps
composé de l'imparfait du subjonctif lui-même et ceux des
formes verbales que nous venons de nommer). Dans chaque
cas nous avons tâché de montrer le comment et le pourquoi
du phénomène qui s'est produit, soit qu'il y ait eu élimination
d'un procédé en faveur de l'autre, soit qu'il y ait eu partage
du domaine commun suivant une détermination de valeur
à définir. Par ce moyen nous avons fait voir et fait comprendre
245aussi bien qu'il était en notre pouvoir, comment sur
un point spécial l'état du français est dérivé de l'état du
latin. Et cette méthode est applicable dans tous les cas.
Toutes les circonstances favorables ou défavorables qui président
à ces évolutions et qui dans la concurrence font pencher
la balance d'un côté plutôt que de l'autre, se peuvent
ramener à une norme constante : l'adaptation de plus en plus
parfaite de la forme grammaticale à la forme de la pensée
(p. 170). Cette adaptation a deux faces : d'une part l'aspect
plus spécialement psychologique qui veut que la forme de la
pensée grammaticale réponde au caractère psychique du sujet,
l'expression devant être analytique ou synthétique, prédicative
ou attributive, etc., suivant que telle ou telle forme de
l'activité psychologique est plus ou moins développée chez le
sujet parlant ; d'autre part l'aspect purement intellectuel qui
consiste en ce que l'organisme grammatical se perfectionne
au fur et à mesure que l'intelligence se perfectionne et que
la collectivité des sujets parlants devient capable de penser
d'une manière plus abstraite et plus rigoureuse.
Tandis que dans la morphologie statique on pouvait commencer
par faire voir le langage humain dans ses traits les
plus généraux, pour remonter de là aux types grammaticaux
particuliers qui correspondent aux types psychiques
divers des races ou des individus, ici, au contraire, il faut
toujours et dès le début avoir l'individu devant les yeux ;
c'est lui qui, soumis aux influences collectives, se crée pourtant
sa grammaire individuelle, et l'impose ensuite à la collectivité
dans la mesure où celle-ci est susceptible de recevoir
cette impulsion. Le point de départ est concret, il est pris en
pleine réalité psychologique.
La fin suprême de tous les exposés de morphologie évolutive
serait de montrer dans la manière dont à diverses époques
une collectivité donnée a réagi vis-à-vis des impulsions
individuelles, et dans l'évolution morphologique qui en est
résultée, la conséquence et la manifestation tangible d'évolutions
psychiques correspondantes ; et la science théorique de
246la morphologie évolutive aura atteint son but quand par ses
procédés d'analyse elle aura fourni l'instrument nécessaire à
cette démonstration.
Ce que nous avons exposé dans le chapitre précédent nous
dispense de répéter ici que tout ce qui concerne les transformations
brusques des sons dues à l'analogie ou à ce que nous
avons appelé la paralogie, est du domaine de la morphologie,
et que par conséquent les disciplines dont nous venons de
parler suffisent pour en fournir l'explication rationnelle.
La phonétique commence avec l'étude des transformations
brusques dues à l'induction des sons (assimilations et dissimilations,
pp. 194 sv.). Ici, la cause motrice n'est pas d'ordre
intellectuel, puisqu'elle est comme nous l'avons vu, une impulsion
psychologique qui n'agit qu'en se dérobant au contrôle
de l'attention. Cependant il n'y a pas encore véritable
évolution phonétique, car le changement a lieu dans les limites
prescrites par le système phonologique établi. Dans la
phonétique proprement dite, celle qui étudie les transformations
lentes des sons, on considère les phonèmes tels qu'ils
se présentent dans leur réalité concrète avec toutes leurs variations
et leurs nuances. Ici, on ne tient compte encore que de
leur relation avec les types du système phonologique. On les
voit donc sous leur aspect abstrait et grammatical. Aussi
cette étude occupe-t-elle une position intermédiaire entre la
science de la forme et la science des sons.
C'est là un domaine restreint, bien défini et d'un caractère
très spécial à l'intérieur des disciplines linguistiques. Les problèmes
qui ressortissent à elle n'offrent d'ailleurs pas de très
grandes difficultés. Nous avons montré comment on les posait
et les résolvait en combinant la connaissance que nous avons
d'un certain phénomène de psychologie physiologique individuelle
(l'induction des sons) avec celle du milieu dans lequel
il se produit et qui en conditionne les effets (morphologie
247statique et évolutive). Les linguistes et psychologues ont
d'ailleurs déjà étudié ces phénomènes avec succès en dehors
de cette systématisation rigoureuse, et nous avons employé
plus haut quelques-uns des termes techniques qu'ils ont
créés pour en désigner les principaux aspects. Nous croyons
cependant que cette discipline bien située dans l'ensemble des
disciplines linguistiques permettra une compréhension des
faits plus complète et plus exacte. Seule cette systématisation
permet de bien voir le rôle qui leur revient dans l'évolution
générale de la langue. Ce rôle a son importance, mais il a
aussi ses limites. C'est ce dont on se rend bien compte quand
on subordonne ces inductions de sons aux lois de la morphologie
évolutive.
S'il est nécessaire de créer un terme pour désigner cette
discipline, nous proposerions peut-être : Science des inductions
phonologiques ; en disant phonologiques, et non phonétiques,
nous marquons justement que ces phénomènes sont
toujours relatifs au système de sons admis, et nous soulignons
nettement la distinction qu'il faut faire avec la discipline
suivante : la phonétique proprement dite.
En phonétique nous ne saurions suivre une autre méthode
qu'en morphologie évolutive. Le principe qui dit que le problème
de la genèse est dans son essence, identique au problème
de l'évolution, devra également être appliqué dans ce
domaine. Si la morphologie évolutive débute en analysant
psychologiquement la transformation du signe en un symbole
considéré d'abord sous l'aspect général et abstrait d'un
x algébrique, il nous faut maintenant en abordant la phonétique,
examiner le même phénomène, mais au point de vue
spécial de la qualité matérielle de ce symbole.
Ce phénomène s'analysera naturellement, lui aussi, en
trois moments : ontogénèse, phylontogénèse et phylogénèse.
248Il s'agit de faire voir tout ce qui ce passe quand un signe
vocal a été mis en œuvre par un individu, compris par un
autre à titre de symbole, puis adopté comme tel par toute
la collectivité. On aura du même coup mis en lumière le
principe rationnel, l'origine psychologique de tout système
phonologique, puisque nous savons que ce principe est impliqué
dans l'acte intellectuel de l'aperception du symbole.
En même temps, si l'on a suivi le phénomène dans toute
sa réalisation concrète, si l'on a vu tout ce qu'il a provoqué
de mouvements, de réactions diverses dans les organismes
psychophysiques, on connaîtra déjà virtuellement tous les
principes logiques, psychologiques ou physiologiques, nécessaires
pour rendre compte des évolutions ultérieures.
Mais ce qui est virtuellement compris dans ce phénomène
relativement simple, mérite d'être développé, et ne peut l'être
que si on en observe les effets tels qu'ils se manifestent dans
des conditions plus complexes. C'est dire que la phonétique
théorique une fois sa base bien établie, devra s'appliquer à
étudier et à expliquer rationnellement les phénomènes multiples
auxquels donneront lieu les sons dans le langage organisé
à ses divers degrés d'évolution morphologique.
Nous avons dû dans le chapitre précédent, tracer par
avance une partie de son programme, quand nous avons
énoncé ce qui nous semblait essentiel au sujet des causes de
l'évolution phonétique.
Après avoir montré génétiquement pourquoi le système
phonologique existe (la phonologie statique nous a déjà appris
ce qu'il peut être), cette science devra énumérer et étudier
en détail les causes des variations que les phonèmes subissent
dans le langage concret des individus. Puis elle devra
montrer comment ces variations individuelles deviennent
définitives et collectives, comment elles entrent dans la grammaire,
et comment au travers de ces transformations de sons
le système phonologique subsiste en évoluant.
D'ailleurs ce sera simplement prolonger les lignes des principes
déjà établis dans l'explication génétique. C'est ce que
249nous avons tenté de faire plus haut, mais en esquisse seulement
et d'une manière moins systématique (pp. 201 sv.).
La phonétique aura ainsi fourni l'explication rationnelle
de la régularité de l'évolution des sons dans le temps. Il y a
un autre problème, connexe à celui-ci, et que nous n'avons pas
encore mentionné : c'est celui qui concerne la régularité dans
l'espace, la continuité géographique dans les variations d'ordre
phonétique.
On sait ce qu'il faut entendre par là. C'est une loi de l'évolution
phonétique que chaque règle particulière de l'évolution,
par exemple : lat. « b » intervocalique > fr. « v », ou lat.
« a » sous l'accent principal > fr. « ẹ », ou toute autre, a un domaine
géographique qui en principe est continu, d'un seul tenant
et sans enclave au dehors. Si la même loi agit simultanément
ou à diverses époques dans deux domaines séparés, il faut
y voir deux faits aussi indépendants l'un de l'autre que l'action
de deux lois distinctes. On peut établir ainsi des cartes phonétiques,
où chacune des tranformations qu'enregistre l'histoire
des phonèmes, a sa province bien délimitée. On trace
la frontière entre le territoire où « a » a donné « ẹ » (lat.
mare > fr. la mer, qui avait anciennement un e fermé, lat. cantare
> fr. chanter) et celui où le même phonème est resté « a »
(ital. mare, cantare). Les provinces de ces diverses lois ne se
recouvrent pas, elles varient de forme et d'étendue ; il résulte
de ce fait qu'il n'y a nulle part de frontières tranchées entre
les différentes formes des langues dérivées d'une même souche.
Plus deux états de langage sont géographiquement rapprochés,
plus nombreuses sont les lois phonétiques dont l'effet
a agi d'une façon identique sur l'un et sur l'autre, et plus ces
deux langages se ressemblent. Plus au contraire la distance
est grande, plus les deux langages seront divergents, parce
que leur évolution n'aura eu que peu de lois communes et beaucoup
de lois différentes. Ainsi en s'éloignant d'un point pour se
diriger vers un autre, on passera par des lieux où l'on entendra
des formes de langage de plus en plus dissemblables de celle
250qu'on entendait parler au point de départ. Par exemple de la
Sicile à l'Espagne en suivant les côtes de la Méditerranée,
on va insensiblement des dialectes de l'Italie méridionale en
passant par le toscan, le provençal et le catalan jusqu'à l'espagnol,
et ce ne sont pas là autant de langues ou de patois distincts,
mais un seul parler qui se modifie par une gradation
progressive. On ne peut observer l'effet de cette loi d'une
façon aussi parfaite que là où il n'y a pas eu de migrations,
ou d'autres événements historiques qui soient venus déranger
la distribution géographique des peuples ou des langues.
L'explication de cette loi, comme de toutes les autres lois
concernant l'évolution phonétique, est virtuellement contenue
dans la genèse du symbole, ou si l'on aime mieux, dans
la genèse du système phonologique rationnellement expliquée.
Si l'on sait comment dans toute création collective d'ordre
phonologique, l'individu est solidaire de son entourage,
on comprendra sans peine comment l'effet d'une loi phonétique
se répand de proche en proche par contact, jusqu'au
point où elle se heurte à une autre loi contraire. Supposez
un village entouré de divers côtés de plusieurs autres villages
dans lesquels l'action d'une même loi phonétique a provoqué
une évolution de son identique ou à peu près semblable
(car il faut toujours réserver les nuances), il est évident
qu'à la longue l'influence de cette même loi devra se faire
sentir sur ce village-là ; il sera fatalement entraîné dans
l'évolution générale. Mais si au contraire, la loi phonétique
n'a été active que dans les villages situés à l'est par exemple,
tandis qu'à l'ouest il n'y aura eu aucune évolution ou
une évolution contraire, le village en question pourra ou
adopter la nouvelle manière de prononcer et tendre par
conséquent à la propager plus loin, ou y résister et faire
frontière, opposer un obstacle à sa diffusion. On comprend
aussi qu'en principe les lois phonétiques sont indépendantes
les unes des autres. Ce n'est qu'en tant que les causes qui
les provoquent et qui les favorisent, sont identiques, que
l'on doit s'attendre à ce qu'elles apparaissent dans les
251mêmes lieux et se propagent en même temps dans les
mêmes limites.
Le plus difficile et le plus important problème qu'ait à résoudre
la phonétique théorique, c'est justement celui auquel
nous venons de faire allusion. Quelles sont les causes des
évolutions phonétiques ? Pour le moment nous connaissons
seulement celles des variations individuelles et nous savons
de quelle manière l'évolution du système phonologique en
dérive ; mais nous ne savons pas ce qui fait que parmi beaucoup
d'évolutions possibles, la grammaire s'attache à l'une
plus spécialement et la réalise aux dépens de toutes les autres.
Nous avons déjà abordé cette question dans le chapitre précédent
où nous disions (pp. 210-211) que le principe directeur
de l'évolution phonétique ne pouvait être autre chose
que l'adaptation de plus en plus parfaite du système phonologique
aux dispositions collectives des sujets parlants, et
son évolution parallèle à celle de ces dispositions. Mais nous
résumions ainsi sous un terme très général, quelque chose
qui en réalité se compose de multiples éléments.
C'est ici que la linguistique théorique aborde le dernier et
peut-être le plus complexe de ses problèmes. Les données
en sont si nombreuses, si subtiles et se combinent de tant de
façons diverses, qu'il peut sembler illusoire de poser même
une question de cet ordre. Saurons-nous jamais pourquoi le
« a » de mare a donné « e » de mer et le « p » de nepotem,
« v » dans neveu en français, tandis qu'en italien ces mêmes
éléments subissaient d'autres destinées (mare, nipote) ?
Est-il possible d'établir une science théorique qui rende
compte de ces faits ?
Sans nous dissimuler la difficulté de la question, nous
croyons qu'une connaissance exacte des facteurs qui entrent
en ligne de compte — or cette connaissance est censée
acquise au point où nous sommes parvenus — , et des
notions claires sur la manière dont chacun d'eux agit,
peuvent jeter beaucoup de lumière sur ces problèmes
252obscurs, et acheminer au moins à une solution partielle des
questions de cet ordre. C'est ce que nous allons montrer en
présentant ici une simple esquisse de ce que cette dernière
partie de la phonétique théorique nous semble devoir
être.
Il y a quatre espèces d'adaptations :
1° L'adaptation physiologique, sur laquelle il n'y a pas
grand'chose à dire. Quand le type physiologique d'une race
évolue, par son mélange avec une autre race ou à la suite
d'un changement d'habitat ou de mœurs, il est évident que,
si ses organes vocaux sont en quelque mesure affectés, son
système phonologique en trahira aussi en quelque manière
le contre-coup. Ce fait, indéniable en théorie, n'a cependant
encore été nulle part pratiquement démontré. Il faut donc
réserver à l'adaptation physiologique une place parmi les
causes possibles de l'évolution phonétique, mais se garder
de tout rapporter à elle (p. 201).
2° L'adaptation psychologique. Nous avons dit à propos
de la phonologie qu'il devait y avoir une certaine correspondance
entre les sons, les mouvements des organes vocaux ou
les perceptions auditives et les dispositions psychiques du
sujet (p. 158). A la psychologie individuelle de l'établir et
d'en formuler les lois. Il est évident que les sons nous paraissent
avoir une valeur expressive en eux-mêmes, qu'ils correspondent
plus ou moins bien à ce que nous ressentons,
et qu'ils peuvent faire l'objet d'un choix, nous déplaire ou
nous laisser indifférents.
Les évolutions phonétiques qui ont pour cause une adaptation
physiologique, ont naturellement leur origine dans
des variations individuelles déterminées directement par
l'état des organes de celui qui parle. Celles qui ont pour
règle l'adaptation psychologique, commencent par les variations
individuelles dues aux impulsions spontanées du
langage affectif. C'est par elles que les modifications de
sons conformes à notre tempérament entreraient dans le
253langage ; et c'est en vertu d'une préférence d'ordre esthétique
que la collectivité s'y attacherait et les incorporerait dans la
grammaire. C'est pour cela que l'italien serait sonore, le
haut allemand rude et guttural et que l'anglais aurait cette
prononciation d'une couleur particulière. Il y a des motifs
subtils mais très réels, qui font que le goût se porte d'un côté
plutôt que d'un autre. Comme la linguistique théorique
touche par d'autres endroits à la théorie des croyances, elle
touche peut-être ici à celle des formes de l'art, de la mode et
du goût régnant, en tant que ces choses procèdent de l'action
collective et non de l'initiative consciente des individus.
3° L'adaptation intellectuelle. Il faut rapporter à cette
adaptation les évolutions qui ont pour point de départ les
variations phonétiques individuelles provenant de la plus
ou moins grande importance grammaticale que chacun
attache aux divers éléments articulatoires dans la phrase.
Quand un phonème ne paraît pas avoir d'importance au
point de vue de la grammaire, l'attention ne s'y attache
pas au cours de la parole et il est plus susceptible qu'un
autre de subir toutes les influences qui peuvent le modifier.
En tant que ces influences sont d'ordre non intellectuel,
on peut ranger sous l'une des trois autres rubriques
l'adaptation qui en résulte. Ici l'intelligence n'intervient
que d'une façon toute négative pour ne pas empêcher
le phénomène. L'intelligence exerce un contrôle constant
sur tout ce qui est du ressort de l'évolution phonétique ;
c'est ce que nous nous sommes efforcé d'établir quand nous
avons emboîté la science évolutive des sons dans celles des
formes et des procédés. Dans ce sens, en phonétique, tout
est intellectuel ; mais comme l'intelligence intervient ici seulement
pour permettre à une tendance d'un autre ordre de
se manifester, pour l'y autoriser en quelque sorte, le phénomène
qui se produit et l'adaptation qui peut en résulter, doivent
nécessairement êtres attribués à la tendance qui a été
déterminante. Cependant, si l'absence d'attention intellectuelle
s'est traduite simplement par un affaiblissement du
254phonème, qui peut perdre son intensité ou sa netteté d'articulation
jusqu'à disparaître ou à se confondre avec un son
voisin, le phénomène n'a, au point de vue psychologique
ou physiologique, que des causes négatives (une diminution
d'activité), et on peut à bon droit le rapporter à sa cause
principale, à son origine intellectuelle. Les variations de cet
ordre sont celles qui concernent la plus ou moins grande
netteté des articulations et les phénomènes de rapprochement
entre sons voisins à la suite d'inductions plus ou moins
fortes (p. 194).
Quand au contraire le phonème possède pour celui qui
parle, un rôle grammatical, soit en lui-même, soit comme élément
caractéristique d'un symbole, il est prononcé avec soin
et l'attention en se portant sur lui exerce à son égard une
influence conservatrice. La cause de ce fait est éminemment
intellectuelle, seulement au point de vue de l'évolution il ne
se passe rien. L'action de l'intelligence empêche d'autres tendances
de se manifester ou les phénomènes de se dégrader
elle se borne à ce rôle conservateur dont nous avons parlé
(pp. 196 sv.), et comme il n'y a pas d'évolution proprement
dite, il ne saurait être question d'adaptation. Toutefois il
arrive, même dans ce cas, qu'il se passe quelque chose de
positif qui puisse être considéré comme un effet direct de
l'action de l'intelligence. Nous faisons allusion à ces phénomènes
de dissimilation qui résultent d'un effort du sujet parlant
pour conserver à chaque son une articulation distincte.
Si telles sont les variations phonétiques qui peuvent être
attribuées directement à des causes intellectuelles, il est
facile de voir où il faut chercher les lois phonétiques qui en
dérivent. Ce sont d'abord celles, si nombreuses, qui concernent
les affaiblissements et les disparitions des sons, surtout
à la fin des mots et en dehors de l'accent, celles également
qui règlent les assimilations de sons en contact à l'intérieur
des mots ou entre les mots qui se suivent. Il y faut
compter aussi les lois qui concourent à la simplification du
système phonologique (p. 186). Le son eu « ø » dans les mots
255actuels : neveu, tu peux et cheveux, correspond en vieux
français à trois sons ou groupe de sons bien distincts :
nevot, tu pues, chevels ; ces trois choses en s'assimilant toutes
à un même type, ont occasionné une simplification importante
à l'intérieur du système phonologique. Mais il y a
encore un autre groupe de lois qui doivent être rapportées
à l'adaptation intellectuelle. Ce sont toutes celles qui concernent
au contraire les dissimilations, les intercalations de
sons intermédiaires (comme le « b » entre « m » et « r » dans
le mot chambre pour * cam'ra (m), lat. camĕram), les consonnes
ou les voyelles d'appui, comme le « e » du vx fr. escu
(lat. scūtum) ou le « ǝ » final de père (lat. patrem > * patr'
sans élément vocalique final), d'une façon générale enfin
tout ce qui tend à favoriser l'articulation nette des phonèmes
du mot et à sauvegarder leur existence intégrale.
Comme il y a à l'intérieur du système phonologique au
cours de l'évolution des assimilations entre les éléments
d'articulation voisine, on peut aussi se demander si le phénomène
inverse n'existe pas, et si les diverses articulations
typiques n'ont pas une tendance à maintenir leurs distances
pour ainsi dire, à rester bien différenciées. Ce qui dans l'évolution
phonétique serait déterminé par une cause de ce genre,
appartiendrait nécessairement aussi à l'adaptation intellectuelle.
4° L'adaptation historique. Nous entendons par là les influences
que les langues exercent les unes sur les autres
relativement à leur prononciation, quand elles entrent en
contact. Nous avons déjà parlé des variations que ce contact
suscite (p. 205). Ces variations tendent d'autant plus fortement
à provoquer des évolutions phonétiques qu'elles ne
sont pas passagères, mais que l'individu qui prononce une
langue en se laissant influencer par des habitudes de
prononciation empruntées à un autre idiome, ne peut se
corriger de ce défaut que dans une faible mesure, et exerce
par conséquent une influence constante sur son entourage.
Si dans une collectivité il y a un grand nombre d'individus
256qui pour la même cause agissent continuellement dans le
même sens, il est impossible qu'il n'en résulte pas une transformation,
une adaptation plus ou moins complète de la prononciation
collectivement admise, aux habitudes de ces individus.
Nous appelons cette adaptation, « historique » parce
qu'il faut pour que ce phénomène se produise en grand,
des événements relatifs aux destinées des peuples : migrations,
guerres, conquêtes, progrès de la civilisation, relations
intellectuelles ou commerciales qui se nouent ou se dénouent.
On remarquera que cette quatrième adaptation touche à
la première, à l'adaptation physiologique, de plusieurs manières.
D'abord parce que la disposition acquise à prononcer
tel ou tel phonème est dans une certaine mesure assimilable
à une disposition physiologique des organes (p. 206), et ensuite
parce que les mélanges de langues sont la plupart du
temps accompagnés de mélanges de races, et que les caractères
physiologiques se transmettent ainsi en même temps
que les habitudes phonologiques.
A y regarder de près on verra peut-être que cette dernière
adaptation est la cause la plus efficace des transformations
phonétiques qu'enregistre l'histoire des langues, et qu'il y
aurait peut-être lieu d'établir une relation entre la rapidité
avec laquelle une langue évolue dans ses sons, et la multiplicité
des influences successives auxquelles la collectivité qui
la parle a été soumise. Cette loi se vérifierait probablement
aussi en morphologie.
Nous signalerons encore deux points de méthode qui
pourraient servir à mettre quelque clarté dans ces recherches
relatives aux causes des évolutions phonétiques.
Le premier, c'est qu'il ne faut jamais oublier de considérer
parmi les conditions déterminantes du phénomène, le facteur
statistique. L'évolution qui se produit est le résultat
d'un ensemble de forces qui tantôt se neutralisent, tantôt
concourent au même but. C'est une question d'équilibre
(p. 207). Or le nombre constitue toujours une force. Si par
257exemple un facteur intellectuel demande cent fois dans le
discours qu'un phonème dans certaines conditions phonologiques
soit conservé, et que dans le même temps il y ait dix
cas où il pourrait disparaître, s'affaiblir ou s'assimiler sans
inconvénient, il est évident que dans ces dix cas il sera conservé
— sauf les transformations brusques toujours possibles
dont nous ne parlons pas — par égard pour les cent cas dont
l'influence l'emportera. Dans la situation inverse il y aura
résistance également, mais le langage n'attendra que d'avoir
trouvé quelque moyen de conserver dans les dix cas en
question la valeur expressive de la phrase malgré l'absence
du phonème, pour permettre à la loi nouvelle de s'établir. Or
la langue trouve toujours une occasion favorable pour créer
ce moyen, et puis dans beaucoup de cas elle a la ressource de
la conservation analogique (p. 213). Quand, dans un système
phonologique, deux ou trois phonèmes d'origines diverses
et d'articulations voisines, s'assimilent en un seul comme
nous venons de le dire pour le son « ø » dans neveu, tu peux
et cheveux, il est bien évident que c'est le plus fréquemment
employé qui a le plus de chances de servir de type aux
autres phonèmes, qui viendront s'accommoder à lui.
Le second point c'est qu'il faut s'attacher non au détail des
lois que la grammaire historique énumère minutieusement,
mais aux grands traits, et s'efforcer pour l'explication rationnelle
de ramener les faits plus particuliers à quelques
principes généraux aussi simples que possible. Il y a, quand
on passe du latin au français par exemple, des phénomènes
qui constituent comme les grandes lignes de l'évolution générale.
Dans le vocalisme, c'est la chute des voyelles non accentuées,
la diérèse des longues sous l'accent principal en diphtongues
descendantes puis ascendantes et qui reviennent ensuite
au son simple. Dans le consonnantisme, c'est la réduction
des groupes compliqués et des consonnes doubles, l'affaiblissement
de celles qui sont placées entre deux voyelles et
la chute des finales. Comme les documents linguistiques ne
donnent que des renseignements imparfaits sur la prononciation
258réelle dans l'état de langage qu'ils représentent, il
est souvent difficile de reconstituer exactement la filière
phonologique d'une évolution. Quand on a pu sur un point
l'établir avec une précision suffisante, on est en droit d'en
conclure par analogie à ce qu'a dû être l'évolution d'autres
phénomènes semblables, parce que les transformations de sons
ne se font pas suivant un système compliqué de règles particulières,
mais suivant des lois générales. Ainsi les destinées
des voyelles longues accentuées du bas latin sont bien connues
en ce qui concerne un certain nombre d'entre elles, qui
ont toutes pour correspondant une diphtongue en vieux
français, et le sort de ces diphtongues, ainsi que celui d'une
série d'autres diphtongues du vieux français, est de se réduire
plus tard à un son unique. Il n'y a pas de fait constaté qui
soit contraire à l'une ou l'autre de ces lois. Il est donc non
seulement loisible, mais même nécessaire d'admettre par
hypothèse que d'autres longues du bas latin qui ont fourni
des voyelles simples à notre français moderne, mais sur les
destinées desquelles les romanistes ont des opinions incertaines,
ont abouti à leur résultat actuel par l'intermédiaire
d'une filière analogue.
Encore dans ces phénomènes faut-il distinguer ce qui est
primaire de ce qui est secondaire ; entre ce qui peut se ramener
directement à l'une des adaptations que nous avons énumérées,
et ce qui n'est qu'une conséquence du phénomène primordial.
Si par exemple une langue, à un moment donné et
par adaptation psychologique, admet un nouveau mode d'accentuation
grammaticale, il est fort probable que cette évolution
aura aussi son contre-coup sur l'articulation des phonèmes
en vertu de la solidarité naturelle ou acquise qui existe
entre les divers caractères des sons (p. 157). Si dans une
langue le consonnantisme devient plus riche et plus expressif,
ce fait sera peut-être en corrélation avec un changement
complémentaire dans le vocalisme.
D'après ces principes et en suivant cette méthode que la
259phonétique théorique aurait à établir d'une façon plus complète
et plus rigoureuse, on arriverait à montrer dans les évolutions
des sons admis par la grammaire, comme on l'aurait
déjà fait pour l'évolution de ses formes, la conséquence et la
manifestation des évolutions psychologiques auxquelles les
sujets parlants sont soumis. Par là la linguistique théorique
serait devenue vraiment pour la linguistique des faits cet
auxiliaire utile qu'elle doit être. Elle lui fournirait les
moyens nécessaires pour ramener autant qu'il est possible,
tous les faits qu'elle enregistre à leur cause, et par là
même, elle lui permettrait de donner à ses exposés descriptifs
et historiques, cette clarté, cette « intelligibilité » qui
procède d'une connaissance rationnelle de l'objet qu'on expose.
Par l'union de ces deux sciences la linguistique remplirait
toute sa tâche.
Nous terminerons ce chapitre par une remarque importante
et qui concerne aussi bien la morphologie que la phonétique.
Nous venons de dire qu'une explication rationnelle
dans ces deux ordres de faits doit aboutir à montrer dans les
évolutions du langage un effet et un témoignage des évolutions
diverses que les sujets parlants peuvent subir dans leur
être physique ou psychique.
Si l'on veut remonter d'une cause à l'autre jusqu'à la cause
première, il sera naturel, après avoir montré que l'évolution
linguistique est une conséquence d'une certaine évolution du
sujet parlant, de se demander quelle est à son tour la cause
de cette évolution-là. C'est une question du plus haut intérêt
de savoir pourquoi et comment le type psychique, le degré
de développement intellectuel ou les dispositions organiques
d'un être se transforment. La science doit tendre à résoudre
ces problèmes : mais quand elle les aborde, elle sort du domaine
propre de la linguistique.260
Il y a des cas, il est vrai, où l'évolution du sujet est solidaire
de l'évolution du langage. C'est particulièrement le cas
pour tout ce qui concerne le progrès intellectuel. La langue
non seulement l'enregistre et le manifeste par son progrès
grammatical, mais par là même, elle le fixe, le réalise, et le
progrès linguistique devient la condition nécessaire du progrès
ultérieur dans l'ordre intellectuel. Sans lui tout serait
sans cesse à recommencer, et il n'y aurait point de continuité
dans cette évolution-là. Mais pour être la condition nécessaire
et l'instrument du progrès, le langage n'en est pas la
cause déterminante. Il l'est encore bien moins quand il s'agit
d'une évolution physiologique ou psychologique.
Les forces vives qui sont dans l'homme créent le langage
et président à toutes ses évolutions. La réciproque n'est pas
vraie. La linguistique tient tout entière dans ces relations de
cause à effet qu'il y a entre ces forces et leur produit : la parole.
Aller plus loin et se demander d'où viennent ces forces
vives et pourquoi elles peuvent d'une époque à l'autre, d'un
sujet à l'autre, varier de qualité et d'intensité, c'est sortir du
champ de notre science.
Ce sont là des problèmes d'anthropologie, d'ethnographie
ou d'histoire. Ce n'est plus de la linguistique.261
Chapitre XV
Conclusions pratiques.
Nous avons essayé de tracer le programme de la linguistique
théorique en nous servant des principes de subdivision
et d'emboîtement que nous avons exposés. En énumérant les
problèmes divers qui, à l'intérieur de ce programme et conformément
aux principes d'ordonnance par nous admis, devaient
être successivement abordés, nous avons reconnu que cette
science se composait de sept disciplines disposées selon le
tableau systématique suivant :
I. Science du langage affectif (1) (Psychologie individuelle).
II. Science du langage organisé (Psychologie collective).
1° Disciplines statiques.
A. Morphologie statique (2).
B. Phonologie (3).
2° Disciplines évolutives.
A. Morphologie évolutive.
a) Sémantique (4).
b) Syntaxe évolutive (5).
B. Phonétique.
a) Science des inductions phonologiques (6).
b) Phonétique proprement dite (7).263
Pour arriver maintenant à des conclusions pratiques, nous
nous demanderons ce qu'il en est de ces diverses disciplines
relativement à l'état actuel de la science. Trouvons-nous déjà
dans les travaux des linguistes et des psychologues, dans les
résultats qui, à l'heure qu'il est, peuvent être considérés
comme acquis dans ce domaine, les éléments nécessaires pour
constituer chacune de ces disciplines au moins dans leurs
grandes lignes ? Sont-ce là autant de sciences neuves, ou y
en a-t-il parmi elles qu'on doive compter déjà comme existantes ?
A cet égard on peut diviser ces sept disciplines en deux
groupes. Celles qui appartiennent au premier groupe, bien
que n'ayant pas été abordées dans les conditions systématiques
que nous préconisons, ont cependant fait l'objet de recherches
fructueuses, de telle sorte que dans leur domaine,
on se trouve actuellement en possession de résultats positifs.
Ce qui leur manque encore serait facilement complété une
fois qu'on les encadrerait à leur vraie place dans l'ensemble
des sciences linguistiques, et dans ces conditions meilleures,
elles accompliraient plus rapidement les progrès qu'elles
ont encore à faire. Nous mettons dans ce premier groupe
d'abord la science du langage affectif qui, étant indépendante
des disciplines suivantes, a pu progresser normalement entre
les mains des psychologues (p. 92). Nous y comptons aussi la
phonologie, qui est pour une grande part une science d'application
de la physiologie ; enfin la sémantique et la science
des inductions phonologiques. Les données de cette dernière
science sont relativement simples, et le problème qu'elle pose
n'offre pas de difficultés bien particulières.
Quant au second groupe comprenant naturellement la
morphologie statique, la syntaxe évolutive et la phonétique
proprement dite, il se compose de disciplines, fort importantes
comme on le voit, qui ont été relativement négligées jusqu'à
présent. Les grammairiens et les psychologues ont souvent
abordé des problèmes qui sont de leur ressort, et ils fourniraient
déjà passablement de données utilisables dans la construction
264de ces sciences ; mais leur problème général n'a pas
encore été posé en ses propres termes, ou, s'il l'a été, on
s'en est tenu à l'énoncé du problème et de quelques vues sur
leur solution. Ces sciences n'ont encore ni principes assurés
ni méthodes, et à cet égard on peut considérer leurs domaines
comme encore vierges ou à peu près.
Parmi ces disciplines la phonétique offre une particularité
très curieuse. C'est la première qui dans l'ordre des sciences
empiriques, a pris une allure scientifique à cause de la régularité
des phénomènes dont elle traite. Ses exposés ont de
l'ordre, de la méthode et de la rigueur. Malgré cela, ce sera
probablement la dernière qui dans l'ordre des sciences théoriques,
arrivera à se constituer d'une façon satisfaisante. Cela
tient à la très grande complexité des causes qui sont en jeu
dans l'évolution lente des sons, et aussi au fait que pour
aborder cette étude en connaissance de cause, le théoricien
du langage devrait être extrêmement familiarisé avec tout
ce qui concerne la vie du langage en tant qu'expression de la
pensée. C'est une chose qui ne peut s'obtenir que par les
études relatives à la forme grammaticale et à ses procédés.
C'est dire que la tâche qui s'impose actuellement à la linguistique
théorique, c'est de constituer les disciplines morphologiques :
la morphologie statique et la syntaxe évolutive.
Pour nous, s'il nous est permis de rappeler ici notre expérience,
nous avons été frappé en entreprenant des études de
syntaxe historique, de voir que dans ce domaine les grammairiens
faisaient des dépenses considérables d'érudition et
d'ingéniosité, mais en dehors de tout principe constant, de
toute méthode éprouvée, de telle sorte qu'il y avait lieu de
craindre beaucoup que cette dépense mal dirigée ne fût souvent
qu'un inutile gaspillage. Nous avons donc cherché cette
méthode mais, remontant d'une question à une autre, nous
dûmes parcourir dans le sens de l'induction le chemin inverse
de celui que nous avons suivi dans les déductions de
ce travail. Nous nous sommes posé le problème de la morphologie
statique après celui de la morphologie évolutive,265et en dernier lieu nous avons abordé le problème général
concernant l'objet entier de la linguistique théorique.
Pour notre part, nous considérons maintenant ce problème
fondamental comme résolu, et s'il nous est permis de continuer
les études commencées, nous devrons naturellement
nous attacher d'abord aux problèmes de la morphologie statique,
pour en faire, si possible, un exposé complet, et nous réserver
pour plus tard d'examiner les questions relatives à la
syntaxe évolutive. Quelques tentatives que nous avons déjà
faites dans ce sens nous ont montré quelle était la difficulté
de la tâche ; mais pourtant nous croyons entrevoir comment
on pourrait la remplir. Les données fournies par les psychologues,
par ceux qui se sont occupés de la classification des
langues, et par les grammairiens dans leurs analyses logiques
et grammaticales, ne demandent qu'à être fondues ensemble,
complétées et organisées d'une manière conforme à l'objet et
aux fins de cette science des lois.
Si nous ne pouvons pas faire ce travail, d'autres s'en chargeront.
Nous sommes persuadé quant à nous que les principes
généraux que nous avons voulu établir ici, sont, dans
leurs éléments essentiels, conformes à la vérité, et en particulier
que les subdivisions que nous avons établies au sein de
la linguistique théorique du langage organisé et l'emboîtement
de ces disciplines, sont fondés dans la nature des choses
et absolument indispensables au progrès de cette science.
C'est donc, pensons-nous, dans les cadres que nous venons de
tracer que tôt ou tard les chercheurs ordonneront leur travail.
Le problème grammatical et plus spécialement le problème
morphologique s'imposera aux psychologues comme
aux linguistes. Sous sa forme statique, ce problème traite de
la question si importante des types de langage correspondant
aux divers types psychologiques ; sous sa forme évolutive il
pose la question des transformations syntactiques et de leurs
causes. Ce sont là des sujets qui sont à l'ordre du jour et sur
lesquels l'attention des psychologues comme celle des grammairiens
est tout spécialement attirée. Plus les chercheurs
266s'y attacheront, plus ils tâcheront de pénétrer dans l'intelligence
de ces deux problèmes, plus ils comprendront qu'ils
sont liés l'un à l'autre par une relation de dépendance, et que
leur solution ne peut s'obtenir qu'en passant du premier au
second, de la question des états de langage à celle des évolutions.
Quelque convaincu que nous soyons de la vérité de ces
principes fondamentaux, nous n'imaginons pourtant pas
que toutes les conséquences que nous en avons tirées, et tous
les développements que nous y avons joints, résistent également
et dans tous leurs détails à la critique. Sans doute, nous
n'avons pas vu partout la vérité tout entière, et sur bien des
points, lorsque nous avons abordé des questions relativement
nouvelles ou proposé des points de vue originaux, nous avons
dû nous contenter d'esquisser des solutions un peu hâtives
que nous proposons aux théoriciens du langage à titre de
suggestions, plutôt que comme des doctrines arrêtées. Agir
autrement, c'eût été attendre d'avoir trouvé sur tous les
points le dernier mot de la science ; c'eût été renoncer à écrire.
Ce que nous avons déjà trouvé valait peut-être la peine
d'être dit. A nos lecteurs d'en juger. La plus haute ambition
que nous puissions concevoir pour notre travail, c'est qu'il
contribue au moins pour une part, à avancer le jour où la
linguistique théorique sera une science bien organisée, un
véritable auxiliaire de la linguistique historique mise au
service de la connaissance de l'homme.
Fin267
11 Nous empruntons cette terminologie à l'ouvrage de M. Adrien
Naville, Nouvelle classification des sciences, Paris, Alcan, 1901. Nous
avons adopté non seulement quelques-uns des termes employés dans ce
livre, mais aussi la plupart des idées judicieuses qui y sont émises, et
les principes fondamentaux si simples et si lumineux sur lesquels ces
idées reposent.
21 Nous ajouterons ici une remarque supplémentaire pour ceux qui
seraient curieux de savoir toute notre pensée sur ces questions.
Entre les sciences des faits bien caractérisées, comme la géographie,
et les véritables sciences des lois comme la physique, on en trouve, et
un bon nombre, qui, à première vue, ne semblent pas cadrer avec
notre principe de division. Elles ne l'infirment pas cependant, mais
elles sont mixtes dans leur donnée et leur fin. Citons comme exemple
la météorologie, qui est la science des lois générales de la nature, mais
telles qu'elles s'appliquent à un objet particulier. En tant qu'il s'agit
de notre terre avec toutes les particularités physiques ou autres contingentes
de sa surface, la météorologie est une science des faits ; mais
en tant qu'elle ne s'attache pas aux faits particuliers (un orage survenu
en tel lieu, à telle date), mais aux faits généraux (la production des
orages, avec leurs causes, leurs conditions diverses et leurs effets possibles),
c'est une science des lois.
Nous pourrions donner de nombreux exemples de ces sciences mixtes.
Peut-être même n'y a-t-il aucune science des lois qui n'appartienne
plus ou moins à cette catégorie. Si l'on pense que le monde entier soit
la manifestation d'une puissance usant de liberté dans ses modes d'action,
on doit considérer la science des lois dans son ensemble comme
étant une de ces sciences mixtes, puisqu'elle a pour but de connaître
les lois d'un fait historique : le monde, qui serait la grande contingence
dont nous sommes les spectateurs.
31 Wilhelm Wundt, Völkerpsychologie, I. Band : Die Sprache, 2 vol.
Leipzig, Engelmann, 1900. Une seconde édition a paru en 1904.
42 Voyez en particulier : Delbrück, Grundfragen der Sprachforschung,
Strasbourg, Trübner, 1901, et la réponse de Wundt, Sprachgeschichte
und Sprachpsychologie, Leipzig, Engelmann, 1901. —
L. Sutterlin, Das Wesen der Sprachgebilde, Heidelberg, Winter,
1902. — V. Rozwadowski, Wortbildung und Wortbedeutung, Heidelberg,
Winter, 1904. — En 1904 également, O. Dittrich a commencé
la publication d'un gros ouvrage : Grundzüge der Sprachpsychologie ;
Einleitung und Allgemeinpsychologische Grundlegung, Niemeyer,
Halle, où il prétend reprendre et perfectionner l'œuvre de son maître
Wundt. Dans l'introduction de cet ouvrage et dans de nombreux articles
de revues, il a traité la question à laquelle notre essai est consacré.
Ses théories nous paraissent peu satisfaisantes et nous nous réservons
de les comparer ailleurs avec les nôtres.
51 Voyez l'introduction de notre travail : L'Imparfait du Subjonctif
et ses Concurrents dans les hypothétiques normales en français.
Romanische Forschungen, 1905, (vol. xix, p. 321 sv.).
61 Voici un exemple de la manière dont le problème est compris et
résolu par un linguiste moderne qui fait de la psychologie. Fink dans
un opuscule intitulé Aufgabe und Gliederung der Sprachwissenschaft
(Halle, Hauft, 1905), prétend que le langage de chacun est à chaque
moment une libre création, seulement, dit-il, cette création est influencée
par la nécessité de se faire comprendre, et par conséquent par le
souvenir de façons de parler déjà entendues ou déjà usitées par celui
qui parle. La langue in abstracto n'a aucune existence réelle. A cela
nous opposons qu'il y a une grande différence entre un souvenir et une
habitude, et il nous semble évident que c'est celle-ci et non pas celui-là
qui entre en jeu dans le fonctionnement de la parole. Qui dit habitude
dit règle, et toute règle expérimentalement constatable a une existence
réelle, bien qu'abstraite. C'est ainsi que la grammaire et par conséquent
la langue existent.
71 Nous formulerions pour notre part comme suit cette définition
grammaticale du mot : Les mots sont dans une langue ce qui résulte
de l'analyse de la phrase dans ses parties les plus petites possibles
possédant chacune prise isolément une valeur d'idée et de fonction,
conformément à un système admis de catégories grammaticales, ou classes
de mots. — Nous reviendrons peut-être une fois sur cette définition
pour la mettre au point, s'il y a lieu, et la développer.
81 V. II, p. 240 : Der sprachliche Ausdruck für die willkürliche
Gliederung einer Gesamtvorstellung in ihre in logischer Beziehung zu
einander gesetzten Bestandtheile.
91 Paul, Hermann, Prinzipien der Sprachgeschichte, Halle, Niemeyer,
1898, p. 259 sv.
101 Discours de la méthode, 2me partie.
111 Wundt, Völkerpsychologie ; die Sprache, I, p. 204 sv.
122 Ibid, I, p. 146.
131 Ch. I, Ch. II, Ch. III (1re et 2me parties, 3me partie § 1), Ch. VII
(2me et 3me parties, sur les phrases émotives, et 4me partie § 6 sur
les ressemblances entre le parler des enfants et les langues incultes).
141 Wundt, o. c., II, p. 90. D'ailleurs on peut journellement observer
l'emploi de ce procédé primitif dans le langage des petits enfants.
151 En proposant ces deux derniers termes pour distinguer la science
statique des sons de leur science évolutive, nous nous conformons à
une terminologie qu'emploie dans ses cours M. le Prof. F. de Saussure.
161 Voici un exemple pris sur le vif de la manière dont la phrase naît
par le juxtaposition de deux symboles-phrases. Un enfant de 21 mois
qui ne parle encore guère que par mots isolés, entend au dehors le bruit
d'une voiture qui passe. Aussitôt il s'écrie : Coco, coco, coco, (c'est-à-dire :
voici un cheval), puis il écoute, attentif, et quand le bruit s'éloigne,
il ajoute : pati, (il est parti) et après une petite pause, il dit encore
d'une voix plus faible, comme pour compléter sa pensée : coco (le cheval).
Ce dernier mot équivaut soit à une phrase isolée : c'est du cheval
que je parle, soit au sujet de la phrase dont le prédicat vient d'être
énoncé : (il est parti), le cheval ; le cheval (est parti).
171 Ch. V, 2me partie (Psychologie der Wortvorstellungen).
181 Nous écrirons ainsi entre guillemets tous les phonèmes et les
transcriptions phonétiques. Pour l'interprétation des caractères spéciaux
dont nous nous servons, voir l'Index à la suite de la Table analytique
des matières.
191 C'est le cas dans une large mesure en grec, où l'accent n'est pas
attaché à une place déterminée d'avance par une loi générale pour tous
les mots. Chaque mot dans certaines limites a sa règle propre. L'accent
grec à l'origine était musical, c'est-à-dire qu'il correspondait à une intonation
plus élevée et non à une émission plus intense ; mais depuis
lors il a changé de nature.
201 Cette association, nous n'avons pas besoin de le dire, est indépendante
de l'identité originelle de valeur que les linguistes modernes
admettent entre ces deux désinences. Suivant une hypothèse à laquelle
J. Schmidt a attaché son nom, cette désinence -ă (Ind. Eur. ǝ)
aurait servi à l'origine à former des substantifs féminins à sens abstrait
indiquant la collectivité. La relation entre φύλλον et φύλλα serait
à peu près celle qui existe entre feuille et feuillage en français. Ce
n'est qu'ensuite que ces substantifs féminins abstraits auraient été
admis à titre de pluriels dans la flexion du neutre. Une dernière trace
du caractère du singulier qui était propre à ces formes en - α, c'est la
règle d'après laquelle en grec on les construit avec le singulier du verbe :
πάντα ῥεῖ. Pour le Gréco-latin des premiers siècles après J.-C., c'était
une ressemblance fortuite, qui donnait lieu à une association et par conséquent
à une assimilation possible.
211 Brunot, Histoire de la langue française, vol. I, p. 91.
222 Meyer-Lübke, Grammaire des langues romanes, vol. III, pp. 57-61,
et le résumé dans vol. II, p. 29.
231 Sur tout ce sujet voyez Meyer-Lübke, o. c., vol. III, p. 832, sv.
241 Nous ne disons rien des changements lents ou brusques qui sont
dus uniquement à des causes physiques directement constatables : une
voix qui mue, quelqu'un qui se casse des dents et qui est désormais
gêné dans l'articulation de certains sons. Ces changements ne peuvent
être que de l'ordre individuel, et, ce qui est plus important, ils n'ont
aucune influence sur l'organisme du langage en tant que système de
dispositions, de représentations et d'idées. Le système phonologique
dans son existence abstraite n'en est pas modifié. Celui qui est incapable
de prononcer le r, l'entend moins bien qu'un autre peut-être,
mais l'entend cependant ; celui qui en parlant ne saurait distinguer
l's de ce que nous écrivons ch, connaît cependant leur existence et s'en
sert pour différencier les symboles à l'audition et à la lecture. Ces
changements ne concernent pas la linguistique. C'est d'un ordre inférieur ;
il s'agit de physiologie et de pathologie des organes de la voix.
251 Il faut remarquer que nous emploierons désormais le mot assimilation
dans deux sens. Nous connaissions l'assimilation psychologique
qui dans la perception assimile ce qui est perçu à son idée ; maintenant
il s'agit d'une assimilation phonétique.
261 T. I, pp. 424-444.
271 Signalons ici qu'il y a des cas où les transformations brusques
dues à l'induction se présentent, elles aussi, avec une certaine régularité.
Il en est ainsi par exemple de la dissimilation du l et du r en
latin. Comparez les adjectifs : naturalis, auguralis, saturnalis, mortalis,
avec : vulgaris, singularis, popularis, insularis. Le l semblant appartenir
à la forme primitive de ce suffixe, on ne s'étonnera pas de le trouver
aussi là où l'influence dissimilatrice d'un r est absente : natalis, venalis,
aestivalis, aequalis, etc. Il en est de même pour les noms neutres en
-al et -ar, comme le montrent les mots : pulvinar, lupanar, calcar et laquear
comparés à : animal, vectigal, etc. On trouve cœruleus au lieu de
*cœluleus dérivé de cœlum. Ces exemples avec beaucoup d'autres permettent
de statuer une espèce de loi. C'est là le point où les domaines
respectifs des transformations brusques et des transformations lentes se
rapprochent sans cependant se confondre.
281 Thurot, De la prononciation française depuis le XVIe siècle,
d'après les témoignages des grammairiens, vol. II, p. 162.
291 Ottmar Dittrich, Grundzüge der Sprachpsychologie, vol. I,
Halle 1904, voyez Einleitung, § 142, et aussi le compte-rendu fait par
l'auteur lui-même dans l'Archiv für die gesammte Psychologie, vol. III,
p. 66, en note.
301 Nous avons déjà employé ce terme de composition en parlant des
procédés de la morphologie (pp. 114 sv.). Il n'est peut-être pas inutile de
rappeler ici que nous l'entendons dans un sens plus large qu'on ne le fait
ordinairement. Toutes les fois qu'un mot se combine avec un autre
d'après un ordre constant : l'article avec le substantif, l'auxiliaire avec le
participe, il y a composition selon nous. Ce qu'on nomme généralement
composition, suppose quelque chose de plus : une synthèse, une soudure.
311 Nous attirons l'attention du lecteur sur ce point important. Il
nous est impossible de le développer comme il le mériterait. Ce serait
surcharger notre démonstration et entreprendre d'écrire tout un chapitre
de morphologie statique. Nous tenons cependant à mieux expliquer
notre pensée. En français par exemple, un mot est substantif,
parce qu'il est composé avec un article et parce qu'il est susceptible
d'être mis au pluriel et d'être accompagné d'un adjectif qui s'accorde
avec lui. Ce sont ces caractères concrets qui font le substantif, et non
inversement la qualité abstraite de substantif qui appelle ces caractères.
Tout mot, fût-il généralement adjectif, verbe ou adverbe devient
substantif dès qu'il est soumis aux règles de cette classe. De même, il
ne faudrait pas dire que le verbe se conjugue, mais plutôt que tout
mot qui se conjugue est un verbe. Considérer les choses sous cet angle,
c'est user de la vraie méthode scientifique qui s'élève de la réalité concrète
aux notions générales. Faire l'inverse, c'est imposer à la réalité,
qui s'en accommode plus ou moins bien, des notions générales toutes
faites. Dans le cas particulier, c'est tomber dans la « psychologie vulgaire »
selon la définition de Wundt. On a souvent l'occasion de constater
que là où l'application des règles fait défaut, toute détermination
de classe devient illusoire. A quelle classe attribuera-t-on, par exemple,
le mot marché dans cette locution : cet objet est bon marché ?
321 Le fait que tous les mots d'une même classe représentent une
même chose à l'imagination, que tous les substantifs par exemple,
évoquent l'idée d'une substance ou d'un être, tous les verbes, celle
d'une action, ne doit pas nous induire en erreur. L'intelligence pour
pouvoir former des pensées avec toutes sortes d'idées, même les plus
abstraites, les transpose indistinctement dans certains cadres, elle les
matérialise ; elle assimile une pensée comme : l'envie dénigre lâchement
les bonnes intentions, à une autre toute concrète et pour ainsi dire
perceptible comme : le vent secoue violemment les grands arbres (voir
plus loin, p. 239). Ce qui nous intéresse ici, c'est l'origine psychologique
des idées, et nous disons qu'une même espèce de symbole au
point de vue grammatical, qu'il s'agisse du radical d'un mot, d'un
suffixe de flexion ou d'autre chose, peut correspondre également bien
à des idées d'origines psychologiques très diverses.
331 En vieux français l'article indéfini sert à évoquer l'image de l'objet
dont on parle ; en conséquence il est employé plutôt dans le sens de
un certain que dans celui de un quelconque. Voyez ces vers de la Vie
de saint Alexis (5e et 6e strophe) : Puis conversèrent ensemble longement,
Qued enfant n'ourent (un enfant qc), peiset lor en fortment ;
Deu en apelent… : E ! reis celestes, par ton comandement Enfant
nos done (donne-nous un enfant qc.) qui seit a ton talent. Tant li
preierent… Que la moillier (datif) donat feconditet : Un fil lor donet
(un certain fils)…
341 2me éd., p. 18, note. Odyss. XXIII, 33.
351 L'Imparfait du Subjonctif, etc. Voyez plus haut p. 22, note.