 Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
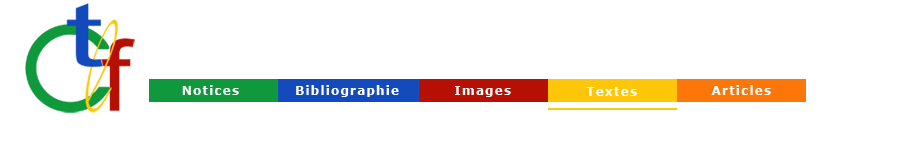
L'évolution
des
formes grammaticales 11
Les procédés par lesquels se constituent les formes grammaticales
sont au nombre de deux ; tous les deux sont connus, même
des personnes qui n'ont jamais étudié la linguistique, et chacun
a eu occasion, sinon d'y arrêter son esprit, du moins de les
observer en passant.
L'un de ces procédés est l'analogie ; il consiste à faire une
forme sur le modèle d'une autre ; soit par exemple les types
français : nous finissons, vous finissez, ils finissent ; nous rendons,
vous rendez, ils rendent ; nous lisons, vous lisez, ils lisent ; sur nous
disons, ils disent, l'enfant qui apprend à parler est conduit à former
vous disez sans avoir jamais entendu pareille forme : c'est
une forme dite analogique. Toutes les formes régulières de la
langue peuvent être qualifiées d'analogiques ; car elles sont faites
sur des modèles existants, et c'est en vertu du système grammatical
de la langue qu'elles sont recréées, chaque fois qu'on en
a besoin. Mais d'ordinaire ces formes régulières sont aussi celles
qu'on a eu occasion d'observer, et, sauf quand il s'agit de mots
nouveaux ou rares, la forme obtenue par le fonctionnement du
système grammatical reproduit le plus souvent une forme déjà
entendue et enregistrée dans la mémoire. La tradition est d'accord
avec les exigences du système. Mais il arrive, comme dans
le cas cité, que la tradition et le système ne soient pas d'accord,
et que, étant donné l'état de la langue à un moment donné, il
y ait plusieurs formes possibles ; alors l'analogie produit des
formes nouvelles, indépendantes de la tradition. Et c'est dans
130ces cas qu'on parle d'ordinaire de formes analogiques ; il serait plus
juste de dire : innovations analogiques.
L'autre procédé consiste dans le passage d'un mot autonome
au rôle d'élément grammatical. Par exemple suis est un mot
autonome dans la phrase, du reste très artificielle, je suis celui qui
suis, et a encore une certaine autonomie dans une phrase telle
que : je suis chez moi ; mais il n'est presque plus qu'un élément
grammatical dans : je suis malade, je suis maudit, et il n'est tout
à fait qu'un élément grammatical dans : je suis parti, je suis allé,
je me suis promené, où personne ne pense ni ne peut pensera à la
valeur propre de suis, et où ce que l'on appelle improprement
l'auxiliaire n'est qu'une partie d'une forme grammaticale complexe
exprimant le passé. Il est pourtant clair — et l'histoire de
la langue montre de manière évidente — que suis est dans : je
me suis promené le même mot que dans : je suis ici ; mais il est
devenu une partie constituante d'une forme grammaticale.
Ces deux procédés, l'innovation analogique et l'attribution du
caractère grammatical à un mot jadis autonome, sont les seuls
par lesquels se constituent des formes grammaticales nouvelles.
Les faits de détail peuvent être compliqués dans chaque cas particulier ;
mais les principes sont toujours les mêmes.
Depuis qu'il existe une grammaire comparée systématique, on
a été amené à attribuer plus d'importance tantôt à l'un et tantôt
à l'autre des deux procédés. Le fondateur de la grammaire comparée
des langues indo-européennes, Fr. Bopp, croyait que
l'examen des plus anciens types de chaque idiome lui donnait
le moyen de remonter à des formes en quelque sorte primitives,
susceptibles d'être analysées en leurs éléments composants, ; pour
lui, un mot tel que sanskrit émi, grec eîmi, lituanien eimi, s'analysait
naturellement en un mot ai, signifiant « aller » et un mot
mi, signifiant « moi ». Mais, pour une analyse comme celle-ci,
qui est plausible — quoique naturellement indémontrable —
Bopp était amené à en proposer cent autres qui étaient ou peu
vraisemblables ou tout à fait inadmissibles. Après une cinquantaine
d'années d'essais infructueux de ce genre, on a compris que
l'origine première des formes grammaticales est hors de nos
131prises. Toutes les langues connues n'apparaissent qu'à une date
plus ou moins basse, la plupart seulement à l'époque moderne
et toutes sous des formes achevées, qui supposent un long développement
antérieur ; les langues des peuples de civilisation inférieure
ont des structures souvent délicates ; elles n'ont pas derrière
elles une histoire moins longue que celles des langues des
peuples les plus civilisés. Aucun idiome, quel qu'il soit, ne donne
ni de près ni de loin l'idée de ce qu'a pu être une langue « primitive »,
et par suite, aucune donnée positive ne permet, non
pas de résoudre, mais même d'aborder le problème de la première
origine des formes grammaticales. Les linguistes étudient
les transformations des systèmes grammaticaux ; ils ne s'occupent
pas de la création de ces systèmes. Sans doute, quand un mot
passe au rôle de forme grammaticale, on peut dire, en un certain
sens, qu'il a été créé une forme, mais cette création a lieu à
l'intérieur d'une langue qui offre déjà une organisation grammaticale
complète, et cette création ne donne pas une idée de ce
qui a pu se passer en un temps où il n'existait aucun commencement
d'organisation grammaticale. Toutefois on peut retenir
que, l'analogie étant par définition exclue de la première origine
des formes, le seul procédé qui reste est l'attribution progressive
d'un rôle grammatical à des mots autonomes ou à des manières
de grouper les mots. En ce sens, Bopp avait évidemment raison ;
mais son illusion était de croire que, avec les données tardives
que l'on possède, on puisse même entrevoir la façon dont les
formes existant dans les langues connues soit par des données
historiques, soit par des procédés comparatifs, ont acquis pour la
première fois les valeurs qu'elles possèdent.
Par le fait qu'ils renonçaient à déterminer l'origine première
des formes et qu'ils se proposaient seulement d'en suivre le développement,
les linguistes ont été conduits à s'attacher surtout à
l'étude des innovations analogiques : car, étant donné un système
une fois constitué qui se transforme peu à peu, l'analogie
est le grand agent qui modifie sans cesse, les détails, et même
parfois la structure générale du système. Le mouvement linguistique
qui a commencé vers 1870 et qu'on a souvent qualifié de
132mouvement « néo-grammairien » est tout entier dominé par deux
idées : la constance de ces correspondances entre phonèmes d'une
même langue à deux dates successives, qui sont connues sous le
nom de « lois phonétiques », et l'importance attribuée aux innovations
analogiques. Quand Brugmann et Osthoff ont publié
à partir de 1878 une collection de travaux conçus suivant les
idées nouvelles, ils l'ont appelée Morphologische Untersuchungen,
et l'analogie tenait la plus grande place dans le recueil. Les Prinzipien
der Sprachgeschichte de M. H. Paul, qui ont été l'exposé
des principes de l'école nouvelle, sont essentiellement une théorie
de l'analogie. Et quand le regretté V. Henry a voulu répandre
en France les idées des « néo-grammairiens », c'est par une étude
sur l'Analogie qu'il a débuté.
Sans avoir jamais été perdu de vue, l'autre procédé d'innovation,
le passage de mots autonomes au rôle d'agents grammaticaux,
a été beaucoup moins étudié durant les quarante dernières
années. On commence maintenant à s'y attacher de nouveau.
L'importance en est en effet décisive. Tandis que l'analogie peut
renouveler le détail des formes, mais laisse le plus souvent intact
le plan d'ensemble du système existant, la « grammaticalisation »
de certains mots crée des formes neuves, introduit des catégories
qui n'avaient pas d'expression linguistique, transforme l'ensemble
du système. Ce type d'innovations résulte d'ailleurs, comme les
innovations analogiques, de l'usage qui est fait de la langue, il
en est une conséquence immédiate et naturelle.
Une phrase consiste essentiellement en une affirmation ; elle
comprend au besoin un sujet, c'est-à-dire un mot qui indique
de qui ou de quoi quelque chose est affirmé, et, normalement,
un prédicat, c'est-à-dire un mot qui indique ce qui est affirmé. Le
sujet peut n'être pas exprimé, s'il est connu des interlocuteurs ;
c'est ce qui arrive à l'impératif, forme qui, par définition, s'adresse
à un interlocuteur : viens, venez n'ont pas besoin de sujet, ce
n'est que si l'interlocuteur n'est pas assez désigné par la situation
133qu'on prévient la personne interpellée : viens, Pierre. Si l'on
attend quelqu'un, on peut en russe dire pridėt « il va venir » ou, en
latinuenit « il vient » sans avoir besoin de désigner autrement la
personne, qui est connue par la situation ou par une phrase
antérieure. Ou bien, surtout dans les langues indo-européennes,
la forme du verbe peut suffire à désigner la personne : russe
pridu « je vais arriver », latin uenio « je viens ». Sauf les cas
de ce genre, une phrase se compose essentiellement d'un sujet
et d'un prédicat, le prédicat pouvant être un nom comme
dans le russe dom nov « la maison est neuve », ou un verbe
comme dans le russe Pëtr pridët « Pierre va arriver ». Ces mots
sont les mots principaux de la phrasé. Une phrase peut comprendre
d'autres mots principaux, ainsi un complément dans
une phrase comme aedifico domum « je bâtis une maison ».ou eo
Romam « je vais à Rome », ou uenio Roma « je viens de Rome »,
ou habito Romae « j'habite à Rome », en latin. Les mots principaux
sont ceux qui indiquent les idées essentielles pour lesquelles
est faite la phrase.
Mais on ne fait pas une phrase seulement avec des mots principaux.
Il faut aussi le plus souvent d'autres mots qui déterminent,
qui précisent la valeur de ces mots principaux. Soit une
phrase comme : laissez venir à moi les petits enfants. L'orthographe
française y distingue sept mots différents. Sans insister sur à
moi où à n'est guère plus qu'un élément grammatical, ni provisoirement
sur l'article les qui est aussi une sorte d'outil grammatical,
on a ici deux mots dont chacun est groupé avec un
autre : laissez, et petits. Chacun de ces mots a un sens propre ;
mais ce sens ne prend une valeur dans la phrase que par le groupement
avec le mot voisin. Laissez peut être un mot principal,
dans laissez cela par exemple ; mais ici laissez venir forme un
ensemble, où laissez est, en quelque mesure, un auxiliaire. Petit
a sa valeur propre, et est, même, en tant qu'un adjectif peut l'être,
le mot principal, par exemple si l'on dit : apportez le petit paquet
(et non pas le gros paquet qui est à côté) ; mais ici petits n'indique
qu'une qualité accessoire d'enfants. Outre les mots principaux,
il-y a donc des mots accessoires. Tel mot qui est principal
134dans une phrase est accessoire dans une autre ; venir est accessoire
dans la phrase exclamative : il vient me dire cela ! Et il y a tous les
degrés intermédiaires entre les mots principaux et les mots accessoires ;
laissez dans la phrase citée est moins un mot accessoire
que faire dans faites le venir. Mais, dans toute phrase donnée, il
importe de bien marquer la distinction entre les mots principaux
et les mots qui sont plus ou moins accessoires.
Or, de ce qu'un mot est accessoire, il résulte deux sortes d'altérations,
les unes touchant le sens, les autres touchant la prononciation.
A chaque fois qu'un élément linguistique est employé, sa
valeur expressive diminue et la répétition en devient plus aisée.
Un mot n'est ni entendu ni émis deux fois exactement avec la
même intensité de valeur. C'est l'effet ordinaire de l'habitude.
Un mot nouveau frappe vivement la première fois qu'on
l'entend ; dès qu'il a été répété, il perd de sa force, et bientôt il ne
vaut pas plus qu'un élément courant depuis longtemps. Ceci est
plus vrai encore d'un groupe de mots : la plupart des gens
parlent et surtout écrivent au moyen de formules toutes faites,
de « clichés » ; aussi deux mots usuels apparaissent-ils presque
neufs s'ils sont rapprochés pour la première fois ou si, du moins,
on les rapproche alors qu'ils ne sont pas rapprochés d'ordinaire ;
Horace a signalé depuis longtemps ce que vaut une alliance de
mots nouvelle, une iunctura noua ; il l'a montré par beaucoup
d'exemples. Les orateurs et les écrivains qui se soucient de style,
c'est-à-dire d'expression, s'efforcent avant tout de combiner les
mots d'une manière qui ne soit pas banale et qui par suite puisse
faire impression sur l'auditeur ou le lecteur. Et si, au bout de
quelques dizaines d'années d'usage littéraire, une langue est en
général usée par la littérature, si tous les écrivains dans toutes
les grandes langues de l'Europe en sont maintenant presque
réduits à écrire d'une manière ou banale ou artificielle, c'est sans
doute en grande partie parce que le nombre des alliances de mots
nouvelles qui sont pratiquement possibles dans un idiome donné
est limité.
Si donc un groupement de mots devient fréquent, s'il est souvent
135répété, il cesse d'être expressif, et il est reproduit de plus
en plus automatiquement par les sujets parlants. Il y a eu un
temps où je laisse venir a constitué deux mots vraiment distincts
et où laisser a eu dans une expression de ce type toute sa valeur
sémantique. Mais on a pris l'habitude de grouper laisser avec un
infinitif, et il en est résulté un affaiblissement rapide de ce mot
qui a perdu son sens propre, pour devenir une sorte d'auxiliaire
d'un mot principal. Néanmoins laisser n'a pas encore passé au
rôle d'élément grammatical parce que l'on exprime par là une
notion très spéciale et encore concrète et que laisser garde une
autonomie nette de sens et de forme.
De ce qu'un mot est groupé avec un autre d'une manière qui
tend à devenir fixe dans certains cas, il résulte pour ce mot la
perte d'une partie de son sens concret dans ces constructions.
Soit par exemple le mot pied ; employé isolément, il désigne une
partie du corps humain très définie, de forme très spéciale ;
groupé avec le nom d'un objet, dans des expressions comme le
pied d'une table, d'une chaise, d'une lampe ou. le pied d'une montagne,
le mot perd sa valeur concrète tout entière, et il n'en reste plus
qu'un élément abstrait : partie d'un objet qui supporte et est en
contact avec une surface portante. Ainsi que l'a montré M. Wundt,
on ne doit pas. parler de métaphore dans les cas de ce genre,
comme on continue malheureusement de le faire ; le terme est
impropre. Il s'agit vraiment d'un autre mot ; et, en russe par
exemple, on emploie en ce cas non le mot noga. « pied », mais le
dérivé nožka pour désigner le « pied » d'un meuble. Inversement,
le groupe de mots a souvent un sens plus précis, plus concret
que ne le fait même attendre le rapprochement des mots composants.
Quand on parle d'un pied de lampe, on ne pense presque
plus ni à pied, au sens abstrait qui vient d'être défini, ni à lampe,
mais à un objet d'aspect particulier qui porte ce nom ; on peut
à la réflexion se représenter les deux éléments du groupe, on en
a peut-être un sentiment vague ; mais, en somme, pied de lampe
est l'équivalent d'un mot un désignant un objet un. Le groupement
peut être tel que l'un des mots ne reçoive pas de caractéristique
grammaticale propre : si en turc osmanli, on veut parler
136d'un jardin du pacha qui n'est pas familier aux interlocuteurs,
on dira paša-nyn baγče-si « le jardin du pacha », avec le signe -yn
du génitif ; si l'on est dans une localité où le « jardin du pacha »
est chose connue, le mot paša ne sera pas décliné, et l'on aura,
en un groupe comportant une seule flexion, paša baγče-si ; il n'y
a presque plus ici deux mots distincts, mais une locution
d'ensemble. Dans les langues d'Extrême-Orient, telles que le
chinois ou l'annamite, qui ne connaissent pas les affixes et où
par suite on ne peut former de noms par dérivation, c'est en
groupant deux mots dont chacun perd sa signification propre
qu'on obtient des noms de personnes ou de choses ; soit par
exemple en annamite phép « règle » et toán « compter » ; on
aura un mot phép toán signifiant « calcul, arithmétique » ; avec ban
« tirer », on aura phép ban « tir », etc. ; de même thay « maître »
forme les noms de professions libérales ; si phép thuoc est la « médecine »,
thay thuoc est le « médecin » etc. En somme le groupement
habituel ôte aux mots et leur force expressive et la force
expressive de leur union et même leur valeur concrète propre.
Les mots ainsi groupés par le sens sont la plupart du temps
juxtaposés les uns aux autres. Ils se comportent dès lors dans la
prononciation à peu près comme un mot long. On sait que la
façon dont les mots sont unis dans la prononciation courante des
phrases ne répond pas à la coupe des mots telle qu'elle apparaît
dans la graphie ordinaire des langues modernes. Il s'est établi la
convention que tout élément séparable ayant un rôle propre dans
la phrase est, dans l'écriture, isolé de tout autre élément ; cet usage
claire et commode est fondé uniquement sur le rôle que les mots
jouent dans la phrase et sur la manière dont ils s'y comportent, et
ne tient aucun compte de la prononciation. Par exemple l'article
français, qui ne saurait en aucun cas être employé seul et qui
fait toujours partie d'un groupe de noms, est écrit isolément
parce qu'il peut se séparer du substantif qu'il détermine, et qu'on
peut dire : les enfants, les petits enfants, les pauvres petits enfants etc.
Au point de vue de la prononciation, les enfants, les petits, les
pauvres forment dans ces groupements chacun un seul mot. La
définition du mot phonétique ne recouvre pas celle du mot syntaxique.
137Le groupe de mots tend à constituer plus ou moins un mot phonétique
unique.
Or, des observations nombreuses ont montré que les mêmes
éléments sont prononcés d'une manière d'autant plus brève
qu'ils font partie d'un mot plus long : en français l'â de pâté est
beaucoup plus bref que celui de pâte, et l'â de pâtissier et surtout
de pâtisserie est plus bref que celui de pâté. L'abrègement a des
conséquences graves : le timbre des voyelles en est souvent altéré ;
une voyelle abrégée tend à se fermer ou, si elle est déjà fermée,
peut s'amuir tout à fait. Les mots accessoires groupés avec
d'autres tendent de ce chef à s'abréger et à changer de prononciation.
De plus, et par le fait de l'abrègement, et par le fait que,
étant accessoires, ils sont prononcés sans effort et entendus sans,
attention spéciale, ils sont négligés, dénués d'intensité, ils ne
sont plus articulés qu'à demi. L'histoire des langues montre que,
par suite, les mots accessoires ont des traitements phonétiques
aberrants. On a souvent invoqué contre le principe de la constance
des « lois phonétiques » les traitements spéciaux que présentent les
mots accessoires. L'argument ne porte pas, on le voit ; les mots
accessoires se trouvent dans des conditions particulières qui
déterminent des prononciations particulières : leurs éléments
constituants, étant abrégés et faiblement articulés, sont exposés
à s'affaiblir ou à disparaître dans des cas où les éléments d'un
mot principal subsistent intacts ou subissent des modifications
tout autres. On a autrefois utilisé par exemple contre la règle de
la constance des « lois phonétiques » le fait que le th anglais est
demeuré sourd (th dit dur) à l'initiale de presque tous les mots
de la langue, mais qu'il est devenu sonore (th doux) dans l'article
the ; on sait maintenant que les consonnes sourdes initiales
des mots accessoires sont sujettes à subir des affaiblissements
propres à ces mots ; outre l'anglais, le phénomène s'observe par
exemple en irlandais, en Scandinave et en arménien ; et il n'est
pas particulier aux langues indo-européennes ; on l'a retrouvé
en polynésien, à Samoa par exemple.
Les altérations phonétiques subies par les mots accessoires
sont parfois très profondes. Si l'on n'avait pas la forme du gotique
138himma daga « ce jour-ci, aujourd'hui », on pourrait avoir peine
à croire qu'un ancien hiu tagu « ce jour-ci » soit devenu en vieux
haut allemand hiutu (allemand moderne heute) « aujourd'hui »,
et que hiu dagu « ce jour-ci » soit devenu en vieux saxon hiudu
« aujourd'hui » ; les doutes qui pourraient subsister sont levés
par le passage parallèle de hiu jâru « cette année » à hiuru (allemand
moderne huer) ou par celui de hînaht « cette nuit » à hînet en
moyen haut allemand, à heint « aujourd'hui » en bavarois
moderne. L'accent portant sur le début du composé, sur le démonstratif
qui renferme l'essentiel de l'idée, à savoir l'indication
qu'il s'agit de « ce qui est le plus près », tout le reste du mot a été
réduit à presque rien et est devenu méconnaissable. — Les mots
accessoires en viennent à ne plus ressembler aux mots principaux
là même où, à l'origine, ils étaient identiques. Ainsi dans un
ancien dialecte grec, le béotien, les mots en -a- long ont un
génitif pluriel en -âôn, sans contraction ; mais l'article correspondant
contracte -âôn en -ôn, et l'on a tôn drakhmâôn par exemple :
au lieu d'une flexion une, il y a deux flexions distinctes, l'une
pour les mots principaux, l'autre pour l'article.
L'affaiblissement du sens et l'affaiblissement de la forme des
mots accessoires vont de pair ; quand l'un et l'autre sont assez
avancés, le mot accessoire peut finir par ne plus être qu'un élément
privé de sens propre, joint à un mot principal pour en marquer
le rôle grammatical. Le changement d'un mot en élément grammatical
est accompli.
La constitution de formes grammaticales par dégradation progressive
de mots jadis autonomes est rendue possible par les procédés
qu'on vient de décrire sommairement, et qui consistent, on
le voit, en un affaiblissement de la prononciation, de la signification
concrète des mots et de la valeur expressive des mots et
des groupes de mots. Mais ce qui en provoque le début, c'est le
besoin de parler avec force, le désir d'être expressif. L'histoire de
la négation fournit une illustration de ce principe.139
La négation s'exprimait en indo-européen commun par un
petit mot accessoire ne qui subsiste clairement dans le na du
sanskrit, le ne du slave et du lituanien, le ni du gotique par
exemple. Mais ce petit mot très bref, qui tendait à être inaccentué
et qui en lituanien et en russe en est venu à se grouper étroitement
avec le mot principal sur lequel il porte, est devenu rapidement
très inexpressif. Là où l'on avait besoin d'insister sur la
négation — et les sujets parlants éprouvent presque toujours le
besoin d'insister, car on parle le plus souvent pour agir sur les
autres en quelque manière, et l'on fait ce qu'il faut pour les
toucher — , on a été conduit à renforcer la négation ne par quelque
autre mot. C'est ce qui est arrivé en latin par exemple ; de même
que pour dire « non », l'allemand en est venu à dire « pas un »
à savoir nein, le latin ancien a dit noenum « pas un », au lieu de
ne. Etant un mot accessoire, noenum a subi un traitement particulier
et a abouti à nôn. Mais dès lors on ne retrouvait plus « pas
un » dans nôn, et, à l'époque historique, le nôn latin n'est pas
sensiblement plus expressif que le na sanskrit, le ne slave, le ni
gotique. Le français a été, par suite, conduit à renforcer sa négation
ne, issue de nôn par un traitement particulier de mot accessoire,
au moyen de petits mots, tels que pas, point, mie. On sait
comment pas a perdu, dans les phrases, où il était un accessoire
de la négation, tout son sens propre — sens conservé parfaitement
dans le mot isolé pas — , comment dès lors, pas est devenu
à lui seul un mot négatif, servant à exprimer la négation, et
comment, par suite, le pas français n'est plus expressif à son tour
et appelle un nouveau renforcement par des mots accessoires ; on
est amené à dire pas du tout, absolument pas, ou à recourir à des
tours tout nouveaux, comme l'exclamation argotique actuelle : tu
penses, s'il est venu ! manière fortement expressive de dire : « il
n'est pas venu ». — L'histoire de la négation allemande nicht,
qui étymologiquement signifie « pas une chose », est parallèle
à celle des négations latine et française. — Les langues suivent
ainsi une sorte de développement en spirale : elles ajoutent des
mots accessoires pour obtenir une expression intense ; ces mots
s'affaiblissent, se dégradent et tombent au niveau de simples
140outils grammaticaux ; on ajoute de nouveaux mots ou des mots
différents en vue de l'expression ; l'affaiblissement recommence,
et ainsi sans fin.
Les catégories grammaticales qui sont sujettes à être exprimées
au moyen de mots devenus éléments grammaticaux sont, par
suite de ce qui vient d'être dit, celles qui ont un certain caractère
expressif ; c'est du moins ce qui a lieu dans les langues
où il existe des formes grammaticales caractérisées par des
affixes soudés aux mots. Les langues, qui, comme le chinois et
plus encore peut-être l'annamite, ignorent toute affixation, sont
conduites à exprimer plus de catégories par des mots accessoires
qu'on appelle souvent mots vides. Mais, dans les langues indo-européennes,
les catégories qui, comme celles du présent et de
l'aoriste dans le verbe, expriment simplement des faits, sont peu
propres à être caractérisées par des mots accessoires progressivement
soudés. Ou si des mots accessoires y interviennent, ce n'est
que secondairement et quand le procès d'affaiblissement est
achevé, comme on le verra. Il en va autrement des catégories
qui ont une signification plus intense et qui appellent par suite
une expression nette et fortement caractérisée. L'histoire du
parfait et celle du futur sont instructives à cet égard.
On entend par parfait une catégorie à sens très fort, qui
indique l'action en tant qu'elle est achevée, le résultat acquis de
l'action, et non pas l'action elle-même dans son développement
et sa durée ou l'acte pur et simple. Un sens de ce genre était
exprimé en indo-européen par un type tout particulier, dont les
désinences et le vocalisme radical étaient propres à ce type, qui
de plus présentait dans une grande partie des cas un redoublement
d'une partie initiale de la racine, ainsi en grec léloipa « j'ai laissé »,
etc. Cette formation, très à part et par suite très expressive, ne
s'est pas maintenue au cours du développement historique des
langues indo-européennes, en partie parce que le sens s'est
affaibli et dégradé jusqu'à celui du présent, comme dans memini
« je me souviens », du latin ou man « je pense » du gotique, ou
141jusqu'à celui du prétérit, comme dans cecini « j'ai chanté » du
latin ou haihald « j'ai tenu » du gotique, en partie parce que la
structure du type était trop spécifiquement indo-européenne
pour survivre à la période ancienne de l'indo-européen : les
changements généraux qui se sont produits dans le système ne
laissaient pas subsister les conditions de formation qu'exige le
parfait indo-européen.
Mais la forme, en disparaissant, laissait un vide. Car on
éprouve le besoin de bien marquer l'action achevée dont on
envisage le résultat. On y parvient le plus souvent par le groupement
d'une forme nominale rattachée à un verbe accessoire.
Et ceci se conçoit bien : l'action achevée n'est déjà plus un
procès, mais une chose ; elle est donc propre à être exprimée
par un nom plutôt que par un verbe, puisque le propre du
verbe est d'exprimer un procès. Cette tendance, est surtout manifeste
au passif, et c'est pour cela que les formes composées qui
servent à l'expression du parfait se présentent d'abord le plus
souvent sous la forme passive : le latin a dictus est « il (quelqu'un)
a été dit », et surtout sous forme impersonnelle dictum est
« il (quelque chose) a été dit, on a dit », dès une époque antérieure
à l'époque historique (le procédé est du reste commun
non seulement au latin et à l'osco-ombrien, mais aussi au celtique,
ce qui atteste une antiquité relativement grande de l'innovation).
Ce n'est que beaucoup plus tard, à l'époque où se sont constituées
les langues romanes, qu'un type actif, de structure toute
différente, apparaît : habeo dictum « j'ai dit ». Quand ce type
roman s'est constitué, il avait une grande force expressive : je
possède quelque chose qui est dit. Le procédé, très frappant,
se retrouve en germanique, après la période la plus ancienne de la
langue (il n'y en a pas encore trace en gotique au IVe siècle après
Jésus-Christ), sans doute par une imitation d'une manière de
dire latine qui semblait frappante et commode ; de ce qu'il y a ici
une imitation d'une manière de grouper les mots, on ne
conclura pas que le germanique a emprunté au latin une forme
grammaticale : les formes grammaticales proprement dites ne
semblent guère s'emprunter ; et, au moment, où l'imitation a pu
142avoir lieu, le type habeo dictum comportait sans doute encore
deux mots sentis comme nettement distincts : ce n'était pas
encore une forme grammaticale, mais un groupement de mots.
Avec le temps, le type j'ai dit s'est unifié, et, de bonne heure, en
français, c'est purement et simplement une manière d'exprimer
l'action accomplie, où l'on ne reconnaît plus la valeur ni de ai ni
de dit ; mais alors le groupe cesse aussi d'être expressif ; il perd
sa valeur de parfait pour devenir un simple prétérit ; et, comme
il fait alors concurrence au prétérit simple, je dis, qui est beaucoup
moins clair, de formation plus compliquée et en partie spéciale,
fléchi d'ailleurs d'une manière particulière (nous dîmes, vous
dites, ils dirent), parfois enfin ambigu (je dis, il dit, vous dites
servent à la fois pour le présent et pour le prétérit), le prétérit
simple a tendu à disparaître : il est aujourd'hui entièrement sorti
de l'usage à Paris et dans toute la région où le français se parle
à la manière parisienne, c'est-à-dire dans un rayon de deux à
trois cents kilomètres autour de Paris. L'affaiblissement progressif
de la valeur du type j'ai dit a abouti à en faire un simple
prétérit, sans aucun reste de la valeur de parfait. Le cycle est
désormais parcouru, et, pour se donner un parfait, le français
devra recourir à quelque tour nouveau, dont on n'entrevoit pas
encore la naissance.
Des phénomènes analogues à ceux que l'on observe dans l'histoire
du latin et des langues romanes, et notamment du français,
ont eu lieu dans beaucoup d'autres langues, et d'une manière
indépendante. Par exemple, le parfait indo-européen était déjà
presque sorti de l'usage en perse à l'époque de Darius, donc dès la
fin du IVe siècle av. J.-C. ; on y suppléait par une forme nominale
de type passif, qui avait une valeur très nette de parfait ; pour
indiquer ce qui est accompli, on disait ima tya manâ krtam « voici
ce qui a été fait par moi », krtam signifiant ici « fait ». Mais
il subsiste encore en vieux perse des prétérits simples pour exprimer
l'acte, et l'aoriste akumâ signifie « nous avons fait », là où
il s'agit d'exprimer le fait pur et simple. Par la suite, le prétérit
simple s'est éliminé ; il n'est resté que l'ancienne forme composée ;
mais elle a pris le caractère actif, et kard signifie en persan
143« il a fait » ; man dans man kardam a pris la valeur d'un cas
sujet ; on fléchit kardam « j'ai fait », qui produit l'impression
d'une forme une et où l'on ne reconnaît plus en rien l'ancien
participe ; pour le sens, kardam est un simple prétérit et n'a plus
la signification du parfait, pas plus que le français moderne j'ai
fait.
Sous une forme tout autre, les langues slaves offrent un développement
exactement parallèle. A date ancienne, on y trouve un
prétérit simple tel que budixŭ « j'ai éveillé » et un parfait composé :
budilŭ jesmĭ « j'ai éveillé » avec (valeur de parfait), littéralement
« je suis l'éveilleur ». La valeur du parfait n'apparaît
déjà plus qu'affaiblie à l'époque des plus anciens textes, et, dans
les langues slaves modernes un type tel que voz-budil en russe,
ou wz-budzilem en polonais est un type simple, à valeur pure et
simple de prétérit. Dans plusieurs des principales langues slaves,
notamment en russe et en polonais, il y a même plus d'autre prétérit
que l'ancien parfait composé ; le prétérit simple est sorti de
l'usage depuis longtemps.
L'évolution est donc la même dans plusieurs langues, et il ne
serait pas difficile d'ajouter d'autres exemples à ceux qu'on vient
de passer en revue. Le parfait tend à s'exprimer par des formes
composées, de caractère nominal ; aussitôt entrées dans l'usage
courant, ces formes tendent à perdre leur valeur de parfait ; elles
se dégradent au niveau de simples prétérits ; du même coup elles
perdent leur caractère nominal et apparaissent comme des formes
verbales. Alors, étant en général plus régulières que les anciennes
formes du prétérit simple, elles tendent à remplacer celles-ci.
Le futur ou le présent duratif donneraient lieu à des remarques
du même ordre que celles qui viennent d'être présentées à propos
du parfait.
Même dans les langues qui comportent une conjugaison compliquée,
il peut n'y avoir aucune expression des actions futures
par des formes grammaticales particulières. Tel est le cas des
langues sémitiques et d'une grande partie des anciennes langues
indo-européennes par exemple. L'ancien germanique n'avait pas
144de futur, et aujourd'hui encore on peut à peine dire que l'allemand
ait un futur. Pour indiquer l'action à venir, on recourt
souvent à des formes qui indiquent qu'on a l'intention de faire
quelque chose ; la forme grammaticale qui, dans l'indo-européen
commun d'où sont issues toutes les langues indo-européennes,
avait ce sens, était le mode subjonctif ; et il se trouve ainsi que,
en latin par exemple, des formes comme erit ou dicet qui, de par
leur origine, sont des subjonctifs, ont pris la valeur de futur et
n'ont même plus d'autre valeur en latin à l'époque historique ;
seule, la grammaire comparée avertit que erit et dicet du latin ont
été, à une époque préhistorique, des subjonctifs. A une époque
plus récente du développement de certaines langues indo-européennes,
le verbe vouloir est devenu un auxiliaire servant à l'expression
du futur ; dans la bouche de beaucoup de Français, je
veux faire forme déjà un groupe dont le sens s'est assez affaibli
pour équivaloir à une sorte de futur. Dans l'anglais I will make,
le développement est plus avancé encore. Dans les langues slaves
du Sud et en grec moderne, l'expression du futur est obtenue au
moyen d'un verbe signifiant « vouloir », mais si dégradé pour
la forme et pour le sens que seul le linguiste peut maintenant l'y
reconnaître. En grec moderne par exemple thelô ina « je veux
que », réduit à thelô na, thena et simplement tha, ne laisse plus
rien deviner du verbe signifiant « vouloir ». Ailleurs on peut se
servir de mots signifiant « devoir », comme dans l'anglais I shall
make ou dans l'arménien moderne occidental bidi anem « je
ferai », littéralement « il y a nécessité que je fasse » ; et alors le
mot accessoire peut se réduire et devenir méconnaissable ; au lieu
de bidi, on trouve simplement di dans nombre de parlers arméniens.
C'est par ce moyen que les langues romanes se sont donné
un futur quand le futur du latin ancien est devenu trop faible,
trop inexpressif : facere habeo, qui est l'original de (je) ferai,
signifie « j'ai à faire », c'est-à-dire « je dois faire ». L'infinitif et
le verbe signifiant « avoir » se sont soudés ; avoir a pris une
flexion propre différente de celle du verbe isolé ; en disant je
finirai un Français ne pense pas à finir ni à ai ; en disant nous
finirons, il ne peut pas penser à finir ni à -ons, et il ne saurait être
145question d'analyser j'aimerai ou je viendrai. Par suite, ces formes
ont perdu toute valeur expressive. Comme on est le plus souvent
tenté de parler de l'avenir avec quelque expression particulière,
celle du désir, de l'attente, de la nécessité, le français en est venu
a se refaire de nouveaux futurs qui aient encore une force d'expression :
un futur prochain : je vais faire, où je vais n'est déjà
plus qu'un auxiliaire et où le sens d'aller n'est plus perceptible ;
je veux faire, où le sens de vouloir est encore bien perceptible ; je
dois faire, où je dois n'est guère plus qu'un auxiliaire, mais où le
sens de nécessité est net ; j'ai à faire ; etc. Le futur n'est pas une
forme nécessaire ; mais dans les langues où il existe, il se refait constamment.
Là où il y a une conjugaison qui exprime le temps, il faut une
forme propre à exprimer une action qui a lieu présentement. Mais
si l'on veut insister sur la durée de l'action, on se sert souvent
d'expressions complexes qui en viennent ensuite à fournir des
formes simples. Le type « je suis faisant », I am making, de l'anglais
est un exemple actuel de ce fait. Dans tous les parlers actuels
de l'arménien, le présent s'exprime par des formes qui n'ont plus
aucune valeur expressive particulière, mais qui ont été des formes
composées exprimant la durée. Le type sirum em de la plupart
des parlers de l'Arménie russe a signifié « je suis à aimer » et le
type g sirem de la plupart des parlers de l'Arménie turque est le
résultat de l'altération d'une forme complexe : kay ew sirê « il se
tient et il aime » où kay ew s'est réduit à ku et ku à kə (ə désignant
une sorte d'e muet) ; la prononciation g de l'ancien k est une
particularité du parler arménien de cette région. L'expression kay
ew sirê a exprimé très fortement la durée de l'action ; la forme
moderne g sire ne vaut pas plus que le français il aime et n'est pas
sensiblement moins une au sentiment des sujets parlants.
Les exemples de cette sorte pourraient être multipliés : toujours
le besoin d'expression fait créer des groupes qui, par l'usage,
perdent leur valeur expressive et servent alors de formes grammaticales,
dénuées de force.
Dès lors on voit combien peu il est légitime de parler de
146langues synthétiques et de langues analytiques. Ce n'est pas pour
analyser qu'on emploie des formes composées ; c'est en vue de
l'expression ; et ce n'est pas pour synthétiser qu'on a des formes
unes : les formes unes résultent du rapprochement qui a lieu en
fait entre mots groupés d'une manière habituelle. Quand on veut
s'exprimer avec force, on donne à chaque notion une expression
séparée ; on ne dit pas « je ferai », mais « j'ai la volonté de faire »
ou « il faut que je fasse » ou « je suis sur le point de faire » ; il
ne s'agit pas ici de logique, mais de sentiment à rendre et d'action
à exercer sur un interlocuteur. Et si je veux faire, je dois faire, je
vais faire n'expriment plus nettement la volonté, la nécessité, la
proximité, c'est que du fait du groupement ordinaire, les mots
veux, dois, vais ont perdu leur sens propre, leur valeur expressive,
et qu'ils sont devenus de simples auxiliaires en attendant qu'ils
fassent corps avec l'infinitif suivant. Le Romain qui disait facere
habeo ne faisait pas d'analyse, pas plus que le Français qui dit je
ferai ne fait de synthèse. Analyse et synthèse sont des termes
logiques qui trompent entièrement sur les procès réels. La « synthèse »
est une conséquence nécessaire et naturelle de l'usage qui
est fait de groupes de mots.
Les mots ne sont du reste pas seuls à être sujets à devenir
des éléments grammaticaux ; la façon de grouper les mots peut
aussi devenir un procédé d'expression grammaticale. En latin où
le rôle grammatical de chaque nom est indiqué par la forme de
ce nom, il n'y a pas d'ordre nécessaire : on peut dire pour « Pierre
bat Paul » : Petrus Paulum caedit, ou Paulum Petrus caedit, ou
caedit Petrus Paulum, ou caedit Paulum Petrus, etc. L'ordre n'est
pas indifférent ; il sert à indiquer certaines nuances : suivant
qu'on met en avant Petrus ou Paulum, on attire l'attention sur
l'un ou l'autre mot ; mais l'ordre n'indique en rien le rôle, grammatical
des mots. En français ou en anglais au contraire, c'est la
place respective des mots qui indique leur rôle, et en interchangeant
la place de Pierre et de Paul dans Pierre bat Paul, on changerait
aussi les rôles grammaticaux des deux noms. Ici, un ordre
de mots devenu habituel pour quelque raison a pris le caractère
de « morphème », c'est-à-dire de marque d'une catégorie grammaticale.
147La valeur expressive de l'ordre des mots, que l'on
observe en latin, a été remplacée par une valeur grammaticale 12.
Le phénomène est de même ordre que la « grammaticalisation »
de tel ou tel mot ; au lieu que ce soit un mot employé en
groupe avec d'autres qui prenne le caractère de « morphème »
par un effet de l'habitude, c'est une manière de grouper les mots.
Ici encore, il y a vraiment création d'outils grammaticaux nouveaux,
et non pas transformation. Tout le parti que le français et
l'anglais tirent de l'ordre des mots pour marquer les relations des
parties de la phrase entre elles est une création de ces langues :
ni le latin ni l'ancien germanique n'offraient rien de pareil.148
11. Scientia (Rivista di scienza), vol. XII (1912), n° XXVI, 6.
21. Sur le rôle du sentiment dans la création des formes grammaticales,
on verra les livres de M. Bally : la Stylistique, le Précis et le Traité et Le langage
et la vie, et, plus récemment le recueil de M. Léo Spitzer, Aufsätze zur
romanischen Syntax und Stylistik (Halle, 1918).