 Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
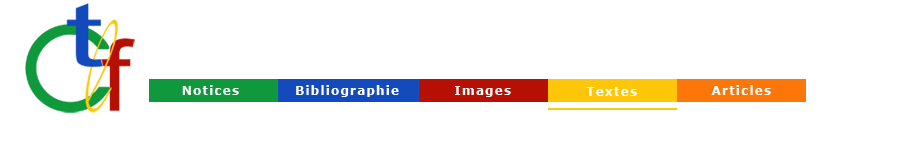
Sur les caractères du verbe 11
Les anciens grammairiens distinguaient une dizaine de « parties
du discours ». Comme les principes de leurs distinctions
n'étaient pas homogènes, et que d'ailleurs la situation diffère
d'une langue à l'autre, ils n'arrivaient pas à fixer un nombre
bien arrêté de ces catégories qui pourtant étaient censées représenter
les éléments fondamentaux du langage.
Il n'y a, en réalité, que deux espèces de mots dont la distinction
soit essentielle, commune à toutes les langues, et qui s'opposent
nettement l'une à l'autre : la catégorie du nom et celle du
verbe. Le nom indique les « choses », qu'il s'agisse d'objets concrets
ou de notions abstraites, d'êtres réels ou d'espèces : Pierre,
table, vert, verdeur, bonté, cheval sont également des noms. Le
verbe indique les « procès », qu'il s'agisse d'actions, d'états ou
de passages d'un état à un autre : il marche, il dort, il brille, il
bleuit sont également des verbes. (On laisse de côté, à dessein,
les mots accessoires, articles, pronoms, prépositions, conjonctions,
etc., qui posent des problèmes particuliers.)
La distinction du nom et du verbe s'exprime toujours par
quelque procédé grammatical. Elle n'est pas également marquée
partout, à beaucoup près, et la forme en varie d'une manière très
considérable suivant les langues.
Les langues où la distinction est le plus immédiatement visible
sont les langues dites flexionnelles où les mots portent dans leur
forme même la marque du rôle qu'ils jouent dans la phrase. Dans
175une langue comme le latin, on voit du premier coup que ago,
agis, etc. est un verbe et que dominus, domini, etc. est un nom.
Telle est la situation pour toutes les anciennes langues indo-européennes
ou sémitiques : la « déclinaison » du nom s'y oppose
à la « conjugaison » du verbe. Et ce n'est pas chose particulière
à ces langues : le finno-ougrien, le caucasique méridional, le
bantou offrent, chacun à leur manière, des faits analogues. Partout
où il y a flexion, la flexion nominale et la flexion verbale
se distinguent en s'opposant l'une à l'autre. Du reste, l'une des
deux flexions peut disparaître sans que l'autre en souffre : beaucoup
de langues indo-européennes, ainsi les parlers romans, l'anglais,
le persan, ont perdu la déclinaison nominale, tout en gardant,
plus ou moins complètement, la conjugaison verbale. De
même, en sémitique, la déclinaison nominale a disparu, à des
dates diverses, suivant les langues, tandis que la conjugaison verbale
s'est largement maintenue partout.
Mais, même en l'absence de toute flexion, la distinction du
nom et du verbe subsiste, exprimée par des moyens linguistiques.
Le fait de placer un complément avant ou après un mot suffit en
chinois à indiquer si ce mot est nom ou verbe. En anglais, un
même mot love peut servir aussi bien de verbe que de nom ; mais
le substantif love « amour » ne se confond pas pour cela avec le
verbe love « aimer » : s'il s'agit du nom, on dira the love, a love ;
s'il s'agit du verbe I love, you love ou, à l'infinitif, to love : le mot
love reste le même, mais les mots accessoires qui l'accompagnent,
et qui sont un des éléments essentiels de la morphologie anglaise,
diffèrent. Et l'on dira the man's love « l'amour de l'homme »,
mais I love the man « j'aime l'homme ». Sans doute, il peut y
avoir tel cas particulier où, en l'absence de toute particule et de
tout complément, une forme love est ambiguë ; mais c'est chose
exceptionnelle ; et l'ensemble des emplois donne aux sujets parlants
le sentiment net qu'il y a un substantif love et un verbe love.
Il ne faut pas envisager le mot isolé : ce n'est qu'une abstraction
vaine ; le mot ne se manifeste que dans la phrase, et, s'il est en
règle générale employé d'une manière telle qu'on ne puisse se
méprendre sur son rôle ou verbal ou nominal, on peut dire que
176le mot est soit verbe, soit nom, même si rien dans sa forme
propre ne le donne comme verbe ou comme nom, et s'il peut jouer
l'un ou l'autre rôle suivant les cas.
Ces considérations autorisent à poser la catégorie du verbe
comme essentielle dans le langage.
Par le fait que le verbe exprime un procès, la langue est amenée
à marquer à qui où à quoi s'applique ce procès. Là où il y a
flexion, le verbe exprime avant tout ce qui agit ou qui est dans
un état donné ou qui passe d'un état à un autre : la flexion personnelle
est la plus naturelle au verbe, et la plus ordinaire. C'est
aussi celle qui persiste le plus. Même celles des langues indo-européennes
qui ont le plus altéré les fins de mots et le plus
réduit tout l'ensemble de la flexion ont gardé quelques traces de
la flexion personnelle. En français, c'est avant tout le pronom —
devenu un simple outil grammatical — qui marque la personne ;
mais, même dans une conjugaison comme celle d'aimer où, au
présent, quatre des formes se sont confondues dans la prononciation
(j'aime, tu aimes, il aime, ils aiment), il reste deux formes
pourvues de flexion : nous aimons, vous aimez. En anglais, où
I love, we love, you love, they love ont une même forme de love, il
y a une forme propre pour he loves. Quand il a une flexion propre,
le verbe se reconnaît donc le plus souvent à ce qu'il possède une
flexion personnelle.
On voit bien en français, par l'affaiblissement de sens qu'entraîne
l'habitude de les employer, comment des pronoms autrefois
autonomes deviennent peu à peu de simples éléments grammaticaux,
équivalant à des désinences : je, tu, il, ils ont été d'abord
des pronoms et ont eu le caractère de mots autonomes ; aujourd'hui,
ce ne sont plus que des parties de formes verbales, dénuées
de sens par elles-mêmes : un tour tel que : je, huissier près le tribunal
de X, signifie, n'est qu'un archaïsme de la langue judiciaire ou
administrative, et un archaïsme qui surprend un Français du temps
présent. Les marques de la personne sont si nécessaires qu'elles
177tendent à figurer même si la personne est exprimée déjà par un
pronom expressif et vraiment autonome : moi, je dis ; toi et moi,
nous croyons. Et même, dans le parler populaire, on tend à mettre
il, elle devant le verbe à la troisième personne quand le sujet est
un substantif : la vache, elle mange ; vos amis, ils sont arrivés ; ton
eau, elle bout ; etc. Mais les formes du type du français : j'aime, tu
aimes, il aime, ils aiment, montrent aussi que le pronom marquant
la personne près du verbe est — ou du moins peut être
— autre chose que le complément d'un nom. En sémitique et en
hamitique, les affixes qui indiquent les personnes près des verbes
sont manifestement identiques aux pronoms personnels ; l'exemple
du français montre que ces pronoms ne doivent pas nécessairement
être considérés comme l'équivalent de compléments de
nom, comme l'ont parfois imaginé des linguistes qui croyaient
à la priorité des formes nominales ; et, par exemple, une forme
sémitique qui s'analyse aime-moi ne remonte pas nécessairement
à un ancien type aimer de moi, où l'élément aime aurait une
valeur nominale, comme on l'a souvent supposé : le pronom
qui est devenu une marque de la personne peut avoir, comme
en français, un tout autre caractère, et le radical peut avoir une
valeur vraiment verbale. Du reste, en indo-européen où le
verbe est distinct du nom plus qu'il ne l'est nulle part ailleurs,
des marques de personnes employées dans la flexion verbale, les
unes sont tout à fait distinctes du pronom personnel, les autres
ne les rappellent que de loin, et l'on n'a par suite pas le droit
d'identifier à des pronoms indo-européens telle ou telle des
désinences de la flexion personnelle qui se trouve, peut-être
par hasard, leur ressembler.
Et, en effet, la flexion personnelle, si caractéristique qu'elle
soit du verbe, ne lui est pas essentielle. Elle manque dans beaucoup
de langues, notamment dans les langues d'Extrême-Orient
où il n'y a aucune flexion, et où, de plus, la personne s'exprime
non par des pronoms, mais par des formules polies, du type de
sa grandeur, son excellence.
Même dans les langues où la flexion personnelle est le plus
développée, il est commode, pour construire les phrases, d'avoir
178des formes capables d'exprimer le procès, mais qui admettent les
mêmes constructions que le nom. Il s'est donc constitué des
formes qui, tout en indiquant le procès, tout en étant des verbes,
puisqu'elles admettent les mêmes compléments et les mêmes
déterminations que les verbes, ont le caractère nominal ; on
appelle infinitifs les formes de ce genre qui ont le rôle de substantifs,
et participes celles qui ont le rôle d'adjectifs. Le nom de
participe est, comme la plupart des termes grammaticaux, un mot
latin, calqué sur un mot grec qui a servi de modèle, et qui signifie :
« qui a part (à la nature du nom et du verbe tout à la
fois) » ; le nom s'appliquerait à l'infinitif aussi bien qu'au participe,
mais, par suite de la structure de la langue grecque où le
mot a été formé et où l'infinitif n'était pas un vrai substantif,
au moins par la forme, tandis que le participe était un véritable
adjectif à tous égards, les Grecs qui ont formé lé mot sur lequel
participe est calqué ne l'ont appliqué qu'à des formes ayant
valeur d'adjectifs ; on est ici en présence d'un de ces accidents
dont est faite toute l'histoire du vocabulaire. Des formes comme
les infinitifs latins dicere ou dixisse ou comme les participes dicens,
dicendus, dicturus, dictus sont aussi verbales, en un sens, que diço
ou dixi. Mais, de plus, elles admettent des constructions nominales,
et elles n'admettent pas certaines constructions verbales :
en général, elles ne servent que d'éléments secondaires, souvent
en apposition, dans des phrases où figurent des formes verbales
personnelles.
D'ailleurs le verbe n'est pas un élément constant de toute
phrase. Il y a deux sortes de phrases : les phrases nominales où
une chose est affirmée d'une autre chose, et les phrases verbales
où est exprimé un procès. Dans les phrases nominales telles que :
l'homme est bon, la maison est neuve, il est chez toi, il ne figure un
verbe que pour la commodité de la phrase ; les langues sémitiques
n'y ont aucune forme verbale ; l'indo-européen n'en avait
pas le plus souvent ; le russe dit encore aujourd'hui dom nov « la
maison est neuve », on u tebê « il est chez toi ». C'est dire à quel
point l'analyse de j'aime en je suis aimant, où s'est complue longtemps
la grammaire dite logique, est artificielle, et loin de la réalité.
179La phrase nominale et la phrase verbale diffèrent de nature,
et il est aussi vain de vouloir ramener l'une à l'autre, qu'il le
serait de vouloir ramener le nom au verbe, et inversement.
Un même mot peut souvent servir de nom et de verbe dans
les langues où le rôle du mot dans la phrase n'est pas indiqué
par la forme du mot : l'anglais love a donné une idée du procédé,
et a montré du même coup que cette identité de forme n'entraîne
pas confusion de la catégorie du nom avec celle du verbe. Les
mêmes éléments radicaux fournissent des noms ou des verbes
suivant les affixes qu'on y adapte dans les langues où les mots
ont des formations compliquées. Une même « racine » indo-européenne
ou sémitique est un élément commun à la fois à des
formes verbales et à des formes nominales ; en pareil cas, on
parle souvent de racines verbales, parce que d'une racine telle
que ag- qui forme le verbe latin ago, on tire aussi des noms tels
que actus ou actio qui éveillent l'idée d'un procès, par association
avec les formes verbales. Mais ces racines ne sont ni verbales ni
nominales ; elles sont la partie du mot qui indique l'élément du
sens commun à des verbes et à des noms. On voit là, de même
que dans les mots susceptibles d'être à la fois noms et verbes,
comment un même élément linguistique peut apparaître soit
sous l'aspect nominal soit sous l'aspect verbal. Une « racine verbale »
est, dans la structure morphologique des langues à flexion,
ce qu'est dans les langues dénuées de toute flexion un mot
capable d'être à la fois nom et verbe. Ceci n'emporte naturellement
aucunes conséquences certaines pour la façon dont se sont
constituées historiquement les racines indo-européennes ou sémitiques ;
mais il est au moins vraisemblable que les « racines »
sont des résidus de mots susceptibles d'être noms ou verbes suivant
l'usage qui en est fait, comme anglais love, ou comme beaucoup
de mots chinois.
Les procès peuvent être envisagés de manières diverses ; il
résulte de là que les formes verbales peuvent exprimer des catégories
180diverses. Mais, comme, dans une langue donnée, le nombre
des formes, et, par suite, celui des catégories est nécessairement
très limité, le verbe présente les procès de manières différentes
suivant les langues ; et les catégories exprimées par le verbe ne
se laissent pas traduire exactement d'une langue à l'autre. Il est
exceptionnel qu'on puisse traduire en français un verbe russe, ou
en russe un verbe français sans rien laisser perdre de la valeur
juste de chaque forme des deux langues. Même quand on réussit
à faire une phrase russe qui équivaut exactement à une phrase
française, le verbe russe exprime presque toujours une nuance
qui n'est pas dans le verbe français, et inversement.
En donnant les mêmes noms à des formes grammaticales de
langues diverses et en construisant autant que possible sur le
même plan la grammaire de langues différentes, les grammairiens
ont beaucoup péché ; ils ont répandu bien des idées fausses.
Tout au plus peut-on ramener les catégories qui apparaissent
dans les diverses langues à un nombre restreint de types généraux.
Mais on ne trouve pas partout les mêmes types ; des types
qui, au fond, sont les mêmes, rendent, d'une langue à l'autre,
des nuances assez différentes, de sorte que, même si l'on
n'applique les mêmes noms qu'à des types semblables entre eux,
néanmoins ces noms recouvrent encore des formes qui ont des
valeurs sensiblement distinctes les unes des autres.
L'habitude d'étudier la grammaire latine et l'influence qu'a
exercée le modèle latin sur les auteurs de grammaires ont habitué
à mettre au premier plan des catégories verbales celle du temps.
Rien de plus naturel au premier abord. Tout procès a lieu dans
le temps, et il est naturel que la forme du verbe situe les procès
dans le temps.
Toutefois, un détail frappe immédiatement : le temps comporte
trois moments essentiels : le présent, le passé et l'avenir. Or, de
ces trois moments, il arrive souvent que deux seulement soient
exprimés par des formes grammaticales propres : le présent et le
181passé. Le futur n'a souvent pas d'expression propre, ou, s'il en
a une, c'est une expression compliquée et qui n'est pas parallèle
à celles du présent et du passé. Ainsi l'allemand a un présent et
un prétérit nets ; mais, au futur, le type ich werde machen est un
tour lourd, gauche, qui s'emploie peu dans la langue parlée.
L'anglais a des présents et des prétérits bien clairs, bien simples ;
mais ses deux formes de futur sont d'un type autre, et elles
expriment deux nuances de procès à venir, bien plutôt que le
futur proprement dit : « je veux faire », ou « je dois faire ». Le
germanique commun, dont les langues germaniques actuellement
parlées sont des continuations, avait un présent et un prétérit,
pas de futur. On n'a aucune raison de croire que l'indo-européen
préhistorique, qui avait des moyens d'opposer le prétérit au
présent, ait jamais possédé un vrai futur.
L'examen du développement linguistique confirme cette observation.
Le futur est instable. Les langues romanes ont conservé
le présent et le prétérit latins ; mais elles ont remplacé le futur
latin par des formes nouvelles : je chante, je chantais continuent
des formes latines ; je chanterai est une forme nouvelle, qui n'a
rien à faire avec le latin cantabo, et qui s'est constituée dans le
développement même du roman : elle signifiait d'abord « j'ai à
chanter ». Aujourd'hui encore le français tend souvent à remplacer
le futur, devenu tout abstrait, je ferai, par des formes expressives :
je vais faire, je veux faire, je dois faire, etc.
L'opposition d'un présent et d'un prétérit est chose normale
et durable ; l'opposition d'un futur au présent et au prétérit est
exceptionnelle et sujette à changement.
Ce détail suffit à montrer que la catégorie « logique » du temps
ne domine pas le verbe autant qu'on pourrait le croire au
premier abord.
La façon dont le temps est envisagé varie d'ailleurs d'une
langue à l'autre. Il y a des langues où plusieurs nuances de prétérit
ont chacune leur marque spéciale, et il y en a d'autres où ne
figure pas d'autre opposition que celle du présent et du prétérit,
l'ancien germanique ou l'ancien slave, par exemple. Le français
est le type d'une langue où des formes grammaticales distinctes
182indiquent des moments finement nuancés du temps : il y a une
unique forme de présent, puisque le présent, par nature, exclut
toute nuance en tant qu'on ne considère que le temps proprement
dit, mais il y a des prétérits multiples : l'un indique la
simultanéité dans le passé : je faisais cela autrefois, je faisais cela
quand vous êtes arrivé ; un autre indique simplement l'action
passée : j'ai fait cela ; la langue parlée du centre de la France,
tout autour de Paris, n'a plus que cette forme ; mais la langue
écrite a conservé deux formes, je fis et j'ai fait, l'une exprimant
purement et simplement que l'action de « faire » a eu lieu à un
moment du passé, l'autre indiquant que l'action est réalisée : il
y a ici un reste de distinction d'aspect dont on verra plus bas
le principe ; une autre forme indique l'antériorité dans le
passé : j'avais fait cela auparavant, j'avais écrit cela quand vous
êtes arrivé ; aussi longtemps qu'a duré le prétérit simple, il
y a eu une forme j'eus fait dont la nuance de prétérit antérieur
concordait avec celle de je fis ; on tend aujourd'hui à dire : j'ai eu
fait, par exemple j'ai eu fait tout cela avant son arrivée. Il y a également
un futur et un futur antérieur. Il y a même un futur et
un futur antérieur dans le passé : je savais qu'il ferait cela, je
savais qu'il aurait fait cela avant mon arrivée. Hors des langues
romanes, on ne trouverait guère pareille variété de nuances.
Aussi, en réfléchissant sur le verbe, un Français doit-il se méfier
de sa façon de concevoir le verbe comme une forme qui exprime
avant tout le temps.
Il y a une catégorie qui interfère souvent avec celle du
« temps », c'est celle que l'on connaît en grammaire slave sous
le nom d'« aspect », et dont le caractère répond aussi bien, sinon
mieux, au caractère du verbe que la catégorie du « temps ».
La catégorie de l' « aspect », non moins variée que celle du
« temps », embrasse tout ce qui est relatif à la durée et au degré
d'achèvement des procès indiqués par les verbes.
En anglais, on distingue par exemple deux sortes de présents :
183l'un, I sing, exprime simplement le fait que « je chante », l'autre,
I am singing, signifie « je suis en train de chanter ». Et il y a
deux prétérits correspondants : l'un, I sang, qui indique le fait
que « j'ai chanté », dans le passé, et l'autre, I was singing, qui
signifie « j'ai été, j'étais en train de chanter » dans le passé.
Le verbe slave est tout dominé par la notion de l'aspect. Un
verbe slave n'est pas simple comme un verbe français ; il se compose
toujours d'une paire de formes, l'une indiquant le procès,
le fait pur et simple, et par suite souvent le procès achevé, l'autre
indiquant le développement du procès. Celle des deux formes du
verbe qui indique le procès purement et simplement est dite
perfective, ainsi pasti « tomber » ; l'autre, qui indique le développement
de l'action, est dite imperfective : padati « être en train de
tomber ». C'est ainsi qu'en vieux slave umréti « mourir » s'opposait à
umirati « être en train de mourir ». L'importance et la
constance de cette opposition de deux aspects caractérisent les
langues slaves ; cette opposition s'est bien conservée dans toutes,
surtout en russe, en tchèque, en polonais.
Mais il y a des langues où les oppositions sont plus complexes
qu'elles ne sont en slave : le grec ancien distinguait non pas deux,
mais trois « aspects », auxquels on donne des noms ou
impropres ou signifiant peu de chose : l'aspect duratif, connu
sous le nom très inexact de présent, qui répond à peu près à
l'imperfectif slave, et qui fournit à la fois un présent proprement
dit, soit thnéskei « il est en train de mourir », et un prétérit, dit
imparfait, ethnéske « il était en train de mourir » — l'aspect
momentané, connu sous le nom d'aoriste, qui répond en partie au
perfectif slave, soit ethane « il est mort » ; l'aoriste ne comporte
pas de temps présent, parce qu'il exprime un événement qui a eu
lieu à un moment donné ; — l'aspect achevé, connu sous le nom
de parfait, au moyen duquel on exprimait que le résultat du procès
indiqué par le verbe est atteint ; le parfait grec ne répond
qu'en partie au perfectif slave, soit tethnéke « il est mort » (non pas
« il est mort à tel ou tel moment », mais « actuellement il est à
l'état de mort ») ; le parfait s'emploie le plus souvent au présent,
pour indiquer un résultat acquis au moment où parle le sujet ;
184mais il en existe un prétérit, dit plus-que-parfait, soit etethnékei
« il était mort », pour exprimer un procès déjà réalisé dans le
passé.
La catégorie de l'aspect est plus concrète que celle du temps, et,
au cours de l'histoire des langues indo-européennes, on voit
l'aspect perdre de l'importance, le temps en gagner.
Le latin offre à cet égard un fait caractéristique. Tandis que le
grec conserve exactement, qu'il a peut-être même précisé et
rendu plus rigoureuse l'opposition des trois aspects : duratif,
momentané et parfait, le latin n'a gardé que deux aspects, un
duratif, dit infectum, et un « perfectif », dit perfectum. Mais à
chacun des deux aspects, il a donné à l'indicatif trois temps : un
présent, un prétérit et un futur, si bien que l'on a le système
suivant :
tableau infectum | perfectum | présent | dicit | il est en train de dire | dixit | il a dit | prétérit | dicebat | il était en train de dire | dixerat | il avait dit | futur dicet | il sera en train de dire | dixerit | il aura dit
Le présent du perfectum dixit indique que l'action de « dire »
est achevée au moment où l'on parle ; cette forme se prête également
bien à raconter un fait passé : dixi « j'ai dit » (à un moment
quelconque du passé) et à insister sur le fait qu'on a fini de
parler : dixi « j'ai dit » (et je n'en dirai pas plus) ; certaines
formes du présent du perfectum, comme memini « je me souviens »
servent de présents. On a traduit le futur du perfectum dixerit
par « il aura dit » ; mais la forme française rend mal la forme
latine, et si l'on s'obstinait à rendre dixerit des textes latins par
« il aura dit », on tomberait souvent dans de graves difficultés ;
la forme latine signifie « il dira », étant entendu que l'action est
envisagée comme achevée ; c'est par suite un futur plus fort que
le futur dicet. (Pour ne pas compliquer un exposé, déjà trop
touffu par nécessité, on laissera de côté ici la nuance fine qu'ajoute
souvent à un verbe l'addition d'un « préverbe », c'est-à-dire
l'opposition de memini et commemini, de vinco et evinco, etc.) —
Les langues romanes n'ont pas gardé ce système, elles ont laissé
185tomber tout ce qui avait valeur d'aspect, et elles n'ont gardé que la
valeur temporelle. Le latin ancien se trouve donc représenter une
transition de l'indo-européen, où dominait l'aspect, aux langues
romanes actuelles, où domine le temps. — - On observe ainsi trois
moments successifs : l'indo-européen, où les divers radicaux d'un
même verbe, celui du « présent », celui de l' « aoriste », et
celui du « parfait », expriment des aspects, où la différence du
présent et du passé n'est exprimée qu'accessoirement et d'une
manière sommaire, parfois ambiguë, et où il n'y a pas de futur —
le latin, où l'opposition d'une forme indiquant le procès en voie
de développement, l'infectum, et d'une forme indiquant l'action
achevée, le perfectum se maintient, mais où il n'y a plus que
deux aspects nets, et où à chacune des deux notions d'aspect se
superpose l'expression nette des trois temps, présent, passé et
futur — le français, où il ne reste rien de la notion d'aspect, et
où le temps est rendu avec tout un luxe de nuances.
Les langues sémitiques, moins abstraites en général que les
langues indo-européennes, opposent pour la plupart un « parfait »
et un « imparfait », dont la valeur essentielle se rapporte à l'aspect ;
et elles n'arrivent à indiquer le temps que par des procédés
indirects, au moyen de formes qui se rapportent à la catégorie
de l'aspect.
Les besoins de l'expression amènent souvent à rétablir des
oppositions d'aspect au fur et à mesure que s'efface par l'usage
la valeur expressive des oppositions existantes.
L'histoire des formes du présent indo-européen est instructive
à cet égard.
Le type dit du « présent » exprimait le procès considéré dans
son développement, dans sa durée. Cette valeur est encore bien
sensible dans les anciens textes indo-iraniens, et surtout en grec,
et même en latin. Mais toutes les catégories qui rendent des
notions expressives et concrètes plutôt que logiques tendent
sans cesse à perdre de leur valeur, et la tendance à parler d'une
186manière expressive et concrète en a sans cesse fait rétablir à la
place de celles qui se sont effacées. C'est ainsi que le futur s'élimine,
remplacé par des formes expressives qui signifient : « Je
veux faire, je dois faire », etc. Les radicaux du « présent » indo-européen
ont peu à peu perdu presque partout leur « valeur relative » ;
ceci se reconnaît à ce qu'ils cessent de fournir un prétérit
en même temps qu'un présent : un radical de « présent » indo-européen
fournissait à la fois un « présent proprement dit » et un
« imparfait », ainsi en grec phérô « je porte » et épheron « je portais »,
tandis qu'un présent slave, lituanien, germanique, irlandais n'est
pas accompagné d'un imparfait, lié au radical du « présent ».
C'est que le radical du « présent » indo-européen exprimait uniquement
l'aspect, et que le radical du présent germanique, par
exemple, exprime uniquement le temps.
Mais le besoin qu'on éprouve d'insister sur la durée d'une
action qui se poursuit persiste. On y répond par divers procédés.
Le persan se sert d'une particule bē pour indiquer la durée de
l'action. Parmi les parlers arméniens, les uns ont tiré parti de
l'usage de coupler des verbes qui existait dans la langue ; ils ont
étendu l'emploi de ka u « il se tient et… », puis ont généralisé
l'usage de ce groupe de mots devenu simple particule devant n'importe
quel présent ; les autres ont recouru à une périphrase, et,
au lieu de « il porte », ont dit « il est dans le porter » : berum ē ;
actuellement, ces deux procédés sont fixés dans les divers parlers
arméniens, et ils ont depuis longtemps perdu leur force ; mais
on voit comment ils se sont créés et pour quelles fins expressives.
Le slave a développé des imperfectifs qui expriment fortement la
durée. L'anglais a fait sa forme composée : I am reading « je
suis à lire ». Le français n'a encore aucun procédé grammatical
fixé, et il doit recourir à des termes dont les éléments ne sont pas
fondus et qui n'ont pas encore le caractère de formes grammaticales,
comme : je suis à lire, je suis en train de lire, etc. ; (le berrichon
a, en pareil cas, je suis après labourer, al est après coudre,
« elle est en train de coudre », etc.) ; par suite, ces types ne sont
pas aussi courants que le type anglais, I am reading, par exemple.
Les sujets parlants sentent aussi le besoin de marquer qu'un
187procès est achevé. Au fur et à mesure qu'elles s'emploient, les
formes grammaticales qui servent pour cette catégorie, les formes
dites de « parfait », s'usent. Elles finissent par n'avoir d'autre
valeur que celle d'un prétérit. Alors il faut créer des procédés
nouveaux pour rendre le parfait. L'histoire des langues indo-européennes
montre d'une manière frappante et l'usure du parfait
indo-européen, et les créations successives auxquelles donne
lieu cette usure, et le fait que des formes qui ont été faites pour
rendre le parfait, c'est-à-dire l'aspect parfait, ont toujours de nouveau
abouti à rendre le passé, c'est-à-dire le temps passé 12.
Ainsi, dès le latin classique, les formes de perfectum présent,
telles que dedi « j'ai donné », dixi « j'ai dit », etc., tout en gardant
leur nuance de sens propre, c'est-à-dire en continuant d'indiquer
le procès achevé, servaient de temps historique, pour
énoncer que tel ou tel procès a eu lieu dans le passé. Ces formes
tendaient ainsi à perdre leur valeur de perfectum, et elles l'ont
enfin si bien perdue que, dans toutes les langues romanes, elles
n'ont fourni que des prétérits, et non plus des parfaits. Pour
rendre le parfait, on a recouru à des procédés nouveaux. Le plus
usuel consiste à prendre le verbe signifiant « avoir », et à y
joindre un participe indiquant le procès achevé, soit habeo illud
factum « je tiens cela fait, j'ai cela fait » ; il y a eu là d'abord
deux mots indépendants l'un de l'autre, habeo et factum. ;. puis
habeo et factum ont été rapprochés au point de vue du sens, et
même au point de vue de la forme, et l'on est arrivé au type
français : j'ai fait. A son tour, ce type a tendu à perdre sa valeur
de parfait quand on a cessé de sentirai et fait comme deux mots
distincts ; aujourd'hui les trois éléments de j'ai fait ne sont pas
plus distincts pour le sujet parlant que ne l'étaient en latin ceux
de feci ; le fait que ces trois éléments sont encore susceptibles
d'être séparés matériellement les uns des autres (ainsi dans : je ne
vous l'ai jamais fait) n'a pas suffi à empêcher la fusion des
valeurs. Aussi le type j'ai fait a-t-il passé au rôle de simple
temps historique et a perdu toute valeur de parfait ; dès lors le
188type je fis était superflu, et le type nouvellement formé en roman
j'ai fait en a pris la place en français parlé d'aujourd'hui, dans
toute la France centrale autour de Paris.
Pareille histoire n'a rien que de courant. La façon dont se
constitue un prétérit nouveau varie, dans le détail, d'une langue
à l'autre ; mais, au fond, le procédé est partout le même.
Les langues germaniques, qui sont en contact avec les langues
romanes, ont employé le même procédé : l'allemand dit ich habe
gemacht, tout comme le français dit j'ai fait ; de même que dans
la France du centre, j'ai fait a pris toute la place de je fis, de
même dans une très grande partie du domaine allemand, ich habe
gemacht a éliminé ich machte. — On a retrouvé le même recours
à un verbe « avoir » dans des parlers iraniens du centre de
l'Asie tout à fait isolés et qui n'ont pu subir l'action du roman
ou du germanique.
En slave, il a été procédé un peu autrement. Le nouveau parfait
se compose d'un nom d'agent, accompagné au besoin du
verbe « être ». « J'ai dit » s'exprime alors par reklŭ jesmĭ « je
suis diseur ». Mais, dès avant l'époque historique, le type des
noms en -lŭ indiquant l'agent ne s'employait pas ailleurs que dans
cette expression verbale ; par suite reklŭ jesmĭ ne s'analysait plus
en « je suis celui qui a dit » ; c'était un procédé pour indiquer
que l'acte de dire était fait. Aussi, dès les plus anciens textes, la
valeur de parfait de l'expression est-elle peu sensible. Dans une
notable partie du groupe slave, et notamment en russe et en
polonais, le parfait ancien a perdu ainsi sa valeur propre ; il est
devenu un simple prétérit, et il a entièrement éliminé l'ancien prétérit
simple : c'est, avec d'autres éléments linguistiques, le pendant
exact des faits français et allemand.
L'arménien a procédé comme le slave. Mais il ne semble pas
que la forme composée, faite pour exprimer le parfait, ait
jusqu'à présent éliminé le prétérit simple dans la plupart des
parlers.
L'iranien s'est servi d'un troisième procédé : un participe qui
est intransitif ou passif suivant le verbe, et qui, comme en slave,
fournit une phrase nominale ; ainsi, en vieux perse, aita manâ
189krtam « cela a été fait par moi », bûta a(h)mi « j'ai été ». Par
des arrangements successifs, ce type est devenu le seul type de
prétérit du persan : kardam « j'ai fait », bûdam « j'ai été », etc.
Quel que soit le détail, il s'agit toujours d'un même type de
développement. Le point de départ est le besoin d'exprimer le
procès achevé, dans une langue où il y a déjà une forme pour
exprimer simplement le prétérit. Le point d'arrivée est la constitution
d'une nouvelle forme de prétérit qui souvent a remplacé
tout à fait l'ancienne.
Ce développement, qui se répète sans cesse, montre comment
la catégorie expressive et concrète de l'aspect fournit, en perdant
par l'usage son caractère expressif et concret, un moyen de
rendre la catégorie abstraite du temps.
Sous le nom de modes on entend les formes au moyen desquelles
est indiquée l'attitude mentale du sujet parlant par
rapport au procès indiqué par le verbe.
On pourrait s'attendre à ce que la différence entre l'énonciation
des faits et le commandement détermine deux catégories grammaticales
tranchées. Or, il se trouve que souvent les différences
entre les formes qui servent à énoncer et celles qui servent à
commander sont ou nulles ou minimes. Ainsi, en grec, c'est une
même forme phèrete qui sert à indiquer le fait : « vous portez »,
et le commandement : « portez ». En français, c'est exactement
la même forme verbale qui sert à énoncer et à ordonner ;
seulement dans un cas il y a pronom préfixé, et dans
l'autre non : chante ou tu chantes (l's est purement graphique),
viens et tu viens, etc. En latin, il y a une légère différence entre
les formes qui servent à énoncer et celles qui servent à commander,
mais cette différence ne porte que sur la désinence,
nullement sur le radical : canta « chante », et cantate « chantez »
ne se distinguent que légèrement de cantas « tu chantes », cantatis
« vous chantez ». L'absence ou la faiblesse de la distinction
entre les formes qui servent à deux usages aussi distincts que
190l'énonciation et le commandement vient de ce que, dans le
discours parlé, la situation des interlocuteurs et le ton du discours
indiquent assez si l'on énonce ou si l'on commande.
On remarquera seulement, en passant, que la forme qui sert à
ordonner, à la 2e personne du singulier, ou bien se confond
avec le radical du verbe, ou s'en distingue assez peu : ainsi en
français chante, viens, cours, etc. C'est que l'on parle surtout pour
obtenir quelque action de l'interlocuteur, et que, au fond, l'impératif
est la forme essentielle du verbe. Les textes écrits, sur lesquels
les linguistes opèrent le plus souvent, donnent à cet égard
une idée fausse de la réalité.
En revanche, — et surtout chez des demi-civilisés ou chez des
hommes de faible culture, — le sujet parlant tend à marquer son
attitude vis-à-vis du procès dont il s'agit. Il tient à indiquer
expressément le fait ou le désir, la volonté, la certitude ou la
possibilité. Ici encore le développement des formes au cours
de l'histoire des langues indo-européennes est instructif.
L'indo-européen commun, organe d'un peuple simplement
demi-civilisé, distinguait un indicatif, au moyen duquel on énonçait
le procès, de deux « modes » dont la forme apparaît comme
dérivée par rapport à celle de l'indicatif : le subjonctif, qui
servait à exprimer une volonté, et l'optatif, qui servait à indiquer
une possibilité ou un désir. Mais cette distinction de trois modes
ne s'observe plus que dans les deux langues de la famille indo-européenne
attestées à la date la plus ancienne et sous la forme
la plus archaïque : le grec et l'indo-iranien. Car, dès le début,
la langue tend à ne plus opposer que deux modes : l'un, l'indicatif,
énonçant le procès comme un fait, l'autre, dit subjonctif,
de forme dérivée, énonçant le procès avec quelque considération
subjective : volonté, désir, possibilité. En grec et en iranien,
l'optatif s'est éliminé d'assez bonne heure (l'optatif grec était
sorti de l'usage de la langue parlée dès le Ier siècle après J.-C.) ;
en sanskrit, c'est le subjonctif qui a succombé, bien avant le
début de l'ère chrétienne à ce qu'il semble. Et partout, il
n'est resté qu'un seul mode à valeur subjective. On n'est donc
pas surpris de constater que des langues comme le latin, l'irlandais,
191les dialectes germaniques offrent un seul mode distinct de
l'indicatif.
Du reste, avec le temps et le progrès de la culture, le mode
unique opposé à l'indicatif change de rôle. En indo-européen,
chaque mode avait sa valeur sémantique propre. Peu à peu, au
fur et à mesure que la structure des phrases se complique et qu'à
l'usage dominant des phrases simplement coordonnées et des
phrases relatives, se superpose un système compliqué de phrases
subordonnées, le mode à forme dérivée sert surtout à caractériser
certains types de subordonnées et certaines nuances de sens chez
les subordonnées. Déjà en latin, le subjonctif est avant tout un
outil de la subordination ; il sert à caractériser certains types de
subordonnées ou certaines valeurs spéciales chez les subordonnées :
hominem quaero qui ueniat « je cherche un homme pour qu'il
vienne » diffère absolument de hominem quaero qui uenit « je
cherche l'homme qui vient ». On retrouve facilement dans les
phrases où figure le subjonctif latin, la nuance de la volonté,
celle de la possibilité, mais tout cela lié la plupart du temps à
certains types de phrases dépendantes. Il est relativement rare
que le subjonctif latin s'emploie dans une phrase principale, avec
sa valeur propre ; la grande majorité des exemples figure dans
des phrases dépendantes.
Le français, qui oppose je crois qu'il le veut à je ne crois pas qu'il
le veuille, par exemple, et je sais qu'il vient à je veux qu'il vienne,
montre bien comment le subjonctif, qui d'abord exprimait la
sensibilité du sujet parlant, est aujourd'hui le moyen de caractériser
certains types de phrases. Aussi le français a-t-il constitué un
nouveau type modal, qui a une valeur surtout grammaticale, le
conditionnel : je ferais volontiers ceci si vous vouliez Parfois le
conditionnel sert à indiquer la possibilité, dans des conditions
assez pareilles à celles où l'on rencontre certains optatifs
anciens : je ferais volontiers ceci ; mais son rôle le plus ordinaire
est de figurer dans des phrases exprimant une condition.
On remarquera ce qui se passe dans certaines langues indo-européennes
qui ont derrière elles un long développement,
puisque les plus anciens monuments sont du IXe siècle après
192Jésus-Christ pour le slave, du XVIe pour le groupe baltique, et
où par suite le mode a pu s'altérer beaucoup ; elles ont perdu
jusqu'à l'opposition d'un « subjonctif » et d'un indicatif, sans
doute parce que, demeurant à un stade archaïque et servant à des
populations relativement arriérées, elles sont allées jusqu'au bout
de l'évolution avant d'avoir beaucoup développé la subordination.
Ainsi le rôle du « mode » a varié, au fur et à mesure que
le sujet parlant a moins éprouvé le besoin de marquer, dans les
formes verbales qu'il emploie, son attitude mentale vis-à-vis des
procès indiqués.
Il y a tout un autre groupe de catégories qui a une grande
importance pour la théorie du verbe ; ce sont celles qui se rapportent
au rôle, par rapport au verbe, de la notion à laquelle
s'applique le procès indiqué, de ce que l'on appelle le « sujet ».
On est amené à distinguer des verbes actifs et passifs, transitifs et
intransitifs, moyens ou réfléchis, causatifs, désidératifs, intensifs.
Comme il s'agit de valeurs sémantiques de caractère ou concret
ou sentimental, la plupart de ces oppositions ont tendu, avec le
temps, à s'atténuer ou à disparaître.
On nomme sujet la notion à laquelle s'applique le procès
indiqué par le verbe : Pierre vient, Pierre dort, lés blés mûrissent,
le monument s'élève là, etc. Les formes fléchies à marque personnelle
comprennent elles-mêmes leur sujet : latin canto, cantas,
cantamus, cantatis ont leur sujet dans la forme même du verbe ;
et, comme, en français, les anciens pronoms je ou tu sont devenus
des éléments de flexion, on peut dire que de même je chante, tu
chantes comprennent leur sujet. S'il s'agit d'une personne qui
est présente à l'esprit des interlocuteurs, la forme cantat se suffit
en latin, et, en français, il chante, elle chante, où il, elle ne sont que
des outils grammaticaux, et non plus des pronoms autonomes ;
ceci est si vrai que, comme on l'a indiqué ci-dessus, ces anciens
pronoms tendent à faire corps avec les verbes : pour annoncer
que de l'eau qui a été mise à chauffer est bouillante, un Berrichon
193dit couramment : « ton eau, a bout », c'est-à-dire « ton eau,
elle bout », là où le français littéraire aurait ton eau bout.
Le procès indiqué par le verbe peut se présenter de façons très
diverses par rapport au « sujet » ; on appelle voix la catégorie
qui se rapporte à ce type de distinctions.
Le procès peut être présenté comme un acte du sujet : Pierre
vient, Pierre mange ; c'est ce qu'exprime un verbe actif, en prenant
le mot « actif » au sens large. L'acte peut être exprimé complètement
par le verbe, ou bien il peut porter sur quelque objet qui
doit être exprimé séparément : Pierre frappe Paul, Pierre mange
du pain. Les verbes qui comportent un objet, sont dits transitifs,
et ceux qui n'en comportent pas, intransitifs. Certains verbes
sont ordinairement intransitifs ; ainsi dormir, venir, etc. ; d'autres
ne le sont qu'en certains cas, ainsi manger ; et, dans ce dernier
cas, on distingue un emploi transitif et un emploi intransitif.
Dans les anciennes langues indo-européennes, les verbes qui
sont susceptibles de l'emploi transitif, l'étaient en même temps
d'un emploi intransitif, dit absolu : un verbe qui signifie « je
laisse » pouvait aussi s'employer intransitivement, et alors le sens
était « je reste », l'action de « laisser » s'appliquant au sujet lui-même ;
un verbe qui signifiait « je tiens » pouvait, sans complément,
signifier « je me tiens », l'action de tenir s'appliquant au
sujet ; ainsi, en latin, uerte signifie « tourne » (quelque chose)
et « tourne-toi ». L'emploi absolu est particulièrement courant
là où existe une détermination qui indique comment se fait l'action
indiquée par le verbe ; en français on ne peut guère dire il
frappe, sans complément, à moins qu'on ne sache ce qui est
frappé ; mais on peut dire il frappe fort ; en grec où ekhô signifie
« je tiens, j'ai (quelque chose) », on dit par exemple kakôs ekhô
« je me tiens mal, je suis en mauvais état ». Le procédé qui
consiste à employer les mêmes verbes transitivement et intransitivement
peut avoir plus ou moins d'extension suivant les
langues, mais la nature des choses fait qu'il existe à peu près
nécessairement.
En revanche, l'indo-européen avait une particularité singulière,
si singulière qu'elle s'est éliminée presque partout, et que, si l'on
194n'avait pas le grec ancien et l'ancien indo-iranien, on ne saurait
s'en faire une idée juste. C'est la distinction de l'actif et du
moyen. L'actif servait à indiquer un procès auquel le « sujet »
n'est pas particulièrement intéressé, le moyen un procès auquel
il avait un intérêt propre de quelque manière : ainsi en sanskrit
védique, du prêtre qui fait un sacrifice pour quelqu'un qui le lui
fait faire, on dit à l'actif yajati ; mais, du personnage qui a commandé
le sacrifice au prêtre et qui est lui-même un des agents
du sacrifice, on dit au moyen yajate ; l'opposition de l'actif thyei
« il sacrifie » et du moyen thyetai « il sacrifie pour lui-même » a
la même valeur en grec ancien. Il va de soi que cette opposition
n'a pas lieu d'exister pour tous les verbes. Tel verbe signifiant
« aller » par exemple, ne s'emploie qu'à l'actif, ainsi en sanskrit
emi « je vais » et en grec eimi ; tel autre signifiant « avoir une
agitation mentale, penser », indiquant par conséquent une activité
intérieure du sujet, est toujours moyen, ainsi manye « je
pense » en sanskrit, mainomai « j'ai une agitation mentale » en
grec. Il est presque toujours facile de rendre compte de l'emploi
des désinences actives ou moyennes en ancien indo-iranien et
en ancien grec. Mais une opposition de ce genre avait un caractère
trop spécial et trop concret, elle entraînait d'ailleurs une
trop grande variété de formes pour durer : un ancien verbe grec
ou indo-iranien a au complet une double série de désinences,
l'une pour l'actif, l'autre pour le moyen, et cela suffit à doubler
le nombre, déjà très grand sans cela, des formes de la conjugaison
dans ces langues. Aussi la distinction s'est-elle éliminée de
bonne heure ; il y a des langues où il en subsiste des traces,
d'autres où elle est tout à fait disparue ; en grec même et en
indo-iranien, elle a cessé d'exister au cours de l'époque historique.
La possibilité d'employer les verbes actifs absolument et le
fait que les désinences moyennes soulignent au besoin cette
valeur absolue ont dispensé l'indo-européen commun d'avoir un
passif. On croit souvent que le passif est une forme du verbe où
le sujet du verbe est indiqué comme subissant une action exercée
par un agent : Paul est battu par Pierre. ; les expressions de ce genre
195se rencontrent en effet ; mais ce sont des tours souvent artificiels,
et en tout cas relativement rares. Le vrai rôle du passif est d'exprimer
le procès là où l'agent n'est pas considéré. Le latin a dicit
« il dit », quand on pense à quelqu'un qui parle, et, à côté, dicitur
« il est dit », pour signifier « on dit » ; dicitur équivaut à
dicunt « ils disent », avec sujet indéfini, équivalant par suite
aussi à « on dit ». Pour le sémitique, où le passif est une partie
constitutive du système verbal, cette valeur a été reconnue par
les grammairiens arabes. Si le passif n'était qu'un renversement
de l'expression active, il serait au fond superflu. Ce qui donne au
passif son utilité, c'est que, au lieu de présenter le procès comme
résultant de l'intervention d'un agent, il le présente en lui-même,
sans aucune notion étrangère. Si, près d'un passif, on marque
l'agent, c'est comme un point de départ de l'action, non comme
un agent proprement dit : le latin occiditur a Marco « il est tué
par Marcus » signifie proprement : « il est tué » et « le point de
départ de ce fait est Marcus » ; les expressions analogues du
slave et du grec le montrent tout aussi clairement : Le passif peut
n'exister que sous forme impersonnelle : le passif dicitur « il est
dit », au sens de « on dit », est courant en latin. Le passif
existe du reste surtout à la 3e personne.
Si l'indo-européen avait une opposition de l'actif et du moyen,
et s'il n'avait pas d'opposition de l' actif et du passif, c'est que
c'est une langue où les procès sont présentés en général d'une
manière active, et comme résultant de l'intervention d'un agent
plus ou moins personnel, plus ou moins défini. Quand un Français
d'aujourd'hui dit « il vente », on parle à juste titre d'un
verbe « impersonnel » : la forme employée signifie simplement
que « le vent souffle », et on ne fait allusion à l'action d'aucune
personnalité définie ; mais quand un poète de l'époque védique
disait vâti, il voulait dire que vâyu, qui est le vent, mais qui est
aussi un agent ayant une personnalité, un « dieu », exerce son
activité spécifique de « venter ». Linguistiquement, les deux
constructions ont l'air toutes pareilles ; mais elles expriment
deux mentalités absolument différentes l'une de l'autre. — Or,
dans une langue où tout procès est présenté normalement
196comme résultant de l'action d'un être plus ou moins personnel,
il est naturel de distinguer si le procès a une relation spéciale
avec celui qui le produit ; mais une catégorie grammaticale
spéciale pour indiquer le procès sans considération d'agent est
assez superflue. En somme, l'opposition de l'actif et du moyen
caractérise l'indo-européen.
Le moyen pouvait indiquer que l'action du sujet a pour objet
le sujet même : la forme moyenne louetai du grec signifie « il se
lave », par opposition à louei qui signifie « il lave ». Mais, pas
plus qu'il n'avait un vrai passif, l'indo-européen n'avait un vrai
réfléchi. On a été en général amené plus ou moins vite à indiquer
le verbe réfléchi à l'aide d'un mot spécial, tel que le pronom
réfléchi. Et, cette forme à pronom réfléchi, perdant progressivement
de sa valeur par l'emploi, a fini par équivaloir au moyen
ancien et par le remplacer ; c'est ce qu'on observe notamment
en slave. En français, surtout au moyen âge, le verbe réfléchi a
ainsi servi à noter une action en tant qu'elle intéresse particulièrement
le sujet : de même que le latin disait moritur, avec sa
forme « déponente » qui continue l'ancienne forme moyenne
avec un mélange d'autres formes, le français a fait il se meurt, à
côté de il meurt ; la forme est plus expressive que le simple il
meurt et montre mieux la réalisation du procès, parce que la
relation du procès avec le sujet est mise en évidence.
L'agent d'une action peut ne pas la faire par lui-même ; il la
réalise souvent par l'intermédiaire d'un autre ; il faut donc que
le verbe comporte un factitif. Le factitif peut être obtenu par un
mot qui a perdu son sens propre et qui est devenu, par là, un
simple outil grammatical, comme « faire » dans le français il
fait venir et, ce qui est bien caractéristique, il fait faire, ou
comme lassen en allemand. Mais très souvent aussi, il y a des
fonctions spéciales au factitif : à côté de bharati « il porte », le
sanskrit a bharayati « il fait porter » ; en face de faran « aller
(en véhicule) », le vieux haut allemand a fuoran « faire aller en
véhicule, conduire » (allemand moderne führen), et ainsi souvent.
On peut aussi indiquer qu'on a l'intention de réaliser un procès :
197une langue telle que l'indo-européen où, on l'a vu, les
procès sont présentés « activement », a été amenée à constituer
un désidératif : le latin, par exemple, a uiso « je désire voir », à
côté de uideo « je vois », et beaucoup de formes analogues, qui
continuaient un usage indo-européen très considérable.
Enfin, bien que ce type de formation se rapporte moins directement
au rôle du sujet par rapport au verbe, il faut rappeler
ici qu'il y a lieu de marquer si l'action se répète, si elle est faite
avec intensité. Il existe des formations itératives, intensives. On
peut marquer l'intensité par un redoublement plus ou moins
complet de l'élément radical ; ainsi, en grec, un verbe tel que
marmairô « je brille » est intensif. Un autre procédé, qui tient
une grande place dans les langues sémitiques, mais qui se rencontre
aussi dans les langues indo-européennes, et surtout,
semble-t-il, dans la manière familière et populaire d'employer
les anciennes langues indo-européennes, consiste à géminer une
consonne intérieure : à côté de glutire, le latin a gluttire « engloutir »
pour noter le procès avec intensité ; le français en-gloutir, où
la gémination n'est pas conservée, conserve encore la force de
sens que cette gémination a donnée.
Dans les langues des peuples incomplètement civilisés où les
catégories grammaticales se rapportent à des notions en partie
concrètes et où elles ont souvent une valeur expressive et sentimentale,
les formes factitives, désidératives, intensives sont
naturelles ; elles tendent à s'éliminer au fur et à mesure que,
avec le progrès de la civilisation, les catégories prennent un
caractère plus abstrait. Elles tendent à se refaire plus ou moins
dans les parlers populaires.
En somme, le verbe exprimant un procès, les catégories principales
que les langues ont été amenées à créer sont celles de la
personne (comprenant indirectement celle du nombre), celles du
temps et de l'aspect, celle du mode et celle de la voix. Le progrès
de la civilisation met en évidence le temps ; il tend à éliminer les
catégories à valeur concrète ou expressive, et à donner aux catégories
abstraites une importance de plus en plus grande.198
11. Revue philosophique, t. LXXXIX (janvier-février 1920), p. 1 et suiv.
21. Voir ci-dessus, p. 141 et suiv.