 Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
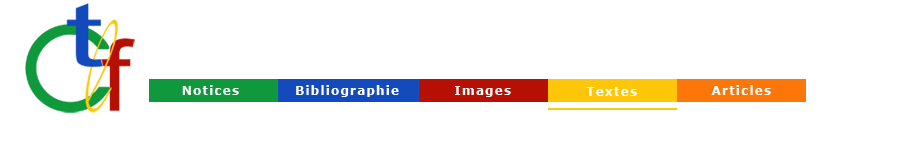
Le caractère concret du mot 11
Plusieurs de nos confrères de la Société de Psychologie ont
montré toutes les lumières que la psychologie a pu répandre sur
la linguistique ; mais les linguistes ne sont pas pour cela des
psychologues : un linguiste est un technicien habitué à manier
des faits particuliers assez abstrus ; il n'est guère préparé à s'orienter
parmi les idées générales. Il y a cependant des questions qui
sont de nature à intéresser psychologues et linguistes : telle celle
du mot. Je me propose de montrer que le « mot » a évolué au
cours des langues indo-européennes, et quel est le caractère de
cette évolution. Dans l'ensemble des langues, l'évolution s'est
dirigée dans un même sens, et les changements, quoiqu'ils se
soient produits d'une façon indépendante, sont universels.
Nous croyons tous savoir ce que c'est qu'un mot, car dès notre
enfance, nous avons vu les mots séparés sur le papier par des
blancs. Dans la réalité les mots sont moins distincts qu'ils ne
nous apparaissent dans l'écriture. Dans l'écriture, le mot nous
apparaît comme un petit être autonome, une quantité constante
que l'on fait figurer dans telle ou telle phrase, comme on transporterait
une lettre d'une équation dans une autre. Cette séparation
entre les mots n'est pas d'ailleurs un fait universel et elle
n'a pas existé de tout temps. Les Grecs ne séparaient pas les
mots dans l'écriture. Les Romains au contraire ont pris l'habitude
de séparer exactement les mots les uns des autres par des
9points. En réalité, séparés ou non les uns des autres, les mots ne
sont autonomes ni phonétiquement ni au point de vue sémantique.
En français un mot peut se prononcer de façon différente
suivant le contexte. Le mot « cheval » par exemple aura dans le
groupe : — un fort cheval — une syllabe de plus que dans le
groupe : — le cheval — où le « v » a une prononciation différente.
En breton un même mot n'a pas de forme déterminée :
il comporte une alternance du phonème initial suivant certaines
conditions grammaticales.
Au point de vue « sens », cette autonomie est encore moins
accusée : ce qui fait l'originalité et la force du langage humain,
c'est que le mot est susceptible de figurer dans des contextes
aussi différents qu'on le veut. Le langage humain diffère essentiellement
du langage animal en ce que les éléments du langage
animal ne sont pas combinables les uns avec les autres. Les mots
du langage humain au contraire interviennent dans toute une
série de combinaisons que nous pouvons faire varier selon notre
volonté ou notre fantaisie ; un nombre d'éléments lexicologiques
assez restreint peut dès lors suffire pour dire tout ce que l'on
désire, tandis qu'un aboiement ou un miaulement ne se prête à
aucune combinaison.
Toutefois ces combinaisons originales existent à des degrés
divers suivant les individus. Un sujet de culture médiocre parle
surtout par formules qui ne varient guère ; chez la plupart des
gens les associations de mots ne sont ni libres ni personnelles.
Le mot n'est qu'une partie de combinaisons pratiquement constantes ;
la valeur du mot dans un pareil ensemble ne s'explique
pas par le sens universel et général de ce mot, mais par l'habitude
que l'on a de le voir dans certaines combinaisons. Le mot
« pied », par exemple, représente quelque chose de bien déterminé
lorsqu'il est lié à un adjectif : « un pied large », mais tous
les autres emplois ont une valeur différente de celle qu'il a lorsqu'il
désigne l'organe : dans le « pied » d'une montagne, d'un
meuble, rien n'éveille l'idée de quelque chose qui ressemble à
l'organe, de même lorsqu'on dit « pied de porc farci » ou « pied
10de mouton » ; cela est si vrai que si on avait à parler de l'organe
en question on dirait : patte. « Pied » n'est, dans tous ces cas,
qu'un élément d'une combinaison toute faite que l'on ne pense
pas expressément. Ce mot désigne en réalité un ensemble de
caractéristiques propres à l'organe et dont nous pouvons déduire
une série d'emplois variés. Le mot pied a donc quelque chose
d'abstrait ; mais l'homme qui parle par formules entendues
autour de lui, emploie un langage relativement concret.-
On s'est demandé comment on enrichit une langue sans en
augmenter le vocabulaire. C'est en donnant aux mots leur valeur
générale. Ce qui caractérise les écrivains de talent, ceux qui
savent écrire, c'est qu'ils n'emploient pas des formules — monnaie
courante d'échange entre les hommes — mais qu'ils utilisent
les mots avec leur pleine valeur, et les combinent chacun
à sa manière. En France, Fénelon, Voltaire, Renan, qui ont un
vocabulaire restreint, qui emploient les mots de tout le monde,
en ont tiré des effets singuliers, parce qu'ils ont su tirer des mots
une grande richesse de combinaisons : cette variété de combinaisons
n'est possible que parce que chaque mot est employé
avec sa valeur la plus générale.
Dans les anciennes langues indo-européennes, en sanskrit, en
grec, en latin, la forme grammaticale du mot est tout autre
qu'en français ou en anglais. Le français a un mot « loup »
invariable, dont la forme est toujours la même, quelle que soit
la phrase où ce mot figure, quelle que soit la façon dont on
envisage l'animal ; on ajoute, il est vrai, « s » au pluriel, mais
personne ne la prononce dans aucune circonstance. En latin au
contraire, il n'y a à vrai dire aucun mot qui signifie « loup » ; si
l'on veut dire que « le loup est venu », on aura la forme : lupus ;
si l'on voit des loups : lupos, un grand nombre de loups : luporum,
on- a fait cela pour les loups : lupis, etc. On ne peut pas
considérer l'une quelconque de ces formes comme étant le nom
du « loup » plutôt que les autres. L'habitude de nommer l'animal
par le nominatif est purement arbitraire. Le nominatif ne
commande aucun autre cas ; il y a un ensemble de formes qui
signifient « loup » ; un Romain n'était pas capable de nommer le
11« loup en soi ». Ce qui n'existe ni en grec, ni en latin, ni en
sanskrit, ni dans la plupart des langues slaves, c'est une forme
universelle du nom d'un être quelconque. Pour un Russe ou
un Polonais, il n'y a pas un nom de tel ou tel objet, mais un
ensemble de formes variables suivant le rôle du mot dans la
phrase et suivant certaines catégories.
Un nom indo-européen exprime à la fois un nombre (un,
deux ou plus de deux), un genre (est-il question d'un être inanimé
ou d'un être animé et dans ce cas est-il mâle ou femelle ?),
le rôle du mot (sert-il de sujet ou de complément ?). Ce mot est
donc beaucoup plus concret que celui d'une langue moderne,
le français ou l'anglais par exemple. Il y a une tendance universelle
à éliminer cette structure linguistique du mot qui n'apparaît
que sous certains aspects particuliers, pour la remplacer par
une structure où le mot a une forme constante servant pour tous
les emplois. Seules les langues slaves et baltiques ont actuellement
conservé le jeu de formes variées ; partout ailleurs, dans
les langues romanes, en germanique, en indo-iranien, se manifeste
une tendance à constituer un mot de forme constante
représentant une idée générale ; et ce qui « réalise » le mot, ce
sont de petits mots qui entourent le mot principal (article, prépositions,
etc.), mots qui permettent de dire : ceci est indéterminé
ou déterminé, et de quelle manière ; de telle sorte que le
mot français « loup » n'est jamais employé seul, mais toujours
dans un groupe : nous ne pouvons prononcer le mot qu'en lui
donnant une réalité saisissable.
Or, il y a deux espèces de mots : le nom et le verbe. Le nom
s'est libéré de toutes les désinences casuelles ; le verbe n'est
jamais arrivé à se détacher de la conjugaison ; il n'a pu se débarrasser
tout à fait des formes qui le « réalisent » d'une manière
particulière. En français, le nom est invariable, mais le verbe
comporte des flexions de formes variées ; c'est que le nom
exprime des notions arrêtées, que l'on peut fixer sous les yeux,
qui ne comportent ni mouvement, ni changement ; le verbe, au
contraire, exprime par lui-même un procès. En parlant du « loup »,
on peut observer un type général ; mais dans le mot « dormir »,
12il s'agit de quelque chose qui se passe, d'un « procès » qui évolue.
Nous ne pouvons donc pas envisager le verbe d'une manière
aussi « abstraite » que le nom. Le verbe appelle des caractéristiques
particulières parce qu'il s'agit d'un procès qui comporte
des variations ; cette différence répond si bien à une réalité que
lorsqu'on veut énoncer l'idée verbale d'une manière générale, on
est obligé de recourir à une forme nominale et l'on constitue
l'infinitif.
La tendance universelle du langage, au cours de la civilisation,
a été de donner au nom un caractère de plus en plus indépendant
de tous ses emplois particuliers. Pour permettre à cette
tendance d'aboutir, il a fallu constituer un système de moyens
d'expression nouveaux.
Discussion
M. Delacroix. — Avec cette brièveté synthétique et ce sentiment
puissant de l'ordre qui caractérisent sa manière, M. Meillet nous a
montré l'évolution du mot indo-européen vers l'autonomie et la simplification
apparente. Mais il nous a montré du même coup la complexité
qui reparaît sous la trompeuse unité. Le mot indo-européen a
pu dépouiller, au cours de l'histoire, les flexions dont il s'enveloppait
et qui incorporaient en lui les modalités diverses de sa vie grammaticale.
Le mot invariable s'enveloppe inévitablement de formes destinées
à exprimer ces modalités et qui sont comme des flexions extérieures.
Dans l'esprit du sujet parlant, « le loup, du loup, au loup » font corps,
et esquissent la position et l'emploi du mot dans la phrase, sans
laquelle il n'y a pas de langage. Le procédé est différent ; est-il moins
complexe ? Le mot se dégage-t-il vraiment des relations, sans lesquelles
il n'est pas vraiment un mot ?
Pourquoi, en effet, cette tendance à « réaliser » le mot ? Cette
nécessité de l'envelopper dans des formes qui signifient son emploi
grammatical ? Parce qu'autrement il est impensable. Le loup qui ne
fait rien, ou à qui on ne fait rien, le loup dont on ne dit rien, est un
loup dont on ne pense rien. Le mot suit le sort du concept, qui n'est
rien, s'il n'est un jugement virtuel. Un concept isolé, renfermé en soi-même,
13n'est rien. La relation, l'affirmation des relations domine tout
l'esprit.
On arriverait, en effet, à des conclusions analogues, si au lieu de
partir de l'analyse linguistique du mot, on prenait comme point de
départ l'existence du mot dans la pensée, dans l'esprit du sujet parlant.
Rappelons-nous la fâcheuse époque, si près et pourtant si loin de
nous, où un dogmatisme aujourd'hui périmé avait fait de l'image verbale
une chose en soi, une idole, hypostasiée sous les espèces sensibles
de l'image visuelle, auditive, motrice. La critique neuve et
profonde que Bergson dirigeait en 1896 contre cette idole aboutissait
à montrer que le mot comme tel n'existe pas, que le mot réel c'est
le mot dans la phrase et dans l'esprit, le mot qui subit la loi de la
phrase et qui contient les intentions de l'esprit. Après lui M. Bernard
Leroy, dans un chapitre excellent de son livre sur le Langage, plaidait
solidement une thèse analogue.
Je n'ai pas l'intention de montrer tous les résultats que cette vue
nouvelle a apporté pour la psycho-pathologie de langage et comment
ce courant en a rencontré un autre, venu de l'observation neurologique
et de l'anatomo-clinique. Je n'ai pas davantage l'intention de
m'acharner sur des dogmes bien ébranlés aujourd'hui et de prendre à
partie ces expériences d'association longtemps classiques, où l'on
commençait par postuler que le mot inducteur déclenche le mot induit,
comme une boule en pousse une autre ; expériences qui, aujourd'hui,
serviraient plutôt à établir combien sont complexes, sauf de rares
exceptions, les opérations mentales qui aboutissent à une réponse
verbale, et combien elles dépendent de l'orientation présente de l'esprit.
L'induit fait généralement partie d'un complexus dont une partie
seulement est remarquée du sujet. En quel sens le sujet a-t-il reçu
l'inducteur ? Quels sont les thèmes qui orientent pour l'instant sa
pensée, son audition, sa motricité ? Autant de questions qui compliquent
étrangement une expérience si simple en apparence, et qui
du reste conduisent à la développer et à lui donner plus de portée.
Une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui « psychologie de la pensée »
se rattache à cette complication.
On pourrait citer également, parmi les erreurs périmées et toujours
vivantes, ces touchantes investigations de pédagogues, insuffisamment
informés, qui s'attachent par exemple à inventorier le trésor verbal
d'un enfant, l'extension de son vocabulaire, sans avoir pris, du côté
psychologique, comme du côté linguistique, les précautions nécessaires.
14Qu'ils méditent les sages conseils que leur donnait récemment
M. Bovet, et qu'ils sachent bien que le vocabulaire psychologique
n'est point bâti sur le plan du dictionnaire.
En effet, le mot, on l'a dit, a toujours une valeur actuelle. Il se
définit par un contexte, par une situation, dont il est le signe, et dont
il signifie la complexité. Il surgit dans l'esprit en vertu de cette
situation, comme une réponse. Il a, même lorsqu'il est seul, valeur
de formule et de phrase. Mais il est rarement seul, soit qu'il s'enveloppe
dans la phrase, soit qu'il surgisse du sein d'expressions concurrentes,
qui n'arrivent pas à leur plein développement, mais qui l'entourent
d'un halo. Il n'est donc qu'un moment d'un procès de pensée
qui suit un cours et dessine une forme. Il n'est donc qu'un aspect
d'une masse de pensée, d'où il émerge : masse singulièrement complexe,
système latent, où travaille cela même qui ne s'exprime pas,
où les types verbaux, où les associations verbales, selon la forme et
selon le sens, ou la classification spirituelle du vocabulaire, le plan
sans lequel l'esprit n'est que désordre et le discours confusion, aboutissent
à une expression qui, sous apparence extrinsèque, reflète tout
l'esprit et toute la technique verbale du sujet.
Il est donc très juste de parler, avec certains linguistes, de la priorité
du système morphologique sur les formes, et des associations
mentales sur les mots. On peut presque dire que le mot est le résultat
d'associations complexes et qu'il est créé chaque fois qu'il est émis.
Comme on peut presque dire qu'il préexistait, avant d'exister dans la
langue, et que sa place y était marquée, avant qu'il fût inventé.
Sonorité fugitive, le mot est aussi réalité permanente. Il engage tout
le système de valeurs, qui est la base de la langue : de Saussure l'a
magistralement montré.
Les mots ne se produisent donc dans notre esprit qu'à partir de
situations et d'intentions, engagés dans des rapports psychiques, dans
des réalités concrètes et complexes. Et ils n'existent dans notre esprit
qu'engagés, à la surface, dans des relations avec les mots momentanément
disponibles que l'orientation du moment fait surgir, au fond,
dans les relations morphologiques que je rappelais il n'y a qu'un
instant et qui font du vocabulaire psychologique un système beaucoup
plus solidement constitué que ne le croit la psychologie courante.
On trouverait donc, croyons-nous, dans le mot psychologique et
dans l'emploi psychologique du mot, la pluralité de significations, le
choix parmi cette pluralité, l'effort d'évocation ou l'habitude de construction,
15l'art de découper l'expérience présente dans le vaste tissu
des expériences passées, d'un mot la complexité d'opérations que
l'emploi du langage suppose.et qu'il faudra bien, quelque jour, que
la psychologie décrive complètement.
M. Vendryes. — Veut prévenir une confusion :
1° M. Meillet nous parle d'un développement du mot vers l'abstrait ;
à quel moment cette transformation s'est-elle opérée ? Lorsque un
paysan français dit : le loup est venu ; il s'exprime comme un
Romain qui aurait dit : « lupus venit ». Au point de vue de la structure
de l'image verbale, les éléments constitutifs sont différents, mais
au point de vue du caractère abstrait ou concret des mots, je n'en vois
aucune. Pour les gens qui parlent, « j'ai vu » ne se compose pas de
trois mots, mais d'un seul ; c'est l'équivalent du latin « vidi ». Il n'y
a pas de différence psychologique.
2° M. Meillet a opposé dans le même sens la langue d'un Français
illettré et celle d'un lettré. Or ce qui me paraît la marque d'un
grand écrivain, c'est qu'il concrétise d'une façon neuve le mot abstrait ;
un Voltaire, un Renan tire des mots du dictionnaire une concrétisation
nouvelle, parce que le français est riche d'applications concrètes
variées : le grand écrivain ne fait qu'enrichir les combinaisons dont
les mots sont susceptibles.
M. Meillet. — Répond à la première des objections de M. Vendryes.
1° Je crois que dans le passage du type indo-européen à une
structure française par exemple, il y a réellement une différence
d'abstraction : la tendance universelle à éliminer la flexion casuelle
n'est pas un accident. D'ailleurs ce qui intéresse le linguiste, c'est
moins la réalité que la forme sous laquelle les choses sont présentées.
Or le linguiste se trouve irrécusablement en face d'une structure inégalement
abstraite.
M. Vendryes. — Aux yeux du faiseur de dictionnaire, mais pas aux
yeux du linguiste : ce développement est peut-être commandé par des
causes extérieures, autres que psychologiques, et par exemple phonétiques.
M. Meillet. — Non, les nécessités linguistiques ne s'imposent
16pas. La mentalité d'un Indo-Européen diffère tout à fait de celle d'un
moderne. Les gens qui parlaient une ancienne langue indo-européenne
pensaient les notions comme actives ; ils ne se représentaient
pas les phénomènes naturels comme des choses, mais comme des
forces intérieures qui agissent ; il n'y avait pas du vent, de l'air qui
circule, mais une force qui souffle, analogue à la force qui est en vous
et en moi. Chacun des mots de la langue se présentait comme le nom
d'un être actif qui agirait autour de moi et avec moi. Le jour où cette
mentalité change, la flexion a changé ; toute une révolution se produit
alors.
M. Delacroix. — Quelle preuve avons-nous de ce changement ?
Peut-on constater nettement cette opposition ?
M. Meillet. — Dans la mesure où je connais l'homme du peuple,
autour de moi, j'ai le sentiment qu'il ne se représente pas les choses
comme un poète védique.
M. Vendryes. — Je suis bien convaincu qu'il y a une grande différence
entre la mentalité d'un Indo-Européen et celle d'un Européen
moderne, comme il y en a une d'ailleurs entre celle d'un bourgeois
parisien très cultivé et celle d'un paysan français illettré. Cette différence
se traduit sans doute dans l'usage que chacun d'eux fait de sa
langue. Mais la question est de savoir si les transformations que l'on
constate dans la structure morphologique depuis l'époque indo-européenne
jusqu'à nos jours résultent d'une différence de mentalité, et
notamment de la substitution d'une conception abstraite à une conception
concrète des choses. Or, dans le cas particulier de la disparition
de la flexion, je ne puis croire que la mentalité du sujet parlant
y soit pour quelque chose. Il est probable que la flexion indo-européenne
résulte d'une évolution linguistique qui a agglutiné des éléments
adventices à des mots de caractère aussi vague et général que
peut l'être le mot loup en français. Et d'autre part la tendance du
français moderne est à agglutiner aux mots (noms et verbes) les éléments
grammaticaux qui expriment les diverses relations ; je-dis, tu-dis,
i-dit tend à devenir l'équivalent de dico, dicis, dicit ; il se crée une
sorte de flexion par l'avant.
M. Emile Borel. — Voulez-vous me permettre d'apporter à ce qui
17vient d'être dit la confirmation, non d'un linguiste, mais d'un homme
de science ? Cette différence de la mentalité concrète à la mentalité
abstraite se retrouve même entre contemporains. Nous avons un langage
scientifique qui n'est pas le même que celui des physiciens
d'outre Manche. C'est peut-être que la façon de penser est différente.
Un physicien anglais, Campbell, dans Physics, n'écrit-il pas : « Qu'est-ce
que l'électricité ? Cette question n'a aucun sens ; car le fait que
nous employons le terme électricité n'implique pas qu'il y ait une
phrase commençant par les mots : l'électricité est…, et que cette
phrase ait un sens. Une phrase est un ensemble de mots destinés à
éveiller une idée chez celui qui l'entend ; mais cette idée n'a aucun
rapport nécessaire avec les mots qui sont dans la phrase. » Cet aveu
d'un physicien anglais cause une certaine stupéfaction au physicien
français qui a l'habitude de chercher à donner un sens précis à chacun
des mots qu'il emploie ; on pourrait dire que l'école de Maxwell,
par exemple, en est encore à la valeur indo-européenne primitive du
mot, et avec ce système-là les Anglais arrivent tout de même à faire
de la physique ; car, bien que leur pensée soit essentiellement concrète,
leur école n'est pas inférieure à l'école continentale. Personnellement,
j'ai dit au Collège de France, dans les discussions qui ont
eu lieu en présence d'Einstein, qu'on avait bien le droit de faire d'un
même phénomène deux théories mathématiques différentes, mais
qu'alors une même variable ne conservait nécessairement un même
sens qu'à l'intérieur de chacune de ces théories, et qu'en passant de
l'une à l'autre elle pouvait prendre une valeur numérique différente :
ce qui n'empêche pas qu'il y a quelque chose de fixe, de même signification,
dans toutes les théories d'un même phénomène. C'est dans
cette mesure que le langage de la physique admet, et peut même
pousser très loin, l'absence d'autonomie d'un mot. J'ai développé ces
remarques dans la Préface de la traduction française du livre de
Campbell, par Mme Pébellier, qui va paraître chez Alcan.
M. Meillet. — L'Anglais parle des faits qu'il observe et ne s'attache
pas d'ailleurs à en donner une formule toujours la même. Ce qui lui
importe, c'est une observation extrêmement précise.
M. Marcel Cohen. — Il paraît paradoxal que les Anglais manifestent
l'esprit le plus concret, au moyen d'une langue où les mots ont acquis
18le plus grand degré d'invariabilité et par conséquent sont le moins
concrets, en termes linguistiques.
En réalité, pour juger de l'évolution, il faudrait distinguer diverses
notions : d'une part, les dispositions morales, esthétiques, et même
strictement psychologiques, où il n'est pas possible de déceler un
progrès en comparant les anciens aux modernes, et où les différences
individuelles et nationales, même entre contemporains, ont une valeur
surtout qualitative ; d'autre part, les faits où le progrès peut se
mesurer quantitativement, comme le rôle grandissant des machines
dans notre vie sociale. Il est probable que les faits examinés par
M. Meillet, et qui semblent entraînés dans un mouvement irréversible
(pour la période de temps qui nous est accessible), sont les correspondants
linguistiques du progrès de la civilisation matérielle.
Il est vrai que l'évolution est très lente et que le langage, dans son
progrès vers l'abstraction, continue à charrier des moyens d'expression
de type plus ancien. Mais le sens du mouvement ne parait pas
douteux, et ne peut être contredit par certaines applications de tests
en psychologie pratique.
Pour répondre précisément à M. Vendryes, il me semble que le
mot dépouillé de toute détermination, le mot de dictionnaire, ait
bien une existence pour les Français (pris comme exemple de
modernes), même s'ils sont assez peu cultivés ; ainsi on peut employer
des substantifs sans article (par exemple dans un titre) et on désigne
les verbes par l'infinitif. Pour tous, la phrase « comment se dit loup
en latin ? » est immédiatement compréhensible.
L'évolution dans le sens de l'abstraction qui s'observe en indo-européen,
est visible aussi dans les autres groupes de langues dont on
peut reconstituer l'histoire : ainsi l'existence ancienne, puis l'élimination
du nombre duel (notion concrète) paraît au moins fréquente.
M. Meillet. — En effet, dans les langues sémitiques il y a un jeu
de formes casuelles différentes pour un même substantif suivant les
fonctions qu'il remplit. Or, cette flexion s'est ruinée de bonne heure,
plus tôt que dans les langues indo-européennes.
M. M. Cohen. — Il est étonnant que les langues sémitiques de
l'Asie antérieure et de l'Afrique soient ainsi plus vite parvenues à un
état apparemment plus « civilisé » que les langues européennes. Mais
il est probable que si nous étions bien outillés par la linguistique
19générale, encore en enfance, nous pourrions mettre à sa juste place
cette apparente anomalie.
M. Lalande. — J'avais été frappé, moi aussi, par l'apparente contradiction
où nous paraissions aboutir, et que relevait tout à l'heure
M. Marcel Cohen. Il n'est pas vraisemblable que les Anglais aient à
la fois, et dans le même sens, l'esprit le plus concret et la langue la
plus abstraite. Mais cette inconsistance vient surtout, je crois, de ce
que, dès le début, on a considéré comme abstraction une opération
toute différente de ce que la logique a coutume de désigner par ce
nom. Je ne veux pas dire que les langues ne sont pas en progrès vers
l'abstraction : si je m'en rapporte à ce que j'ai entendu dire par plusieurs
linguistes, les langues civilisées possèdent des termes plus
abstraits et plus généraux, en ce sens que l'on trouve par exemple
certains peuples qui n'ont point de terme pour désigner l'arbre, bien
qu'ils en aient pour désigner chaque espèce d'arbre particulière. On
s'élève ainsi, de plus en plus, au-dessus de l'individuel et du concret,
tel qu'il est perçu (ou plutôt au-dessus des espèces les plus étroites,
car les noms propres mis à part, les termes les plus spéciaux ont
déjà un certain degré de généralité). Et cette marche est évidemment
un passage du moins abstrait au plus abstrait. Mais le progrès vers un
radical verbal de plus en plus nettement isolé, et dont on prend de
mieux en mieux conscience comme d'une entité fixe, qui se déplace
et qui entre dans différentes combinaisons sans cesser d'être la même,
c'est, me semble-t-il une opération toute différente, dans laquelle on
ne quitte pas le domaine du concret. Le rapport n'y est pas celui de
l'espèce au genre, mais celui de la partie au tout. Un bras coupé n'est
pas une abstraction (sauf peut-être au sens hégélien du terme, qui
me paraît prêter fort à la confusion). Disséquer n'est pas abstraire.
Bacon, voulant exprimer la supériorité de l'explication atomistique
sur l'explication scolastique par les vertus et les forces, disait :
« Melius est naturam secare quam abstrahere ». — Et sans doute,
quand on retrouve par la dissection des éléments de même nature
dans diverses parties du corps, ou dans divers corps (par exemple des
filets nerveux), on peut s'en servir pour tirer de là par une véritable
abstraction proprement dite l'idée générale de nerf ; mais cette abstraction
par comparaison, qui néglige certains caractères et en identifie
certains autres, se superpose à la dissection, et ne se confond pas avec
elle. De même le linguiste pourra remarquer, même sur le latin, qu'à
20considérer les termes, lup est l'élément commun des formes lupus,
lupi, lupos, luporum ; et qu'en ce sens l'idée de loup est un abstrait
des différents cas où l'on parle de loup. Mais alors on est dans un
autre plan, où la matière de l'opération n'est plus la même : c'est une
abstraction faite par le grammairien sur le langage, non par le sujet
parlant sur ses représentations. Autrement dit, tandis que le pelage,
la taille, l'attitude, le regard de divers loups sont bien des caractères
concrets qu'on élimine pour dégager l'idée abstraite de loup (en général),
les relations de sujet, de possesseur, d'objet ou de fin de l'action,
que représentent les désinences, sont tout autre chose ; non des données
concrètes par opposition au loup abstrait, mais des relations que
pense l'esprit, soit entre tel loup concret et d'autres réalités concrètes,
soit entre le loup général et abstrait et d'autres notions prises également
sous leur forme générale et abstraite 12.
L'opération par laquelle on passe de formes à flexion à la forme
invariable et isolable loup est bien plutôt comparable à ce que fait le
chimiste quand il isole un métal de son mineral, ou encore à ce qui a
lieu lorsqu'à des outils divers et montés chacun une fois pour toutes,
par exemple une série de tournevis différents de taille, de trempe, de
profil, on substitue des outils démontables composés d'un manche
unique, auquel on adapte à volonté des lames interchangeables. Le
manche commun n'est pas une abstraction, et ne soutient pas du tout
avec les divers outils qu'il contribue à former le même rapport que
soutient l'idée abstraite de tournevis avec les différents tournevis
concrets. — Ce qui suggère le rapprochement est sans doute le sens
littéral et étymologique d'abstraire, qui matériellement veut dire
extraire. Mais la constitution du « mot de dictionnaire » est si peu une
abstration proprement dite qu'elle aboutit au contraire à lui conférer
de plus en plus une individualité, à en faire un tout complet, permanent,
qui se suffit, et qui, à cet égard, est diamétralement opposé à
un abstrait.
Il me semble que si l'on sépare bien ces deux sortes de relation :
d'une part entre le tout et la partie, tous deux concrets ; de l'autre
entre l'espèce, abstraite, et l'individu, concret, on évite les difficultés
21dont il était précédemment question ; et la phrase la plus analytique,
où les mots sont le plus invariables et le mieux isolés de leurs relations,
ne s'oppose plus au caractère d'une pensée concrète dont elle
peut très bien être l'expression 13.
M. Barbelenet. — Il eût été prudent de définir « abstrait » et
« concret ».
La théorie de M. Meillet me suggère deux observations :
1° J'aperçois une forme « lupus » concrète par rapport à « loup »
parce que « lupus » est un nominatif et un singulier.
2° N'y a-t-il pas un cas où le mot « loup » s'emploie seul ? Tous
les vocatifs ont un synonyme commun : tu…
Les formes du français sont plus abstraites que celles du latin ; mais
sommes-nous capables pour autant de parler davantage par abstractions ?
L'Anglais, plus que tout autre, doit affirmer qu'il a besoin de
parler par phrases ; le mot, pour lui, ne suffit à rien. Le Français pensera
davantage en algébriste.
M. Poirot. — En phonétique, ce qui domine, c'est la phrase ; le
mot n'existe pas isolé. Même une suite de quatre mots telle que : Er
hat das Buch, ordonnés suivant les règles de la grammaire, n'a aucun
sens au point de vue phonétique : selon l'accentuation, la ponctuation,
etc., j'obtiens des sens différents. Le mot a une fonction psychologique
à exprimer : je crois que ce serait une illusion de se figurer
que le français exprime cette notion autrement que le latin.
M. Seignobos. — Comment cette théorie peut-elle s'appliquer au
sabir ou au parler des tirailleurs sénégalais, composé de mots isolés
empruntés à des langues différentes ?
M. Meillet. — Répond à la seconde objection de M. Vendryes.22
« Le mot répond ou à des formes particulières, ou à des formes plus
universellement employables. » M. Vendryes disait que l'usage que
fait un écrivain d'un mot n'est pas plus abstrait ; il a raison ; mais c'est
le mot qui est plus abstrait : ce mot apparaît chez l'écrivain avec une
valeur plus générale que chez l'homme illettré. Pour un écrivain, un
mot a toute la valeur générale qu'il comporte, valeur qui se précise
dans chaque phrase, car nous ne pouvons penser que « particulièrement ».
M. Vendryes. — Il semble qu'un poète comme Mallarmé est difficilement
compréhensible, précisément parce qu'il emploie les mots
avec toute leur abondante richesse.23
11. Exposé présenté et discuté à la Société de Psychologie, à la séance
du 14 décembre 1922 (Journal de Psychologie, 1923, p. 246 sq.).
21. Exemple du premier cas : « In lupum canes, qui excitati fuerant clamore,
statim insiluerunt » ; — du second cas : « Triste lupus stabulis ». — Une seule
et même réalité concrète s'exprimera aussi bien sous la forme lupus a canibus
arcetur, ou lupum arcent canes.
31. J'ajoute que les logiciens modernes donnent entièrement raison à ce que
disait au début M. Meillet, en considérant presque tous le jugement (qui correspond
à la proposition) comme l'acte fondamental et primitif de l'esprit ; et
le concept exprimé par le mot comme un simple élément constitutif de celui-ci,
qu'on en extrait par analyse et qui en tire tout son sens. Un concept pour
M. Russell, par exemple, est une fonction propositionnelle, c'est-à-dire une
proposition contenant une place « en blanc » où l'on peut adapter divers termes
appropriés.