 Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
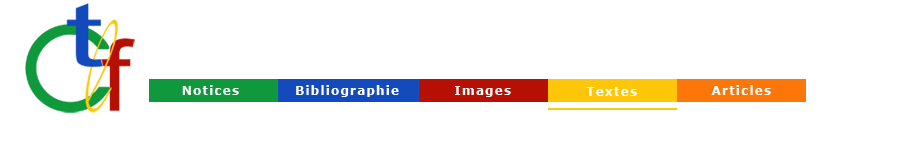
Les
interférences entre vocabulaires 1
Toutes les grandes langues de l'Europe moderne ont un mot
pour dire « oui », et un Français d'aujourd'hui ne s'imagine pas
qu'on puisse se passer d'un outil aussi familier. Pourtant ce mot
n'est ancien nulle part ; le latin n'avait rien de pareil ; le grec
non plus. Chaque langue romane a dû se donner un mot « oui »
par ses propres moyens ; aussi le oui du français n'a-t-il rien de
commun avec le si des Italiens ou des Espagnols. Un mot pour
« oui » ne figurait pas parmi ceux que les peuples de langue
indo-européenne ont reçus de la langue d'où sortent nos
idiomes européens.
Qu'on ouvre les dialogues de Platon, on verra que la réponse
à la question : « As-tu dit cela ? » est volontiers : « Je l'ai dit »
ou : « C'est moi (sous-entendu : qui l'ai dit) », ou : « Assurément ».
Un Russe d'aujourd'hui à la question : « L'as-tu vu ? »
répond : « Je l'ai vu ». C'est que, en russe, la réponse da n'est
pas idiomatique comme l'est en français, celle par « oui ».
Que « oui » s'exprime par si comme en italien et en espagnol,
par ja comme en allemand, par yes comme en anglais, par
tak comme en polonais, par da comme en russe, il n'importe :
partout dans les grandes langues de civilisation de l'Europe
moderne, il y a, plus ou moins employé, un petit mot qui sert
aux mêmes usages, qui rend à chaque instant les mêmes services.36
Comment s'est réalisée cette unité nouvelle ? on ne sait. Mais il
semble bien que les langues se soient imitées l'une l'autre. Sans
doute les sons diffèrent d'une langue à l'autre ; mais on peut
imiter un procédé sans en reproduire le détail matériel. Un mot
« oui » une fois créé dans une langue, ceux des voisins qui
connaissaient cette langue auront à leur manière reproduit une
pratique aussi commode.
Au premier abord, les vocabulaires de nos langues européennes
sont très différents les uns des autres, et bien des gens s'efforcent
de les rendre plus différents encore qu'ils ne le sont. Mais ces
vocabulaires dont les sons ne concordent pas expriment un
même fonds de civilisation. La science et la philosophie
grecques, l'humanisme romain, le christianisme, la scolastique
médiévale, la science expérimentale moderne nous ont fait une
pensée commune et, que nous le voulions ou non, il nous faut
des mots qui aient, sinon les mêmes sons, du moins les
mêmes sens.
Quand on n'a pas emprunté des mots étrangers, il a donc
fallu charger quelques mots de la langue d'exprimer les notions
de la civilisation universelle, ou tirer de ces mots des formations
qui permettent d'exprimer les notions communes.
A la fin du XVIIIe siècle, on a, en Allemagne, transposé
expression en ausdruck, impression en eindruck. A première vue,
l'allemand a ainsi l'air d'avoir des mots à lui, autres que ceux
que les langues romanes et l'anglais doivent au latin. Pure apparence :
sous un masque allemand ausdruck n'est toujours que
expression, et eindruck que impression. Mais, au lieu des mots
latins qui marquent l'unité d'une notion commune à tous les
Européens, il y a des mots que l'étranger ne comprend que s'il
les a appris. Et ces mots sont de moins bons signes que les
mots latins devenus des mots européens. Car si expression et
impression se rattachent à la notion concrète de « peser sur », ni
un Français, ni un Anglais ne l'aperçoit : servant à exprimer des
idées abstraites, ces vocables ont le mérite de n'évoquer rien de
physique. Isolés de toute représentation concrète, il sont des
signes, nets comme les idées qu'ils traduisent. En allemand.
37ausdruck et eindruck évoquent druch, qui est un nom verbal près
du verbe drücken, et l'idée matérielle de « peser sur » risque de
se mêler à la pureté de la notion abstraite.
Quand, au cours du XIXe siècle, le mouvement démocratique
a conduit à ériger en langues de civilisation des langues de
paysans, on s'est piqué de tout dire au moyen des ressources
propres de ces langues. On a poussé ce souci jusqu'à l'excès de
bannir des termes universels du vocabulaire européen. En donnant
au monde civilisé le modèle de la tragédie et de la comédie,
les Grecs lui ont donné aussi le mot théâtre. Mais les arrangeurs
du vocabulaire tchèque ont cru devoir le traduire par un mot
nouvellement frappé, divadlo qui signifie littéralement « lieu où
se donne un spectacle » ; double faute, car on perdait ainsi un
terme européen, et on le remplaçait par un mot qui, si on le
prend au sens que sa formation suggère, exprime d'une manière
vague une notion précise : tout endroit où se donne un spectacle
n'est pas pour cela un théâtre. Pour sentir l'un des vices du
procédé, il n'y a qu'à voir ce qui est arrivé au serbo-croate : on
sait que Serbes et Croates se sont constitué une même langue
littéraire, affirmant ainsi leur unité profonde et préparant, par la
langue, l'union politique que la grande guerre a enfin réalisée.
Mais, quand on a voulu rendre « théâtre » avec les ressources
propres du serbo-croate, on l'a fait séparément en Serbie et en
Croatie, et il y a eu deux mots différents : ce qui à Zagreb est
kazalište est pozorište à Belgrade. Tant il est dangereux de vouloir,
par des masques, dissimuler le mot théâtre que les Romains
ont emprunté aux Grecs, et l'Europe aux Romains.
Les peuples modernes de l'Europe ont, par nationalisme, abusé
du procédé qui consiste à transposer dans leurs langues des
valeurs de mots étrangers. Mais le procédé est ancien, et c'est à
des interférences de vocabulaires que nous devons beaucoup des
termes que nous employons à chaque instant.
Tout le monde parle de cause. Mais, si causa du latin a pris le
sens de condition déterminante d'un fait, c'est parce qu'il a
absorbé le sens du grec aitia. Au sens philosophique, les Romains
n'ont employé causa que comme le substitut latin d'un mot
38grec. Et causa est resté à Rome, en ce sens, un mot de la langue
des gens instruits. Dans le parler du peuple, causa avait d'autres
valeurs qui ont abouti à notre mot chose. Dans la langue écrite,
chez les philosophes, chez les théologiens, causa a gardé l'équivalence
une fois acquise avec le grec aitia. Le français a pris ce
mot à la langue des clercs, en l'adaptant ; il a fait cause. Aujourd'hui
cause est devenu un mot populaire, vulgaire même. L'enfant
qui interroge en disant : à cause ? ne parlerait pas ainsi si la
philosophie grecque n'avait dégagé l'idée de la causalité, de l'aitia,
et si les Romains n'avaient versé dans causa le contenu sémantique
de aitia.
Ces interférences sont d'autant plus frappantes que les langues
dont les vocabulaires ont interféré diffèrent davantage entre elles.
La traduction de la Bible hébraïque en grec a donné à certains
mots grecs des valeurs imprévues. Il sort de là dans le vocabulaire
des peuples actuels de l'Europe des termes familiers à tous
qui, de par leur origine, ne sont que des mots hébreux sous un
déguisement grec.
L'habitude nous fait trouver naturel de désigner la divinité
par le mot Seigneur ; les Anglais disent de même Lord, les Allemands
Herr, et ainsi partout. Or, nous n'en ferions rien s'il
n'avait pesé à un certain moment, sur l'un des noms hébraïques
de Dieu, une interdiction. Dans la Bible, Dieu est nommé en
partie d'un mot qui est noté par les quatre consonnes y h w h ;
c'est le tétragramme fameux qui, à un certain moment, est
devenu ineffable. Partout où on le rencontrait, on le remplaçait
par un substitut, par un mot signifiant « Seigneur ». Et ceci se
marque dans la Bible hébraïque d'une manière expressive :
quand, à une date tardive, les massorètes ont mis en dessous et
en dessus des consonnes, seules écrites dans le texte primitif,
des signes indiquant la prononciation des voyelles, les voyelles
qu'ils ont juxtaposées aux consonnes du tétragramme y h w h ne
sont pas celles qui auraient convenu à ce mot qu'ils ne prononçaient
jamais, ce sont celles du mot signifiant « Seigneur » qu'ils
prononçaient réellement ; c'est ce que des lecteurs naïfs ont lu
Jéhovah, simple lecture d'ignorants. Les Juifs d'Egypte déjà hellénisés
39qui, vers le IIIe siècle avant J.-C, ont traduit la Bible en
grec avaient dès lors l'usage de dire « Seigneur » là où il y avait
y h w h. Au lieu de transcrire en grec un nom qu'ils n'avaient
pas le droit de faire entendre, ils ont traduit le mot qu'ils lisaient
en fait, et c'est ainsi que le grec biblique kyrios « Seigneur » a
désigné Dieu. En latin, kyrios a été traduit naturellement par
Dominus, et le Dominus du latin par Seigneur en français, par
Herr en allemand, par Lord en anglais, et ainsi de suite. Tous
ces noms sont la traduction d'un nom grec qui, lui-même, traduit
le substitut hébraïque du nom interdit Jahweh.
Des mots usuels de nos langues se sont produits par des traductions
de cette sorte.
Ange est en français un mot courant ; il a l'air d'être grec,
mais c'est à l'hébreu que nous le devons. Dans la Bible, Dieu, au
lieu d'intervenir par lui-même, le fait souvent par des intermédiaires
que le texte hébreu nomme ml'k « envoyé ». Dans leurs
conceptions religieuses, les Grecs n'avaient rien de pareil. Les
Juifs qui ont traduit la Bible en grec n'ont donc trouvé aucun
mot grec pour rendre le terme hébraïque. Ils ont pris le nom
usuel du « messager » qui était angelos. Dès lors, il y a eu en
grec deux mots angelos, l'un universellement usuel, qui continuait
de signifier « messager », l'autre propre à la langue
biblique, qui résultait de l'interférence d'un mot hébreu avec un
mot grec. Les auteurs du Nouveau Testament emploient l'un et
l'autre mots : l'angelos proprement grec et l'angelos qui est le
masque d'un mot hébreu.
Si fort qu'ils aient subi l'influence du vocabulaire grec, les
Romains n'ont pas eu besoin d'emprunter le mot grec angelos au
sens de « messager », ni l'occasion d'en subir l'influence : il y
avait en latin ce qu'il faut pour désigner le « messager ». Mais,
pour le sens biblique et chrétien, le latin n'avait pas plus de mot
que le grec. Plutôt que de traduire angelos qui était clair seulement
si l'on y ajoutait une détermination, si l'on disait angelos
kyriou « messager du Seigneur », le latin a pris l'angelos biblique.
Et il a eu ainsi un nom biblique et chrétien angelus qui est
emprunté au grec biblique. Mais, à la différence de dominus, ce
40mot angelus n'avait en latin que son sens technique. Dès lors,
on n'a pu le traduire ; les langues européennes n'ont eu d'autre
ressource que de l'emprunter ; et toutes les langues de l'Europe
ont hérité du latin angelus, en l'adaptant plus ou moins ; en
français, l'emprunt est si ancien et l'adaptation si parfaite que
ange, tout en gardant sa valeur technique, est devenu un terme
du parler courant. Du mot hébreu de valeur religieuse, à notre
terme familier pour exprimer la tendresse, il y a loin ; mais sans
l'interférence qui s'est produite un jour entre un mot grec et un
mot hébreu, la maman française ne dirait pas : mon petit ange à
son enfant.
L'histoire du mot diable est plus compliquée ; mais elle commence
de la même manière. Il y a dans la Bible un personnage
mauvais qui dénonce les hommes à Dieu. C'est ce personnage
qui sert à ouvrir le livre de Job. Job est un juste, mais tout lui
réussit ; il est riche, il est heureux ; serait-il aussi pieux s'il lui
arrivait malheur ? Le satan, « le contradicteur », l'« opposant »,
demande à Dieu de tenter Job. Les Grecs ne connaissaient auprès
des dieux aucun personnage malfaisant de cette sorte. Les traducteurs
juifs de la Bible n'ont donc trouvé aucun terme propre
pour traduire le satan hébreu. Mais, à côté du verbe diaballein
qui ne signifie pas seulement « faire passer », mais aussi « tromper,
calomnier, dire du mal de… », il y a normalement un nom
d'agent diabolos « accusateur, calomniateur ». Ce mot n'était en
grec ni usuel, ni bien important.
C'est un de ces vocables, que les traducteurs sont heureux de
trouver dans leur dictionnaire pour se tirer d'une situation embarrassante.
Le diabolos joue dans l'Évangile un grand rôle ; il tente
même Jésus. Pas plus à Rome qu'en Grèce, pareille figure n'était
connue. Le latin biblique et chrétien n'a donc eu d'autre recours
que d'emprunter le grec diabolos, et d'en faire diabolus. De là le
mot est passé dans toutes les langues de l'Europe et l'anglais a
devil aussi bien que le français a la forme française diable. Jusqu'ici,
l'histoire est pareille à celle de l'ange.
Mais il s'est produit une seconde interférence. On sait quel
rôle jouent dans l'Évangile les esprits malins qui pénètrent chez
41l'homme et chez les animaux et leur font perdre la maîtrise
d'eux-mêmes ; dans le texte grec de l'Évangile, ces personnages,
dont le nombre n'est pas limité, sont nommés daimones, daimonia,
d'un nom grec dévié de son sens propre. Ils n'ont rien à
faire avec le diabolos qui est unique : le mot satan a fourni le
nom propre Satanas. Mais on s'est mis à voir dans les daimones
la contre-partie malfaisante des anges, et il s'est constitué ainsi
comme des groupes ennemis d'anges et de démons. Satanas le
diabolos grec, le diabolus latin, est devenu une sorte de chef des
démons. Et l'on a pu dès lors nommer diables les démons. Là où
il n'y avait qu'un diable, il y en a des légions pour le peuple.
Du-coup, le mot français diable se trouvait avoir interféré avec
démon, et à sa valeur ancienne, il avait joint un sens nouveau.
La valeur actuelle du mot diable en français et de ses équivalents
dans les autres langues de l'Europe résulte donc d'une
double interférence.
Ces exemples ont été pris parmi les plus clairs qu'on connaisse.
Ils montrent combien complexe est l'histoire des mots.
Plus on étudie l'histoire des langues, plus il apparaît que les
actions qui se sont croisées sont multiples et diverses, plus aussi
on voit que le parler du peuple se nourrit de la langue des
savants. Quand on étudiait autrefois l'histoire des langues, on
s'attachait à suivre la destinée des formes populaires d'une langue
particulière au cours des siècles. Aujourd'hui, l'on sait que le
vocabulaire de chaque langue est, souvent pour la plus large
part, le produit d'influences étrangères et d'influences savantes.
C'est la vieille civilisation égéenne qui nous a donné les noms de
l'huile, du vin, de la rose, c'est la subtilité grecque qui nous a
donné la machine, c'est la manière gauloise de faire la guerre qui
nous a donné le char, c'est l'humanisme romain, héritier de la
culture hellénique, qui nous a donné la qualité, pour ne rien
dire de la masse des mots que nous devons aux écoles médiévales.
Beaucoup plus qu'on ne le croit, beaucoup plus que ne le
souhaitent des nationalismes myopes, les vocabulaires qui
expriment notre civilisation européenne concordent entre eux.
Nous devons à l'aristocratie indo-européenne la base de notre
42organisation sociale qui a pris à Rome une forme nouvelle ; nous
devons à la Grèce le système de notre pensée, et à Rome l'adaptation
de cette pensée à l'usage commun ; nous devons à la religion
juive et à la religion chrétienne nos conceptions religieuses ;
nous devons à la science expérimentale des derniers siècles nos
idées sur le monde. Toute l'Europe actuelle, et l'Europe de
langue germanique ou slave autant que l'Europe de langue
romane, a hérité de ce fonds universel, et, directement ou sous
un déguisement, tous les vocabulaires intellectuels de l'Europe
sont faits des mêmes éléments. Pour ce qui exprime la civilisation,
il y a dans nos langues, en dépit des amours-propres nationaux,
beaucoup de bien commun, presque pas de bien particulier.43
1. Lecture faite à la séance publique des cinq Académies, le 24 octobre 1925.