 Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
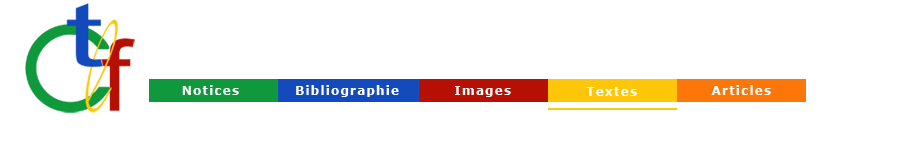
Sur une période
de bilinguisme en France 11
Pendant longtemps, on a volontiers considéré les langues en
elles-mêmes, et l'on en a envisagé le développement sans considérer
les conditions où se trouvaient les hommes chez qui avait
lieu ce développement. Depuis que l'on a observé de près
quelques situations linguistiques singulières, on a été conduit à
se poser des questions nouvelles et à préciser la position du
problème.
M. Ščerba a observé sur place le domaine sorabe ; il a publié
le résultat de ses observations dans un livre qui n'a pas été assez
remarqué, en partie parce qu'il est écrit en russe, en partie parce
qu'il a paru en 1915 : Vostočnolužickoje narečije. Depuis, il a tiré
de là des observations générales et les a publiées en français,
mais dans un recueil peu répandu en Europe, le Recueil japhétique,
IV (1926), dans un article intitulé : Sur la notion du
mélange des langues. Les théories aventureuses de M. Marr à ce
sujet ne doivent pas rendre suspect cet article de M. Ščerba qui
est fondé sur des faits positifs et qui est aussi précis que judicieux
et délicatement nuancé.
Le fait observé est celui-ci : tous les sujets parlant sorabe
parlent aussi couramment l'allemand ; l'allemand est la langue
où ils ont étudié ; le sorabe n'est, pour eux, qu'un second parler
auquel ils sont attachés, dans leur vie de famille, par la tradition.
Il en résulte que les Sorabes observés par M. Ščerba, tout en se
90servant de mots slaves, reproduisent souvent des modèles allemands ;
par exemple, ils recourent aux prépositions wot ou za
là où l'allemand a von ou für, indépendamment de la tradition
slave. Le sorabe s'est donné un article qui n'existait pas en slave
et qu'aucun des parlers slaves voisins, ni le tchèque, ni le polonais,
n'a constitué. En son état actuel, le sorabe est resté un
parler dont les éléments organiques sont tous slaves, mais où les
formes slaves ne sont souvent qu'un masque dissimulant des
procédés allemands. M. Ščerba présente lui-même sa pensée sous
la forme suivante : « Les sujets parlants ont la conscience que
telle forme est sorabe et telle autre allemande, mais passent
facilement de l'une à l'autre, de sorte que les substitutions réciproques,
dans le cas où une des deux formes faiblit pour une
raison quelconque, restent toujours inaperçues. Il serait peut-être
même inexact de dire que les sujets dont il est question savent
deux langues : ils n'en savent qu'une, mais cette langue a deux
modes d'expression et on emploie tantôt l'un, tantôt l'autre. »
Des périodes de bilinguisme où ont dû avoir lieu des faits de
ce genre ont existé souvent au cours de l'histoire des langues.
Partout où il y. a eu substitution d'une langue à une autre, ce
qui est un cas fréquent, il a dû y avoir un temps plus ou moins
long où nombre de sujets ont possédé et pratiqué simultanément
les deux langues et où pouvaient intervenir des phénomènes du
type de ceux qu'a constatés M. Ščerba en Lusace. Dès lors, il
convient d'examiner quels sont, parmi les changements linguistiques,
ceux qui s'expliquent par là.
Cette action est à distinguer de celle qui consiste en la survivance
d'usages et de tendances de la langue ancienne dans la
façon dont est parlée la langue nouvellement adoptée et que l'on
a coutume d'appeler action du substrat. Il arrive fréquemment
que les sujets prononcent la langue nouvelle avec les habitudes
articulatoires qu'ils avaient dans leur parler propre ; ainsi les
Français du Midi prononcent le français du Nord avec les
voyelles des parlers méridionaux qui sont sensiblement différentes
de celles du français septentrional. Il arrive aussi — et
c'est un fait plus délicat et plus contesté — que des tendances articulatoires
91se conservent et produisent leurs effets après l'époque
du changement de langue ; ainsi la forte altération des consonnes
intervocaliques et la production de certains types de voyelles en
français semblent résulter de tendances qu'on observe dans les
langues celtiques. Ce n'est pas de faits de cet ordre que je veux
parler maintenant.
Sur le domaine français, il y a eu deux périodes prolongées de
bilinguisme.
La première est celle qui a suivi l'introduction du latin sur un
territoire de langue gauloise à partir de la conquête romaine. En
raison de l'insuffisance des données sur le gaulois, on ne l'examinera
pas pour le moment.
La seconde est celle qui a suivi les invasions germaniques ; du
VIe au IXe siècle, la puissance politique a été aux mains des
conquérants de langue germanique. Les parlers de ces conquérants
ont été divers : le burgonde différait du franc. Mais tous ces
parlers s'opposaient ensemble à la lingua romana des habitants ;
on peut alors faire abstraction du gaulois qui ne devait subsister
que dans des régions reculées de la campagne. Les rois et les
chefs qui dominaient le pays conservaient leurs parlers germaniques :
on sait que le parler propre de Charlemagne était germanique.
Mais ils ont, de bonne heure, accepté le christianisme
dont la langue est le latin ; ils se sont servis des institutions
romaines autant qu'ils l'ont pu, et leur civilisation est devenue
de plus en plus romaine ; il n'y a pas eu, en pays gallo-roman,
rupture avec le passé. Les chefs germains ont donc été amenés
à apprendre la lingua romana, tandis que les Gallo-Romains qui
étaient en rapports avec les Germains, devaient apprendre à
employer les parlers germaniques. La coexistence de deux
groupes importants, l'un par sa puissance, l'autre par sa civilisation,
a eu pour conséquence nécessaire que la plupart des
hommes des classes dominantes et nombre de leurs sujets ont
dû pratiquer à la fois les deux langues, qui toutes les deux
avaient du prestige, cas assez rare.
Dans son article des Mélanges P. Thomas, p. 511, M. Mansion
signale que dès le Ve siècle, des parents qui portaient les noms
92purement classiques de Severus et Gerontia donnent, à Paris, une
appellation « barbare » à leur fille.
Ce n'est pas à dire que ni toute la population, ni sans doute
même le gros de la population, ait été bilingue. Mais, dans la
plupart des cas, c'est la langue des classes dominantes qui prévaut :
le français qui se répand aujourd'hui en France n'est pas
la langue du peuple ; c'est le parler de la classe cultivée du
XVIIe siècle à Paris. Et le travail de Gilliéron a montré que ce
n'est pas le français qui se nourrit de patois ; c'est le patois qui
se nourrit de français cultivé.
Des faits en grand nombre attestent l'influence qu'a eue le
bilinguisme. Ces faits sont connus, pour la plupart ; et, dans son
Histoire de la langue française, où il résume les connaissances
acquises, M. A. Dauzat insiste avec force, p. 13, sur l'importance
de l'élément germanique dans la formation du français. Ce que
l'on veut essayer de faire ici, c'est de marquer la façon dont
l'élément germanique s'est introduit.
Rien de plus banal que l'emprunt de noms indiquant des
objets de civilisation. C'est ainsi que les noms relatifs aux chemins
de fer et aux courses de chevaux sont en français, ou
anglais, comme rail, wagon, jockey, ou calqués sur des expressions
anglaises : chemin de fer (railroad), ou entraîneur (trainer). Une
acquisition de vocabulaire de ce genre a le caractère d'un emprunt
de termes techniques dénonçant l'emprunt d'une technique.
Mais on n'emprunte pas aisément des verbes et des adjectifs. Or,
haïr et choisir, tarir et saisir, blanc, brun, bleu et blond sont notoirement
en français des mots d'origine germanique. Pour que
soient empruntés ces termes qui ne traduisent pas l'emprunt d'un
élément de civilisation, il faut qu'il y ait eu des gens pratiquant
à la fois les deux langues, ayant les deux langues présentes
simultanément à l'esprit, et qui recouraient au vocabulaire de
l'une ou de l'autre langue suivant leur commodité.
Le fait que les sujets parlants dont le parler a servi de modèle
et s'est perpétué avaient présents à l'esprit à la fois le mot latin
et le mot germanique est établi par un trait qui a été souvent
cité, mais dont on ne remarque pas assez le caractère. Au
93VIe siècle, le latin n'avait pas de w initial : l'u consonne était
devenu v labiodental, et h avait disparu de toute la Romania.
Or les emprunts ordinaires de mots ne comportent pas introduction
de phonèmes nouveaux. Si les mots français pris au germanique
étaient des emprunts de type brut, ils ne présenteraient
que des phonèmes existant dans le latin au temps où les mots
se sont introduits. Or le w- et l'h- des mots germaniques ont
reçu des traitements qui supposent des prononciations spéciales :
le w- de wardon et l'h- de hatjan ont laissé leur trace dans la
forme qui a persisté, fr. garder et haïr. Sans doute il n'est pas
demeuré en français de phonèmes spéciaux dus au germanique,
et w a passé à gu, d'où garder ; de h, il n'est rien resté que
l'hiatus : Je hais. Mais, abstraction faite de la réaction qui a fini
par éliminer des phonèmes étrangers, n'en laissant subsister que
des traces, on voit que les mots ont figuré d'abord dans la lingua
romana avec quelque chose d'une articulation germanique. Fait
plus significatif : dans le cas où le mot germanique se trouvait
ressembler au mot latin synonyme, soit par suite d'unité d'origine
comme pour uespa, uadum, uastare, soit par accident,
comme pour altus, les mots latins ont pris l'initiale des mots
germaniques correspondants : guêpe, gué, gâter, haut. Mieux
encore, un mot latin qui, se rapportant à l'armement, a été à
demi germanisé, uagina, est représenté par fr. gaine. A travers ces
faits, on aperçoit comment les sujets avaient à la fois dans
l'esprit le mot latin et le mot germanique.
Le plus bel exemple a été reconnu par M. A. Thomas ;- en
montrant que le traitement français -ier du suffixe latin -arius
repose sur une prononciation germanique 12, il a dénoncé un cas
où, sur le domaine gallo-roman, un suffixe latin qui avait été
emprunté par le germanique, — dans la mesure où s'emprunte
un suffixe — , s'est fixé non pas sous la forme latine, mais sous
la forme qu'il avait prise dans la bouche des Francs. Le suffixe
-arius, qui s'est répandu sur l'Europe n'a évidemment pas disparu
en Gaule. Mais, y existant simultanément sous la forme latine
94et sous la forme germanique, il a survécu sous la forme germanique
sans doute parce qu'il désignait des fonctions. M. Thomas
a de plus remarqué le fait curieux qu'en slave une partie des
formes de suffixes empruntées repose aussi sur la forme germanique,
ainsi v. sl. grŭnĭčarjĭ « potier » 13. Ce traitement apparaît
nettement en polonais.
Dès lors on ne s'étonnera pas de rencontrer en français et en
allemand une même manière d'employer certains mots. Ce n'est
pas un hasard que homo n'ait abouti à on et rem à rien qu'en
français. La façon dont on et rien ont pris le sens indéfini est
connue : c'est dans les phrases négatives, interrogatives et conditionnelles
que les mots passent par cette forme. En gotique,
les faits sont transparents. Mais, si facile à comprendre que soit
le fait, il n'a pleinement abouti qu'exceptionnellement et le fait
qu'on et man, synonymes à peu près exacts, se trouvent en français
et en allemand, et non ailleurs, est significatif. L'évolution
de rem vers le mot négatif rien a aussi son pendant en germanique
où le mot « chose », *wihti, subsiste dans nicht ; c'est le
gotique ni waiht, « non rem ». Ainsi on et rien nominatif et
accusatif de deux mots latins, sont, pour le sens et l'emploi,
deux mots germaniques ; autre chose est la forme d'un mot,
autre chose sa substance sémantique et sa valeur syntaxique.
Il est aussi facile de couper forfaire en fors et faire qu'impossible
d'expliquer par là le sens du mot. En réalité, on a le calque
d'un usage germanique, celui de fra : for-faire est la reproduction
avec des éléments latins du got. fra-waurkjan « commettre
une faute ». C'est le type, largement répandu, de all. ver-derben,
ou de angl. for-swear « parjurer », qui repose sur un usage ancien
représenté en latin par per-īre et per-dere. Dans son fond, forfaire
est un mot germanique autant que haïr.
L'état de bilinguisme a touché parfois jusqu'à la structure
interne des mots. On sait que, en français, au lieu de demeurer
comme en roumain, en italien et en espagnol, medius, qui ne
subsiste qu'à l'état de survivance dans mi (à mi-corps), a été
95remplacé par la forme plus pleine demi. On sait aussi que demi,
pas plus que la forme provençale correspondante, ne repose pas
pas sur lat. dīmidius, mais sur la forme refaite dī-medius. C'est
que le gallo-roman est du latin parlé par des hommes à qui la
pratique du germanique avait rendu le sens de la composition,
aboli ou affaibli par les altérations des parties intérieures des
mots latins. En gallo-roman, les éléments de la composition
tendent à être restaurés.
Dans son livre Le latin des diplômes royaux et chartes privées,
p. 85, Mlle Vielliard a fait remarquer que dans les textes d'époque
mérovingienne, on constate un usage très marqué qui tend à
rétablir dans les composés la forme primitive de leurs éléments,
et elle marque justement qu'il y a là la trace d'un fait de langue.
Ce fait n'est pas propre au gallo-roman. Mais il y a plus d'importance
qu'ailleurs, et c'est parce que les gens des classes dirigeantes
y parlaient le latin en personnes qui avaient le sens
profond d'une langue où la composition était chose courante. Si
l'on a écrit requero et non requiro, perdedit et non perdidit, c'est
qu'on prononçait ainsi, et en effet le français a requiers, le vieux français
perdiet. L'italien a chiudere d'après inchiudere ; inversement,
le français a enclore c'est-à-dire in-claudere, d'après claudere,
et a perdu in-clūdere. On comprend ainsi pourquoi le français a
élire d'elegere, non d'eligere ; enfraindre (graphie ancienne) d'infrangere,
qui est dans les vieux diplômes, et non de infringere que le
roumain seul a gardé.
Il est surprenant que le nom flōs de la « fleur », qui était
masculin en latin et qui est resté masculin dans la plupart des
langues romanes (mais non en roumain, il est vrai), soit devenu
féminin en français ; or, le nom de « fleur » est féminin en
allemand : v. h. a. bluoma. — Les mots latins en -or sont représentés
en français par des féminins. Or, il se trouve, on le sait,
que la traduction allemande de ces abstraits est du genre féminin.
Suivant une tendance générale des langues indo-européennes,
qu'elles ont menée à son terme extrême, les langues romanes
ont ruiné le système de la flexion casuelle. Un seul groupe a
gardé jusqu'au moyen âge un reste de déclinaison sous la forme
96de l'opposition d'un cas sujet et d'un cas régime : le groupe
gallo-roman. C'est celui où, de par les habitudes d'employer des
parlers germaniques où la flexion casuelle était simplifiée, mais
où le sujet s'opposait nettement à diverses formes de cas régimes,
des sujets parlants gardaient le sens de l'emploi des cas. La
concordance est d'autant plus saisissante que la tendance à ruiner
le système des cas persistait, et que, au bout de peu de siècles,
une fois l'influence germanique éliminée, elle a abouti : au
XIIIe siècle, l'opposition du cas sujet et du cas régime n'était sans
doute plus qu'une tradition littéraire.
L'usage d'un reste de flexion casuelle a permis au français de
garder des tours tels que pro Deo amur des Serments. Pour des
gens à qui le germanique était familier, pareil tour n'avait rien
que de naturel. Mais il allait contre les tendances générales du
développement roman. Aussitôt finie la période de bilinguisme,
le tour sort progressivement de l'usage.
Tant que le sujet était marqué par une forme propre, il n'y
avait pas grand inconvénient à le mettre avant ou après le verbe.
La concordance entre l'usage français et l'usage germanique est
complète ici : le sujet se place après le verbe soit pour indiquer
l'interrogation, soit si la phrase commence par quelque détermination :
Ci-gît Pierre. Comme ces usages n'ont en eux-mêmes
rien de nécessaire, qu'ils résultent de conventions traditionnelles,
ils traduisent le fait que, durant plusieurs siècles, des hommes
habitués à pratiquer à la fois le latin et le germanique ont construit
leurs phrases latines comme leurs phrases germaniques.
Quand le bilinguisme a pris fin, la tendance romane à fixer
l'ordre des mots a pris le dessus, et, comme l'a montré
M. Foulet, dans son admirable Syntaxe de l'ancien français, la
postposition du sujet s'est éliminée peu à peu au point de n'être
plus aujourd'hui qu'une survivance dont le sens est perdu.
Ainsi, à part un certain nombre de mots, la longue période
où, en Gaule, les classes dominantes de la population ont été
bilingues, — parlant latin et germanique à la fois — n'a laissé
au français aucun élément linguistique proprement germanique :
le français ne doit au germanique ni un phonème, ni une forme
97grammaticale ; mais elle a dévié, pendant le temps qu'a duré le
bilinguisme, le développement roman, et elle a laissé, jusque
dans le français d'aujourd'hui, des traces considérables.
On n'a envisagé ici que l'action du germanique sur le français.
Il y a eu inversement en germanique des actions pareilles.
Par exemple il y a chance pour que l'emploi du prétérit composé
se soit propagé en germanique à partir des parlers romans.
Et il a dû y avoir des innovations parallèles : l'article est une
notion nouvelle en roman, — où, comme l'a remarqué
M. F. Muller dans sa Chronology, le développement a eu lieu au
cours du haut moyen âge — , et en germanique ; en Gaule le
bilinguisme a dû jouer son rôle en pareil cas.
Les faits qu'on vient de grouper font apparaître un type de
complexités dont il est juste de tenir compte. Ils montrent de
quel intérêt il serait d'examiner toutes les populations bilingues,
en France notamment les provinces où il s'emploie deux langues,
et surtout où l'une des deux langues n'est pas défendue par une
langue voisine, comme c'est le cas pour le breton et pour le
basque. Des recherches minutieuses sur place devraient être
entreprises. Il ne serait pas moins intéressant d'envisager l'arabe
et le berbère par exemple en Algérie et au Maroc. Il y a là un
type d'enquête dont l'importance serait capitale pour la linguistique
historique, et dont Schuchardt avait indiqué déjà la portée.
Il ne faut pas laisser échapper le moment, fugitif, où les expéditions
sont possibles.98
11. Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
1931, p. 29 sq.
21. Nouveaux essais, p. 109 et ss.
31. A. Meillet, Vocabulaire du vieux slave, p. 211 et ss.