 Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
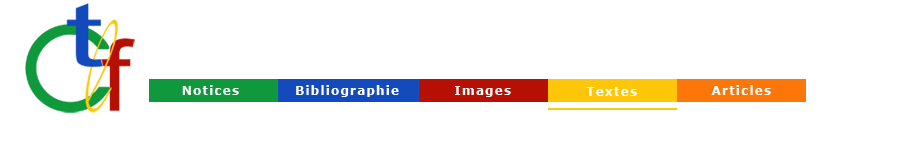
Introduction11
But de l'ouvrage
Questions de méthode — La langue et le groupe
1. Dans les pages qui suivent, on a essayé de ramener la caractéristique
du français moderne à quelques traits généraux surpris dans les différentes
parties de sa structure. La tentative n'est pas nouvelle : à côté des brefs
exposés de M. Meyer-Lübke (Einführung in das Studium der roman. Sprachen
§ 54 ss.), et de M. E. Lewy (Zeitschr. f. roman. Philologie 42, p. 71 ss.),
nous rencontrons les ouvrages de MM. Vossler (Frankreichs Sprache und
Kultur) et Strohmeyer (Der Stil der französischen Sprache), auxquels sont
venus s'ajouter, depuis la première édition de ce livre, la Französische
Sprache und Wesensart de M. E. Lerch et l'ouvrage de M. v. Wartburg :
Evolution et structure de la langue française.
Mon objectif est surtout méthodologique. C'est la raison pour laquelle
j'ai placé au seuil de l'exposé relatif au français des principes de linguistique
générale qui me semblaient nécessaires pour la démonstration. Comme
d'autre part les règles de méthode que j'ai suivies dans la recherche diffèrent
en partie de celles qui sont en faveur aujourd'hui, j'en dirai quelques mots.
2. Les vues d'ensemble sur les langues sont entachées d'erreurs plusieurs
fois séculaires, alimentées non seulement par notre ignorance, mais aussi,
dans bien des cas, par notre volonté (inconsciente ou réfléchie) de voiler
ou de déformer la réalité.
La conception symbolique de la langue est le plus grand obstacle qui
s'oppose à l'explication des faits. La langue maternelle est constamment
mêlée à notre vie, à la vie de la société et de la nation ; comment n'engendrerait-elle
pas des vues erronées, en devançant l'observation désintéressée
par des a priori et des idées toutes faites, introduites du dehors et sans
contrôle ?
Certes, personne ne s'aviserait aujourd'hui de nier les rapports qui unissent
la pensée collective et la langue. Mais, par tendance au moindre
effort, on imagine que ces rapports sont directs, que la langue doit
refléter exactement la civilisation, l'art, la littérature du groupe qui la
parle. Ce postulat se justifie socialement, car c'est une idée-force. Mais,
dès qu'on le serre d'un peu près, on se trouve aux prises avec des difficultés
insurmontables, que l'on préfère d'ailleurs ignorer. On sait qu'en matière
de littérature, p. ex., on n'hésite pas à trouver un reflet de la société dans
les œuvres ; le style de leurs auteurs est donné pour l'expression fidèle
13de la mentalité du groupe ; mais il suffit de considérer les aspects profondément
individuels, parfois anarchiques, de l'art pour concevoir des doutes.
3. On admet, le plus souvent sans preuves à l'appui, que l'évolution de
la langue et celle de la société sont parallèles et synchroniques, que tout
changement dans la vie sociale et politique du groupe doit avoir, de
manière automatique, immédiate et unilatérale, son contre-coup dans la
structure de la langue. Mais d'abord, y a-t-il nécessairement parallélisme ?
On sait combien une langue est ouverte aux influences du dehors, influences
le plus souvent ignorées de ceux qui la parlent. On sait aussi qu'elle arrive
à s'imposer, par la colonisation, la conquête ou le prestige, à des populations
qui parlaient un idiome différent, et qui souvent avaient, et conservent,
un caractère ethnique sans analogie avec celui des colons ou des
conquérants.
Ensuite — et voici qui est paradoxal, — la langue est en même temps la
plus traditionnelle de toutes les institutions sociales, celle dont l'évolution
est la plus lente. Elle ne connaît pas les mutations brusques qu'on observe
dans la politique, le droit, voire la morale et la religion. La conséquence
est qu'elle peut fort bien refléter une mentalité collective qui s'est profondément
modifiée au cours du temps. A cela s'ajoutent encore l'indétermination
et le dilettantisme dont souffrent les descriptions de cette fameuse
« mentalité collective ». Elles sont toujours suspectes de subjectivisme,
parce que les jugements de valeur n'en sont presque jamais absents. De
plus, ces notions sont, le plus souvent, fondées, elles aussi, sur le passé
du groupe ; il est très difficile de voir clairement s'il a évolué, et de quelle
manière. En sorte que, dans les cas les plus favorables, on attribue à un
état ce qui n'est vrai que d'un état antérieur.
En conséquence, vouloir trouver une correspondance constante entre
langue et culture, surtout si l'on base l'argumentation sur la langue littéraire
et le style des grands écrivains, c'est là une entreprise séduisante
sans doute, mais qui réserve, je le crains, bien des désillusions.
4. Autre idée couramment admise : ce sont, croit-on, les sujets parlants
qui font évoluer la langue ; la pensée est toute-puissante vis-à-vis de la
forme linguistique. Que l'idiome maternel, parlé dès le bas âge, soit au
contraire capable d'imposer à notre esprit des formes que nous subirons
pendant toute notre vie, c'est là une hypothèse que notre amour-propre
est mal disposé à accepter. Et pourtant le bon sens suffit à la confirmer,
au moins partiellement.14
Si la pensée agit sur la langue, la langue façonne, elle aussi, la pensée
à sa mesure. Nous cherchons sans cesse à adapter la parole à nos besoins ;
mais elle-même nous contraint à plier notre esprit à des formes d'expression
que l'usage impose inéluctablement. Les changements qu'on observe
dans un idiome au cours des temps résultent en partie d'une orientation
nouvelle des esprits, mais le système linguistique, à lui seul, lancé dans
une certaine direction, peut se développer de façon autonome, et par
contre-coup, modeler la pensée collective d'une façon nouvelle. Comment
faire le départ entre ces influences contradictoires ? 11
5. Il se peut aussi qu'une innovation soit voulue par le groupe linguistique,
mais que les effets dépassent les intentions ou s'en écartent. Exemple
banal : voici un néologisme que la mode, ou les nécessités de la technique
introduisent dans la langue ; tout est-il fini par là ? Non, car les mots n'ont
jamais d'existence autonome, et le nouveau venu trouvera autour de lui
des synonymes ou des antonymes dont il changera en quelque mesure la
signification ; le réseau des associations en sera modifié ; ainsi le mot récital,
en se faisant une place à côté de concert, a restreint la signification de ce
dernier. Cette modification n'était pas voulue primitivement.
Ce qui est vrai des détails est vrai, à plus forte raison, des ensembles. J'ai
rappelé (L V3, p. 61 ss.) que les créations expressives dues à l'affectivité
15ont des effets inattendus sur le système de la langue courante ; elles s'usent
assez vite, mais le langage non affectif y puise souvent des ressources pour
d'autres fins. C'est ainsi que dans les langues romanes, l'expressivité a
amorcé bien des innovations qui ont renouvelé la langue non expressive
dans le sens analytique. Le futur latin intrabo, faciam, etc., a été supplanté
par un plus expressif intrare habeo, qui a fourni au français le paradigme
du futur non expressif j'entrerai, finirai, recevrai, ferai, etc., qui offre
l'avantage de désinences plus nettes, valables pour toutes les conjugaisons.
C'est encore une innovation expressive qui est à la base du tour latin
habeo feminam amatam, qui a fait concurrence au parfait amavi ; les langues
romanes s'en sont emparées, parce que j'ai aimé satisfait la tendance à
terminer les mots par l'élément lexical ; le passé simple j'aimai, contraire
à cet usage, a été éliminé de la langue parlée. Mais la rançon de cette
victoire du passé composé est la perte de toute valeur expressive.
6. D'autres vues générales et contestables se perpétuent parce qu'elles
donnent à l'esprit une facile certitude ou bien flattent l'orgueil national.
Rien n'est plus aisé que d'attribuer à un idiome des qualités de logique,
de clarté, que sais-je encore ? Mais la plupart du temps, c'est le peuple,
non la langue que l'on caractérise. Aussi les mêmes faits déclenchent-ils
souvent des jugements étrangement divers. Nous verrons, par exemple,
que le français ordonne les termes de l'énoncé par détermination croissante
(une table longue de deux mètres), l'allemand par détermination décroissante
(ein zwei Meter langer Tisch) : excellente occasion pour prétendre que l'une
des constructions est plus « logique » que l'autre ; seulement, pour les uns
c'est celle de l'allemand, pour les autres celle du français 12.
Pour peu qu'on ait d'esprit de contradiction, il est facile de prendre le
contre-pied de telle ou telle hypothèse de ce genre. Un exemple : on parle
beaucoup de la clarté du français ; le plus souvent, c'est à une attitude de
l'esprit français qu'on pense, bien plus qu'à la langue. On peut admettre
que tout homme qui écrit une phrase française éprouve le besoin et presque
la hantise d'être clair ; mais qui nous prouvera que la langue facilite cette
tâche et nous délivre de ce cauchemar ? Une langue est claire quand elle
fournit un ensemble de procédés permettant de tout dire clairement avec
un minimum d'effort ; elle pèche contre la clarté quand elle oppose au libre
16jeu des idées une foule d'entraves inutiles. On confond la clarté du français
et la clarté française. Un manuel scolaire 13 contient de nombreux préceptes
relatifs aux fautes de langue qui empêchent la pensée d'être claire ; or
ce sont des fautes que la langue elle-même suggère et qui tiennent à sa
constitution intime. Citons au hasard : les rencontres de sons : On ne va
plus aux eaux (raison, voir § 564 s.) ; le risque de calembours : vins feints
et fruits qu'on fit (286) ; ambiguïté des rapports syntaxiques : Je connais
Pierre mieux que Paul. Faites-le voir (276).
Ce n'est pas tout : si le français est clair, de quelle clarté s'agit-il ? On
ne s'avise guère de définir cette notion ; nous essaierons de le faire (593 s.),
et l'on verra que notre définition est assez différente de celles dont on se
contente le plus souvent, et qui, au fond, ouvrent la porte à toutes les
équivoques.
7. En face de ces difficultés, une seule méthode paraît raisonnable, celle
que F. de Saussure a résumée dans la dernière phrase de son Cours de
linguistique générale : « La linguistique a pour unique et véritable objet la
langue envisagée en elle-même et pour elle-même. »
On cherchera donc à dégager dans le mécanisme du français un certain
nombre de traits généraux, révélant certaines tendances internes, considérées
à un point de vue strictement linguistique. Les quelques vues générales
qui terminent l'ouvrage semblent déborder ce cadre ; le lecteur attentif
s'apercevra bien vite qu'il n'en est rien.
Nature du système linguistique
8. Dans un système, tout se tient ; cela est vrai du système linguistique
comme de tous les autres : ce principe, proclamé par F. de Saussure, conserve
pour nous toute sa valeur ; ce livre n'a pas d'autre but que de le
confirmer.
Mais on se tromperait grossièrement si cette vue générale aboutissait
à présenter la langue comme une construction symétrique et harmonieuse.
Dès qu'on essaie de démonter la machine, on est bien plutôt effrayé du
désordre qui y règne, et l'on se demande comment des rouages si enchevêtrés
peuvent produire des mouvements concordants.
Si la langue maternelle nous donne presque toujours l'impression d'un
tout organique, présentant une unité parfaite, cette impression peut fort
17bien être illusoire. L'idiome maternel fait corps avec notre pensée ; il est
mêlé à toute notre vie, individuelle et sociale ; véhicule de nos plaisirs et
de nos peines, de nos désirs, de nos haines, de nos aspirations, il devient
pour nous le symbole de notre personnalité et de la société où nous vivons,
Cette croyance à une harmonie presque préétablie répond à un besoin
profond de notre être, besoin d'équilibre et de synthèse.
Mais la réalité nous présente un tableau bien différent. En fait, quelle
est la langue où l'on découvre, à la lumière d'une étude désintéressée,
une unité même approximative ? L'anglais penche résolument vers le monosyllabisme
à la chinoise, mais cette tendance est tenue en échec par le
flot montant des emprunts latins et romans qui l'inonde de polysyllabes.
Par la simplicité de sa grammaire, cette même langue décharge le plus
possible la mémoire d'un poids inutile (pas de flexions compliquées, pas
de genres masculin, féminin et neutre) ; mais voici que les emprunts mentionnés
plus haut créent des complications inextricables : leur prononciation
s'adapte difficilement à celle des mots indigènes, et leur accentuation
échappe à peu près à toute règle.
Quant au français et à l'allemand, nous les verrons partagés entre plusieurs
tendances en partie contradictoires dont ce livre essaie de rendre
compte.
Ce qui, par-dessus tout, semble incompatible avec l'idée d'un système
cohérent, c'est le constant désaccord entre la forme des signes et leur
valeur, entre les signifiants et les signifiés. Cette question sera traitée en
détail § 213-307.
9. A quoi tient ce manque d'harmonie ? Voici quelques-unes des causes
auxquelles on peut, semble-t-il, le ramener.
Tout d'abord, les langues changent sans cesse et ne peuvent fonctionner
qu'en ne changeant pas. A chaque moment de leur existence, elles sont
le produit d'un équilibre transitoire. Cet équilibre est donc la résultante
de deux forces opposées : la tradition, qui retarde le changement, lequel est
incompatible avec l'emploi régulier d'un idiome, et d'autre part les tendances
actives, qui poussent cet idiome dans une direction déterminée.
Or, la force de la tradition est elle-même proportionnelle à l'unité de
la langue. Plus celle-ci est une, plus elle tend à se fixer. C'est le cas du
français, beaucoup plus que de l'allemand : là, en effet, les dialectes sont
encore vivants et pénètrent de toutes parts dans le haut-allemand ; la
littérature et la poésie, tout en se créant des moyens d'expression très
18distincts de ceux de la prose, inondent celle-ci de mots et de tours qui
empêchent la constitution d'une prose solidement établie, telle qu'elle
existe depuis longtemps en français.
Mais l'effet de la tradition est tout de même paradoxal : le français,
farouchement traditionaliste, est forcé d'évoluer pour servir les besoins
sans cesse variables de la pensée et de la vie ; mais il conserve jalousement
des reliques de presque toutes les époques de son développement. On dirait
que la langue participe de cette passion de la propriété et de l'épargne, où
l'on a voulu voir un trait caractéristique du peuple français. Or, à tout
conserver, on encombre la langue d'un bagage inutile et l'on gêne la spontanéité
de la pensée, d'autant que tout usage est, dans cette langue,
réglé minutieusement et que toute infraction à la règle encourt le ridicule
ou le blâme. Mais aussi, quiconque est parvenu à surmonter ces mille difficultés
trouve dans ces survivances de multiples ressources pour l'expression
des pensées les plus nuancées.
En outre, les tendances propres à une langue ne se vérifient pas uniformément
dans les diverses parties du système. Il est clair, p. ex., que
le français marche vers l'élimination des flexions postradicales et les remplace
progressivement par des éléments préfixés (cf. lat. De-i et de Dieu,
cant-o et je chante) ; mais si le substantif s'est débarrassé de presque toutes
ses désinences, le verbe en conserve un grand nombre ; dans le verbe même,
les formes les plus employées (présent, imparfait, etc.) en ont moins que
celles qui végètent dans la langue écrite (passé défini, imparfait du subjonctif).
Ou encore : les innovations syntaxiques pénètrent plus rapidement
dans les syntagmes libres que dans les groupes très serrés (319), et ainsi
de suite.
10. Puis il y a les emprunts, dont nous avons déjà constaté l'action.
Les langues n'ont jamais vécu dans un isolement complet : à notre époque,
toutes se compénètrent intimement. Ces emprunts de toute espèce (lexicaux,
morphologiques, syntaxiques, stylistiques) risquent constamment
d'altérer l'unité linguistique. Ajoutons cependant que, pour juger du rôle
des emprunts, il ne faut pas les mettre tous sur le même pied : ainsi les
anglicismes, si nombreux soient-ils, sont peu de chose dans une langue qui,
comme le français, les traite en parents pauvres tant qu'ils ne se sont pas
adaptés au système. Au contraire, les emprunts au latin ont pénétré le
tissu même de la langue ; ils en sont partie intégrante, au même titre que
les éléments hérités du latin par évolution lente. L'anglais — nous venons
19de le voir — offre la même dualité foncière, grâce aux importations latines
et romanes, tandis que les acquisitions qui lui viennent d'autres sources
sont à peu près négligeables.
11. Peut-on, après tout cela, continuer à parler de système et d'unité ?
Non, encore une fois, si le mot système évoque l'idée d'une harmonie, si le
principe « tout se tient, tout est associé à tout » fait penser à une construction
architecturale. Et pourtant l'usage constant que nous faisons de la
langue prouve que, en fait, notre cerveau assimile, associe, compare, oppose
sans cesse les éléments de la matière linguistique, et que ceux-ci ont beau
être parfois disparates, ils ne se juxtaposent pas simplement dans la mémoire,
mais réagissent les uns sur les autres, s'appellent, se repoussent,
et ne demeurent jamais isolés ; ce jeu incessant d'action et de réaction finit
par créer une sorte d'unité, toujours provisoire, toujours réversible, mais
réelle.
En outre, on ne doit pas chercher cette unité dans les parties superficielles
de la langue, mais dans ses couches profondes ; celles-ci sont moins
accessibles à l'observation, parce qu'elles échappent le plus souvent à la
réflexion consciente ; mais quand on y pénètre, on voit que certains caractères
fondamentaux sont communs à tout le mécanisme interne et font
apparaître des correspondances souvent inattendues. On peut même dire
qu'aucun caractère d'une langue n'est digne de ce nom si l'on ne le retrouve
pas dans sa structure générale.
12. Un système linguistique se présente donc à nous comme un vaste
réseau d'associations mémorielles constantes, sensiblement analogues chez
tous les sujets, associations qui s'étendent à toutes les parties de la langue,
depuis la syntaxe et la stylistique, en passant par le lexique et la constitution
des mots, jusqu'aux sons et aux formes fondamentales de la prononciation
(accent, mélodie, durée, pauses, etc.). Il n'est pas jusqu'aux habitudes
graphiques et à l'orthographe qui n'accusent un certain parallélisme avec
les manifestations de la vie proprement linguistique (204 n.).
13. Cette vue demande, pour recevoir un commencement de démonstration,
de vastes enquêtes, qui sont à peine amorcées. Une étude qui semble
promettre les plus brillants résultats est celle des systèmes phonologiques.
L'école linguistique de Prague, notamment les travaux du prince Troubetzkoy 14,
ont ouvert dans ce domaine une voie nouvelle. On sait maintenant
20que, pour me servir de l'expression de M. A. Sechehaye, il y a une
grammaire des phonèmes. Mais il ne suffit pas d'en étudier le mécanisme ;
il faut montrer le parallélisme de sa structure avec celle du reste de la
langue, montrer enfin qu'il y a interdépendance entre la grammaire et la
phonologie (v. Bally, Actes du IIe Congrès International de Linguistes,
p. 116 ss.).
La linguistique historique commence à reconnaître que les changements
phonétiques ne sont pas des phénomènes de nivellement qui passent uniformément
sur toute la surface de la matière phonique. Les mots soumis
à une « loi phonétique » ne la subissent pas tous de la même manière,
mais diversement selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, ou (ce
qui revient au même), selon le rôle qu'ils jouent dans le discours. Un mot
autonome ne change pas comme un mot agglutiné dans un groupe (cf. « Cela
peut être vrai » et « c'est p't-être vrai »), un mot simple comme un mot analysable
dans ses parties, un mot proprement dit comme un mot grammatical
(cf. calque et quelque prononcé souvent quèque ; de lait et de les devenu des),
un mot usuel comme un terme technique et rare, un mot onomatopéique
comme un mot qui a perdu ce caractère (cf. lat. pīpāre, fr. pépier, et pīpiōnem,
fr. pigeon), un mot désignant une notion pure et simple comme un mot
chargé d'affectivité (« le cochon domestique » et « ce ccochon de domestique »),
etc. etc. (Cf. 0. Jespersen, Grundfragen, p. 142 ss., et W. Horn, Sprachkörper).
Cela revient à dire que les signifiants n'évoluent pas indépendamment
des signifiés, et ce n'est pas l'analogie seule qui rétablit leur concordance ;
celle-ci est maintenue pendant le changement même. La tâche de la phonétique
de demain sera de serrer le détail de ces distinctions, qui sont à peine
esquissées aujourd'hui 15.
Mais si un signifiant évolue suivant la nature du signifié, c'est que dans
le fonctionnement même, au sein du système, à une époque donnée, il se
comporte d'une certaine façon, et que ce comportement dépend à son tour
de la nature du système tout entier. C'est donc dans la langue en équilibre
et en plein fonctionnement, dans la parole, qu'on peut le mieux surprendre
la solidarité qui existe entre le système phonologique et le reste de la langue.21
Statique et histoire — Langue parlée et langue écrite
14. Plusieurs principes de méthode découlent de cette définition du
système :
1) Elle nous amène à considérer la langue dans un état donné, à une
époque donnée, laquelle, pour ce qui concerne notre sujet, est le présent.
L'idée d'état est une abstraction, mais une abstraction nécessaire et naturelle,
puisque ceux qui parlent une langue n'ont pas conscience de son
évolution. Relier le français actuel aux diverses phases antérieures de la
langue, et vouloir expliquer chaque fait linguistique par le ou les faits qui
l'ont amené à ce qu'il est aujourd'hui, c'est le plus sûr moyen de fausser
la perspective et de donner de l'état actuel une caricature au lieu d'un
tableau, et cela pour deux raisons. 16.
Tout d'abord, la méthode historique, pour expliquer un fait linguistique
et le ramener à son origine, est obligée de le considérer en dehors
des associations synchroniques qui font toute sa valeur pour les sujets ;
c'est une méthode isolante ; or, toute la statique opère par voie associative
synchronique.
En second lieu, — A. Meillet l'avait déjà dit, — la matière de la linguistique
historique, ce sont les survivances, car seules elles peuvent montrer
ce qu'une langue a été pour autant que son passé diffère du présent. Mais
les survivances sont, au regard d'un état de langue, des faits isolés et
aberrants ; ce sont précisément ceux qui ne peuvent caractériser un système.
L'existence de l'opposition il est : ils sont est une des meilleures preuves que
notre langue remonte à l'indo-européen (cf. lat. est : sunt, all. ist : sind,
sanscrit asti : santi, etc.) ; mais rien n'est plus étranger au système verbal
actuel que la conjugaison du verbe être. Je ne connais pas de principe qui
prouve mieux le divorce radical entre linguistique statique et linguistique
historique. L'appel au passé, dans l'étude du présent, ne peut avoir d'autre
utilité que de fournir des points de comparaison qui éclairent, par contraste,
la nature vraie — et différente — de la langue actuelle. On voudra bien ne
pas oublier cette réserve toutes les fois que nous mentionnerons quelque
particularité de l'ancien français ou que nous tenterons de remonter à
l'origine de tel ou de tel fait : si tête a été autrefois un mot d'argot par
opposition à chef, il est maintenant un mot usuel et chef un mot noble de
22la langue écrite ; et si, à côté de tête, l'argot a créé des vulgarismes tels
que caboche, melon, poire, citrouille, ciboulot, etc., dont l'un pourra prendre
plus tard la succession de tête, il n'en est pas moins vrai que, actuellement,
ce sont des vulgarismes qui prouvent, par contraste, que tête est le mot usuel.
Qu'il entre ! a été un subjonctif en phrase indépendante et avait à côté de
lui Que tu entres, (cf. lat. Veniat ! et Venias !). Aujourd'hui, c'est un impératif,
et la seconde personne est Entre ! ; Que tu entres ! a disparu. Et ainsi
de tous les cas ; si minime que soit la différence entre l'état passé et l'état
présent, elle déclenche deux jeux distincts d'associations selon qu'on fait
de l'histoire ou de la statique.
15. 2) Rien ne fausse davantage la recherche que l'étude exclusive des
formes matérielles et perceptibles du discours : conséquence de l'attention
trop grande accordée aux textes écrits. Un des principes saussuriens les
plus féconds est celui qui affirme que les réalités linguistiques ne se révèlent
pas seulement dans les formes syntagmatiques, déroulées dans le discours,
mais aussi dans les associations virtuelles emmagasinées dans la mémoire ;
bien plus, chaque réalité discursive a son corrélatif dans une réalité mémorielle.
Nous montrerons, par exemple, que la notion de synthèse n'est pas
contenue uniquement dans les formes in praesentia, in actu (formes fléchies,
liberté relative de la construction, etc.), mais qu'elle se prouve aussi par
les associations virtuelles incapables de se réaliser telles quelles en syntagme,
p. ex. la polysémie (215).
Mais, à côté de ces associations mémorielles latentes, reposant sur le
parallélisme entre formes explicites et formes implicites, il en est d'autres
plus importantes et plus délicates : ce sont les associations nécessaires
existant entre des signes matériels et d'autres qui sont pensés en même
temps qu'eux et sans lesquels telle expression serait irrationnelle ou inintelligible ;
ainsi un mot comme la marche évoque inconsciemment, mais nécessairement,
en même temps que l'idée d'action (signifié), l'existence d'un
suffixe (signifiant) ; comparer marche et mont-ée, ascen-sion, etc. (248). Il
s'agit de la grande catégorie des syntagmes implicites, dont il sera question
à propos du cumul, du signe zéro, de l'ellipse, de l'hypostase (voir l'Index).
Il faut d'ailleurs observer que les associations mémorielles ont pour
point de départ des associations discursives, et qu'elles sont souvent suggérées
par le contexte. Ainsi une forme synthétique peut voisiner dans la
même phrase avec une forme analytique qui l'explique, et que le sujet
parlant unit d'autant plus aisément avec l'autre. Si p. ex. au est senti
23comme valant à le, c'est qu'il est parallèle à à la, et ce parallélisme est
constamment manifesté dans le discours : « être adonné au jeu et à la boisson »,
« renoncer au monde et à la société », etc. L'importance de ce fait,
qui peut paraître banal, est considérable, et son application pédagogique
n'aurait que d'heureux effets.
16. 3) Si un état de langue, tout en étant une abstraction, plonge dans la
réalité, le centre de l'étude doit se trouver dans une forme d'élocution
moyenne et fondamentale, dont toutes les autres sont comme des irradiations.
Cette forme-type, c'est la langue parlée. La linguistique historique,
obligée, par son objet même, de se fonder sur les textes, nous a fâcheusement
habitués à négliger les formes vivantes que nous avons la bonne fortune de
trouver, dans leur fraîcheur et leur spontanéité, au sein des langues actuelles.
Quand on songe que la langue est faite avant tout pour l'usage oral, ce
serait une faute de ne pas prendre celui-ci comme norme.
Entendons-nous bien cependant : la langue parlée, elle aussi, est une abstraction.
Elle n'est pas une ; il y en a autant qu'il y a de groupes sociaux, de
centres d'intérêt, autant même qu'il y a d'individus. Tout d'abord, on confond
trop souvent langue parlée et langue familière, populaire, argotique ;
l'argot est, comme la langue littéraire, décentré. Nous prenons le terme de
langue parlée dans un sens purement fonctionnel, voulant dire par là que
dans une foule de cas, un Français, surtout le Français moyen, emploie, la
plume à la main, des formes linguistiques qu'il ne peut pas, avec la meilleure
volonté, introduire dans son parler (p. ex. l'emploi du passé défini). Ce sera
pour nous un critère, et nous le croyons valable au moins pour les faits fondamentaux,
qui intéressent les parties vitales du système.
Ces différences tiennent à ce que dans la langue parlée l'interaction des
individus et la contrainte sociale sont au premier plan, tandis que la langue
écrite, surtout dans ses formes littéraires et poétiques, laisse plus de place
à la volonté individuelle et au choix. On pourrait dire, sans trop exagérer,
que le parlé obéit à des règles, et l'écrit à des modes, ce mot étant pris dans
le sens large qu'indique la phrase précédente.
17. La langue écrite n'est donc pas étrangère à notre recherche, mais elle
y est envisagée dans sa relation avec le parler moyen qui demeure pour nous
la norme. Il est parfaitement logique de se demander : « Tel ou tel tour, telle
ou telle formation est-elle possible dans la conversation, même de gens
cultivés ? » La réponse ne sera presque jamais catégorique, mais même sous
une forme relative, elle a son prix. Car l'instinct nous avertit que tout fait
24de langue important qui n'est pas absolument spontané n'est pas absolument
vivant, et ne peut figurer au premier plan des pièces à conviction
pour qui veut caractériser un état.
C'est la vue presque exclusivement livresque du français d'aujourd'hui
qui fausse la perspective dans plusieurs travaux parus à l'étranger, notamment
en Allemagne, et qui conduit à des conclusions souvent bien faites
pour étonner.
Ajoutons enfin que la langue parlée est d'un prix inestimable parce
qu'elle révèle la valeur linguistique des éléments musicaux du langage (accent,
mélodie, pauses, etc.), qui jouent, dans la structure grammaticale d'un
idiome, un rôle aussi important que mal étudié. Nous y recourrons aussi
souvent que possible 17.
Utilisation des faits pathologiques
18. Les anomalies linguistiques méritent d'être utilisées expérimentalement
pour autant qu'elles relèvent de la langue vivante et éclairent par
reflet sa nature et son fonctionnement, la direction des changements
qu'elle est en train de subir. Il y a une pathologie linguistique, qui est une
exagération du fonctionnement normal et le fait mieux comprendre par
contre-coup.
Ces anomalies sont de deux sortes. D'abord les aberrances positives,
c'est-à-dire les innovations « illégitimes », les tours néologiques, les incorrections
auxquelles on se laisse aller en parlant ou en écrivant, soit par
négligence passagère, soit par manque de culture, soit enfin par le secret
désir de suppléer à un déficit de la langue correcte. C'est ce dernier cas
seulement qui intéresse le linguiste. Ces déviations-là se reconnaissent généralement
à leur persistance, à la fréquence de leur répétition. Quand un
solécisme a la vie dure, quand il fait tache d'huile, il est rare qu'il soit négligeable ;
il doit s'expliquer par quelque cause générale.
19. Cette source d'information a attiré dès longtemps les linguistes. M.
Henri Frei a montré dans la Grammaire des fautes tout le parti qu'on peut
en tirer pour la connaissance du français et de son orientation actuelle.
Les incorrections révèlent souvent une déficience du langage correct, comme
se rappeler de quelqu'un, qui permet la tournure « Je me rappelle de vous »,
25alors qu'il est impossible de risquer « Je me vous rappelle ». Il est clair que,
en comparant la forme déjà un peu archaïque « je ne sais » avec le je sais pas
du peuple, on surprend une exagération de la tendance à la séquence progressive,
qui domine tout le français d'aujourd'hui (327ss). Sans doute, il
n'est pas toujours facile de décider si telle innovation résulte de la poussée
intérieure du système (ce qui fait pour nous tout son prix), ou bien si elle
satisfait quelque besoin général de l'expression. C'est cette seconde hypothèse
qu'admet, un peu exclusivement, M. Frei, car il classe les fautes sous
les rubriques : besoin d'assimilation, de différenciation, de brièveté, d'invariabilité,
d'expressivité. Ce sont là des tendances communes à toutes les
langues.
20. Mais il existe un autre genre d'anomalies, dont on ne semble pas
avoir encore compris toute la portée : les entraves imposées à l'expression
de la pensée par l'observation stricte des règles de la langue.
Il y a une pathologie de la « grammaire sans fautes ». Souvent l'emploi
d'un mot enregistré par l'Académie, l'application d'un tour de syntaxe
consacré par l'école, dans un contexte conforme à la « propriété des termes »
rendent la pensée ambiguë, engendrent des coq-à-l'âne, ou blessent l'oreille
et finalement conduisent l'expression dans une impasse dont on ne se tire
qu'en « tournant autrement ».
Les gênes imposées par le fonctionnement régulier placent l'observateur
sur un terrain plus solide que les incorrections. En effet, c'est ici la règle,
non son infraction, qui est matière d'expérience. Ces entraves, ces impossibilités
révèlent, plus sûrement que les innovations, tel ou tel rouage caché du
mécanisme linguistique, car elles sont les fruits de la tradition et de l'usage.
21. L'étude des faits pathologiques réclame une méthode strictement
expérimentale et repousse toute préoccupation pratique. On sait quelle
attitude prend ici l'école : « N'employez pas une phrase telle que Sophie quitte
Anna rassurée, bien qu'on la lise chez M. Romain Rolland, car il est impossible
de savoir si c'est Sophie ou Anna qui est rassurée ; cela n'est pas
clair, et ce qui n'est pas clair n'est pas français. » Notre point de vue est tout
autre : cette phrase correcte, de bonne grammaire, comment se fait-il que le
français nous induise à l'employer, au risque de nous jouer un mauvais
tour ? Nous répondons : c'est là une conséquence extrême de l'abandon des
flexions, caractéristique du français moderne. Autre cas : on peut imaginer
une loi ainsi libellée : « Les veuves des fils de fonctionnaires morts à la guerre
ont droit à une pension annuelle de dix mille francs » ; de quels morts s'agit-il ?
26Sont-ce les fonctionnaires ou leurs fils ? Ce qui est en cause ici, c'est une
fois de plus la prédilection du français pour la séquence progressive, en conflit,
encore à l'heure actuelle, avec une séquence plus libre ; ce conflit produit
des ambiguïtés plaisantes, qu'on surprend dans les annonces des journaux :
« A vendre une bicyclette de dame ayant peu roulé », etc. Un complexe
phonique tel que illafèvnir peut signifier : 1) il la fait venir ; 2) il l'a fait
venir (lui) ; 3) il l'a fait venir (elle). Cette équivoque résulte de l'habituelle
fusion des mots dans le groupe syntaxique et rythmique, fusion telle qu'elle
arrive parfois à rendre indistincts les éléments serrés les uns contre les
autres (529ss). On sourit en entendant « Tu devais prendre la parole : pourquoi
t'es-tu tu ? ». C'est qu'ici plusieurs syllabes consécutives sont identiques
ou analogues, et ce n'est pas un hasard : la structure uniforme de la syllabe
française est en cause, et cette structure tient elle-même à des causes plus
profondes (436). L'équivoque « Pierre et Paul viendront avec leur(s)sœur(s) »,
« Je m'intéresse au grec (aux Grecs, aux Grecques, aux grecs) », peut faire
réfléchir de diverses manières, et entre autres parce que la juste interprétation
dépend de la lecture, non de l'audition. Le français est souvent fait pour
l'œil, l'allemand presque jamais ; cela ne peut être tout à fait fortuit (609).
22. Pourquoi ne ferait-on pas une enquête complète sur les déficits de la
langue normale ? Il vaudrait la peine de noter, au moment où elles surgissent,
les fautes que l'on commet en parlant ou en écrivant correctement.
Ces notations, centralisées et commentées, constitueraient un riche matériel
d'observation. On verrait que la pathologie de la langue correcte
s'étend au lexique, à la syntaxe, à la morphologie, au système phonologique.
On ne s'étonnera pas que, malgré l'indigence de la documentation,
nous fassions çà et là quelques incursions dans ce domaine.
Cette méthode — est-il besoin de l'ajouter ? — ne jette aucun discrédit sur
l'idiome ainsi mis sur la sellette ; d'une part, ces défauts sont la plupart du
temps sans gravité : la situation et le contexte lèvent presque toujours les
doutes qu'on pourrait avoir ; puis il est aisé de trouver autre chose, et l'on a
même prétendu que cette obligation de faire effort pour être clair en dépit
de la langue est un excellent exercice d'assouplissement. Enfin le français,
étudié sous cet angle, n'est nullement mis en infériorité ; il est probable que
n'importe quel idiome de grande communication fournirait des cas semblables
et aussi nombreux. Ainsi en anglais, un même groupe de mots peut
appartenir à des syntaxes totalement différentes : French supply trouble in
Syria signifie ou bien « Les Français fomentent des troubles en Syrie », ou
27bien « Difficultés d'approvisionnement éprouvées par les Français en
Syrie » ; de même Workers fashion plates = 1) « les ouvriers fabriquent des
assiettes » ; 2) « planches de gravures de mode pour ouvrières ». D'où cela
vient-il ? C'est que l'anglais peut faire passer les mots d'une catégorie dans
une autre (notamment changer des substantifs en verbes) avec un minimum
de changement formel. C'est un caractère fondamental de cette langue, et
ces ambiguïtés contribuent à le faire toucher du doigt.
Méthode comparative
23. Comme l'indique la préface de ce livre, le français sera systématiquement
comparé avec l'allemand. Dans quel dessein ?
La comparaison de deux idiomes peut être faite à deux points de vue fort
différents : historique ou statique. Tantôt on s'attache aux faits qui prouvent
une origine commune ou des analogies surgies au cours de l'évolution,
tantôt on relève dans les deux langues, surprises à un moment précis de
leur histoire, sans souci de prouver une parenté généalogique, des caractères
différentiels qui accusent plus fortement l'originalité de chacune
d'elles et le type général dont chacune relève. C'est à ce second point de vue
que le français d'aujourd'hui sera mis en parallèle avec l'allemand moderne.
Ajoutons que là aussi les anomalies ont leur prix pour l'observateur ; les
fautes que font les Allemands en parlant ou en écrivant le français sont
utiles à observer quand elles sont caractéristiques ; elles éclairent le système
par le fait même qu'elles le faussent. Il n'est pas jusqu'aux fautes de prononciation
qui n'aient leur prix. Et ce qui est vrai des Allemands qui
apprennent le français ne l'est pas moins des Français aux prises avec l'allemand.
Les inhibitions, les gênes, les impossibilités se prêtent aussi à l'examen ;
quand, en parlant ou en écrivant une langue étrangère, ou en traduisant
de cette langue dans l'idiome maternel, on est acculé à une impasse,
quand les diverses tentatives qu'on a faites échouent, on peut penser à bon
droit qu'on est venu buter sur un point vital du système, et il faut s'y arrêter ;
il y a là quelque chose à méditer.
24. Quand on compare deux systèmes linguistiques, il est théoriquement
indifférent qu'ils appartiennent ou non à une même famille historique ;
deux langues indo-européennes comme l'arménien et l'allemand n'ont
presque plus rien de commun ; même deux langues germaniques telles que
l'allemand et l'anglais diffèrent profondément. Au contraire, deux idiomes
28issus de souches différentes peuvent se rapprocher sensiblement dans leur
structure. La communauté d'origine n'est cependant pas négligeable pour
la caractérisation : on a reconnu que, malgré de grandes diversités, les langues
du groupe indo-européen présentent des analogies dans les traits fondamentaux
de leur évolution 18 ; seulement elles sont plus ou moins avancées
sur la voie des changements convergents. C'est là surtout ce qui fait l'intérêt
d'un parallèle entre l'allemand et le français ; le second est plus évolué
que le premier, au moins à certains égards ; on observe donc entre eux des
différences quantitatives aussi bien que qualitatives ; la présence des caractères
communs fait mieux ressortir les contrastes.
Il reste que le point de vue adopté ici est purement didactique et n'a pas d'autre
but que d'éclairer le visage du français par la comparaison de l'allemand.
25. Une étude comparative comme celle où nous nous engageons exigerait
que les faits soient d'abord exposés avant que les conclusions qu'on
peut en tirer soient énoncées.
Mais la tâche est compliquée du fait que l'on opère sur des notions souvent
mal définies et qui doivent être précisées.
Nous voici, par exemple, devant l'opposition entre la tendance synthétique
attribuée à l'allemand et la tendance analytique qui est censée caractériser
le français. Analyse et synthèse sont des termes courants et qui
semblent clairs ; on s'aperçoit très vite qu'ils ne le sont pas : autant de linguistes,
autant de définitions, et le grand public croit les linguistes sur
parole. Une revision des idées reçues s'impose ; mais cette recherche soulève
à son tour la question de l'enonciation tout entière. Nous voici obligé,
pour asseoir notre étude sur des bases plus solides, d'exposer quelques principes
de linguistique générale.
Nous groupons donc ces principes sous deux chefs : la théorie de l'enonciation,
et les caractères de la tendance synthétique et de la tendance analytique.
En réalité, on le verra, il s'agit de la langue considérée d'abord sous
l'angle des signifiés, puis sous l'angle des signifiants. Ainsi ces deux sujets,
qui sembleraient à première vue être découpés arbitrairement, touchent à
l'essence même du système linguistique, sans prétendred'ailleurs l'expliquer
complètement. Enfin ces principes généraux, étrangers en apparence à
l'objet de ce livre, sont directement applicables à l'étude du français, et la
plupart des faits utilisés sont empruntés au français.29
Première partie
Principes de linguistique générale31
Première section
Théorie générale de l'énonciation33
Chapitre premier
La phrase
26. Toute énonciation de la pensée par la langue est conditionnée logiquement,
psychologiquement et linguistiquement. Ces trois aspects ne se recouvrent
qu'en partie ; leur rôle respectif est très variable et très diversement
conscient dans les réalisations de la parole. L'analyse permet cependant
de les retrouver par un jeu d'associations spontanées, soit discursives,
soit mémorielles, mais toujours synchroniques, propres à un même
état de langue ; ces associations permettent de découvrir les équivalences
fonctionnelles qui sont à la base de tout système linguistique. Il y aurait
avantage à étudier séparément les trois aspects indiqués plus haut ; mais
les facteurs psychologiques de la pensée sont si bien engrenés dans sa
texture logique qu'on ne peut en faire totalement abstraction dans l'analyse
logique ; à son tour, la forme linguistique ne peut être entièrement
séparée des deux autres. On ne s'étonnera donc pas de trouver, dans l'analyse
logique des formes de l'enonciation, des considérations qui relèvent
des deux autres ordres.
Analyse logique de la phrase
27. La phrase est la forme la plus simple possible de la communication
d'une pensée.
Penser, c'est réagir à une représentation en la constatant, en l'appréciant
ou en la désirant.
C'est donc juger qu'une chose est ou n'est pas, ou estimer qu'elle est
désirable ou indésirable, ou enfin désirer qu'elle soit ou ne soit pas. On
croit qu'il pleut ou on ne le croit pas, ou on en doute, on se réjouit qu'il
pleuve ou on le regrette, on souhaite qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas.
Dans le premier cas, on énonce un jugement de fait, dans le second un
jugement de valeur, dans le troisième une volition.
La première opération relève de l'entendement, la deuxième du sentiment,
la troisième de la volonté, qui a son aboutissement dans l'action, aboutissement
qui est une des fonctions du langage tout en le dépassant.
La pensée ne se ramène donc pas à la représentation pure et simple,
en l'absence de toute participation active d'un sujet pensant.35
28. Transportons-nous maintenant sur le terrain du langage, et demandons-nous
quelle est la forme la plus logique que puisse revêtir la communication
de la pensée. C'est évidemment celle qui distingue nettement la
représentation reçue par les sens, la mémoire ou l'imagination, et l'opération
psychique que le sujet opère sur elle, comme c'est le cas dans les
exemples cités plus haut. La phrase explicite comprend donc deux parties :
l'une est le corrélatif du procès qui constitue la représentation (p. ex.
la pluie, une guérison) ; nous l'appellerons, à l'exemple des logiciens, le
dictum.
L'autre contient la pièce maîtresse de la phrase, celle sans laquelle il
n'y a pas de phrase, à savoir l'expression de la modalité, corrélative à
l'opération du sujet pensant. La modalité a pour expression logique et
analytique un verbe modal 19 (p. ex. croire, se réjouir, souhaiter), et son sujet,
le sujet modal ; tous deux constituent le modus, complémentaire du dictum.
La modalité est l'âme de la phrase ; de même que la pensée, elle est
constituée essentiellement par l'opération active du sujet parlant. On ne
peut donc pas attribuer la valeur de phrase à une énonciation tant qu'on
n'y a pas découvert l'expression, quelle qu'elle soit, de la modalité.
29. Il est évident que les formes du dictum sont aussi diverses que les
représentations qu'il peut exprimer. Logiquement, il contient le corrélatif
verbal d'un procès (phénomène, état ou qualité), lequel est le plus souvent
localisé dans une substance, c'est-à-dire en langage linguistique dans un
substantif : « la terre tourne, le soleil brille, le ciel est bleu ». Seuls les verbes
impersonnels (il pleut, etc.) ont un substrat diffus et pensé très inconsciemment,
malaisé à dégager ; p. ex. la pluie fait penser à l'état général de
l'atmosphère dans un moment donné (le temps est à la pluie), ou à un
agent indéterminé (pop. comme ça tombe ! ou même comme ça pleut ! ).
30. Le verbe modal peut, lui aussi, comporter les nuances les plus diverses
du jugement, du sentiment et de la volonté. Notre aperçu, forcément
schématique, fera abstraction de cette diversité ; on trouvera d'ailleurs
tous les détails désirables chez F. Brunot, P L, p.507ss. Il importe seulement
de remarquer que ces trois catégories elles-mêmes ne sont pas toujours
rigoureusement distinctes.
Tout d'abord, elles peuvent s'échanger par emploi hypostatique (257),
c'est-à dire lorsqu'elles sont prises dans des acceptions figurées. Dans une
36phrase telle que « Socrate veut que l'homme ne fasse le mal que par ignorance »,
veut signifie « prétend, juge ». Dans cette autre : « Mon mari a décidé
que je le trompe », le mot souligné marque aussi un jugement 110. Inversement,
« Le général a décidé que les prisonniers seraient tous mis à mort »
a une syntaxe propre au jugement, alors qu'il s'agit d'un ordre.
En deuxième lieu, certaines expressions verbales trahissent une véritable
compénétration de plusieurs formes de pensée. Ainsi craindre comporte un
jugement de vraisemblance accompagné d'un mouvement de déplaisir,
tandis qu'espérer implique à la fois croyance et désir. L'ordre et l'interrogation
présentent des cas différents de complexité qui seront envisagés plus
loin (58).
Le sujet modal peut être et est le plus souvent en même temps le sujet
parlant ; c'est le cas dans les exemples cités jusqu'ici. Mais il peut englober
d'autres sujets : « Nous ne croyons pas qu'il pleuvra », ou bien c'est un
autre ou plusieurs autres sujets : « Galilée, les astronomes affirme(nt) que
la terre tourne » ; puis on reste dans le vague : « On croit que le roi est mort » 211.
31. Mais même lorsque le sujet pensant est identique au sujet parlant,
il faut prendre garde de confondre pensée personnelle et pensée communiquée.
Cette distinction est de la plus haute importance, et s'explique par
la nature et la fonction du signe linguistique lui-même. En effet, le sujet
peut énoncer une pensée qu'il donne pour sienne bien qu'elle lui soit étrangère.
Il s'agit alors d'un véritable dédoublement de la personnalité. Le
mensonge en est la forme la plus caractéristique. Un témoin dit au tribunal :
« Cet homme est coupable » tout en sachant parfaitement qu'il est innocent.
Ce fait n'est pas particulier au langage, mais est propre à tout système de
signes : un garde-voie déclenche un signal équivalant à « La voie est libre »,
bien qu'il sache qu'elle est encombrée et qu'un déraillement s'ensuivra.
L'antiphrase est une autre manifestation de ce dédoublement : une bonne
d'enfants dira à son petit protégé : « Patauge dans la boue ! Ta maman va
être bien contente ! » Cela nous amène à une conception particulière de la
réalité en matière de sémiologie : le signe porte en lui-même sa signification
37(son signifié), et c'est celle-là seule qui compte pour la communication.
Elle peut être en contradiction avec la pensée de celui qui emploie le signe,
et ne recouvre donc pas la notion de réalité. En dehors du langage, c'est
la raison d'être de la fiction littéraire et poétique : on peut dire que les
aventures de don Quichotte sont autant de mensonges de Cervantès.
Analyse de la phrase explicite
32. Cherchons maintenant à déterminer les rapports qui unissent les
termes d'une phrase logiquement constituée : sujet modal, verbe modal et
dictum.
Une phrase telle que : Je crois que cet accusé est innocent nous présente
un sujet pensant (moi) opérant un acte de pensée (croire) sur une représentation
(l'innocence d'un accusé). Nous dirons que par l'acte psychique
la représentation est actualisée. En outre, elle est visée par l'acte, elle en
est la raison d'être, l'objet, le but ; c'est à propos d'elle que la croyance
surgit dans l'esprit. Le modus (ma croyance) est au contraire le substrat
de la représentation. Nous dirons donc que le modus est le thème, et le
dictum le propos de l'énonciation explicite 112.
Nous trouvons ici un premier exemple du conditionnement réciproque qui
est à la base de tous les rapports grammaticaux. En effet, croyance implique
objet de croyance, et vice versa : il n'y a pas d'objet de croyance
sans l'acte même de croire ; le modus et le dictum sont complémentaires
l'un de l'autre.
33. En portant maintenant notre attention sur le sujet du modus, nous
découvrons un autre rapport de complémentarité. Ce sujet nous apparaît
comme le siège, le « lieu » de la représentation exprimée par le dictum, et
celle-ci est reliée au sujet par le verbe porteur de la modalité ; il a la forme
d'un verbe transitif dont le dictum est le complément d'objet. C'est donc,
plus exactement, une copule, et une copule de rection (166), qui crée entre
les deux termes qu'elle associe un rapport de conditionnement réciproque ;
car il n'y a pas de représentation pensée sans un sujet pensant, et tout sujet
pensant pense à quelque chose.38
Constatons enfin que le dictum transpose en terme de phrase, en complément
d'objet, une phrase par ailleurs autonome (dans notre exemple :
« Cet accusé est innocent »), et que, dans les langues de notre type, cette
transposition est marquée par une particule vide (en français que ou ses
suppléants 113, qui joue par conséquent le rôle de transpositeur en même
temps qu'elle relie le terme ainsi formé à la copule modale.
34. En résumé : la phrase explicite présente deux rapports chevauchant
l'un sur l'autre : l'un qui unit à la copule le corrélatif de la représentation
transposée, c'est-à dire le dictum (ligament que), l'autre qui rattache le
dictum au sujet modal au moyen de la copule. La figure ci-après concrétise
ce système grammatical (les ligaments sont imprimés en italique) :
image je crois que tu mens
35. Terminons par quelques détails sur l'interrogation, en tant que ses
différentes formes éclairent le mécanisme de l'énonciation explicite.
On sait que la grammaire distingue deux classes d'interrogations : les
partielles et les totales ; exemple du premier type : « Qui vient de sortir ?
(Paul) — Où est-il allé ? (A l'école) — Quand ? Comment ? etc. » Exemples
du second : « Paul est-il ici ? (Oui) — Est-il allé à l'école ? (Non) — Reviendra-t-il
bientôt ? (Peut-être) ».
En réalité, il n'y a pas d'interrogations totales ; la question peut porter
tantôt sur une partie du dictum ou sur sa totalité (1), tantôt sur la totalité
du modus ou sur une de ses parties (2), mais jamais sur le dictum et le
modus réunis.
1 a. Interrogation portant sur une partie du dictum. Quand on demande :
« Qui vient de sortir ? », on sait que quelqu'un est sorti, mais on ignore
qui c'est, et on le demande. L'assertion n'est pas en cause, puisque le fait
est connu comme certain ; on veut seulement compléter la représentation
du dictum. C'est une interrogation dictale partielle (celle qu'on appelle
ordinairement partielle tout court).
1 b. On veut être renseigné sur la totalité du dictum, mais du dictum
seulement. On demande : « Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-il
arrivé ? » La réponse est formée du dictum total, p. ex. « Qu'est-il arrivé ?
Une auto vient d'écraser un piéton ». Là non plus, l'assertion n'est pas
39en cause ; en interrogeant, on pose la réalité du fait ; on sait qu'il est
arrivé quelque chose, mais on ignore ce que c'est : interrogation dictale
totale.
2 a. On a une représentation totale dans l'esprit, mais on ne sait si elle
correspond à la réalité, et l'on en veut la confirmation ; le dictum entier
est formulé dans la question, et la réponse est : « Oui. Non. Peut-être » ou
leurs équivalents. « Paul est-il ici ? Est-il allé à l'école ? » On voit qu'il
s'agit de la forme d'interrogation qu'on appelle communément totale ; elle
ne l'est pas absolument, puisque ce n'est qu'une demande d'assertion ; le
dictum figure tout entier dans la question, et celle-ci a pour but de rechercher
la vérité ou la fausseté du dictum. C'est une interrogation modale
totale.
2 b. Enfin on peut douter de la réalité d'une partie du dictum : on sait
par exemple que Paul est sorti et l'on croit, sans en être sûr, que c'est
à l'école qu'il est allé. La forme employée dans ce cas est : « Est-ce à
l'école que Paul est allé ? » On peut, de la même manière, fixer l'attention
sur n'importe quelle partie du dictum : « Est-ce toi qui as fait cela ? Est-ce
cela que tu as fait ? Est-ce à cause du froid que tu trembles ? etc. » : interrogation
modale partielle.
Formes implicites de l'énonciation et signes
extra-articulatoires
36. On a sans doute remarqué déjà que la forme logique et analytique
de la pensée communiquée, bien loin d'être la seule possible, n'est pas la
plus usuelle ni la plus expressive. Nous devons donc jeter un coup d'œil
sur quelques autres formes typiques de l'énonciation, en suivant un ordre
qui nous éloigne progressivement de l'explicite et nous fasse parvenir aux
expressions les plus synthétiques de la pensée. Notre guide sera ici, comme
dans toutes les recherches grammaticales, le procédé des équivalences fonctionnelles,
par quoi nous entendons des pièces du système grammatical
qui peuvent s'échanger au nom de leur fonction commune, sans que leurs
valeurs sémantiques et stylistiques soient nécessairement identiques. Comparez
les « équivalents fonctionnels » suivants, d'ailleurs étrangers à la présente
étude : (la maison) dont mon père est propriétaire, que possède (a)
mon père, qui appartient (est) à mon père, possédée par lui, et enfin :
(la maison) de mon père.40
37. Supposons maintenant que quelqu'un, incommodé par le bruit que
fait une personne dans la pièce où il travaille, veut se débarrasser du
fâcheux et lui ordonne de quitter la chambre ; voici quelques-unes des
formes que peut prendre cette injonction (nous ne prétendons pas que ce
modeste aperçu épuise la totalité des cas à envisager, ni que nos équivalences
fonctionnelles apparaissent avec évidence, tant s'en faut : la justification
ne viendra que plus tard) :
1. Je veux (j'exige) que vous sortiez.
2. Je vous ordonne (vous intime l'ordre) de sortir.
3. Il faut que vous sortiez.
4. Vous devez sortir.
5. Sortez !
6. A la porte !
7. Ouste !
8. Geste indiquant la porte et jeu de physionomie marquant une volonté
irritée.
9. Expulsion pure et simple du perturbateur.
38. En parcourant ces exemples, on est amené à faire deux constatations :
a) en allant de l'un à l'autre de ces types, on voit telle ou telle pièce de l'énoncé
logique se fondre dans une autre ou disparaître de la parole articulée ;
b) l'esprit supplée cependant sans effort aux déficiences de l'expression, et
l'énoncé ne perd rien d'essentiel.
Ainsi la phrase 2) ne contient pas le pronom-sujet vous ; dans 3), le sujet
modal reste imprécis, le verbe modal étant impersonnel ; 4) exprime le modus
d'une façon indirecte, car devoir n'est pas un verbe modal, mais un
auxiliaire de mode ; 5), une des formes les plus usuelles, ne renferme aucun
mot de nature modale ; 6) réduit la phrase à un seul terme nominal qui fait
place dans 7) à une exclamation, et dans 8) à une mimique ; quant à 9)
(expulsion du perturbateur), il s'agit d'un procédé évidemment extérieur
au langage, mais qui montre l'étroite parenté de celui-ci avec l'action.
Et pourtant, comme nous l'avons dit, la compréhension ne souffre pas
de la carence sans cesse accrue de l'expression explicite et des signes articulatoires ;
l'expression devient même plus claire et plus incisive à mesure
que les mots font défaut. Comment expliquer ce paradoxe ?
La réponse est que d'une part la langue possède, outre les mots articulés
en voyelles et consonnes, tout un arsenal de procédés susceptibles d'en
tenir lieu ; c'est d'autre part que la parole trouve, en dehors du langage,
41quantité de ressources pour alimenter l'énonciation positive ou la suppléer.
Disons quelques mots de ces signes « extra-articulatoires » afin de comprendre
comment ils subviennent à l'insuffisance des signes matériels.
39. Parmi les éléments non-articulatoires de la langue, nous donnons la
première place aux signes musicaux. Si nous les appelons ainsi, c'est qu'ils
présentent quelque analogie avec les procédés du chant ; on distinguera par
exemple l'intensité, la mélodie ou intonation, la durée, les silences ou pauses,
et en général tout ce qui est de la nature du rythme (p. ex. la répétition).
L'accent d'intensité peut remplir des fonctions grammaticales : en
allemand, il détache, dans une phrase, le mot qui est l'essentiel de l'énoncé,
le propos : « Karl ist gestern abgereist » signifie « C'est hier que Charles est
parti » (232). La durée des voyelles a une valeur différentielle ; en grec phérŏmen
veut dire « nous portons » et phérōmen « que nous portions » ; en français
voyage est substantif, (il) voyage est un verbe. La mélodie, sur laquelle
nous reviendrons sans cesse, est l'expression naturelle de la modalité ; c'est
elle qui permet de percevoir si Vous me suivrez est une constatation, une
interrogation ou un ordre. Les pauses, enfin, dont l'importance sera bien
des fois soulignée, différencient, le plus souvent avec la mélodie, des patrons
syntaxiques qui pourraient passer pour identiques ; ainsi « Grandes
richesses ! Gros soucis ! » = On a de grandes richesses et l'on se crée par là
de gros soucis ; « Grandes richesses, gros soucis » = Quand on a beaucoup
d'argent, on a aussi beaucoup de soucis ; « Grandes richesses gros soucis » =
De grandes richesses entraînent de gros soucis (67).
40. Les interjections sont une forme curieuse de la combinaison des
« mots » et du « chant ». Ces formes affectives du langage ont bien des articulations
pour support, mais cette base est étroite et d'autant moins considérable
que le sentiment est intense, au point que parfois l'orchestration
est tout, les sons presque rien. On constatera une gradation de ce genre
dans : Qu'est-ce que vous me dites là ! — Pas possible ! — Ah bah ! — Oh /, toutes
exclamations qui signifient à peu près : « Comme je suis étonné (de ce que
vous me dites, ou encore : de ce que je vois, etc.) ». Le cas le plus frappant
est celui où les mots n'ont plus par eux-mêmes aucun sens, ou auraient un
sens absurde sans la mélodie, comme : Allons donc ! = « Je n'en crois rien » ;
Diable ! = « Voilà qui est embarrassant » ; etc. cf. Pas possible !
Les valeurs attachées aux interjections sont infiniment diverses et nuancées,
mais elles se groupent assez bien sous trois chefs : les unes, comme
celles qu'on vient de citer, expriment des émotions et des volitions ; ce sont
42des exclamations ; elles sont, par suite, de nature modale (Eh eh ! = « Voilà
qui est assez curieux » ; Chut ! = « Taisez-vous ! »). D'autres sont descriptives
et peignent des événements, des situations ; on les appelle onomatopées, elles
sont donc dictales (Boum ! = « Une explosion vient de se produire » ; Patatras !
= « Quelque chose est tombé »). D'autres enfin donnent des indications,
ce sont des « signaux » ; leur fonction est déictique (Pst !, Holà ! =
« C'est à vous que je m'adresse ») ; elles expriment des rapports et rappellent
les ligaments grammaticaux.
41. A côté de la musique, nous devons faire une place à la mimique, qui
en est, jusqu'à un certain point, le pendant visuel. Les gestes, les mouvements
du corps, les attitudes, et surtout les jeux de physionomie ont des
significations tout aussi déterminées et usuelles que les autres signes de la
langue. Car si une marge est laissée aux formes individuelles de la mimique,
il est indéniable qu'elle est, comme la musique, enfermée dans certaines
formes, fixées dans chaque groupe linguistique par la tradition. D'ailleurs,
dans la parole, les gestes se classent de la même manière que les interjections
et ils sont des équivalents de phrases. Il y a des gestes « exclamatifs »
et modaux : un haussement d'épaules peut signifier « Cela m'est indifférent »,
un froncement de sourcils accompagné d'un regard perçant « Telle et telle
chose me met en colère ». D'autres formes sont onomatopéiques : l'index frappant
le front à plusieurs reprises signifie « Il a un coup de marteau, il est
fou ». Enfin on peut inviter quelqu'un à s'approcher par un geste déictique
approprié ; on montre à quelqu'un la place qu'il doit occuper en désignant
cette place du doigt, et l'on remarquera que même la phrase complète
« Asseyez-vous ici » n'aura aucun sens tant que le geste (vrai ligament grammatical)
n'aura pas précisé l'endroit désigné par « ici » (125). D'ailleurs, dans
les langues normalement constituées, le geste a le plus souvent une fonction
subalterne et se borne à accompagner la parole.
42. Signes situationnels : deux mots qui semblent jurer ensemble : comment
des choses, des êtres, des mouvements, des événements perçus par nos
sens au moment où nous parlons, pourraient-ils figurer dans nos paroles ?
Et pourtant il suffit que nous montrions un avion en même temps que nous
disons Regardez ! pour que cet avion devienne partie intégrante de la phrase,
et plus particulièrement le complément d'objet du verbe. Si quelqu'un,
témoin d'un horrible accident d'automobile, s'écrie Quelle horreur !, il est
clair que cet accident est la raison d'être, le thème de l'exclamation ; il ne
viendrait à personne l'idée de dire Quelle horreur ! sans aucun motif.43
L'ambiance matérielle où se déroulent nos discours nous offre, comme
nous l'avons dit, des choses et des procès qui, le plus souvent il est vrai,
s'enchevêtrent dans des ensembles globaux. Mais l'analyse de ces éléments
nous suggère encore les relations qui les unissent. C'est ainsi que les procès
sont généralement perçus en même temps que les choses qui en sont le
siège : les sauts d'une grenouille, le chant d'un oiseau, le feu qui sort d'un
tas de bois : c'est le germe de la phrase à sujet et prédicat. De plus, les mouvements
sont souvent dirigés : l'oiseau, en volant, s'approche de son nid, il
y entre, il y est ; les états nous apparaissent comme consécutifs aux mouvements ;
en outre, un rapport s'établit dans notre esprit entre l'oiseau et le
nid : voilà l'embryon de la relation entre sujet et objet grammaticaux.
Mais ce que nous appelons situation a un sens plus large ; il n'y a pas que
les éléments perçus par les sens au cours de la parole, il y a encore toutes
les circonstances connues des interlocuteurs et qui peuvent être les motifs
de leurs conversations. Si une personne de ma connaissance a perdu un être
cher, je lui dirai, à la prochaine rencontre « Mon pauvre ami ! » Un souvenir
commun et qu'on sous-entend suffit pour motiver ce mot de sympathie.
43. Ceci nous montre qu'en définitive il n'y a pas de différence essentielle
entre les signes muets fournis par notre entourage et ceux (également
muets !) que nous extrayons, par la mémoire, des mots qui ont été prononcés
précédemment, c-à-d. du contexte. Quand Sully-Prudhomme dit : « N'y
touchez pas, il est brisé », il veut, par y et il, qui sont des « gestes », qu'on se
souvienne qu'il s'agit d'un vase, et quand, plus bas, on lit : « Il est brisé, n'y
touchez pas », ces mêmes « gestes » reportent notre mémoire au cœur qu'a
effleuré la main qu'on aime. Le contexte évoque des mots, et la situation
des représentations ; mais, encore une fois, les uns et les autres jouent le
même rôle dans le discours.
Si ces formes (sensorielles et memorielles) de la situation ont un caractère
passager, n'oublions pas qu'il existe une situation permanente, formée de
toute la vie sociale des individus au sein d'un groupe : vie de famille, exercice
d'une même profession, traditions et usages d'une classe, etc., etc.
Tout cela se reflète indirectement dans les paroles que nous prononçons, et
- c'est là ce qui nous importe ici — dans la syntaxe de la phrase.
44. Si maintenant nous faisons un retour sur les signes musicaux et mimiques,
nous surprenons la différence essentielle qui les distingue de la
situation. Celle-ci fournit des signes qui portent toujours l'empreinte de la
réalité : ils sont tous actuels. Au contraire, une courbe mélodique, un geste,
44une exclamation, etc., etc. existent sous forme d'empreinte mémorielle,
à l'état latent, chez les sujets, et n'entrent en fonction que dans la parole.
Ils ont donc le même caratère que tous les signes proprement linguistiques,
d'être virtuels et de devoir être actualisés par l'usage qu'on en fait.
45. Après cette digression, justifiée par le fait que l'importance des procédés
non-articulatoires croît en raison directe du caractère implicite de la
phrase, nous pouvons reprendre notre étude syntaxique, en passant en
revue quelques-unes des formes les plus typiques que revêt la phrase dans
sa condensation progressive.
Nous n'insisterons pas sur le dictum, puisque c'est l'expression de la modalité,
seule raison d'être de la phrase, qui importe ici. On se souviendra
seulement que le verbe dictal peut être, le cas échéant, transposé en infinitif
(« Je crois que je suis innocent » — « Je crois être innocent »), et celui-ci en
substantif abstrait (« Je crois à mon innocence »). Enfin il arrive que l'idée
verbale soit entièrement absente de l'énoncé et se déduise uniquement de la
présence d'un appellatif concret, comme dans « Je veux du thé », qui signifie
« Je veux avoir (boire) du thé », car logiquement un verbe modal ne peut
avoir un régime concret, comme cela est naturel dans « Je bois du thé ». On
expliquera de la même manière Je ne vous comprends pas « Je ne comprends
pas que vous agissiez ainsi ». Vous m'étonnez = « Je m'étonne de votre conduite »,
etc. Sans doute l'idée verbale est parfois trop vague ou trop complexe
pour que son rétablissement soit possible, et l'on a affaire à des compléments
d'objet purs et simples de verbes proprement dits, p. ex. dans
Je vous aime (par opposition à J'aime le chocolat = « J'aime à en manger ») 114.
46. Quant à la modalité, elle peut, sans jamais cesser d'être exprimée,
perdre progressivement son autonomie :
1) Le verbe modal demeure distinct du dictum, mais il prend la forme
impersonnelle, et c'est la situation qui peut seule le faire connaître. Dans
notre exemple-type Il faut que vous sortiez, c'est le sujet parlant ; mais si,
dans un train, un voyageur dit à son voisin qui fume « Il est interdit de fumer
dans les non-fumeurs », il fait allusion à une prescription de la Compagnie.
2) La modalité est encore partiellement autonome mais est indirecte, et
de plus incorporée dans le dictum, quand elle est contenue dans un auxiliaire
45de mode (v. plus haut) : Vous devez sortir = « Je veux que vous sortiez » ;
Puis-je sortir ? = « Me permettez-vous de sortir ? » ; Vous semblez souffrir
= « J'ai l'impression que vous souffrez ».
Nous pouvons conclure des exemples précédents qu'un auxiliaire de mode
est l'équivalent fonctionnel d'un verbe modal construit au passif et dont le
complément d'agent est implicite. Ainsi Vous pouvez sortir = « Vous êtes
autorisé (par moi ou quelqu'un d'autre) à sortir ». Certaines formes intermédiaires
éclairent cette interprétation ; p. ex. dans Paul est censé honnête, le
verbe est aujourd'hui un pur auxiliaire modal ;mais il est étymologiquement la
forme passive du verbe inusité censer. En latin vidēri « sembler » a signifié primitivement
« être vu ». L'analogie a, dans la plupart des cas, substitué des verbes
actifs aux anciens passifs : passer pour= « être censé, être considéré comme ».
47. La modalité est aussi incorporée dans le dictum sous la forme d'un
adjectif de jugement ou d'appréciation : Cette hypothèse est fausse (= Je
nie que telle ou telle chose soit) ; Ce fruit est délicieux (= J'ai du plaisir à le
manger). Un cas plus délicat est celui où l'adjectif cumule les significations
de qualité objective et d'appréciation subjective : Ce sermon est monotone
(= Je m'ennuie à écouter ce sermon parce qu'il est uniforme).
La modalité peut encore être logée dans le dictum sous la forme d'un
adverbe : Le train a certainement du retard ( — Il est certain ; on est, je suis
certain…) ; Vous arrivez malheureusement trop tard (= Je regrette que…).
48. Nous en venons à la forme la plus usuelle de la modalité, celle où elle
est incorporée non seulement dans le dictum, mais dans la caractéristique
modale du verbe dictal (indicatif, impératif, conditionnel ; le subjonctif n'a
pas de valeur modale autonome, v. 51) : Il pleut = « Je constate qu'il pleut » ;
Sortez ! = « Je veux que vous sortiez » ; Vous seriez heureux (si vous vous contentiez
de peu) = « Je me représente en imagination votre bonheur ». Sans
compter les nombreuses formes dérivées et figurées du mode : Cet étourdi
aura manqué son train = « Il est probable, je suppose qu'il a … » ; Tu aimeras
ton prochain = « Dieu ordonne que… ».
49. A partir de là, nous ne trouvons que des phrases dépourvues de tout
verbe conjugué. On peut encore y distinguer deux termes, comme dans :
Vous ici ? (= Je suis étonné de vous rencontrer ici), et A bas les anarchistes !
(= Nous voulons qu'il n'y ait plus d'anarchistes). Enfin l'énoncé ne présente
plus qu'une seule unité ; ces monorèmes 115 consistent tantôt en mots ou locutions
46stéréotypés, dont la plupart ont un caractère exclamatif ou sont des
exclamations proprement dites : Que voulez-vous ? — Pas possible. — Allons
donc ! — Sapristi ! — Bah !, etc. (40).
Quant aux phrases énoncées par des gestes et des jeux de physionomie,
nous ne les signalons que pour rappeler que la mimique, qui peut se suffire à
elle-même (qu'on pense au poing fermé, au haussement d'épaules, aux
gestes d'appel, etc.), intéresse le linguiste surtout parce qu'elle peut doubler
les paroles et la musique ; p. ex. en prononçant A quoi bon ! (= Tout est
inutile) avec la mélodie appropriée, on peut hausser les épaules et prendre
un air découragé.
50. On comprend mieux maintenant pourquoi les éléments extra-articulatoires
interviennent d'autant plus abondamment et avec une importance
croissante à mesure que l'expression par les mots est implicite et insuffisante.
Ce sont eux qui, malgré les apparences, font des énoncés les plus
pauvres des phrases complètes, et explicites.
Parmi ces procédés, c'est la mélodie qui a la première place. En effet,
toute phrase est prononcée avec une intonation autonome qui correspond à
la nature de la pensée. La mélodie n'est jamais absente, bien que son caractère
de nécessité soit d'autant moins apparent que l'énoncé proprement
lexical est suffisant pour la compréhension. C'est ainsi que dans le type le
plus analytique défini en tête de cet exposé (J'affirme que la terre tourne,
Je suis étonné qu'on ne me comprenne pas, Je veux que vous sortiez, Je
vous demande si la pluie a cessé) le sens est le même quelle que soit l'intonation.
Il n'en est pas moins vrai qu'une mélodie chantée à faux paraît
choquante dans ces phrases.
Le caractère autonome et nécessaire des mélodies de phrases apparaît
d'autant mieux qu'on part des formes brèves et implicites pour remonter
aux formes plus étoffées. On constate alors qu'une inflexion de voix caractéristique
de tel ou tel monorème, de telle ou telle exclamation, se retrouve
dans les formes de plus en plus amples pourvu qu'elles fassent la même impression
(que leur modalité soit identique).
Le ton sur lequel est prononcé un Non ! très sec, marquant une interdiction
formelle, se retrouvera dans toutes les expressions qui auront cette
signification et cette valeur expressive : Absolument pas ! Je vous le défends !
Je ne veux pas ! etc.
Nous pouvons donc, en terminant, compléter notre définition de la
phrase : si celle-ci est, comme il a été dit, l'expression d'une pensée, c'est-àdire
47d'une réaction subjective à une représentation, cette réaction a pour
corrélatif sensoriel une mélodie qui lui correspond exactement.
Dictum et modalité
51. On peut s'étonner que, dans la phrase à modalité explicite, le verbe
dictal comporte un mode, puisque c'est au verbe modal qu'est dévolue la
fonction d'exprimer la modalité. Il est certain que des expressions telles que
« Je crois être innocent » et lat. « Credo me insontem esse », ou « J'affirme mon
innocence », sont plus logiques, puisque ni l'infinitif ni le substantif n'ont
de valeur modale. Le mode du dictum fait double emploi avec celui du modus.
Pourquoi ?
C'est une survivance de l'époque, différente selon les cas, où l'énonciation
explicite avait encore la forme de deux coordonnées ; cet état remonte parfois
très haut, et si nous l'éclairons par des tours français et latins, c'est pour
la commodité de l'explication. Ainsi « Je crains qu'il ne soit coupable » a
signifié autrefois « J'ai peur ! Oh ! Qu'il ne soit (pas) coupable ! ». Le subjonctif
avait sa pleine valeur modale, puisqu'il exprimait le désir dans une phrase
autonome. C'est seulement après la soudure des deux énoncés que, comme
la négation ne, le subjonctif est devenu inutile — ou, plus exactement, a été
interprété comme symbole de la transposition d'une phrase indépendante en
terme d'une phrase dont le verbe modal exprime l'idée de crainte. On sait
que lat. « Dubito num insons sit » s'explique aussi par une coordination primitive
(= Je doute : est-ce qu'il serait innocent ?) La même explication est
plus difficile pour « J'affirme qu'il est innocent » ou plutôt pour le bas-latin
« Affirmo quod (quia ou quid) est insons », mais elle ne fait pas de doute ; là
aussi, est a été une fois le verbe d'une phrase indépendante où l'indicatif
avait sa pleine raison d'être (cf. E. Lerch, Syntax, I, p. 140 ss.)
52. Le français et la plupart des langues du même type présentent une
exception remarquable à cet état de choses. Il s'agit du conditionnel 116.
Qu'on le fasse figurer a) dans une phrase à modalité implicite comme :
« Vous seriez heureux si vous vous contentiez de peu », ou b) dans des explicites
telles que : « Je pense (je pensais, je persisterai à penser) que vous seriez
heureux si vous vous contentiez de peu », la valeur modale éclate dans toutes
48les formes du dictum de b) aussi bien que dans la phrase indépendante a).
Nous ne sommes donc pas ici devant une survivance et un pléonasme.
53. Ce cas spécial s'explique, semble-t-il, par la nature très particulière du
conditionnel : sans doute, il n'est pas le seul moyen de présenter un procès
comme lié à une condition, ce n'est pas là ce qui lui appartient en propre,
car on trouve ce rapport de condition et de conditionné à l'indicatif : « Si on
insiste, il cède (toujours) ; Si on insiste, il cédera ; Si on insistait, il cédait ».
Mais le propre du conditionnel, c'est d'abord d'imaginer un procès, dont la
réalisation dépendrait d'une condition également imaginaire : c'est une
simple supposition, une pure création de l'esprit. Le conditionnel est le
mode de la potentialité 117. Au contraire, les formes de l'indicatif mentionnées
plus haut posent que c'est la réalisation ou la non-réalisation effective du
procès qui dépend d'une condition. En outre, ces mêmes formes ne sont pas
indissolublement associées à une condition ; rien n'empêche de dire simplement :
« Il cède, il cédera, il cédait ». Or le conditionnel, lui, est inconcevable
sans l'énoncé de la condition : « Vous seriez heureux » est une phrase incomplète,
à moins que la condition ne puisse être rétablie à l'aide de la situation
ou du contexte 218.
54. C'est, selon nous, ce double caractère très spécial du conditionnel qui,
joint à sa vitalité (c'est le plus récent des modes du français), justifie son
maintien dans le dictum. En effet, la totalité des verbes modaux de la première
classe désignent des constatations ou des jugements de réalité ou
d'irréalité (s'apercevoir, savoir, affirmer, prétendre, croire, nier, contester,
douter), et non des hypothèses imaginaires. Seuls le verbe supposer et ses
équivalents (poser, imaginer, admettre), suivis du subjonctif, semblent faire
exception : or ils ne peuvent jamais former une phrase autonome ; ils équivalent
49toujours à une phrase commençant par si et introduisant une condition,
non une constatation ou un jugement. Exemples : « Je suppose (supposons,
etc.) qu'il pleuve demain : (que ferions-nous ?) » = S'il pleuvait, … ;
« Admettons que la terre cesse de tourner : (que se passerait-il ?) » = Si la
terre cessait…
Dès que ces verbes sont accompagnés de l'indicatif, ils désignent des constatations
et des jugements proprement dits.
Procédés de communication
55. Puisque le langage sert à communiquer 119 la pensée, il faut s'attendre
à ce qu'il marque ce caractère primordial par des procédés appropriés,
qu'on appelle procédés déclaratifs. Ces procédés existent, mais ils se dérobent
à un examen superficiel : comme les signes modaux, ils ont des formes soit
indirectes, soit implicites. Si la phrase La terre tourne signifie logiquement
« Je vous fais savoir (communication) que je suis convaincu (modalité) que
la terre tourne », on ne s'étonnera pas que l'on ne trouve presque jamais
d'expressions chargées de cette double et pesante armature.
56. Tout d'abord cet appareil est superflu quand le sujet exprime sa
propre pensée ou est censé le faire (31). La situation l'indique le plus souvent,
et de plus la parole est un déictique général (125), qui identifie l'expression
à la pensée du parleur. Il suffit de dire « Il pleut » pour que l'entendeur
comprenne qu'il s'agit d'une constatation faite par le parleur. Mais des
formes plus explicites peuvent apparaître, p. ex. en cas de contestation :
« Je vous dis, moi, qu'il pleut ! » Ce qui est plus ou moins insolite dans ce cas
est au contraire normal lorsque le sujet modal est différent du sujet parlant.
Alors qu'il est naturel qu'on dise simplement Je suis malade quand on parle
de soi-même, il est naturel aussi qu'on fasse usage d'un verbe déclaratif
dans des tours tels que : Paul dit : je suis malade (ou : Paul dit qu'il est malade).
C'est toute la raison d'être de la syntaxe particulière du style direct
et du style indirect. Cependant, même dans ce cas, la situation permet l'économie
de procédés déclaratifs. La communication est implicite, parce que
la modalité l'est aussi. Qu'on se rappelle les exemples cités aux § 46, 48
(Il est défendu de fumer, Tu ne tueras point). Ainsi, de même qu'il y a un
« style direct » explicite (L'administration déclare : « Il est défendu de fumer »),
50il y a un style direct implicite ou libre ; si une servante annonce à sa maîtresse :
« Un monsieur désire parler à Madame », elle reproduit les paroles du
visiteur : « Je désire parler à Madame ».
57. Dans la phrase explicite, il est intéressant de déterminer la nature
du verbe dont le dictum est le complément d'objet. Tantôt il est déclaratif
et implique la modalité : « Galilée dit que la terre tourne » ; tantôt c'est un
verbe modal qui sous-entend la déclaration : « Galilée croit que la terre
tourne » ; tantôt enfin le verbe cumule les fonctions modale et déclarative :
ainsi affirmer signifie « dire qu'on croit », se plaindre (d'être oublié) « dire
qu'on est mécontent », louer « dire qu'on approuve » ; promettre, jurer, c'est
« dire qu'on s'engage à qch. », dire que + subj. « dire qu'on veut que », etc.
Dans certains cas, les idées sont si bien fondues ensemble qu'on ne saurait
dire si les verbes sont déclaratifs ou modaux : contester, convenir, refuser, etc.
C'est la raison pour laquelle la grammaire distingue et, en même temps,
traite conjointement les verba sentiendi et les verba dicendi 120.
58. Deux cas sont particulièrement importants : l'interrogation et l'ordre.
En effet, soit qu'on ordonne (ou prie, supplie, etc.), soit qu'on interroge,
on prend l'entendeur directement à partie, et dans la plupart des cas la
forme linguistique marque qu'on s'adresse à lui. C'est pourquoi le cumul
des deux fonctions se reflète ici dans la forme, quelle qu'elle soit : « Est-ce
qu'il pleut ? » signifie « Je vous demande s'il pleut » ; la syntaxe de la phrase
interrogative aussi bien que le verbe demander comportent ces deux idées :
désir de savoir quelque chose par quelqu'un, et communication de ce désir.
Il en est de même de l'ordre ; qu'on s'exprime analytiquement : « Je
vous demande, prie, ordonne, etc. de venir ici », ou synthétiquement : « Venez
ici ! », soit les verbes du type ordonner soit l'impératif renferment les idées
de volonté et de communication.
59. La communication emploie aussi des adjuvants ; nous désignons par
ce terme des procédés externes qui permettent de signifier clairement à
l'interlocuteur qu'on s'adresse à lui. On peut citer au premier rang le
vocatif. A quoi sert cette forme, sinon à communiquer ? « Paul, sortez ! »
signifie « Je vous fais savoir, à vous Paul, que je veux que vous sortiez ».
51Paul ! équivaut à la formule moliéresque « C'est à vous que ce discours
s'adresse ». Cela est si vrai que le vocatif a été primitivement une phrase
autonome à un membre ; le motif de la communication, c'est-à-dire l'énonciation
proprement dite, pouvait, et peut encore, être impliquée tout
entière dans la situation et n'être suggérée que par l'intonation et la
mimique. Cet état de choses est encore parfaitement vivant ; le simple
vocatif Paul ! pourra signifier selon les cas : « Paul, viens ici ! Paul, je te
défends de faire cela ! — Paul, je te plains bien ! — etc. » C'est seulement par
l'adjonction de l'énoncé proprement dit que le vocatif est devenu un élément
de phrase, sans jamais perdre complètement son indépendance (indiquée
par la pause qui le sépare du reste de la phrase).
Les interjections du type Pst ! Holà ! (40) ont la même fonction que
le vocatif dans le langage familier, et le remplacent surtout quand on ne
connaît pas le nom de la personne à qui l'on s'adresse. Ainsi p. ex. Hé !
Vous là-bas !
60. La communication a encore d'autres formes explicites : ce sont les
multiples procédés par lesquels on éveille ou soutient l'attention de l'interlocuteur :
« Ecoutez, je voudrais vous demander un service. » — « Tenez, vous
m'ennuyez. » — « Dites donc, est-ce que vous vous moquez de moi ? » etc.
(v. Bally, Traité, II, p. 208 ss.). Le datif éthique a la même fonction :
« Il vous a des airs de grand seigneur ».
On citera aussi les expressions qu'on a appelées « présentatives » (Brunot,
P. L., p. 81), p. ex. : « Voici (voilà) ce qui est arrivé ». D'une façon plus
générale, tous les signes appelés déictiques (125) n'ont pas d'autre fonction
que de communiquer à l'entendeur tout ou partie d'une pensée : « Regardez
ceci ! » équivaut à « ce que je vous signale » (un objet, une scène, etc.) ;
« Allez là-bas ! » = « à l'endroit que je vous montre. »52
Chapitre II
Trois formes caractéristiques
d'énonciation :
phrase coordonnée, phrase segmentée,
phrase liée
Introduction : monorème et dirème
61. Nous avons vu dans ce qui précède que l'énonciation est implicite
ou explicite à des degrés variables, et que ces variations sont déterminées
soit par des motifs psychologiques, soit par les données de la situation,
c-à-d. les circonstances où se trouvent les parleurs.
La pensée qu'on veut faire connaître est — nous le répétons, cf. 32 — le
but, la fin de l'énoncé, ce qu'on se propose, en un mot : le propos ; on
l'énonce à l'occasion d'une autre chose qui en forme la base, le substrat,
le motif : c'est le thème. On peut figurer le thème par A et le propos par Z.
Ainsi un sentiment d'admiration peut être le but de la communication ;
mais cette admiration doit avoir une cause : il ne suffit pas de dire Magnifique !,
il faut que l'on sache ce qu'on trouve magnifique.
62. Dans le langage courant, le terme Z peut figurer seul dans la parole,
au moins en apparence. Cet abrègement résulte à la fois de la tendance
au moindre effort et de l'affectivité, qui a pour effet de bloquer la pensée.
Nous avons appelé monorème (49) une phrase à un seul terme articulé
(Magnifique !, A la porte !). Mais on peut appeler aussi monorème dans
le sens large toute expression complexe où l'on ne distingue que Z et où
le terme A doit être suppléé, comme lorsque Richard III s'écrie « Mon
royaume pour un cheval ! » ou qu'un sans-culotte chante « Les aristocrates
à la lanterne ! » On a vu (40) que les interjections sont des monorèmes d'une
espèce particulière.
63. Mais dans une langue dûment constituée, il n'y a pas de monorèmes
absolus, ni psychologiquement, ni linguistiquement.
1) Les éléments fournis par la situation ou le contexte sont impliqués
dans l'énoncé, et sans eux celui-ci serait simplement absurde. Dans l'exemple
« A la porte ! », la présence du perturbateur suffit pour que l'interprétation
spontanée soit « Je veux que vous sortiez ».
Les circonstances extérieures qui déclenchent une phrase monorème
peuvent être aperçues obscurément, être même tout à fait subconscientes ;
53mais il y a un abîme entre ce que l'on pense imparfaitement et ce qu'on
ne pense pas du tout. On peut s'écrier « Quelle horreur ! » à propos d'un
ensemble indéterminé de faits qu'on aurait peut-être de la peine à définir ;
mais personne ne songera à dire « Quelle horreur ! » sans aucun motif.
D'autre part, celui qui entend cette expression peut en ignorer la raison ;
pourtant, il n'imaginera pas un seul instant que cette cause n'existe pas.
64. C'est parce que le monorème est l'exposant d'une pensée logiquement
complète qu'il peut en reproduire n'importe quelle partie, pourvu
que celle-ci soit au centre de l'intérêt et constitue le propos. Dans le langage
embryonnaire, il exprime soit le phénomène qui forme la matière du
dictum, soit le sentiment ou la volition qui est à la base du modus. C'est
la raison d'être, dans le premier cas, des onomatopées (frrrt, boum, paf,
tic-tac, etc.), et dans le second des exclamations (ah ! oh ! bah ! fi ! pouah !
cf. 40). Dans une situation donnée, l'onomatopée boum signifiera « Je constate
avec surprise que cette assiette vient de tomber ! » (la surprise est
rendue par l'intonation). Si l'on apprend qu'un alpiniste est monté sans
guide au Mont-Blanc, et qu'on dise Bah !, cette exclamation signifie « Je
suis grandement étonné que cet alpiniste soit monté sans guide au MontBlanc »,
et ainsi de suite. Le monorème est comme un projecteur qui peut
éclairer n'importe quelle partie de l'énonciation logique.
65. 2) Linguistiquement, il n'y a pas non plus de monorèmes purs,
parce que les articulations qui les composent ne sont qu'une partie de leur
substance. Un geste poli désignant une chaise (geste parfaitement conventionnel
et fixé par l'usage) est aussi clair que « Je vous prie de vous asseoir
sur cette chaise ». Bien plus, le monorème Ici !, qui peut avoir la même
signification, est incompréhensible si aucun geste ne l'accompagne (41).
Pour ne parler que de l'intonation, ou mélodie, c'est elle qui fixe dans la
plupart des cas la modalité du monorème (50), c'est elle qui en fait une
phrase. Ainsi « Un éclair ! » est prononcé avec une intonation qui vaut un
indicatif « Je vois un éclair » ; celle de « A la porte ! » équivaut à un impératif,
celle de « Du blanc ou du rouge ? » indique une interrogation ; sans compter
toutes les nuances émotives (étonnement, colère, etc.) qui peuvent accompagner
la tonalité modale fondamentale.
66. Comment a-t-on passé du monorème à la phrase complexe, et tout
d'abord à la phrase à deux membres ou dirème, celle qui unit en un tout
explicite le thème et le propos (formule AZ ou ZA) ? Evidemment par la
54condensation de deux monorèmes en une énonciation unique (v. Sechehaye,
Structure, p. 19 ss.). Mais ce changement doit avoir une cause ; celle-ci
réside dans l'analogie. Le modèle du monorème s'est appliqué sur un
ensemble plus complexe et l'a amené à se resserrer. En outre, il est naturel
que ce resserrement présente des degrés divers.
Dans le vaste champ de la syntaxe, que le présent ouvrage ne tente
pas de survoler dans toute son étendue, nous détachons trois types d'énonciation
qui ont ce caractère commun de lier deux termes par un rapport
grammatical, et ce caractère différentiel de donner à ce rapport une rigidité
croissante : coordination, segmentation et soudure.
67. Pour donner une première idée de ces trois syntaxes, faisons appel
à un langage embryonnaire et enfantin, où un monorème coucou désignerait
quelque chose qui fait « coucou », par exemple un oiseau, et un autre mot-phrase
frrt, un bruit léger, par exemple celui d'un oiseau qui prend son
vol. Dans la parole, coucou ! pourra signifier « Je vois un oiseau, il y a un
oiseau là », et frrt « J'entends un bruit d'ailes ». L'une et l'autre phrase
peuvent être prononcées séparément, dans des circonstances différentes.
Mais il se peut qu'un même individu constate d'abord la présence d'un
oiseau, et qu'ensuite il le voie s'envoler. Dans sa parole, cette succession
sera marquée sous la forme Coucou ! — Frrt !, où les deux monorèmes,
séparés par une pause appréciable, auront chacun une intonation autonome.
L'analyse de ce petit système serait : « Quelque chose fait coucou, et (ce
qui fait coucou) fait frrt », ou, dans un langage moins primitif « Il y a là
un oiseau et (cet oiseau) s'envole ». C'est ce rapport-là que nous appelons
coordination 121.
Cette succession de deux monorèmes peut subir un premier resserrement
lorsque, par analogie avec le monorème unique, les deux termes sont
conçus comme appartenant à un seul et même énoncé, bien qu'ils soient
encore séparés par une pause médiane, généralement plus brève ; le schéma
Coucou, frrt s'interprète alors à peu près ainsi : « Cet oiseau, il s'envole » ;
le premier terme est le thème de l'énoncé, le second le but de l'énonciation,
le propos. Telle est la phrase que nous appellerons segmentée.
Si enfin, toujours par analogie avec le monorème, l'unification des deux
termes est complète, on peut parler de « soudure » ; la phrase est liée et
55correspond au type à sujet et prédicat grammaticaux : « Cet oiseau s'envole ».
Avant de passer à la description de chacun de ces types, prévenons le
malentendu qui consisterait à croire que la coordination précède nécessairement
la segmentation, et celle-ci la soudure : ces formations sont autonomes ;
nous verrons qu'une phrase liée peut prendre la forme d'une
segmentée et même celle de deux coordonnées.
Coordination
68. Deux phrases sont coordonnées (formule C1 C2) quand la seconde a
pour thème la première.
Tout langage spontané présente des coordonnées analogues à notre
exemple initial. Tandis que je marche, ma canne se casse, et j'exprime
émotivement la chose en disant Crac !, puis mon dépit par l'exclamation
Oh ! L'ensemble Crac !Oh ! signifie à peu près : « Ma canne est cassée ! Quel
contretemps ! » ; plus exactement : « Ma canne est cassée (et le fait qu'elle
est cassée) me cause du dépit. »
Mais les coordonnées de la langue usuelle sont régies par le même mécanisme :
« Il gèle. Nous ne sortirons pas », équivaut à : « Il gèle (et, à propos
du fait qu'il gèle, j'ajoute :) Nous ne sortirons pas ». L'ordre inverse obéit
à la même règle : « Nous ne sortirons pas (et j'ajoute à cela :) Il gèle ». Le
plus souvent, un rapport logique existe entre les deux phrases sans qu'il
apparaisse dans l'énoncé : « Nous ne sortirons pas (et la cause de ce fait,
c'est qu') il gèle ». Ou inversement : « Il gèle (et la conséquence de ce fait
est que) Nous ne sortirons pas ». Il y a équilibre parfait dans l'attitude
psychologique des deux coordonnées. (Cf. dans le Vase brisé de Sully-Prudhomme :
« N'y touchez pas, il est brisé » et la reprise : « Il est brisé,
n'y touchez pas »).
69. Dans tous ces cas, la coordination reprend la première phrase dans
la seconde par sous-entente, c'est-à-dire par ellipse (245). En effet, cette
reprise peut être explicite : « Il pleut ». « Puisqu'il pleut, nous ne sortirons
pas ». Le thème peut être représenté par un exposant : « Il pleut, à cause de
cela 122 (cela = le fait qu'il pleut), nous ne sortirons pas ». Enfin ce représentant
peut être contenu par cumul (225) dans une conjonction coordinative :
56« Il pleut, aussi nous ne sortirons pas » ; aussi = « à cause de cela », cela =
« le fait qu'il pleut ». Nous reviendrons plus bas (94) sur les conjonctions
coordinatives.
70. Une coordonnée peut être introduite par anticipation dans le corps
de la première phrase sous forme d'incise. C'est ainsi que, au lieu de « Vous
avez renoncé à votre projet ; c'est fort heureux », on peut dire « Vous avez
renoncé — c'est fort heureux — à votre projet » ; cf.« Paul est plus fort — du
moins c'est lui qui le dit — que tous les autres élèves de sa classe ».
L'incise coordinative est caractérisée par son intonation autonome, qui
serait la même si elle était une phrase isolée.
L'incise peut être un monorème : « Paul a — malheureusement (ou : hélas !)
— échoué à son examen ». Dans ce cas, le membre intercalé se fond
souvent dans le reste de l'énoncé par la suppression des pauses et de
l'intonation : « Paul a malheureusement échoué à son examen ». C'est ainsi
que peut-être (« Paul a peut-être échoué ») signifiait autrefois « Cela peut être ».
Ce changement s'explique par l'analogie, qui applique sur la phrase à
incise certains « patrons » de phrases liées (100 ss.) ; p. ex., dans la phrase
Paul a — malheureusement — échoué, l'incise a pu être interprétée comme
un simple adverbe de manière. En fait, « Il a malheureusement échoué »
comporte deux interprétations différentes.
71. Il va sans dire que la simple juxtaposition de deux énoncés quelconques
ne suffit pas pour faire de deux phrases des coordonnées, p. ex.
lorsque quelqu'un dit au cours d'un repas : « Paul est arrivé ! Passe-moi
le pain ! » Mais, chose plus importante à noter, les phrases coordonnées,
bien que reliées entre elles, sont grammaticalement indépendantes les unes
des autres. En effet, la première peut être énoncée avant qu'on pense à
la seconde, elle est un tout qui se suffit à lui-même ; d'autre part, la seconde
contient la première par reprise ; elle aussi est autonome. Cette autonomie
des coordonnées apparaît particulièrement bien lorsqu'elles sont réparties
entre deux interlocuteurs. Exemple : A : « Il pleut ». B : « Alors nous ne sortirons
pas ».
C'est ce caractère autonome qui fait que la coordination comporte un
nombre indéterminé de membres, formant des séries ouvertes. Exemple :
« Nous resterons à la maison. Nous ferons du feu. Nous lirons, etc. ». Cf. latin
Veni, vidi, vici.
Aussi la coordination vraie se reconnaît-elle au fait que chacune des
phrases a l'intonation modale autonome et variable d'une phrase indépendante (50),
57de sorte que celle-ci est identique si les phrases sont de même
espèce, p. ex. des phrases énonciatives : « Paul est arrivé. Je l'ai vu. Il est
bien. » La différence qu'on observe p. ex. dans « Paul est arrivé. L'avez-vous
vu ? » tient uniquement à la différence entre énonciation et interrogation.
72. Les coordonnées sont, dans la règle, séparées par une pause ; celle-ci
peut être prolongée à volonté ; un débit rapide peut au contraire l'abréger,
ou même la supprimer. Il peut arriver qu'on prononce d'affilée Paul est
arrivé je l'ai vu. Mais c'est là un cas où la phonologie de la langue s'oppose
à la phonétique de la parole : le parleur a le sentiment que la pause, même
supprimée, est latente et peut être en tout temps rétablie. Inversement, si,
pour quelque raison, des pauses sont introduites dans une phrase liée
(p. ex. Le jour — n'est pas plus pur — que le fond de mon cœur), on sent fort
bien qu'elles sont occasionnelles (de la parole) et que la phrase susdite n'en
comporte aucune au point de vue de la langue 123.
73. La « proposition » relative explicative est en réalité une phrase coordonnée
semblable à celle qui renferme l'antécédent du pronom relatif
(v. Brunot, P. L., p. 27), et cette coordonnée est, le cas échéant, une incise
de la première : comparez « Je hais cet homme, qui a causé ma perte » et
« Cet homme, qui a causé ma perte, ignore la pitié » ; en effet « qui a causé
ma perte » équivaut à « il a causé ma perte ». Le caractère coordinatif de ce
type est marqué 1) par la ou les pauses obligatoires qui l'isolent ; 2) par
la nature de l'intonation, qui introduit une précision ajoutée après coup.
On sait en outre que la relative explicative peut contenir un verbe au
subjonctif (suppléant l'impératif !), ce qui est incompatible avec la subordination :
« Ce scélérat — que la peste fasse crever ! — m'a acculé à la faillite. »
Sur ce dernier point, v. § 242, note.
On voit par là en quoi les relatives de ce type diffèrent radicalement
des relatives déterminatives, qui en sont dérivées par condensation
(« L'homme qui a causé ma perte, etc. »), et qui relèvent de la phrase liée.
74. On peut faire la même distinction entre l'apposition explicative
(« Démosthène, l'orateur grec bien connu ») et l'apposition déterminative,
issue de la précédente (« Démosthène orateur » par opposition à « homme
politique »). L'explicative est au fond une coordonnée monorème : « l'orateur
grec » est intercalé en manière d'explication et signifie « Je veux
58parler de l'orateur grec ». Là aussi, les pauses isolantes et l'intonation
explicative prouvent la coordination.
Même différence encore entre l'épithète explicative et la déterminative.
Dans « L'écolier, attentif, buvait les paroles du maître », attentif = « qui
était attentif », ou « il était attentif ». C'est une coordonnée incidente. Au
contraire, « L'écolier attentif » s'oppose à celui qui ne l'est pas.
75. On remarquera que ces différents types (relatives, appositives,
adjectif prédicatif) sont reliés à leur déterminé par la syntaxe d'accord
(164). Au contraire, l'épexégèse 124 relève de la rection. Il s'agit de l'adjonction
d'un monorème avec valeur prépositionnelle destiné à compléter, à expliquer
après coup la première énonciation. Soit par exemple Venez chez moi
demain, à cinq heures : là, on peut encore parler de deux coordonnées
(= « Venez chez moi demain ; (J'ajoute : Venez) à cinq heures »). On remarquera
la pause interne et l'autonomie relative des mélodies dans les deux
parties de l'énoncé. Au contraire, dans une phrase liée telle que Venez
chez moi demain à cinq heures, tout souvenir de la coordination est effacé ;
ou, si l'on préfère, il s'agit alors d'une épexégèse déterminative.
76. Avant de quitter la coordination, signalons quelques formes syntaxiques
qui en sont des variétés, mais ont des caractères particuliers
tant au point de vue sémantique qu'au point de vue mélodique.
a) C'est d'abord la répétition sous ses différentes formes. Une même
idée ou un même sentiment est exprimé plusieurs fois de suite. C'est alors
la notion commune à tous les éléments, non l'enchaînement de ces éléments
les uns aux autres, qui constitue le lien grammatical qui les réunit. Le
corrélatif de ce caractère, c'est le parallélisme des mélodies : les mélodies-types
peuvent être diverses, mais elles se répètent sans changement d'un
bout à l'autre de la série. Quant à la nature phonique des éléments répétés,
elle peut présenter tous les degrés d'identité ou de ressemblance, et de différence,
pourvu qu'un « dénominateur commun » détermine le rythme des
signifiés et des signifiants. Le cas le plus banal est celui des interjections ;
exemples : « Si tu désobéis, pan, pan, pan !! » (= « tu recevras des coups ») ;
« Quand j'aperçus le lièvre, pif, paf, pouf ! » (=« je tirai plusieurs coups
de fusil »). Puis des monorèmes : « A la porte ! A la porte ! » ; des phrases complètes :
« Venez vite ! Venez vite ! ». La même idée peut être exprimée par
des synonymes : « Venez vite ! Dépêchez-vous ! » Enfin le lien qui unit le
tout n'apparaît souvent que dans une partie de chaque phrase ; c'est la
59raison d'être de la figure appelée anaphore : « C'est toi que j'aime ! C'est
toi que je suivrai ! C'est pour toi que je vivrai ! » L'épiphore est le renversement
de ce tour : « Nous vivrons ensemble, nous souffrirons ensemble, nous
mourrons ensemble ». Le fait qu'il y a gradation d'intensité d'une des
expressions à l'autre ne change pas grand'chose à ce type : « C'est laid !
C'est hideux ! C'est répugnant ! ».
En résumé, partout communauté d'un élément sémantique et succession
de mélodies autonomes identiques.
77. b) L'énumération se distingue à peine de la répétition ; les objets
énumérés sont groupés autour d'une catégorie commune (qui peut d'ailleurs
être assez vague) ; le rythme est, là aussi, caractérisé par le parallélisme
des mélodies : « Voici le roi ! Voici la reine ! Voici les ministres ! »
Les caractères de l'énumération se retrouvent dans les formes qui en
dérivent et qui sont réductibles à des séries de phrases juxtaposées, le
plus souvent sous forme de monorèmes. Ainsi dans « Les hommes, les
femmes, (et) les enfants (furent massacrés) », on peut remonter à « Les
hommes ! Les femmes ! Les enfants ! » (c'est-à-dire : « Voici les hommes !
Voici les femmes ! etc. »). Cf. : « Ces enfants sont intelligents, dociles et travailleurs ».
Dans « Un soir, vers sept heures, alors que les bruits de la ville
s'assoupissaient », on relève une série de trois membres parallèles dont
chacun pourrait avoir la forme d'une phrase. Dans « Hommes, femmes,
enfants (tout fut massacré) », la série énumérative forme un composé collectif
ou copulatif (146), de même que dans « un drapeau rouge, blanc,
bleu ». D'une façon générale, toute série d'éléments énumérés forme un
seul terme à l'intérieur d'un syntagme.
78. c) L'opposition antithétique se distingue nettement des cas précédents ;
il s'agit de deux expressions désignant des idées du même genre,
mais appartenant à deux espèces extrêmes ou suffisamment distantes, et
qui, de ce fait, s'opposent en se faisant pendant ; la mélodie présente le
schéma image / \ : elle monte sur le premier terme et descend sur le second.
Exemples : « Ou tu obéiras, ou tu seras puni » ; « Plus je vous connais, plus
je vous aime » ; « Tel maître, tel valet ». On se gardera de confondre la mélodie
image / \ avec celle de la segmentée AZ (voir plus loin 82).
Phrase segmentée
79. Nous appelons phrase segmentée une phrase unique issue de la condensation
de deux coordonnées, mais où la soudure est imparfaite et permet
60de distinguer deux parties dont l'une (A) a la fonction de thème de l'énoncé,
et l'autre (Z) celle de propos (67).
Une suite de phrases comme « Plus de joies, plus de chansons » peut être
une simple énumération, et toute énumération est de nature coordinative.
Mais si l'on aperçoit un rapport entre la première phrase et la seconde
(par exemple un rapport de cause à effet), le resserrement peut intervenir,
et « Plus de joie, plus de chansons » forme une seule phrase, synonyme de
« Puisqu'il n'y a plus de joie, il n'y a plus de chansons ».
Il semble que la phrase segmentée soit née, dans la coordination, de la
reprise explicite de la première coordonnée : « Il pleut. Il pleut ? Nous ne
sortirons pas ». Cela paraît encore plus vraisemblable si l'on suppose ces
énonciations réparties entre deux interlocuteurs : A : « Il pleut ! » — B : « II
pleut ? (= Vous dites qu'il pleut ?). Nous ne sortirons pas. » Alors on comprend
mieux que la reprise faite par B ait pu, à la longue, créer un type
nouveau par oubli de la phrase C1.
Sans poursuivre plus loin ces vues sur l'origine du type, qui seront reprises
plus bas, voyons quelles formes cette syntaxe a prises dans le français
actuel, qui en fait un large usage.
A cet effet, opposons la segmentation à la syntaxe liée, et comparons
p. ex. « Cette lettre, elle ne m'est jamais parvenue » et « Cette lettre ne
m'est jamais parvenue ». Nous surprendrons deux différences principales,
l'une relative à la fonction, l'autre à la forme.
80. 1) La segmentation permet de faire de n'importe quelle partie d'une
phrase ordinaire le thème, et de l'autre l'énoncé proprement dit, le propos ;
ainsi « Je n'arrive pas à résoudre ce problème » devient « Moi, je n'arrive
pas à résoudre ce problème », ou « Résoudre ce problème, je n'y arrive pas »,
ou « Ce problème, je n'arrive pas à le résoudre ». Alors le thème précède et
le propos suit ; mais l'ordre peut être renversé : « Je n'arrive pas à résoudre
ce problème, moi », ou « Je n'y arrive pas, à résoudre ce problème », ou
« Je n'arrive pas à le résoudre, ce problème ».
81. 2) Comme la coordination, la segmentation est caractérisée avant
tout par le jeu des deux procédés musicaux sans lesquels elle n'est pas
concevable : la pause médiane et la mélodie 125.61
On constate sans peine que, dans la phrase segmentée, A et Z sont
séparés par un silence, si court soit-il, tandis que dans des phrases liées
comme : « Le soleil éclaire la terre — Je vous punirai si vous désobéissez,
etc. », les pauses que peuvent découvrir les appareils n'ont aucune réalité
pour le sujet parlant.
82. Les inflexions de la voix sont, elles aussi, partie intégrante de la
syntaxe segmentée, car non seulement elles séparent nettement les deux
termes, mais surtout elles permettent de distinguer clairement les deux
types AZ et ZA.
Z a l'intonation modale de toute phrase indépendante, intonation autonome,
et qui comporte des variétés infinies ; dans la forme la plus banale,
la voix monte légèrement pour redescendre ensuite un peu (figure image).
Le terme A comporte, au contraire, deux intonations stéréotypées très
différentes l'une de l'autre, et toutes deux dépendantes de Z, à savoir :
une forte montée de la voix dans AZ, tandis que dans ZA A est prononcé
sur un ton bas et comme en sourdine. On peut représenter grossièrement AZ
par image et ZA par image ; l'intervalle entre les deux traits symbolise
la pause.
83. La montée de la voix dans AZ s'explique, comme on l'a vu, par le
fait que le thème est une sorte de question, dont le propos est la réponse.
Tantôt il s'agit d'une question qui serait posée par le partenaire et reprise
par le parleur, comme en témoigne la forme de l'interrogation : Où il est ?
Personne ne le sait. = « (Vous demandez) où il est ? » ; tantôt c'est une
question que le parleur s'adresse à lui-même : Où est-il ? Personne ne le sait.
Dans le second cas, l'intonation propre à l'interrogation a été remplacée
par la montée uniforme qui est caractéristique du premier type ; car Où
est-il ?, prononcé avec la mélodie descendante d'une interrogation réelle,
ne pourrait être qu'une phrase autonome, à laquelle la réponse serait coordonnée.
Pour l'interrogation modale totale (35, 2a), la différence entre
l'intonation de l'interrogation réelle et celle d'un segment A est moins
sensible, puisque la mélodie monte dans les deux cas (Viendra-t-il ? et
Viendra-t-il ? Personne ne le sait.) ; cependant, elle est autonome et monte
plus haut dans une interrogation réelle que dans le segment A, où elle est
plus ou moins figée.
84. Quant à la mélodie basse de A dans ZA, (exemple : cet élève a échoué,
à son examen), elle dérive de son caractère originel ; car A procède, dans
ce cas, d'une coordonnée explicative qui précisait après coup le sens de
62la phrase précédente (75). Cette coordonnée avait la mélodie propre à la
coordination, c'est-à-dire autonome, mais la segmentée a perdu ce caractère :
elle ne constitue plus une simple adjonction, mais est un thème retardé,
et ce changement se marque dans la mélodie (intonation en sourdine, sans
analogie avec celle de la coordination).
Comparez la mélodie des deux types, qui peuvent figurer dans un même
énoncé : « C'est bon pour l'âne ou pour le bœuf (Z), de brouter dans un
clos (A) ! Les chèvres (A), il leur faut du large (Z) ! » (Daudet).
85. La phrase segmentée comporte des formes complexes ; p. ex. A peut
comprendre plusieurs segments : « Moi, accepter ce compromis, (A), vous
n'y pensez pas ! (Z) ! ». « Il l'aimait tant (Z), son enfant, ce brave homme (A) ».
« Moi, je les adore, les enfants » est une segmentée ZA où Z contient lui-même
une segmentée az, formule image La segmentée peut figurer dans une
proposition subordonnée, p. ex. « (Voyons si), à force de réclamer, nous
obtiendrons gain de cause » (AZ).
86. Comme la coordination, la segmentation connaît des formes à incise ;
d'une part, la branche A d'une segmentée AZ peut figurer, par retardement,
dans le corps de Z ; mais sa mélodie montante révèle son vrai caractère ;
comparez « Soudain, un obus éclata » et « Un obus, soudain, éclata ».
D'autre part, le terme A d'une phrase ZA peut figurer, par anticipation,
dans l'intérieur de Z ; là encore, l'intonation descendante montre la véritable
valeur du terme intercalé. Le cas le plus typique est celui du vocatif :
destiné à attirer l'attention de l'entendeur sur l'énonciation qui va lui être
communiquée, le vocatif fonctionne comme un thème général sur lequel
repose l'énoncé proprement dit dans sa totalité. Les jeux mélodiques de
« Paul, viens ici ! » (AZ) et de « Viens ici, Paul ! » (ZA) sont donc parfaitement
naturels. Mais le vocatif peut être intercalé dans Z par anticipation,
et dans ce cas il a, comme on doit s'y attendre, l'intonation en sourdine,
p. ex. dans « Viens, Paul, auprès de moi. » Autre cas connu : les phrases
parenthétiques telles que dit-il, pensai-je, etc., appartiennent toujours à
la syntaxe ZA, comme l'indique leur intonation sourde : « Je vous pardonne,
dit-il » ; or, cette intonation sera la même en incise : « Je consens, dit-il, à
vous pardonner ».
87. La mélodie permet de distinguer nettement des types de phrases qui,
sur le papier, se confondent. Soit notre exemple Cet élève a échoué, à son
examen : si les deux membres ont des mélodies parallèles, à son examen signifie
63« (et il a échoué) à son examen » ; nous sommes ici dans la coordination
explicative (75). Au contraire, avec le schéma mélodique image, à son
examen est le thème (postposé) d'une segmentée ZA, et n'a plus le caractère
d'une adjonction. Enfin l'absence de pause et de mélodies oppositives fait
de cette même phrase une phrase « liée » (104), où, comme nous le verrons, on ne
peut plus distinguer le thème et le propos (sinon par le contexte et la situation).
88. L'exemple précédent montre l'importance, primordiale en syntaxe,
de la mélodie : c'est ainsi que dans la langue parlée une phrase liée peut
devenir segmentée par simple application de la musique de segmentation.
« Je savais bien que vous viendriez » est lié si la mélodie est uniforme et la
pause absente ; mais la même phrase « Je savais bien, que vous viendriez »
devient ZA si elle comporte une pause médiane et un second segment prononcé
en sourdine.
Le jeu de la mélodie suffit aussi à transformer une subordonnée en principale,
et inversement. « Nous étions au jardin lorsque l'orage éclata » est
une phrase liée contenant une principale et une subordonnée ; mais prononcez-la
en AZ, elle équivaudra à « Alors que nous étions au jardin (A), un
orage éclata (Z). » De même : « Nous étions à peine rentrés, que l'orage éclata »
signifie en réalité « Un peu après que nous étions rentrés (A), l'orage éclata
(Z) » ; là aussi, la succession des propositions est l'inverse de ce que fait prévoir
la forme matérielle, et seule la mélodie décide de l'interprétation ;
voyez encore « Vous me menaceriez (A), que je ne céderais pas (Z) ».
Il suffit encore que deux phrases présentant le schéma que nous avons
appelé antithétique (78) soient intonées en AZ pour que l'interprétation
syntaxique soit modifiée : Tu te reposes, je travaille peut être l'équivalent
de « Tandis que tu te reposes, je travaille » ; Je le croyais sain et sauf : il courait
le plus grand des dangers (= « Alors que je le croyais… ») ; Paul n'est pas
seulement paresseux : il est insolent (= « Si Paul est paresseux, il est en outre
insolent ») ; Ou tu obéiras, ou tu seras puni intoné en AZ équivaut à « Si tu
n'obéis pas, tu seras puni. »
Enfin la mélodie sépare complètement de la coordination des formes telles
que A peine le maître était-il sorti, les élèves se mirent à danser ; Il aurait tout
l'or du monde, il ne serait pas content. C'est grâce à la mélodie AZ que Il y a
huit jours, j'ai vu Paul est d'un autre type que « J'ai vu Paul il y a huit
jours » et « Il y a huit jours que je n'ai vu Paul » (phrases liées).
89. La segmentation présente des analogies évidentes avec la coordination :
il suffit de rappeler certains exemples où seule la mélodie permet
64de déterminer le type auquel la phrase appartient. Ainsi, le segment Z
a toujours la forme d'une phrase indépendante, comme ce serait le cas
pour une coordonnée ; détachée de l'ensemble, elle est syntaxiquement et
mélodiquement autonome. Le terme A y est représenté dans la mesure
du possible (ce qui est normal en français lorsque A contient un terme
nominal 126) par des pronoms : « Cet enfant, je l'aime bien » ; « Je ne m'intéresse
pas à cela, moi » ; « Votre argent, je n'en veux pas », etc. Remarquons par
anticipation (94) que toute conjonction de coordination renferme aussi un
pronom.
Mais cette parenté formelle ne doit pas nous faire perdre de vue les différences
essentielles qui séparent la segmentation de la coordination. Elles
apparaissent dans la mélodie (82) et dans la valeur syntaxique du segment A :
celui-ci, surtout en AZ, est un présentatif de l'énoncé contenu dans Z,
qui se distingue d'une coordonnée (autonome !) par le fait qu'il équivaut
toujours à une phrase subordonnée.
Cette dernière peut être explicite : « Quand il pleut, je reste à la maison » « Si
vous désobéissez, vous serez punis », etc. Ou bien on peut la mettre en
lumière par échange fonctionnel : « Il fait froid, nous ne sortirons pas »
(= « Puisqu'il fait froid ») « Par ce moyen, je réussirai » (= « En procédant
ainsi, si je procède ainsi ») ; « Lentement, il avançait sur la route » ( — « En
marchant lentement, pendant qu'il marchait lentement »). Le segment A
peut même avoir la forme d'une phrase autonome : « Tu mens, je ne te crois
pas », mais sa valeur est toujours celle d'une subordonnée (= « Puisque tu
mens »). Enfin, réduit à un simple terme nominal, on pourrait l'interpréter
comme un monorème : « Cet élève, je l'aime bien ; cet élève, je lui ai donné
un livre ; etc. » ; ce cas a été appelé nominativus pendens (cf. W. Havers,
L. F., 43, p.207ss.), mais ce n'est là qu'une étiquette : c'est un cas extrême
où un être ou une chose est présenté comme substrat pur et simple de
l'énoncé contenu dans Z, et il est lui aussi assimilable à une subordonnée
(= « Pour cet élève, quant à cet élève, puisqu'il est question de…, s'il
est question de… », etc.).
90. Ce qui distingue le mieux la segmentée de la coordonnée, c'est l'interdépendance,
le conditionnement réciproque des segments A et Z : on sait
que les propositions « subordonnées » introduites par que équivalent à des
65sujets ou des compléments d'objet, que celles qui commencent par une
conjonction de sens spatial, temporel ou logique sont réductibles à des
compléments circonstanciels, c'est-à-dire à des substantifs à un cas oblique.
A est donc essentiellement nominal, et Z (de forme autonome) essentiellement
verbal, ce qui concorde avec la nature syntaxique du thème et du
propos : le thème est en effet de la nature du sujet, et le propos de celle
du prédicat ; or, c'est le substantif, comme lieu du prédicat, qui est prédestiné
à être sujet, et le verbe à être prédicat, puisque le prédicat désigne
un procès, un état ou une qualité. Il y a donc entre A dans son ensemble
et Z dans son ensemble un rapport de complémentarité.
91. Il ne faut pas croire cependant que A soit une simple inversion,
une simple anticipation d'un élément contenu dans Z, et que le type
Cet élève, je l'aime bien soit une forme de phrase liée. Nous insistons sur
le fait que, même si A ne consiste qu'en un terme nominal, il équivaut
logiquement à une subordonnée dont le terme nominal (Cet élève) n'est
qu'une partie. Si ce terme est représenté à l'intérieur de Z en tant que mot,
cela n'a rien de surprenant : nous savons qu'on peut reprendre dans une
phrase principale n'importe quel terme de la subordonnée qui précède ;
plus généralement, n'importe quelle partie d'un syntagme peut être reprise
dans le syntagme suivant sous forme d'un représentant (126) : cf. « Puisque
Paul nous rend visite, nous l'invitons à dîner » : l' représente le seul terme
Paul, et non pas toute la subordonnée. Or, le conditionnement réciproque
entre A et Z s'entend de l'ensemble de A par rapport à l'ensemble de Z,
et c'est ce qui différencie nettement la phrase segmentée de la phrase liée.
92. La segmentation s'éloigne de la coordination dans la mesure où des
procédés grammaticaux accentuent le caractère nominal de A (1) et marquent
sa relation avec Z (2).
1) Ainsi A peut être caractérisé par certains tours périphrastiques qui
lui enlèvent son apparence d'élément indépendant (v. plus haut : Cet élève,
je l'aime bien = « Pour cet él., quant à… etc. »). Au lieu de Honnête, il l'est
assurément, on dira « Pour honnête, il l'est », ou « Si quelqu'un est honnête,
c'est lui ».
2) La fonction de A peut être marquée par A lui-même, qui cesse alors
d'être un terme de forme autonome. Cette indication anticipée, due à
l'analogie de la phrase liée, a souvent pour conséquence de supprimer le
représentant de A dans Z. Comparez « Moi, on ne me donne rien » et « A moi,
on ne (me) donne rien » ; « Cette affaire, je n'en comprends pas le premier
66mot » et « De cette affaire, je ne comprends pas le premier mot ». On voit
combien ces tours nous rapprochent des inversions simples de la phrase liée.
93. L'histoire montre que la plupart des tours prépositionnels ou conjonctionnels
(cela revient au même) sont nés par condensation de deux coordonnées,
et plusieurs ont conservé la forme segmentée. En grec, ei « si »
a commencé par être une particule optative (cf. eíthe, ei gár). Ainsi
Eí moi peíthoio, tó ken polù kérdion eiē a signifié d'abord « Puisses-tu m'écouter !
Cela vaudrait beaucoup mieux », et ensuite seulement « Si tu m'écoutais… ».
Il est probable qu'en latin qui a d'abord été un indéfini : Quae
pecunia deest, ea sumatur = « Une certaine somme manque ; qu'on l'emprunte » ;
et plus tard seulement « La somme qui manque, qu'on l'emprunte »,
etc. (v. Kretschmer, Sprache, p. 62). D'autres tours, de même origine, ont
versé dans la phrase liée (104).
En français, les constructions « absolues » du type L'ennemi vaincu, l'armée
se retire relèvent de la segmentation ; ce sont des termes A de phrases AZ.
Là aussi, on retrouve une origine coordinative ; on a commencé par dire
« L'ennemi (est) vaincu ; l'armée se retire » ; puis l'analogie de phrases telles
que « maintenant que l'ennemi est vaincu, après la défaite de l'ennemi… »
a opéré un changement d'interprétation en même temps qu'un changement
de mélodie. L'ablatif absolu du latin hoste victo a servi d'adjuvant, surtout
pour la langue écrite ; il n'est pas le point de départ unique du type.
Quant à l'ablatif absolu latin lui-même, on constate qu'il est dû à un
accident exactement opposé : il résulte de la disjonction, par segmentation,
de deux termes cohérents d'un même syntagme. Soit la phrase « Carthagine
deletā Scipio profectus est ». A l'origine, Carthagine deletā était le complément
de profectus est. (« Il partit de Carthage détruite »), et cette interprétation
n'est pas impossible en latin classique même. Mais, séparé de son
verbe par un espace suffisant, ou simplement par une pause, ce membre de
phrase a subi l'analogie de propositions du type « Cum Carthago deleta
esset », et en est devenu l'équivalent. Ainsi le type Carthagine deletā, parti
d'un tout autre point que l'ennemi vaincu, a abouti au même résultat.
94. C'est enfin la segmentation qui rend compte de l'origine et du développement
des conjonctions coordinatives.
Dans une phrase telle que « Il fait froid, à cause de cela nous ne sortirons
pas », le terme à cause de cela a été tout d'abord une détermination (tʼ, cf.
§ 155) du verbe nous ne sortirons pas (t), et, en cette qualité, il ne reliait pas
67la seconde coordonnée à la première. Mais un terme de C2 est prédestiné à
devenir conjonction coordinative lorsqu'il renferme un représentant de C1
tout entier, soit explicitement (p. ex. « Il fait froid ; nous ne sortirons pas à
cause de cela »), soit en cumul ou zéro (p. ex. « Je me suis levé, je suis sorti
ensuite », c'est-à-dire « après cela »). On voit que dans ces cas le terme en
question est un déterminant de tout ou partie de C2 ; mais le représentant
qu'il contient a ce double effet de l'attirer, par une sorte de chiasme, vers le
début de la phrase, et d'en faire le signe de son sujet psychologique. Or, c'est
par segmentation qu'il prend la tête de la phrase : « A cause de cela, nous ne
sortirons pas » est du même type syntaxique que « Depuis hier, il fait moins
froid ». Ce sont des ZA transvalués en AZ ; l'interprétation est dès lors « A
cause de cela (t), nous ne sortirons pas (tʼ) ».
Au fur et à mesure que se relâche le lien qui faisait d'un terme le déterminant
d'un autre à l'intérieur de C2, sa relation avec C1, devient plus étroite ;
dans « Vous travaillez, vous jouerez ensuite » (construction déjà un peu archaïque),
ensuite est encore une détermination (tʼ) de vous jouerez. Dans
« Je me levai, ensuite je sortis », la valeur coordinative du mot apparaît, sans
cependant annuler son sens originel ; mais son déplacement en a fait le
terme A d'une phrase segmentée ; il y a eu transvaluation en t.
Enfin le passage à la fonction nouvelle est accompli quand la conjonction
ne peut plus fonctionner comme complément du verbe de C2 ; si malgré cela
en est encore capable, son synonyme pourtant ne le peut plus. Comparez « Il
pleut, je sors malgré cela ») et « Il pleut, pourtant je sors ». Alors même qu'on
place pourtant après le verbe, où il pourrait être encore tʼ, il ne saurait plus
reprendre cette valeur.
95. Ajoutons cependant qu'une conjonction coordinative peut naître
aussi dans un système de trois coordonnées dont la médiane est comprise
comme reliant les deux autres. Ainsi bien plus est presque une coordinative
dans « Paul a perdu beaucoup d'argent au jeu ; bien plus : il est ruiné ». Le
passage à la nouvelle fonction est consommé dans mais = lat. magis (« il
y a plus »). De même « Je suis resté à la maison. Pourquoi ? Il pleuvait ».
Pourquoi ? = « Vous demandez pourquoi ? » Ce tour montre comment le
latin quare ? « pourquoi ? » est devenu une pure conjonction coordinative
dans le français car. Cf. aussi sanscrit param « mais », littéralement « (Il y a)
encore autre chose ».
Mais ce n'est là qu'une variété du type général. Les trois coordonnées ont
commencé par se déterminer de proche en proche comme toutes les autres :
68« Paul a perdu beaucoup d'argent au jeu ; à cela s'ajoute quelque chose de
plus ; et c'est qu'il est ruiné ». « Je suis resté à la maison ; et j'y suis resté pourquoi ?
Le pourquoi, c'est qu'il pleuvait ». Ensuite est intervenue l'analogie
des systèmes de deux coordonnées reliées par une conjonction, et l'on a
interprété comme conjonction la phrase médiane, surtout lorsque celle-ci
était très courte.
96. Il semble parfois difficile d'établir la frontière entre la conjonction
coordinative et les autres termes A de segmentées contenant un représentant
(explicite ou implicite). Le critère déterminant n'est pas l'impossibilité de
rattacher le terme initial à un verbe de la phrase, puisque cette impossibilité
découle de la syntaxe de toute segmentée (cf. A cet endroit, nous fîmes
halte, ou : Là, nous fîmes halte). Ce qui caractérise la conjonction coordinative
à l'exclusion des autres termes A, c'est le fait que son représentant
représente la totalité de la première coordonnée, et non un de ses termes
seulement (v. plus haut : à cause de cela). Ce critère est souvent doublé du
fait que la forme de la conjonction lui interdit tout rapprochement avec le
verbe de C2 (p. ex. c'est pourquoi, aussi nous ne sortirons pas). En effet,
toute conjonction de cette nature (donc, pourtant, mais, etc.) représente C1,
dans sa totalité.
97. La segmentation, si caractéristique de la phrase française (par opposition
à celle de l'allemand) 127, est un procédé éminemment expressif. AZ et
ZA relèvent de tendances opposées de l'expressivité, l'attente et la surprise.
Dans AZ, le thème produit un effet de tension ; il fait désirer le propos, qui
prend toute sa valeur par cette préparation. Au contraire, dans ZA, le
propos éclate par surprise, et le thème est comme l'écho de cette explosion.
Si la segmentation permet de distinguer nettement le thème et la fin de
l'énoncé, c'est qu'elle les met l'un et l'autre en relief. C'est ce que n'ont pas
vu les grammairiens qui ont effleuré cette question ; ils sont partis de l'hypothèse
que dans toute phrase, il ne peut y avoir qu'une seule idée dominante ;
aussi la segmentation a-t-elle été considérée comme un moyen de
relever uniquement le prédicat selon les uns, uniquement le sujet selon les
69autres. Les uns et les autres ont raison. Le régime des accents des phrases
allemandes correspondantes le montre (81 n.).
98. Il est facile de voir combien la syntaxe segmentée fleure la langue
parlée. En effet, si la langue écrite peut présenter l'énoncé de la pensée dans
une phrase organique et cohérente, les nécessités de la communication rapide
exigent que les éléments de l'énonciation soient présentés pour ainsi
dire par morceaux, de manière à être plus facilement digérés.
On a souvent remarqué que le français est, beaucoup plus que l'allemand,
une langue « sociable », orientée vers l'entendeur, soucieuse de lui épargner
l'effort. Ce n'est donc pas un hasard si la syntaxe segmentée joue ici un
rôle si important ; elle est, avec la séquence progressive, dont il sera question
plus loin, un facteur essentiel de compréhension aisée.
99. La segmentation restitue au français la souplesse d'allure que l'ordre
rigide des mots, consécutif à la perte des flexions, aurait pu lui ravir. Pourvu
que les termes dispersés soient représentés par des pronoms dans la phrase
Z, on obtient des permutations extrêmement variées dont nous avons cité
des exemples au § 80.
Chose curieuse, la souplesse de construction obtenue par la segmentation
rapproche aussi la syntaxe prosaïque de celle de la poésie, où, comme on
sait, les inversions sont fort habituelles. Toutefois, il importe de faire le
départ (comme j'ai essayé de le faire dans mon Précis de stylistique, p.
121 ss. ; cf. ici § 330) entre ce qui est purement conventionnel dans la phrase
poétique et ce qui est vivant. On trouvera d'abondants matériaux pour cette
étude dans le travail de M. F. Boillot, Psychologie de la construction dans la
phrase fr. mod., auquel on peut reprocher seulement de n'avoir pas toujours
distingué les deux points de vue. La distinction est cependant essentielle.
Si nous parcourons les Souvenirs du peuple de Béranger, il est facile de noter
d'une part des phrases segmentées vivantes et expressives, telles que :
« Près de lui, je me troublai » — « Un soir, tout comme aujourd'hui, j'entends
frapper à la porte » — « Comme un trésor, j'ai depuis gardé son verre » « Longtemps,
aucun ne l'a cru ». D'autre part, des constructions nettement
archaïques et conventionnelles : « D'un fils Dieu le rendait père » — « Même à
dormir le feu l'invite » — « Mais à sa perte le héros fut entraîné ». Les passages
suivants présentent la combinaison des deux constructions : « L'an d'après,
moi, pauvre femme, à Paris étant un jour, je le vis avec sa cour. » — « Quand
d'erreur on nous tira, ma douleur fut bien amère ».70
Phrase liée
100. Nous avons dit que la condensation de deux monorèmes a pu
prendre dès le début une forme cohérente sans passer par la coordination
ni par la segmentation. C'est la phrase à un membre, sans articulations
intérieures, qui a servi de modèle, de « patron » pour la fusion des deux termes
en un tout compact. Pour reprendre l'exemple symbolique du § 67,
l'analogie d'une expression frrt ! « quelque chose s'envole » a pu influencer le
dirème et lui imposer la forme coucou frrt ! « l'oiseau s'envole » (sans pause
médiane). L'échange entre les trois types (coordination, segmentation, unification)
est toujours possible, même dans une langue organisée. Ainsi il
suffit de prononcer « Tel maître, tel valet » avec une mélodie montante-descendante
et une pause médiane pour obtenir une phrase segmentée
signifiant « Si le maître a tel caractère, le valet l'a également » ; mais il suffit
aussi de supprimer la pause et d'unifier la mélodie pour que la même expression
devienne une phrase liée signifiant « Le caractère du maître est aussi
celui du valet ».
101. L'histoire des langues confirme cette idée que des groupes coordonnés
peuvent devenir cohérents par l'analogie d'autres groupes plus serrés.
Les formes de cette condensation sont multiples ; on se bornera à en rappeler
quelques-unes.
C'est ainsi qu'en latin les phrases du type Timeo ne pluat remontent à
deux coordonnées (51) ; mais, par imitation du tour Timeo pluviam « Je
crains la pluie », ne pluat est devenu un complément d'objet étroitement
attaché au verbe. On expliquera de la même façon le passage de l'anglais
« I am sure ! You are innocent ! » à I am sure you are innocent (cf. « I am sure
of your innocence ») ; de même encore all. « Ich sage das : Du lügst » devenu
« Ich sage, dass du lügst », où dass est devenu un simple transpositeur (183),
comme ne dans timeo ne pluat (la virgule est un contre-sens). Citons encore
la forme de syntaxe dénommée « apò koinoû ». On peut l'expliquer, au moins
en partie, par la fusion de deux coordonnées : ainsi la phrase anglaise There is
a man wishes to speak with you, qui se traduit aujourd'hui par « Il y a là un
homme qui voudrait vous parler », a signifié au début « Il y a là un homme ;
(il) voudrait vous parler » 128. L'absence de pause entre les deux phrases a
induit à considérer la seconde comme une détermination de « a man ».
102. Mais demandons-nous surtout comment le sujet et le prédicat sont
71arrivés à être reliés par une copule. C'est le résultat d'une nouvelle condensation,
parallèle à la première.
On peut supposer que, dans un état primitif que nous symbolisons, pour
plus de commodité, par des mots latins, on a dit d'abord : Deus est ! Bonus !
« Il y a un Dieu ! (Il est) bon ». D'autre part, on connaissait le dirème Deus
bonus « Dieu (est) bon », qui s'est appliqué analogiquement sur ce système de
coordonnées. Le verbe qui y figure est apparu comme un moyen commode
d'exprimer à la fois la transposition de bonus en prédicat et la liaison,
jusqu'alors implicite, entre le sujet et ce prédicat. Ainsi Deus est bonus
n'a plus formé qu'une phrase liée, et le verbe a passé du premier membre
dans le second, car tout ligament est attaché au prédicat ou au déterminant
(154).
Les copules de rection sont nées des mêmes actions analogiques. Soit une
énonciation que nous transcrivons en mots latins : Caesar vivit ! Romae !
« César vit ! (Il est) à Rome ». L'analogie de Caesar Romae « César (est) à
Rome » a fait apercevoir dans vivit un ligament reliant Caesar avec Romae ;
vivit est sur la voie qui mène au verbe transitif ; il devient une copule de
rection, attachée à Romae, qui en est le déterminant ; ce procès est achevé
dans Caesar petit Romam, primitivement « César marche. (Il va) à Rome »,
mais en latin classique « César gagne Rome ».
103. On voit que, dans la plupart des cas mentionnés plus haut, le terme,
incorporé dans la phrase liée était primitivement une phrase coordonnée
destinée à compléter, à préciser après coup la précédente. C'est une des
fonctions les plus habituelles de la coordination, et les conséquences pour
la syntaxe liée en sont multiples. Qu'il me soit permis d'en signaler encore
deux aux hellénistes :
1) Des ex-voto sont accompagnés fréquemment de la formule Alkíbios
(ou Nikías, etc.) anéthēken Athēnaîos : cela signifiait d'abord « Alkibios a consacré
ceci. (Il est) Athénien » ; plus tard seulement on a interprété « Alkibios
l'Athénien a consacré ceci ».
2) L'accusatif de spécialisation n'a pas d'autre origine : chez Homère
(Iliade, 11, 240) on lit : Tòn d'áori plêx'auchéna : à une première époque, le
sens a été « Il le frappa. (Il frappa) sa nuque » ; ensuite seulement « Il le frappa
à la nuque ». Cf. Kieckers, Stellung des Verbs, p. 87ss.
104. Après cette esquisse génétique forcément rudimentaire et incomplète,
abordons l'étude de la phrase liée au point de vue statique. Elle est
72caractérisée par l'absence de mélodies contrastantes et de pauses médianes
appréciables susceptibles d'être prolongées sans altérer la structure syntaxique :
« Dieu est bon, Dieu est partout, La terre tourne autour du soleil,
J'affirme que cet homme est innocent, Nous sortirons s'il ne pleut pas,
etc., etc. ». Tel est, quant à la forme, le double caractère qui sépare la
phrase liée de la segmentée.
Pour la valeur, la différence est tout aussi tranchée : abstraction faite de
cas privilégiés dont il sera question ci-après, la phrase liée, au moins dans
ses formes les plus pures et les plus simples, ne caractérise le thème et le
propos par aucun signe linguistique. Nous écartons naturellement l'accent
d'intensité, qui permet à d'autres langues, à l'allemand par exemple, de
mettre en relief le propos à n'importe quelle place de la chaîne (39). Cette
possibilité est refusée au français, du moins dans la phrase non affective.
Quant à la mélodie, ses inflexions sont trop floues pour distribuer clairement
les éléments de l'énoncé : c'est une intonation modale cohérente qui
caractérise la phrase dans sa totalité, non dans ses éléments. Dans la phrase
« Ils sont venus tous deux m'apporter des livres », un sommet, mal déterminé,
d'ailleurs, coïncide avec le mot deux, mais le propos peut être selon les cas
tous deux (réponse à la question : « Combien étaient-ils ? ») ou bien venus
(question : « Les avez-vous vus ? »), ou encore m'apporter des livres (« Pourquoi
sont-ils venus ? »).
105. Ainsi le sujet et le prédicat grammaticaux ne correspondent qu'incidemment
au sujet et au prédicat psychologiques. Dans la phrase liée,
thème et propos se déduisent soit de la situation et du contexte, soit de la
nature de la pensée exprimée. Voyons comment s'analysent, à cet égard, les
phrases suivantes d'après le contexte qui les précède. « (Je me promenais.)
J'ai rencontré Paul » : c'est la phrase entière qui forme le propos. « (Paul
s'ennuyait à la maison.) Il est sorti » : c'est l'idée de sortie qui est le but de
l'énoncé. « (Cet homme n'est pas malhonnête.) Sa trop grande confiance
fait tout son malheur » : ici, c'est le sujet grammatical qui est le prédicat
psychologique, etc. Si à la question « Combien Paul a-t-il d'enfants ? » on
répond « Il n'a qu'une fille », c'est une qui joue le rôle de prédicat psychologique ;
mais si la même phrase répond à la question « Paul a-t-il un fils ? »,
c'est fille que vise l'énoncé. Voici enfin deux passages où un sujet grammatical
est le prédicat psychologique : « Les grandes personnes peuvent parler
tant qu'elles veulent ; (les enfants, on les fait taire) ». -« Henriette, Madame,
est l'objet qui me charme » (Molière, Femmes savantes I, 4).73
106. Il suit de là que la phrase liée absolument régulière, sans mélodie
segmentée, a tous les caractères du signe arbitraire, puisqu'elle n'est fixée
dans chaque cas que par les associations qu'elle contracte avec son entourage.
En d'autres termes, dans la phrase liée régulière et banale, la distribution
du thème et du propos s'obtient par les procédés de la parole, alors
que la phrase segmentée offre cette distinction par sa structure même, qui
relève de la langue, puisque les signes musicaux sont des signes comme les
autres ; la phrase segmentée est donc un cas de syntaxe motivée.
107. Mais l'arbitraire de la phrase liée n'est absolu que dans les types
syntaxiques les plus ordinaires, ceux, par exemple, qui offrent l'une des
séquences sujet-verbe-attribut, ou sujet-verbe-objet. Les compléments circonstanciels,
plus mobiles, peuvent déjà marquer par leur place s'ils sont
déterminés ou déterminants. « Je suis allé à Paris par avion » insiste sur le
mode de locomotion, « Je suis allé par avion à Paris » sur le but du voyage.
On sait en effet que la dernière place d'un syntagme coïncide en français
avec la partie accentuée. Mais, outre que cet accent est faible, il ne frappe
pas toujours l'élément prédicatif ; ainsi le rythme est souvent en conflit
avec l'ordre logique (317) : on évite de dire « Je suis allé à Paris hier », même
si l'on tient à souligner la date du voyage. La langue parlée n'admet plus
guère la séquence « J'ai donné à mon ami un beau livre » qui, dans la langue
écrite, permet de faire du complément direct le prédicat psychologique. De
même le tour « Alors entra le roi », contrastant avec « Le roi entra », est
étranger à la syntaxe parlée. De même encore « Lui lisait, elle tricotait »
(phrases liées, le type à deux sommets valant thème + propos) est définitivement
supplanté, dans la langue courante, par : « Lui, il lisait ; elle, elle
tricotait » (segmentées AZ).
108. C'est donc à d'autres procédés que le français doit recourir pour
souligner le propos ou l'opposer au thème dans une phrase liée. Mais on
constate alors l'intervention de l'accent et de la mélodie, qui rapprochent
la phrase liée de la segmentée. On sait, par exemple, que le propos peut être
mis en relief par le tour c'est…qui (que), avec le concours de l'accent et de
l'intonation aiguë : « C'est moi qui ai fait cela », type très voisin de la segmentée
ZA ; de même « C'est une belle chose que la poésie ». Par contre, on
obtient une succession thème-propos et une phrase à deux sommets mélodiques
par la variante : « C'est moi le coupable. » Même succession, et phrase
à deux sommets, mais intonée plus énergiquement, dans le tour très différent
« C'est lui qui sera content ! » (c'est-à-dire « Lui, ah ! certes, il sera très
74content »). Deux sommets encore dans le tour « Il y a une chose qu'il faut
reconnaître » (all. « Eines muss man zugestehen »), « Il n'y a que le premier pas
qui coûte ». L'expression Voilà que… fait de la phrase entière le propos ;
« Voilà que la pluie se met à tomber » ; au contraire, la variante Voilà… qui
constitue une phrase à deux sommets (AZ) : « Voilà le train qui arrive ». Le
parler populaire crée des phrases valant AZ au moyen de il y a… qui : « II
y a Paul qui m'a chipé mon couteau ».
On serait tenté de mentionner enfin les faits de construction qu'on appelle
inversions ; cf. « Le matin, je travaille. — Dans ce cas, renoncez ». Mais
il est facile de voir qu'il s'agit là de phrases segmentées où les éléments
musicaux ont passé un peu à l'arrière-plan (92). Le fait qu'on peut introduire
une pause après le terme inversé sans altérer la syntaxe prouve à lui
seul la segmentation.
D'une façon générale, ces cas privilégiés ne sont qu'une exception apparente
au principe d'après lequel la syntaxe liée est arbitraire ; on vient de
voir, en effet, que dans la plupart des exemples cités les éléments musicaux
interviennent et contribuent à distribuer, d'une façon discrète, le thème et
le propos. Ainsi la phrase « C'est une belle chose que la poésie » est très voisine
de la segmentée ZA « C'est une belle chose, la poésie » : même mélodie, même
faculté de mettre une pause après chose.
109. En somme, on le voit, cette indétermination du thème et du propos
affecte surtout les formes parlées ; elle décroît par conséquent en raison directe
de la complexité de la phrase, notamment en raison du nombre des
propositions. Il est un cas où la distinction thème-propos est bien tranchée :
c'est celui où une proposition modale est suivie d'un dictum introduit par
que ou ses équivalents : Je crois que Paul est sorti, Je veux que Paul sorte,
Je ne sais si Paul est sorti, etc. ; lorsque le verbe modal est un faux impersonnel
(238), comme dans Il est certain que Paul est sorti, Il est désirable qu'il
sorte, l'ordre thème-propos éclate d'autant plus visiblement que la proposition
introduite par que est le sujet grammatical du verbe modal (cf. Le
départ de Paul est certain). La même remarque s'applique également au
type plus simple Il faut du courage, Il manque de l'argent, où le faux impersonnel
se détache nettement, en qualité de thème, de son sujet grammatical
substantif, qui est le vrai propos.75
Chapitre III
Les termes de la phrase
Actualisation des termes de la phrase
110. Pour devenir un terme de la phrase, un concept doit être actualisé.
Actualiser un concept, c'est l'identifier à une représentation réelle du sujet
parlant. En effet, un concept est en lui-même une pure création de l'esprit,
il est virtuel ; il exprime l'idée d'un genre (chose, procès ou qualité). Or,
la réalité ignore les genres : elle n'offre que des entités individuelles.
Le concept virtuel est indéterminé en extension : il est impossible de
penser que la notion de fleur comprenne un nombre fixe de choses appelées
« fleurs », la notion de marcher un nombre fixe d'actes de marche, ou que
rouge désigne un nombre déterminé de nuances de cette couleur. Inversement,
le concept est déterminé en compréhension ; tout concept, même
spécialisé, soit qualitativement (cheval, cheval blanc, all. Schimmel, cheval
de trait, cheval qui rue ; regarder, regarder attentivement, regarder d'un œil
sévère), soit quantitativement (grand homme, géant, nain ; travailler comme
un nègre, se surmener), est toujours déterminé par un nombre limité de
caractères distinctifs. Ce que l'on appelle généralement aspect relève de la
caractérisation quantitative des procès (criailler, voltiger, etc. ; cf. 115 IIb).
111. L'actualisation a pour effet de renverser le rapport entre l'extension
et la compréhension des concepts ; en effet, un concept actualisé est déterminé
en extension et indéterminé en compréhension. Tout ce qui est pensé
comme réel est conçu comme déterminé, ou tout au moins comme déterminable,
en quantité, même lorsque cette quantité est impossible à vérifier.
Si j'entends aboyer des chiens, je puis ignorer leur nombre, mais il ne me
viendrait pas à l'idée d'imaginer qu'ils peuvent être indifféremment quatre,
cinq ou six. La notion grammaticale d'indéfini est donc équivoque ; quand
on parle de quelques chiens, le nombre des chiens est inconnu ou n'est pas
exprimé, mais il n'est pas indéterminé. De même, l'expression « Donnez-moi
du pain » suppose toujours une portion mesurable de la substance en question :
elle est réellement déterminable.
La compréhension d'un concept actualisé est également inverse de celle
d'un virtuel. Alors que celui-ci est défini par un nombre limité de caractères,
l'actuel, étant individualisé, renferme une infinité de caractères qu'aucune
77expérience pratique ne pourrait épuiser. On peut définir l'idée de maison
et celle de neiger, mais la description de cette maison et de il neige ne peut
jamais être exhaustive. Là encore, peu importe que quelques-uns des
caractères réels ou même leur totalité échappe à la conscience du sujet
parlant ; il a l'intuition que ces caractères existent et qu'ils sont innombrables.
Si mon voisin m'apprend qu'il a acheté une maison, je ne sais
rien de celle-ci, mais mon esprit est tout prêt à la concevoir comme réelle,
c'est-à-dire différente de toutes les autres 129. « Le malade, me dit-on encore,
a beaucoup souffert » : cette souffrance, par le contact avec la réalité, revêt
une infinité de caractères conçus comme vérifiables.
112. L'actualisation des concepts consiste donc à les faire passer dans
la réalité ; rappelons (31) que cette réalité peut être non seulement objective,
mais aussi idéelle et imaginaire. Elle est objective quand je parle de mon
ami, de Napoléon Ier, ou bien de la promenade que j'ai faite ce matin, de
la Révolution française : elle est idéelle, subjective, quand je pense à
Don Quichotte, à Hernani, ou bien à l'avarice d'Harpagon, à la mort
d'Iseut. La distinction entre ces deux sortes de réalités est d'ailleurs
fluctuante (cf. l'idée de Dieu ou celle des miracles de Jésus-Christ pour
un croyant et un non-croyant) ; elle n'a d'importance ni pour la logique
formelle ni pour la grammaire.
113. Nous avons dit (110) qu'un concept virtuel de chose, de procès ou
de qualité doit, pour être actualisé et devenir un terme de l'énonciation,
être identifié avec une représentation réelle du sujet parlant, c'est-à-dire
individualisé ; or, individualiser un concept, c'est en même temps le localiser
(I) et le quantifier (II).
Ia) Un concept de chose (p. ex. maison) appliqué sur un objet réel (la
maison que je vois, cette maison) se trouve localisé dans une portion de
l'espace réel, en tant qu'il occupe une position déterminée par rapport à
celle du sujet parlant. Ainsi dans les exemples ci-dessus la proposition
relative et le démonstratif déterminent la place de la maison par rapport
au sujet parlant moi. Les procédés de localisation dans l'espace sont très
divers ; nous y reviendrons (121).
Ib) De même qu'un concept de chose, un concept de procès (p. ex.
78neiger), identifié avec un phénomène conçu comme réel par le sujet parlant,
se trouve inséré, et de ce fait localisé, dans une portion du temps
réel : il neige, il neigeait, il neigera, — le temps réel étant celui qui a pour
point de départ le moment présent, simultané à l'énonciation de la pensée
par le sujet parlant. C'est donc le temps du verbe qui marque la localisation
du concept de procès. Toute localisation déterminée à partir du sujet parlant
sera appelée ici localisation absolue.
114. La localisation d'une chose ou d'un procès peut être indéterminée
(sur le sens de ce dernier mot, v. 111), être même hors des prises du sujet
parlant, elle n'en est pas moins conçue comme nécessaire. Nous nous représentons
la terre, la lune, le soleil, dans une portion plus ou moins vague
du monde stellaire, mais nous savons que cette localisation est déterminable,
bien qu'elle ne le soit pas pour nous. Penser à Napoléon, c'est le voir à
Austerlitz, à Fontainebleau, à Sainte-Hélène, dans un cadre plus vague
encore : ce cadre est toujours déterminable pour notre esprit, même s'il
est très indéterminé. Il en est de même de la réalité « imaginée » définie
plus haut : Don Quichotte nous apparaît nécessairement dans les ambiances
diverses créées par Cervantès.
La notion d'existence est un cas-limite de localisation « indéterminée ».
D'ailleurs l'idée d'existence pure répugne à notre esprit ; nous ne pouvons
dire « il pleut », « il neige » sans évoquer instinctivement l'ambiance, si vague
soit-elle, du procès. Dieu est involontairement pensé comme localisé dans
le monde, hors du monde, au ciel, partout, etc. Si, à titre de curiosité,
nous consultons l'histoire, nous constatons que les expressions désignant
l'existence remontent à des notions spatiales : « il y a un Dieu » (y = lat. hic
« ici ») ; « les médecins sont là pour les malades » ; all. « das Dasein Gottes »,
« etwas ist vorhanden » (littéralement : « devant les mains ») ; exister remonte
au latin ex(s)istere, qui a signifié « se montrer, apparaître » ; l'imparfait
était = lat. stabat « se tenait debout ». Il n'est pas douteux que l'indo-européen
esti ne confirmât cette vue si l'étymologie en était connue.
115. IIa) La quantification d'un actuel de chose est suffisamment claire
par ce qui précède ; s'il s'agit des objets nombrables, elle peut être — on le
sait — singulière (un chien), plurale déterminée (six chiens) ou simplement
déterminable (quelques chiens, des chiens), totale (tous les chiens, ou simplement
les chiens).
La quantification des objets mesurables est parallèle à celle des nombrables :
une livre, deux livres de pain ; « Paul a mangé tout le pain ». La
79langue ne permet pas de voir ce qu'est en réalité le quantificateur, c'est-à-dire
un partitif : un chien, six chiens, quelques chiens signifient « un, six,
quelques-uns de tous les chiens » ; des chiens a été primitivement l'équivalent
du génitif partitif et signifie « quelques-uns des chiens ». Sur l'aspect grammatical
de ces faits, voir § 361s. L'expression de la totalité est naturellement
un cas-limite : elle est parfois assimilée au partitif, comme en anglais
dans les tours tels que all of us = « nous tous » 130.
Quant à l'emploi générique du substantif (« le chien est l'ami de l'homme »,
« le pain est l'aliment par excellence »), il présente à l'imagination des entités
existant à un seul exemplaire et échappant à toute quantification.
IIb) La quantification des procès se distingue elle aussi de leur localisation,
mais cette distinction n'apparaît pas aussi clairement que dans l'actualisation
des choses.
Le concept de procès est quantifié par l'aspect du verbe ; il est vrai que
celui-ci, bien que de nature quantitative, est un caractère du procès virtuel
pris en compréhension : il mesure la quantité du procès considéré en soi.
Nous le séparons donc nettement du temps verbal (113, Ib). Ainsi, dans
voltiger, itératif, la notion quantitative fait partie des caractères du concept ;
le verbe partir est d'aspect ingressif, etc. Mais en contact avec le temps
verbal, l'aspect quantifie le procès actualisé. Par exemple, l'oiseau voltigeait ;
le voyageur partit, part ou partira indiquent des points réels du temps.
De même que les objets, les procès peuvent être quantifiés par mesure
ou par dénombrement. On peut parler de mesure lorsque l'aspect indique
la durée du procès ou les phases de cette durée (aspects duratif : travailler,
ingressif : partir, progressif : vieillir, terminatif : arriver, etc.), et de numération
lorsqu'il désigne la répétition ou la non-répétition du procès (aspects
itératif : battre, ou singulatif 231 : frapper).
116. Les principes énoncés plus haut souffrent une restriction : la langue
n'a pas besoin d'actualiser les signes qui sont eux-mêmes actuels. En effet,
l'actualisation fait d'un concept de chose un nom propre de la parole ;
80d'autre part, il n'y a que des « verbes propres », car le verbe conjugué, dans
nos langues, n'est jamais réduit au sémantème pur, c'est-à-dire au radical 132.
Mais on sait qu'il y a des noms propres dans la langue même : un nom propre
de la langue est individualisé par lui-même (Annibal, les Pyrénées, le soleil,
la lune, la terre ; Don Quichotte, Hernani, etc.), c'est-à-dire qu'il apparaît
dans chaque acte de parole avec les caractères d'un concept actualisé,
individualisé, localisé.
Un nom propre de la parole est, au contraire, tout concept actualisé,
c'est-à-dire individualisé occasionnellement et qui peut, d'un cas à l'autre,
désigner un individu différent ; p. ex. moi, qui s'applique au sujet parlant,
indéfiniment variable ; ce chien, qui peut désigner à tour de rôle tous les
chiens de la création 233.
Un nom propre de la parole peut être compris par cumul (225) dans
un autre signe. Le cas le plus fréquent est celui des adverbes « circonstanciels »
(ici = « à cet endroit » : cet endroit est un nom propre), et des conjonctions
coordinatives (aussi = « c'est pourquoi » = « à cause de cela » : cela est
un nom propre), etc.
117. Un nom propre de la langue peut être formé par cumul du concept
général de personne ou de chose et d'un actualisateur, p. ex. quelqu'un
(= une personne), tout ( — toutes les choses), chacun, etc.
Nous rangeons encore dans les noms propres de la langue les noms de
matières et les noms abstraits. Une matière telle que l'or, l'air, etc. est
conçue par l'imagination comme un tout unique, susceptible d'être divisé,
mais non d'être nombré. D'autre part, les abstraits (la vertu, la vie, etc.)
sont pensés comme des entités autonomes, que l'imagination personnifie
souvent ; aussi n'est-il pas rare que les noms de l'une et l'autre catégorie
soient ornés de la majuscule (la puissance de l'Or, le spectre de la Mort).
Cette particularité se retrouve d'ailleurs dans les noms propres de la parole,
notamment dans les concrets génériques (le culte de la Femme), qui relèvent
de la parole. En effet, comme nous l'avons vu, l'imagination nous
présente les genres comme des entités personnifiées : l'Homme (est mortel) ;
81(qu'est-ce qu') un requin ? L'entité peut être caractérisée sans perdre son
caractère singulier : ainsi l'homme qui trahit son ami (est un lâche), l'homme
qui tue son père (= le parricide) est un monstre, etc.
Ces personnifications ne peuvent être qu'imaginaires, puisque par définition
un nom propre a une compréhension illimitée, tandis qu'un nom de
matière et un générique sont définis par un nombre limité de caractères,
et que les abstraits n'en ont qu'un seul.
118. La distinction entre virtuel et actuel vaut aussi pour le système
phonologique. Un phonème est virtuel tant qu'il est isolé, p. ex. a, ou qu'il
fait partie d'un groupe de sons dépourvus de sens, tel que ari. Un phonème
est actualisé dès qu'il figure dans une chaîne parlée significative, faisant
elle-même partie d'une phrase réelle lue à haute voix ou prononcée mentalement,
p. ex. a de arbre dans Cet arbre est un sapin. Le phonème virtuel
est générique, conceptuel, de même que le mot arbre désigne un concept
pur. Au contraire, l'actualisation individualise les phonèmes comme les
mots. De même que l'expression Cet arbre désigne, dans chaque emploi,
un arbre différent, ou le même arbre dans des circonstances différentes
de même le signifiant arbre (et par conséquent le phonème a) n'est jamais
prononcé deux fois exactement de la même manière. C'est donc la contrepartie
du fait que, dans la parole, on n'emploie jamais le même mot dans
la même acception.
119. Tous les développements exposés jusqu'ici montrent que l'actualisation
a pour fonction de faire passer la langue dans la parole : c'est par
l'actualisation modale qu'un ou plusieurs mots exprimant une représentation
deviennent une phrase (la phrase est l'acte de parole par excellence) ;
c'est aussi par l'actualisation que les signes de la langue peuvent devenir
des termes de la phrase. L'expression ces chevaux n'indique par elle-même
ni les caractères ni le nombre des animaux en question : seuls le contact
direct avec la réalité (« Regardez ces chevaux ») ou le rappel d'une description
faite antérieurement (au sein de la parole) peuvent éveiller dans
l'esprit l'idée d'une représentation individualisée. Il en est de même d'un
procès tel que il pleut.
Ce qui appartient à la langue dans le mécanisme de l'actualisation, ce
sont les actualisateurs, c'est-à-dire les divers procédés qu'elle emploie pour
se transformer en parole, autrement dit pour relier les notions virtuelles
aux objets et aux procès qui leur correspondent dans la réalité, pour muer
82le virtuel en actuel : les actualisateurs sont donc des ligaments grammaticaux.
Ainsi ce, dans ce livre, relie le concept virtuel de livre à un « livre »
offert par la situation ou le contexte ; de même dans régnait, le signe de
l'imparfait relie la notion virtuelle de « régner » à un règne concret du passé.
120. Le mécanisme de l'actualisation montre aussi d'une façon évidente
que, au point de vue statique, la langue préexiste à la parole et que la
parole suppose toujours la langue, puisque c'est cette dernière qui fournit
les actualisateurs sans lesquels la parole ne pourrait se réaliser. Cela est
vrai non seulement de la phrase, mais aussi des termes ; ainsi des expressions
telles que mourut, cet homme, sans être des phrases, donnent tout de
suite l'impression d'être prédestinés à figurer dans des phrases. Il est à
peine besoin de rappeler qu'au point de vue génétique l'ordre de priorité
est renversé et que la parole a précédé la langue dans la genèse du langage 134.
Actualisation implicite et explicite des termes
121. Comme la phrase (36ss.), les termes de la phrase sont actualisés par
des procédés tantôt implicites, tantôt explicites.
Deux remarques préalables sont nécessaires. Tout d'abord, l'actualisation
du substantif est seule en cause ici, puisque, comme nous l'avons vu (116),
le verbe est toujours actualisé explicitement par la forme conjuguée. De
plus, puisque nos substantifs sont toujours quantifiés par le nombre (singulier
ou pluriel), et qu'ils sont toujours sous leur forme actuelle munis de
quantificateurs (p. ex. les articles, les noms de nombre, etc.), les termes
83d'actualisation implicite et explicite doivent s'entendre ici uniquement au
point de vue de la localisation.
122. I. L'actualisation est totalement implicite quand elle ne se déduit que
de la situation ou du contexte. Ainsi dans la phrase latine Canis latrat, littéralement
« chien aboie », canis peut désigner soit un chien inconnu, soit le
chien que nous connaissons, soit le chien en général ; il n'est en tout cas pas
virtuel. De même, dans certaines langues, comme le chinois, les concepts de
procès ne sont pas nécessairement actualisés par le temps du verbe ; celui-ci
peut être « pensé » au passé, au présent ou au futur selon la situation ou le
contexte. C'était probablement l'état de l'indo-européen, où le verbe marquait
les aspects de l'action plutôt que les temps. Dans tous ces cas, la situation
ou le contexte, ou tous les deux, font office d'actualisateurs.
123. L'actualisation est encore implicite quand l'actualisateur est contenu
dans le signe indiquant la quantité : deux soldats, des soldats, du vin. En
effet, si l'on compare deux soldats avec ces deux soldats, etc., on constate que
deux soldats désigne certains soldats au nombre de deux ; le partitif des lui-même
cumule les fonctions de quantificateur et d'actualisateur : des soldats
signifie « certains soldats en nombre indéterminé ». Il en est de même pour
un : il est à la fois quantificateur déterminé et actualisateur indéterminé ;
mais on insiste tantôt sur la quantité (= un seul), tantôt sur la qualité
(= un certain).
Les noms de matières donnent lieu aux mêmes observations : l'actualisation
est implicite dans un litre de vin comme dans un chien. Remarquons
que peu (de vin) est aussi actuel que un peu (de vin) : l'un et l'autre désignent
une quantité réelle ; la différence est purement subjective : un peu
suppose que la quantité est suffisante ou qu'elle convient à une certaine
destination ; peu désigne une petite quantité pure et simple, ou insiste sur
son insuffisance.
Certains actuels (déjà cités plus haut, 117) cumulent l'idée générale de
personne ou de chose avec un quantificateur : quelqu'un, tout le monde,
chacun, personne, autrui, ceci, quoi ? etc. ; quelqu'un = une personne, tout =
toutes les choses, autrui = les autres gens, ceci = cette chose, etc.
124. En français, l'infinitif, c'est-à-dire le verbe transposé en substantif,
peut être virtuel ou actuel. Il est virtuel p. ex. comme second terme de composé :
l'art d'aimer ; mais il est actuel dans Mentir est odieux = « Le mensonge
est odieux ». Dans ce cas, on le voit, l'actualisation est implicite. Mais
l'infinitif actualisé tend à se faire précéder d'une particule de, qui n'est préposition
84que par la forme et qui joue le rôle d'un article. On condamne sans
doute des tours tels que « De mentir est odieux », « De pleurer est lâche », mais
ils sont fréquents, et de est obligatoire dans la construction inverse « Il est
odieux de mentir », et aussi devant le second infinitif de tours comparatifs
tels que « Mieux vaut se taire que de mentir » 135. Quand je lis une phrase
comme : « Autre chose est reconnaître l'existence de l'évolution, autre chose
soutenir qu'elle est hors des prises de la volonté humaine », j'ai le sentiment
qu'il manque quelque chose devant les infinitifs.
125. II. L'actualisation est partiellement explicite lorsque l'actuel fourni
par la situation ou contenu dans le contexte est désigné par un signe qui le
localise, le montre, le présente dans une situation réelle, ou bien le rappelle,
le représente en l'associant à un contexte déjà énoncé.
a) Plaçons-nous d'abord au point de vue de la situation. Le signe qui
présente l'actuel peut être de nature mimique, c'est-à-dire un mouvement
volontaire quelconque servant d'indication : geste de la main, mouvement
de tête, direction du regard, etc. Si p. ex., en montrant un objet du doigt,
je dis « Donnez ! », mon geste complète la phrase, qui équivaut à « Donnez-moi
la chose qui est là » ; ce geste est un actualisateur, c'est-à-dire un lien
grammatical, un ligament, qui associe l'idée virtuelle de chose avec l'objet
qu'il montre (119). La présentation est appelée aussi « déixis » (mot grec
signifiant « action de montrer ») ; le geste est un signe déictique, un déictique.
Le geste peut être doublé — mais non remplacé — par un geste vocal, un
mot déictique, un présentatif, p. ex. dans « Donnez-moi ceci », c'est-à-dire
« la chose qui est à l'endroit que je montre » ; ceci contient à la fois l'idée virtuelle
de chose et le ligament qui double le geste et relie l'idée de chose à
l'objet présenté.
Dans le cas de Donnez !, où rien de l'actuel ne figure dans la parole, on
peut parler d'ellipse situationnelle. En tout cas, la déixis est totale dans
Donnez ! et à peu près totale dans Donnez-moi ceci !, parce qu'elle ne comporte
qu'une désignation très vague du virtuel (chose) ; elle n'est plus pure
et simple dans « Donnez-moi ce livre », ou même « Donnez-moi cette chose »,
parce que le virtuel figure dans l'actuel. Aussi bien dans « Asseyez-vous ici
(=à cet endroit) » que dans « Asseyez-vous à cette place, sur cette chaise »,
il y a déixis partielle.85
Moi est aussi une sorte de présentatif, car il désigne la personne qui parle,
et la parole est un geste qui identifie cette personne. On peut en dire autant
de mon, puisque « mon chien » équivaut à « le chien de moi ». Le mécanisme
de la présentation est le même pour toi et ton, car toi désigne la personne à
qui l'on parle ; mais dans ce cas la parole suffit comme geste seulement
quand il n'y a que deux interlocuteurs ; dans le cas contraire, un geste proprement
dit doit intervenir.
126. b) Le terme auquel on se réfère pour actualiser un virtuel peut être
non plus présenté, mais représenté. Ce n'est plus un objet ou un procès
offert par la situation, mais un concept déjà actualisé, contenu dans le contexte
de la parole, p. ex. « J'avais un chien ; un jour, ce chien disparut. » La
représentation est donc une actualisation au second degré, car l'actualisateur
(dans l'espèce, le représentant, p. ex. ce dans l'exemple ci-dessus)
représente un chien, déjà actualisé par le procédé indéterminé signalé au § 111.
Comme la déixis, et dans les mêmes conditions, la représentation peut
être ou purement implicite, ou explicite à différents degrés. Exemple : « J'avais
un chien ; un jour, il (ou : celui-ci) disparut » ; il (celui-ci) cumule l'expression
du virtuel chien et du ligament qui le relie à l'actuel fourni par la
phrase précédente. Dans la variante « J'avais un chien ; un jour ce chien (ou
cette bête) disparut », la représentation est partielle, parce que le virtuel
(chien, bête) est exprimé, et l'adjectif démonstratif ce sert seulement à rappeler
qu'il s'agit du chien dont je viens de parler.
127. Comme la déixis, la représentation peut se faire soit par un signe
positif, soit par un signe zéro (248), dont le sens se déduit du contexte ; c'est
ce que nous appellerons une ellipse contextuelle, par opposition à l'ellipse
de situation (125). Le représentant représente tout l'actuel dans « Ce fonctionnaire
est dévoué ; je l'estime » et dans « J'ai acheté au marché des oranges
qui sont délicieuses ». On remarquera que dans « J'aime le théâtre et j'y vais
souvent » y cumule deux signes : la préposition à et le représentant total de
« le théâtre ».
La représentation est partiellement explicite dans « Ce chapeau est celui
de mon ami » ou « celui que j'ai acheté hier » ; celui équivaut à le chapeau ; il
introduit donc, au moyen de l'article le, qu'il contient implicitement, le virtuel
chapeau dans un nouvel actuel (= « le chapeau de mon ami, le chapeau
que… »).
128. La notion de représentant recouvre en partie celle de pronom ; mais
on peut représenter non seulement des actuels nominaux, mais des actuels
86ou parties d'actuels appartenant à n'importe quelle catégorie : il y a des
représentants d'adjectifs, de verbes, d'adverbes, et enfin des représentants
de propositions-termes et de phrases entières.
Exemples : « Etes-vous prêt ? Je le suis » ; le = « prêt » et représente un adjectif.
« Vous avez mieux parlé aujourd'hui que vous n'avez fait (ou : l'avez
fait) hier » ; (l')avez fait représente « avez parlé » : c'est un représentant de
verbe. « Paul a agi malhonnêtement ; ceux qui agissent ainsi méritent la
réprobation » ; ainsi = « malhonnêtement », c'est un représentant d'adverbe.
« Vous êtes malade ? Je l'ignorais » ; l' = « que vous étiez malade » ; il représente
donc une proposition-terme à valeur nominale (= votre maladie). De
même en dans « Vous avez réussi, je vous en félicite » ; « On punit les citoyens
qui vendent leur patrie ; mais de tels hommes ne devraient pas exister » ;
tels = « qui vendent leur patrie » : c'est le représentant d'une proposition-terme
à valeur adjective. « Vous avez fait de grosses pertes d'argent, et cela
par votre faute » ; cela représente toute la phrase précédente comme telle,
et non plus comme proposition-terme : c'est un « prophrase ». Si l'on dit
« Vous avez fait des pertes d'argent, et par votre faute », le même représentant
a la forme zéro, c'est une ellipse, un prophrase implicite. Dans la
phrase « Quand le maître m'adresse la parole, c'est toujours sur un ton méprisant »,
c'est représente la phrase « Le maître m'adresse la parole » (impliquée
dans la subordonnée quand…).
129. Comme la représentation proprement dite, la représentation implicite
ou ellipse (245) peut être totale ou partielle ; de même encore, elle
peut représenter des noms, des adjectifs, des adverbes, des propositions-termes,
des phrases. Dans « Voici votre soupe, mangez ! », mangez ! = « Mangez-la »,
et la = « votre soupe » (terme nominal total) ; l'ellipse est partielle
dans « Je veux du vin rouge et non du blanc » (ellipse de vin, partie du terme
actuel du vin blanc) ; « Paul est plus malade que vous n'êtes » (c'est-à-dire
malade) ; « Paul est plus coupable que vous (ne) croyez » (c'est-à-dire qu'il est
coupable, proposition-terme à valeur nominale) ; « J'ai cédé, mais à mon
corps défendant » (ellipse de j'ai cédé, phrase entière), etc.
L'ellipse et la représentation sont donc absolument parallèles, mais la
syntaxe exige tantôt l'une, tantôt l'autre ; comparez « Cet élève a quinze ans
et celui-ci seize » et « Cet élève a quinze ans et celui-ci en a seize ». L'usage
a varié selon les époques : au XVIIe siècle, Racine a pu écrire « Le pape
envoie le formulaire tel qu'on lui demandait ». L'ellipse — et cela se comprend
- est plus fréquente dans la langue parlée que dans la langue écrite.
87Enfin, il y a des différences de langue à langue : si on traduisait en latin la
phrase « La fortune de César fut aussi tragique que celle de Pompée », on
devrait supprimer celle.
130. Remarque : Il existe un cas limitrophe entre la déixis et la représentation :
c'est celui où, en désignant un être ou un objet, on pense à son nom
et on le représente dans l'énoncé comme s'il figurait dans le contexte. Ainsi,
en montrant un chapeau, on peut dire« Donnez-le-moi », ou, si l'on a le choix
entre deux chapeaux présentés sans aucune explication, « Donnez-moi
celui-ci ». Le genre masculin suppose évidemment qu'on pense le mot chapeau,
et non comme dans la déixis pure l'idée vague de chose, laquelle s'exprimerait
par « Donnez-moi ceci ». Si, en montrant du linge, on dit : « Elle
n'a pas empesé les chemises », elle désigne évidemment la blanchisseuse.
Cet emploi du pronom ou de l'ellipse correspondante peut devenir usuel
quand il s'agit d'actions habituelles, exécutées par une personne déterminée ;
c'est ainsi qu'en grec, dans la langue militaire, salpizei signifiait « il (c'est-à-dire
le trompette) sonne de la trompette », et dans celle des marins airein
(sous-entendu ánkuran) « lever l'ancre ».
131. III. Enfin l'actualisation est explicite quand le terme qui localise le
virtuel figure expressément dans le même syntagme à titre de déterminant
(tʼ) du virtuel. Exemples : « le chien du jardinier, le toit de notre maison,
l'oiseau que j'entends chanter, Celui qui règne dans les cieux, ce que vous désirez,
quiconque enfreint la loi (quiconque = tout homme qui), qui perd
(gagne) (qui = celui qui) », etc.
Il importe de noter que l'actualisation dite explicite ne l'est pas complètement,
car le déterminant qui localise le virtuel (du jardinier, de notre
maison, que j'entends chanter, etc.) est lui-même actualisé implicitement
(le jardinier, nous, moi). En d'autres termes, dans nos exemples, « chien,
toit, oiseau » ont une actualisation relative, et les déterminants actuels (jardinier,
nous, moi) une actualisation absolue (c'est-à-dire sont localisés par
rapport au sujet parlant, cf. 113 Ia). En effet, toute notion relative se ramène
en dernière analyse à une notion absolue (sur ce principe, voir Bally, Absolu) 136.
132. L'actualisation explicite se distingue nettement de la caractérisation
(135ss.), qui spécialise les concepts virtuels. Les critères qui déterminent
cette distinction sont les suivants :88
1) Un concept virtuel est caractérisé par un virtuel (son caractérisateur), et
actualisé par rapport à un actuel (son actualisateur). Comparez « fils de fonctionnaire »
et « le fils de ce fonctionnaire » (« d'un fonctionnaire »), « oiseau
chanteur » et « l'oiseau que j'entends chanter », « être assis confortablement »
et « (Paul) est assis à côté de moi », « mourir subitement » et « (Napoléon) est
mort le 5 mai 1821. »
133. 2) Il suit de là qu'un virtuel qui en caractérise un autre ne peut recevoir
lui-même de détermination actuelle (142). Il serait absurde de parler d'un « pot
à eau que l'on fait bouillir ».
Ce critère sert de réactif dans certains cas qui pourraient paraître douteux :
a) Un virtuel peut être caractérisé par un nom propre (116), mais à condition
que celui-ci perde sa qualité d'actuel et prenne valeur d'adjectif ;
ainsi oranges d'Espagne, pommier du Japon, sont des virtuels caractérisés ;
il est en effet impossible d'ajouter « d'Espagne, qui est située au sud de la
France ». Fauteuil Voltaire est de la même espèce, parce que, en l'absence de
la préposition de, le mot prend la fonction d'un adjectif (comparez : « les
œuvres de Voltaire, le plus grand prosateur du XVIIIe siècle ») 137.
b) La présence nécessaire d'actualisateurs préposés au substantif (119,
471) a pour conséquence que ceux-ci arrivent à perdre leur vertu actualisatrice,
et l'usage les introduit dans des syntagmes où le substantif est
évidemment virtuel. Ce sont alors les associations spontanées qui fixent le
vrai caractère de l'expression.
Ainsi il apparaît que l'article n'actualise pas dans des expressions telles
que « examiner avec une grande attention, avec la plus grande attention,
avec l'attention d'un expert », etc., parce que l'analogie de « examiner avec
attention, ou attentivement » est inévitable et prouve que tous ces tours
relèvent de la caractérisation virtuelle. Une nouvelle preuve en est que l'infinitif
(dépourvu de la notion de temps) est parfaitement naturel dans
« examiner avec la plus grande attention », tandis qu'il est contre nature
dans examiner avec cette loupe, parce que l'expression est nettement actuelle,
et que l'actualisation n'apparaît linguistiquement que grâce à la flexion
verbale.
En français, l'article défini a perdu toute valeur actualisatrice dans les
très nombreux tours qui forment avec le verbe une notion virtuelle complexe,
89autrement dit un composé (141 ss.). Quelques exemples suffisent :
chasser le tigre (par opposition avec « Nous chasserons le tigre qui dévaste
notre forêt »), pêcher à la ligne, aller à la messe, au bal, au café, etc. De même
dans des cas tels que savon du Panama, oiseau du Paradis, où le déterminant
est un nom propre (voir plus haut). La même classe englobe encore les déterminations
fournies par des substantifs quantifiés, comme dans tailleur
pour messieurs, char à quatre roues : tout nous montre qu'il s'agit de notions
virtuelles.
134. 3) Un mot caractérisé est toujours réductible (grammaticalement) à
un mot simple, un actualisé jamais.
En effet, un caractérisé désigne une espèce d'un genre : cheval blanc :
cheval, souffrir du froid : souffrir. Mais une espèce peut toujours être mise en
parallèle avec une autre espèce représentée par un mot simple : cheval blanc :alezan,
souffrir du froid : geler ; une espèce peut être comparée à une autre
plus particulière désignée par un mot simple : habit d'homme : redingote, ou,
inversement, une espèce à un genre : cheval blanc : cheval ou animal. Dans
des cas privilégiés, un mot simple est le synonyme d'un virtuel complexe :
lynx = loup-cervier, colibri = oiseau-mouche. Sous certaines réserves, il est
légitime de représenter le caractérisé par un équivalent simple d'une autre
langue : cheval blanc : all. Schimmel, pêcher à la ligne : all. angeln, mourir de
faim : angl. to starve, etc.
Aucun de ces échanges n'est possible avec un actualisé explicite : « le livre
de mon frère ; je pécherai avec cette ligne, etc. »
Modalités de la caractérisation des virtuels
135. La distinction entre actualisation explicite et caractérisation étant
bien établie, on peut être très bref sur les modalités de la caractérisation, car
celle-ci relève plus du vocabulaire que de la grammaire.
Les caractérisés appartiennent à la classe de mots de leur déterminé ; on
peut caractériser des substantifs (maison blanche, maison de campagne), des
adjectifs (affreusement laid, blanc de neige), des verbes (agir prudemment,
mourir de froid), des adverbes (fort justement, conformément à l'usage), des
ligaments grammaticaux (à cause de, etc. 136).
La caractérisation peut être intérieure aux mots ; tout mot qui n'est pas
simple est un virtuel caractérisé : il en est ainsi des composés (bleu foncé,
90assurance-vieillesse, porte-plume ; cf. 141 ss.), des préfixaux (im-patient, em-poter,
ap-porter) et des suffixaux (encr-ier, jardin-et ; cf. 174).
Enfin la caractérisation interne peut être totalement implicite et présenter
tous les degrés qui mènent du signe motivé au signe arbitraire. Ainsi par
cumul (225), charrue désigne un instrument pour labourer, et cette analyse
est nécessaire et spontanée ; il en est de même pour meute « troupe de chiens
de chasse ». Cette vue sera complétée § 205ss.
136. Les ligaments grammaticaux peuvent être, eux aussi, caractérisés
(ou lexicalisés) ; c'est le cas toutes les fois qu'un outil grammatical exprime
un rapport spécialisé par une notion spatiale, temporelle ou abstraite ;
cette spécialisation est le plus souvent interne, et fait corps avec l'idée de
lien grammatical pur. L'idée spatiale, temporelle ou abstraite peut être
au premier plan, comme dans les prépositions vers, dès, à cause de. Les verbes
transitifs (168) sont l'exemple-type de ligaments grammaticaux où la
caractérisation est dominante. Dans d'autres cas, la spécialisation n'apparaît
pas dans la forme, mais elle est imposée par l'usage ; ainsi dans « mourir
de froid », de exprime nettement, et par lui-même, une idée de cause, mais
rien ne l'indique dans la forme. Ce cas est comparable à celui de meute et
charrue dans l'ordre lexical.
Un cas très fréquent de caractérisation grammaticale est celui où un type
général de relation (p. ex. l'hypothèse marquée par si) est spécifié par la
structure de la phrase, l'emploi de tel ou tel mode ou temps du verbe, etc.
(p. ex. deux nuances de l'hypothèse spécifiées par la distinction entre le présent
et l'imparfait : si tu veux : si tu voulais).
Le ligament grammatical n'est absolument pur que lorsqu'on n'y distingue
pas autre chose qu'un rapport d'accord ou de rection (164ss.) ; d'accord
dans robe blanche, de rection dans maison de campagne. On peut dire
alors — ce qui revient au même — que la caractérisation du ligament pur
dépend de la parole et diffère d'un cas à l'autre : ainsi maison de campagne
= « maison située à la campagne », maison de repos = « m. destinée à procurer
le repos », cadeau d'un ami = « fait par un ami », etc., etc.
137. Le ligament peut être implicite ; c'est ce qu'on observe p. ex. dans
les constructions participiales dites absolues, dont le rapport réel avec la
phrase principale dépend de la parole : L'ennemi vaincu, l'armée rentra au
camp (= « lorsque ») ; L'avenir étant incertain, je reste dans l'expectative
(= « comme, parce que »). C'est le cas aussi dans les coordonnées sans conjonction
de coordination (68) : Il fait froid. Restons à la maison (= « donc ») ;
91c'est encore le cas dans les segmentées (79ss.) : Vous n'êtes pas gentilhomme,
vous n'aurez pas ma fille (= « puisque », conjonction subordinative).
Notons cependant que le ligament implicite peut être caractérisé par la
langue, non par la parole, p. ex. dans le tour infinitif : Je viens vous demander
un service (= « pour, afin de »).
138. L'appartenance d'un mot simple et arbitraire à une classe de mots
(substantif, adjectif, etc.) est un cas-limite de caractérisation ; un mot
simple est caractérisé minimalement par le fait qu'il est classé spontanément
dans une partie du discours ; ainsi arbre désigne une chose caractérisée
par ses qualités d'arbre, travailler une action spécifiée par les caractères du
travail, etc. Seule une langue qui ne connaît pas les catégories a des mots
absolument simples.
De même, dans nos langues, les signes grammaticaux non lexicalisés permettent
(165, 167) de distinguer au moins l'accord de la rection ; c'est le
pendant grammatical des parties du discours. Dans un idiome qui ne ferait
pas cette distinction, le signe grammatical perdrait ce minimum de caractérisation
et serait totalement arbitraire. On peut rappeler qu'en persan la
particule i sert pour l'accord et la rection : comparez gul i surkh « rose rouge »
et bère i gul « pétale de rose ».
En français « d'avant-garde », que est aussi sur le point de devenir une particule
« passe-partout » ; dans J'affirme que tu es innocent = « J'affirme ton
innocence », elle est un ligament de rection, mais dans le tour populaire une
femme que son mari est mort à la guerre, elle introduit une proposition relative,
donc adjective ; elle est un ligament d'accord (cf. G. Cuendet, Mélanges
Bally, p. 93ss.).
139. Mentionnons un autre cas-limite de la caractérisation : le genre
grammatical (115n.). Il importe peu qu'il ait sa marque propre dans le
substantif lui-même, p. ex. sous la forme d'un suffixe qui ne comporte
qu'un genre, comme dans fr. audi-teur, audi-trice, all. Mäd-chen, ou qu'il
soit déterminé seulement par la forme des actualisateurs ou des adjectifs
accordés avec lui (cette table, air vif) : dans les deux cas, le substantif,
même isolé de tout contexte, est « pensé » avec son genre : table est féminin
en tant que mot. Or, le genre présente les choses à l'imagination sous
certains aspects, avec certaines particularités, si vagues soient-elles (117) ;
le genre caractérise donc, à sa manière, les substantifs virtuels.
Dans la catégorie du verbe, les aspects (115 IIb) relèvent aussi de la
caractérisation ; ils portent sur l'action envisagée dans sa virtualité. Dans
92reconnaître, all. erkennen, l'aspect terminatif est signifié par un préfixe
attaché au radical ; dans toussoter, l'itératif est exprimé par un infixe, de
même qu'en russe le perfectif peut l'être par le suffixe -nutʼ. Souvent le
signe aspectif est cumulé avec le signe temporel, p. ex. au passé simple
du français (585) et à l'indicatif de l'aoriste grec ; mais cela n'empêche pas
l'aspect d'être distinct du temps : celui-ci, comme nous l'avons dit (113 Ib),
actualise le procès et relève de la parole, non de la langue.
140. Il y a une caractérisation des phonèmes. Un phonème est caractérisé
lorsque les sujets ont le sentiment spontané (mais le plus souvent
inconscient) qu'il est une espèce d'un genre. Ainsi, en français, p et b sont
étroitement unis dans leurs caractères communs et distingués par leurs
différences spécifiques (sourdité et sonorité) ; de même t et d, k et g,
á et à, etc. A ce propos, il importe de noter les points suivants :
1) Les caractères spécifiques sont naturellement intérieurs aux phonèmes ;
les oppositions entre phonèmes ne sont pas comparables au type cheval
blanc : cheval noir, mais à celui de l'allemand Schimmel : Rappe.
2) Ces caractères peuvent être nettement perçus sans que les sujets
aient la moindre notion du mécanisme musculaire qui les produit ; la plupart
des Français ignorent que g diffère de k par la présence de vibrations laryngales.
L'explication purement phonétique fausse la perspective phonologique,
fondée, comme on sait, sur ce que les sujets croient prononcer.
3) Il s'ensuit que ces mêmes sujets n'ont pas conscience qu'un caractère
s'ajoute à un phonème qui en serait privé ; k et g sont exactement parallèles,
comme Schimmel et Rappe. Il n'y a donc pas hiérarchie dans les phonèmes
associés, mais interdépendance et opposition : k est solidaire de g, mais g
n'est pas un k auquel s'ajouteraient des vibrations glottales.
Comme les phonèmes forment un système, un même phonème peut être
caractérisé dans une langue et ne pas l'être dans une autre. Il n'y a qu'un l
en français (l mouillé a à peu près cédé la place à y) ; mais il y en a deux
en russe, l'un vélaire (l), l'autre palatal (lʼ) : cf. pïl « flamme » et pïlʼ
« poussière » ; ces deux l sont sentis différents ; peut-être se rend-on compte
des positions respectives de la langue dans l'émission de l'un et de l'autre,
mais ils sont sentis égaux l'un à l'autre.93
Composés
141. Nous appelons composé un syntagme virtuel caractérisé qui désigne,
en la motivant, une idée unique : fr. pot à eau, all. Wassertopf.
a) Le composé est un syntagme : chacune des pièces qui y entrent peut
donc être remplacée par une autre de la même classe (160) ; au lieu de
pot à eau, on peut dire d'une part pot à lait, pot à vin, etc., d'autre part
verre à eau, verre à vin, etc. Par là, le composé se distingue du groupe
locutionnel, dont les éléments ne souffrent aucun échange de ce genre,
p. ex. pot au feu, blanc-manger, etc. (218). A plus forte raison ne doit-on
pas appeler composés, en statique, d'anciens syntagmes dont les altérations
phonétiques ont rendu l'analyse impossible, comme connétable (comes
stabuli), aubépine (alba spina), etc.
b) Le composé exprime une idée unique : il est donc susceptible d'être
remplacé par un mot unique (oiseau-mouche = colibri), même si le sens
n'est pas absolument identique (cf. verre à bière et chope, pot à eau et
carafe ou aiguière). Par là, le composé diffère du groupe syntaxique, où
plusieurs idées sont discernables, comme c'est le cas pour étoffe rouge,
bijou précieux, qui n'ont pas d'équivalents dans les mots simples.
c) Enfin le composé est un virtuel ; l'absence de signes d'actualisation
l'oppose aux groupes syntaxiques parallèles : fils de roi : le fils du roi,
lettres et paquets : les lettres et les paquets, rendre service : rendre un service,
agir en ennemi : agir comme un ennemi, etc. Le français moderne connaît
des composés où un substantif est accompagné de l'article le, la, mais
celui-ci n'actualise plus ; ainsi prendre la fuite, pêcher à la ligne (133b).
Prendre la fuite est de même espèce que prendre peur ; comparez aller à
la messe et aller à confesse, boîte aux lettres et boîte à chapeaux. Il n'y a
plus de différence entre pot à lait et pot au lait.
142. Le caractère virtuel du composé se reconnaît aussi, comme on l'a
vu (133), à l'impossibilité de joindre une détermination actualisante à l'un
des composants. Dans « les lettres et paquets livrés par la poste », le participe
ne peut se rapporter qu'à l'ensemble, non au dernier substantif. On peut
dire « enduire de graisse, de graisse de porc, de beurre fondu, etc. », car les
seconds éléments de ces composés sont des virtuels ; mais « enduire de
graisse qui salit les doigts » est incorrect : on dit « d'une graisse qui… ».
Incorrects aussi les tours « Pêcher à la ligne, qui est plus maniable que le
filet. Je vais à la messe, qui n'est pas encore commencée ». Il y a une
94exception apparente dans le traitement de de avec un substantif au pluriel ;
on peut dire « Garnir de rubans bleus qui tombent jusqu'à terre », « Cet
habit est couvert de taches que rien ne peut faire disparaître » ; mais c'est
qu'ici de équivaut, par cumul (225), à de des ; cf. « Cet habit a des taches
que… » ; le substantif est donc actualisé et peut recevoir une détermination
propre.
143. D'autres caractères encore séparent le composé du groupe syntaxique.
L'un des composants ou tous les deux peuvent n'avoir pas la
forme de mots ordinaires. Ainsi en latin signifer « porte-enseigne » a une
forme de signum qui n'apparaît nulle part, et -fer n'existe pas comme mot
indépendant. Ce cas est très rare en français, où les composés, malgré tout,
se rapprochent de la syntaxe. On peut citer cependant le type porte-plume,
essuie-mains, etc., où l'élément verbal n'a plus la valeur ni d'un impératif
ni d'un indicatif, mais est un pur radical ; porte-plume correspond à peu
près à ce que serait en grec pherekálamos.
La distinction du singulier et du pluriel est totalement ou partiellement
effacée dans les composants : dans porte-plume, ni porte ni plume ne
sont pensés à un nombre déterminé ; seule l'orthographe maintient artificiellement
des nuances inexistantes. On peut rappeler qu'on ne fait pas
la liaison entre les composants, p. ex. dans « des moulins à vent », et qu'inversement,
on se surprend à dire « les chemins de fer z algériens, des pots t à
eau ». C'est que le composé dans son ensemble est seul susceptible d'être
au singulier ou au pluriel ; on en a un indice dans l'habitude de dire « un
nom d'animal, des noms d'animaux » et d'orthographier « un nom de lieu,
des noms de lieux ; un cure-dent, des cure-dents ; un passeport, des passeports ».
Cet effacement de la notion de nombre n'est cependant pas absolu,
car on la retrouve dans tailleur pour messieurs, char à quatre roues, all.
Kindergarten, etc.
144. Le composé se reconnaît encore à ce que les composants peuvent
ne pas être liés entre eux par les procédés de la syntaxe de la phrase ;
citons la juxtaposition de deux substantifs, comme dans la question argent,
l'assurance vieillesse ; la construction transitive de certains verbes intransitifs
comme parler politique, parler français, et l'emploi de certaines prépositions
dans des fonctions que la syntaxe repousse, comme à désignant
la destination (pot à lait, moulin à café), par opposition à un pot pour le
lait, etc. Un cas curieux est celui du type chaleur solaire, qui sera repris
au § 147.95
145. Les composés reflètent les principaux types de rapports grammaticaux :
il y a des composés de coordination : nos parents et amis ; hommes,
femmes et enfants ; sourd-muet ; rouge-blanc-bleu ; des composés d'accord
(chaleur solaire) et de rection (maison de campagne, porte-plume).
Les composés peuvent appartenir à n'importe quelle catégorie lexicale :
substantifs (pot à lait), adjectifs (sourd-muet), verbes (enduire de graisse),
adverbes (sac au dos, l'épée à la main). Enfin, il y a des composés de
phrases (Vive le roi ! A bas les tyrans !).
146. D'une étude d'ensemble qu'il est impossible d'aborder ici, nous
extrayons deux ou trois points particuliers susceptibles d'intéresser à un
point de vue plus général.
Les composés de coordination sont appelés, selon leur valeur spéciale,
composés copulatifs, collectifs, etc. Nous y insistons, parce qu'ils concernent
indirectement la question de l'autonomie du substantif, qui sera
traitée § 466 ss.
Dans un premier type, la nature du composé est marquée par le fait
que son actualisateur ne figure que devant le premier des substantifs :
les lettres et paquets ; mon parent et ami. Ces formes appartiennent surtout
à la langue administrative et sont peu usitées dans le langage courant.
Remarquons en passant que dans les lettres et paquets, le collectif est pris
en extension, il désigne un ensemble de choses ; il est pris au contraire en
compréhension dans M. X., mon parent et ami ; il s'agit d'un groupe de
qualités. Il s'ensuit que les deux types se confondent au pluriel et prêtent
à confusion, p. ex. dans Nous recevrons aujourd'hui nos parents et amis Paul,
Jacques et Jean.
Un second type de collectif se rapproche de l'énumération (77) ; exemple :
Hommes, femmes et enfants (furent passés au fil de l'épée). Là, en apparence,
point d'article ; mais en fait il est zéro (248) : hommes, femmes et enfants
équivaut à « l'ensemble formé par les hommes, les femmes et les enfants » ;
il va sans dire que cet article se rapporte au tout, et le type est bien distinct
de « les hommes, les femmes et les enfants ».
Le composé coordinatif est de nature oppositive dans des cas comme
« Forme et valeur sont solidaires ; rapports entre frères et sœurs », etc. Ici
encore, l'article est zéro et se rapporte au syntagme total.
147. Dans les composés d'accord, mentionnons le type chaleur solaire.
Un groupe formé d'un substantif et d'un adjectif est un composé quand
l'adjectif apparaît étroitement lié au substantif par le fait qu'il repousse
96la syntaxe de l'adjectif ordinaire. Ainsi dans chaleur solaire, solaire ne
peut pas se placer devant le substantif (solaire chaleur est impossible) ; il
ne peut recevoir les adverbes propres à l'adjectif : on ne peut pas dire
chaleur très solaire ; enfin et surtout, il ne peut fonctionner comme prédicat :
Cette chaleur est solaire serait inintelligible.
On fera les mêmes constatations à propos de boîte cranienne, anémie
cérébrale, etc., etc. Le caractère de composé est encore plus apparent quand
il s'agit de noms propres selon la définition donnée au § 116, c'est-à-dire
de la désignation de choses uniques en leur genre, comme l'étoile polaire,
l'histoire romaine, la municipalité parisienne, ou existant en nombre déterminé :
les cercles polaires (cf. les rives de la Seine).
On ne confondra pas ce type avec le cas de événement bien parisien,
chaleur véritablement tropicale (180), où l'on a affaire à des adjectifs proprement
dits. On sait que, au contraire, dans les composés du type chaleur
solaire, l'adjectif dit « de relation » transpose des substantifs (soleil, crâne,
cerveau, etc.) sans rien changer à leur valeur de substantifs.
148. Les composés verbaux les plus importants sont ceux qui permettent
au français de dédoubler l'expression verbale en détachant le sémantème
de l'élément proprement grammatical et en le plaçant à la fin du syntagme,
généralement sous la forme d'un substantif (comparez faire impression et
impressionner). C'est à cette tendance qu'on doit l'expression analytique
des aspects (395) : prendre la fuite, entrer en scène, en séance, pousser un
soupir, être au travail, être en construction ; du causatif : faire bâtir une
maison, donner un habit à réparer ; du verbe pur et simple : faire panache,
faire tête à queue, faire la lessive, etc. On notera cependant que dans ces
cas, le verbe fléchi, ayant un sens général, n'est guère interchangeable avec
d'autres de même signification, et cesse d'être élément de composé pour
prendre une valeur voisine de celle d'un préfixe.
149. Il y a enfin des phrases composées. Nous savons (61 ss.) qu'une
phrase peut avoir la forme d'un mot simple (Mes pantoufles ! Un avion !) :
il est donc naturel, a priori, qu'elle puisse avoir celle d'un mot composé.
C'est le cas lorsque les membres qui la constituent n'ont pas la forme
qu'exige la syntaxe stricte, ou qu'ils sont unis par des procédés étrangers
à cette syntaxe, sans que la phrase, dans son ensemble, perde son caractère
propre.
Soit l'expression Vive le roi ! : c'est une phrase authentique, qui équivaut
à j'acclame, je glorifie le roi. Mais le premier membre a une forme exclamative
97inanalysable. D'autre part, le syntagme vive le roi est libre, comme
celui des composés, puisqu'on peut dire, en brodant sur le même canevas,
A bas les mouchards ! Au diable les soucis ! Malheur aux vaincus ! Gloire
à Dieu ! Hourra pour l'empereur !, etc. On remarquera que la séquence est
ici progressive (ttʼ), comme dans les composés proprement dits du français.
L'intonation, à elle seule, le montrerait : si l'on prononçait « A la porte,
les perturbateurs ! » comme « Je le déteste, cet homme », l'ordre serait au
contraire tʼt (phrase segmentée ZA, v. 87).
150. Il va sans dire que les composés ne sont pas séparés des types
voisins par des cloisons étanches ; ce serait contraire à l'essence même du
langage. Un groupe de mots donnera l'impression d'un composé dans la
mesure où les critères les plus décisifs apparaissent (p. ex. la réduction
d'un mot à un radical, comme dans porte-plume), ou bien selon que plusieurs
critères concourent à lui donner ce caractère (p. ex. dans pot à lait,
l'emploi non syntaxique de à et l'absence d'actualisateur devant lait). On
sait d'autre part qu'il suffit qu'un groupe de mots soit très usuel pour
qu'il s'agglutine et se rapproche du mot simple (217) : comparez pot à lait
et pot-au-feu.
Quant aux vrais composés du français, pris dans leur ensemble, ils se
rapprochent sensiblement des groupes syntaxiques, dont ils ne sont parfois
séparés que par de très fines nuances ; plusieurs des exemples cités en
font foi. C'est là une des différences les plus remarquables avec l'allemand,
où les composés ont une physionomie beaucoup plus accusée.
Condensation de la phrase en signes virtuels
151. Demandons-nous maintenant comment, des termes actualisés de
la phrase, on a pu tirer des signes virtuels et des actualisateurs.
On sait en effet que la langue est sortie de la parole, et que tout ce qui
est virtuel dans la langue a commencé par être actuel. L'enfant qui emploie
l'onomatopée oua oua ne lui donne certes pas la signification virtuelle
de « chien » ; le monorème oua oua signifie pour lui « Ici il y a un chien »
ou « Voici mon chien », etc. Le signe actuel a précédé le signe virtuel.
Comment s'est effectué le passage ? Nous nous permettons, ici encore,
d'employer des exemples latins pour symboliser un état primitif hypothétique.
Dans Canis latrat, canis est (implicitement) actuel (122). De même
dans canis meus « le chien est mien ». Mais supposons que deux coordonnées
98Canis meus ! Latrat ! se resserrent en un dirème, de la façon qui a été décrite
ci-dessus (67) : canis meus signifie « Ce chien (qui est) à moi » et finalement
« le chien (qui est) à moi », « mon chien » ; chien est alors un virtuel,
actualisé par le possessif.
De même, Meus canis strenuus « Mon chien est brave » est devenu « mon
brave chien » dans Meus canis strenuus latrat, et canis strenuus « brave
chien » est un virtuel caractérisé. De même encore Hic homo (où hic remplace
un ancien adverbe déictique ; cf. l'homonyme hic « ici ») = « Ici est
un homme, voici un homme » ; Hic homo ambulat = « L'homme (qui est)
ici marche ». Domus patris = « La maison est à mon père » ; Domus patris
alta = « La maison de mon père (est) haute ».
152. Ce même resserrement explique plusieurs autres types de membres
de phrases, et finalement le passage du signe actuel au signe virtuel. Les quelques
faits exposés ici ne sont qu'une orientation générale.
Certains adverbes ont été d'abord des phrases autonomes, puis on les a
rattachés étroitement au verbe d'une autre phrase. C'est le cas p. ex. des
locutions adverbiales « absolues » telles que sac au dos, l'épée à la main, drapeau
en tête, la tête haute. Ces expressions étaient primitivement des phrases
indépendantes, le plus souvent des commandements : « La tête haute ! » =
« Tenez la tête haute ». Puis, combinées avec d'autres phrases par la coordination
(ex. « Marchez ! La tête haute ! » c'est-à-dire « Marchez et tenez la
tête haute »), elles ont fini par n'en former qu'une, par imitation de phrases
liées de sens analogue. On a dit « Marchez la tête haute » sur le modèle de
« Marchez résolument, hardiment, etc. ». C'est de la même façon qu'un impératif
tel que « Porte (la) plume » a fini par devenir un substantif : le porte-plume.
Ce procès est toujours à l'œuvre ; dans le parler populaire, une expression
telle que « Le patron est en colère (il) faut voir » finit par signifier « est extrêmement
en colère » (pas de pause interne).
Les adverbes modaux (peut-être, naturellement, certes, etc.) sont, pour la
plupart, d'anciennes coordonnées adjointes ou incises (70). Il s'agit partout
de phrases monorèmes, plus ou moins exclamatives, qui interrompaient le
courant de la phrase et ont fini par y être absorbées. Mais elles reprennent,
à l'occasion, leur indépendance : « Vous avez — oh ! sûrement — entendu parler
de la chose ».
153. Les éléments des mots complexes (composés, préfixaux, suffixaux,
dont nous parlons ci-après au point de vue statique § 378 ss.) remontent,
99eux aussi, aux éléments actualisés de la phrase. On sait p. ex. que les composés
sont d'anciens groupes syntaxiques devenus virtuels ; plusieurs portent
encore la marque de leur origine ; ainsi, en allemand, Mannesalter « âge
viril » est à peine différent, pour la forme, de des Mannes Alter « l'âge de
l'homme ».
Il n'en va pas autrement pour les préfixes : ce sont d'anciens adverbes
équivalant à des prépositions à régime actuel implicite (354). Ainsi le latin
superponere « superposer » a signifié d'abord « poser (une chose) au-dessus
(d'une autre) » et cette autre chose était nécessairement (et est encore en
latin) désignée par un actuel.
Les suffixes sont eux aussi d'anciens mots autonomes employés en fonction
actuelle (cf, all. -heit, -tum, -lich, -bar, -sam, etc.). Il s'ensuit que les
mots suffixaux remontent à d'anciens groupes syntaxiques ; ainsi l'allemand
Gottheit correspond à gotique gudis haidus « la manière d'être de
Dieu » ; clairement remonte au latin clarā mente « avec un esprit clair ». Ces
choses sont trop connues pour que d'autres précisions soient nécessaires sur
le passage du signe actuel au virtuel.100
Chapitre IV
Rapports grammaticaux et
questions connexes
Syntagmatique
154. Toute énonciation comprend logiquement deux termes, la chose
dont on parle et ce qu'on en dit ; ce qu'on en dit est le propos ou prédicat
(dans le sens large) ; le terme qui est l'occasion du propos est le thème ou
sujet (dans le sens large).
Le propos est rattaché au thème par un ligament grammatical, p. ex. la
copule être ; ce signe fait corps avec le propos (« La terre — est ronde »). Le
sujet est le lieu du prédicat, et c'est la copule qui localise le prédicat dans le
sujet.
Quand je dis « Galilée affirme que la terre tourne », la terre tourne est une
idée que je place, pour ainsi dire, dans l'esprit de Galilée, que je lui attribue
au moyen du verbe affirme ; ce verbe, attaché à « la terre tourne » (le propos),
est un ligament grammatical que nous avons appelé copule modale (33).
Ainsi, dans la phrase logiquement complète, c'est le dictum tout entier qui
est le propos. La copule modale est un verbe transitif dont le dictum est le
complément d'objet, et l'on sait que celui-ci est inséparable de son verbe :
Paul — bat Pierre.
Même mécanisme dans la proposition-dictum, et, ce qui revient au même,
dans la phrase réduite au dictum. Dans « la terre est ronde », rond est une
qualité dont la terre est le siège ; le verbe être, ou plutôt son radical, est
attaché à l'adjectif et le relie au sujet la terre (29).
Dans « La terre tourne », le propos est constitué par le radical du verbe, et
c'est l'idée générale d'action ou d'état, contenue par cumul (225) dans tout
verbe, qui joue le rôle de copule implicite : comparez souffrir et être souffrant,
vivre et être en vie, La terre tourne et La terre est en rotation, Je travaille
et Je suis au travail. Syntagmatiquement, tourne est strictement parallèle
à est ronde (cf. latin « domus vacat » et fr. « la maison est vide », latin « rosa
rubet » et fr. « la rose est rouge », etc.).
La comparaison de (La terre) tourne et de (La terre) est ronde montre
encore mieux que la copule est inséparable du propos. Elle forme avec lui
un syntagme partiel où elle a le rôle de déterminé, et le propos celui de déterminant.
101C'est par elle et avec elle que le propos tout entier est lui-même
le déterminant du thème. Si l'on désigne celui-ci par A, le propos par Z et la
copule par c, la formule de toute énonciation est, non pas A + c + Z (La
terre — est — ronde), mais A x cZ (La terre — est : ronde) ; on peut, pour la
commodité, la réduire à AZ, mais à condition de sous-entendre que tout Z
renferme son ligament, sa copule 138.
155. Tout ensemble de signes répondant à la formule AZ est dit syntagme ;
ainsi la phrase est un syntagme, de même que tout groupe de signes
plus grand ou plus petit, susceptible d'être ramené à la forme de la phrase.
Il est d'usage, pour les syntagmes réduits, de remplacer « thème » par
déterminé et « propos » par déterminant. Nous préférons aussi, dans ce cas,
remplacer A par t et Z par tʼ. D'ailleurs, nous emploierons dans la suite ttʼ
(ou tʼt) pour désigner un syntagme quel qu'il soit.
Dans toutes les formes d'énonciation, le thème (A) et le propos (Z), le
déterminé (t) et le déterminant (tʼ) sont dans un rapport d'interdépendance,
de complémentarité, de conditionnement réciproque. On ne peut imaginer
d'énoncé sans qu'on dise ou pense à propos de quoi il est fait. On retrouve
ce genre de rapport dans tous les types de syntagmes : pas de sujet sans prédicat
et vice versa ; pas de copule sans un terme qu'elle rattache au déterminé
(par exemple : pas de verbe transitif sans un complément d'objet ;
inversement, pas de complément d'objet sans un verbe transitif, etc.) 239.
Ce principe de complémentarité est absolu dans les réalisations de la
parole, tandis que dans la langue, au point de vue mémoriel, il y a des cas de
détermination unilatérale à côté des cas de complémentarité : ainsi un adjectif
détermine nécessairement un substantif, tandis qu'un substantif n'est
pas nécessairement déterminé par un adjectif. Dans la parole, au contraire,
un syntagme tel que robe rouge ne présente pas cette dualité, robe étant
déterminé par rouge et rouge déterminant robe. C'est la complémentarité au
sein de la langue qui explique le jeu des catégories linguistiques.
Tout syntagme est donc le produit d'une relation d'interdépendance grammaticale
établie entre deux signes lexicaux appartenant à deux catégories complémentaires
102l'une de l'autre. C'est dans ce sens qu'on peut dire en abrégé :
tout syntagme est binaire.
Le rapport syntagmatique exclut donc la coordination et les groupements
qui en dérivent. En effet, deux phrases coordonnées, bien que liées
entre elles, sont autonomes (71). Si, dans l'intérieur d'une phrase, deux ou
plusieurs termes sont groupés coordinativement (p. ex. sous forme d'énumération
ou d'opposition), ils comptent pour un seul terme : dans la phrase :
« Les chevaux, les chiens, les chats sont des animaux intelligents et utiles »,
les trois substantifs ne valent que pour un seul sujet, et les deux adjectifs
pour un seul prédicat. De même dans « Cet homme est pauvre, mais honnête ».
156. Le caractère binaire du syntagme est moins apparent, mais tout
aussi réel, lorsque l'un ou l'autre des termes, ou tous les deux, sont complexes.
Ainsi un composé peut renfermer plus de deux unités syntagmatiques,
mais celles-ci se regroupent toujours en binômes : machines : à coudre
- Singer, patrons — de robes : pour dames et fillettes. Même lorsque deux analyses
sont possibles, l'esprit doit opter, mais non renoncer à l'analyse ; ainsi
maître d'école de village signifie ou bien maître d'école enseignant dans un
village ou bien maître enseignant dans une école de village. De même all.
Dorfschullehrer.
157. Un syntagme peut être implicite. C'est le cas lorsqu'un des termes
ou tous les deux ne sont pas représentés par des signes positifs mais sont
nécessairement rétablis par association avec des syntagmes explicites. Ces
variétés seront étudiées dans la seconde section. Mentionnons à titre
d'exemples le cas du cumul (225) : pire (cf. plus mauvais), la sous-entente
(244) : latin (Paulus) aeger = (P.) est aeger, le signe zéro (248) : (la)
marche (cf. mouve-ment), l'hypostase (257) : (étoffe) orange (cf. argent-é).
158. En anticipant sur la théorie de la tranposition (179 ss.), on posera
les deux règles suivantes, qui découlent du caractère binaire des syntagmes :
1) Un composé ne peut pas être dérivé, et un dérivé ne peut pas être
composé. En effet d'une part, pot à lait, all. Milchtopf, étant de la même
catégorie que le mot simple pot (Topf) ne sont pas dérivés ; inversement,
porte-plume (= (chose qui) porte une plume) et all. Federhalter 140 (= etwas
103(-er), was eine Feder hält) sont des dérivés, le premier au moyen d'un suffixe
implicite, le second par le suffixe -er ; il s'ensuit que le suffixe est le
t de l'ensemble du radical complexe, lequel équivaut à une unité tʼ.
159. 2) Un mot préfixal n'a pas de suffixe et un suffixal n'a pas de
préfixe. Ainsi dans (je) réélis, ré- est bien un préfixe qui détermine élis, et
réélis n'est pas un dérivé de élis ; mais dans (ré-élec)-tion, ré- est un élément
d'un syntagme partiel qui détermine dans son ensemble le suffixe -tion.
Une variété importante du second cas est celle où un « préfixe » est en
réalité une préposition qui, avec son régime, a passé dans le radical d'un
verbe ou d'un adjectif (174A) ; ainsi en barque (syntagme ttʼ) a formé le
verbe embarquer, littéralement « mettre en barque », où em- n'est pas un
élément autonome ; comparez emporter « porter loin » (tʼt) où em- est vraiment
préfixe (tʼ) et terme autonome de syntagme ; extra- est préfixe autonome
dans extrafin « très fin » (tʼt) et préposition (t) dans extrabudgétaire
« qui est en dehors du budget ».
160. Un syntagme de n'importe quelle forme a pour caractère fondamental
d'être libre, c'est-à-dire que les signes lexicaux qui le composent
sont échangeables avec n'importe quel autre signe de la même catégorie,
sans que le syntagme soit grammaticalement altéré. Ainsi « table ronde »
peut être changé en table carrée, polie, etc., ou en table carrée, planche carrée,
feuille carrée, etc. Même des combinaisons absurdes telles que table tendre
ou cercle carré sont parfaitement correctes au point de vue grammatical.
Il va sans dire qu'il ne peut y avoir échange direct de signes d'une
même catégorie quand celui qui figure dans le syntagme représente lui-même
la catégorie tout entière. C'est le cas, par exemple, des suffixes.
Ainsi dans imitation, -ation n'est directement remplaçable par rien ; mais
comme il désigne l'action en général, il suggère indirectement tous les substantifs
abstraits qui peuvent désigner les modalités de cette idée et être
déterminés par celle d'imiter : « fait d'imiter : dessein, intention d'imiter,
etc. ». De sorte que le syntagme imitation est absolument libre.
Il en est de même des ligaments grammaticaux purs. Dans « la maison
de mon père », de exprime un rapport de rection variable d'un contexte à
l'autre, et qui implique un nombre illimité de modalités (« la tendresse
d'une mère, la passion du jeu, etc. ») ; dans chaque cas, de suppose de multiples
équivalents sémantiques : « la maison appartenant à, possédée par
mon père », la tendresse manifestée par une mère », « la passion inspirée par
le jeu », etc.104
Sur le plan de la parole, le cas des actualisateurs est semblable : « mon
chapeau » ne comporte directement qu'un petit nombre d'échanges (« ton,
son chapeau, etc. ») ; mais « mon chapeau » = « le chapeau de la personne
qui parle » ; or, cette personne varie indéfiniment ; le syntagme en question
est un syntagme libre de la parole.
Il suit de là que tout syntagme peut être remplacé dans son ensemble
par un syntagme de la même catégorie : table ronde est de même espèce que
planche carrée, arbre vert, bois dur, etc., etc., parce que chacun de ces
groupes s'analyse exactement de la même façon.
Le syntagme se distingue donc du groupe agglutiné (217), qui n'admet
pas d'échanges du type table ronde, table carrée ; table ronde, pomme ronde ;
on ne peut remplacer ouvrir les hostilités par « ouvrir la guerre, ouvrir la
bataille ». D'autre part, si un groupe agglutiné est échangeable avec un
autre groupe, cette substitution ne fait pas découvrir un rapport grammatical
commun (tout à coup : sur-le-champ).
161. Un syntagme peut constituer une énonciation complète (une phrase),
ou une partie seulement de cette énonciation. Mais cette distinction a une
valeur différente selon qu'on se place au point de vue discursif, dans les
réalisations de la parole, ou au point de vue mémoriel et associatif de la langue.
1) Discursivement, un syntagme total est, naturellement, une phrase
et un syntagme partiel, une partie de phrase. Dans « Le frère de Paul est
mon ami », syntagme total, « le frère de Paul » est un sujet complexe, et
par suite un syntagme partiel où frère est le déterminé et Paul le déterminant ;
de même « est mon ami » forme un prédicat complexe, un syntagme
partiel, composé de la copule (t) et de l'attribut « mon ami » (tʼ) ; à son tour,
« mon ami » se décompose en deux termes : ami, le déterminé, et mon (= « de
moi »), le déterminant.
Inversement, tout terme de phrase peut être syntagmatisé par adjonction
d'un déterminant, sans que la valeur grammaticale de ce terme soit
modifiée. Si p. ex. « le général » devient « le général de la IIe division » ou
« le général auquel on a confié le commandement de l'armée », toutes ces
expressions remplissent la même fonction dans une phrase donnée ; il en
est de même pour « blanc » et « blanc de neige » ; dans « Je te punirai » et
« Je te punirai si tu désobéis », le prédicat punirai reste prédicat avec ou
sans l'appoint du complément circonstanciel si tu désobéis.
2) Associativement, un syntagme total est un syntagme susceptible
d'être ramené mentalement à une phrase contenant un verbe personnel
105dont le sujet est un appellatif ou l'équivalent d'un appellatif. L'appellatif
est un nom (simple ou complexe) désignant un être ou une chose (enfant,
maître d'école, laboureur ; table, pot à lait, encrier) ; les équivalents des
appellatifs sont les représentants et les déictiques (125) : il, ceci, moi, je,
qui, etc.
Voici quelques exemples où des syntagmes partiels sont convertis en
phrases : « (un homme) qui trahit sa patrie » Il la trahit ; « (Je sais) que tu
mens » Tu mens ; « une pomme rouge (= qui est rouge) » Elle est rouge ;
« la maison de mon père (= qui est à mon père) » Elle est à lui ; « mon chapeau
(= qui est à moi) » Il est à moi ; « cette table (= la table qui est ici) »
Elle est ici.
Les mots analysables dans leurs éléments obéissent aux mêmes conditions.
Les noms abstraits de qualité (vertu) et d'action (mort, etc.) sont également
réductibles à des phrases, mais le mécanisme de cette interversion
ne peut apparaître que par la théorie de la transposition, v. § 195.
162. Ce qui précède montre que tout ligament grammatical d'un syntagme
dérivé de la phrase se laisse ramener à un verbe. « La maison de
mon père » est une maison qui appartient à mon père, et rappelle la phrase
« Cette maison appartient à mon père » ; le rapport d'appartenance est contenu
implicitement dans de = « qui appartient à » ; de est un lien verbal,
un ligament, échangeable avec une copule (appartenir, être à), et qui relie
le déterminant au déterminé. Dans « une pomme ronde », on reconnaît aussi
un déterminé, le substantif, et un déterminant, l'adjectif ; ce qui sert ici
de copule, c'est la simple juxtaposition du substantif et de l'adjectif ; le
rapport qu'elle exprime est le même que celui de la copule dans « Cette
pomme est ronde ».
Ainsi, dans les langues indo-européennes, tout rapport grammatical est
verbal. La grammaire tout entière est dans le verbe ; inversement, tout verbe
exprime par lui-même ou contient de la grammaire, car il est une copule (165,
167) ou en contient une.
163. Le système phonologique a aussi sa syntagmatique. Les syntagmes
phonologiques se reconnaissent à la possibilité qu'ils offrent d'échanger
les éléments donnés avec d'autres de même espèce, et les ensembles avec
des ensembles présentant le même rapport phonologique. C'est ainsi que nt
(dans anta) peut être remplacé par nd, mp par mb. Ces couples sont sentis
comme homogènes par le fait que la première consonne est fermante de
106syllabe et la seconde ouvrante. Si les échanges sont infiniment moins nombreux
que pour les signes proprement dits, c'est que le système phonologique
est beaucoup plus pauvre.
Par là aussi, le syntagme phonologique se distingue de combinaisons
plus serrées qu'on peut assimiler aux agglutinations, p. ex. les mi-occlusives
(all. z), les aspirées (all. pʼ dans Pute), etc.
Le système phonologique connaît aussi le conditionnement réciproque
(239). L'exemple le plus connu est celui des assimilations. Ainsi en grec et
en latin, une consonne sonore devient sourde devant un suffixe commençant
par une sourde : grec légein : lektós, latin ago : actus. Dans la plupart
des langues, une nasale fermante de syllabe prend le point d'articulation
de la consonne suivante ; allemand impfen, Ente, Enkel. En russe, une consonne
se palatalise devant voyelle palatale : tʼebʼé « à toi », contre tobóy
« par toi ».
Dans tous ces cas, il ne s'agit plus d'évolution phonétique, mais de conditions
imposées, à une époque donnée, par le fonctionnement de la langue.
Dans tous ces cas aussi, on peut dire que l'un des sons est conditionné par
l'autre et réciproquement. Ainsi t ouvrant exige que devant lui la nasale
fermante ait la forme n ; inversement, n fermant suppose après lui une
dentale, p. ex. t ; pour cette raison, kt, nt, etc., sont des syntagmes phonologiques.
Le phonème qui commande l'assimilation peut être considéré
comme le déterminant et le son assimilé comme le déterminé, en sorte que
kt, nt, etc., sont des syntagmes ttʼ, tandis que dans angl. lovd (loved) et
laikt (liked), vd et kt sont des syntagmes tʼt.
Rapports grammaticaux — Accord et rection
164. Le rapport entre sujet et prédicat ou entre déterminé et déterminant
est d'inhérence ou de relation.
L'inhérence est une compenétration intime des deux termes et indique
soit qu'une chose (le sujet) appartient au genre désigné par l'attribut (« La
terre est une planète »), soit qu'il possède la qualité désignée par cet attribut,
propriété qui peut être ou une qualité constante (« La terre est ronde »), ou
un accident : état ou action (« La terre tourne »).
165. L'expression grammaticale de l'inhérence est l'accord.
L'accord est marqué par le radical de la copule être (son mode a une
autre fonction [48], ainsi que son temps [113 Ib], et, en français, par la
107concordance en genre et en nombre de l'attribut avec le sujet (« La terre
est ronde »), en nombre seulement si c'est un verbe (« La terre tourne »).
Les verbes intransitifs tels que marcher, travailler, souffrir, etc., renferment
par cumul (225) dans leur radical la copule et l'attribut : marcher —
« être en marche », travailler = « être au travail », souffrir = « être souffrant »,
Cet homme boit (habituellement) = « est un buveur ».
Comme tout ligament, la copule d'accord peut être pure (être) ou lexicalisée
(devenir, sembler, passer pour, etc.).
Un verbe intransitif du type tourner, etc., peut, non plus contenir simplement
la copule d'accord, mais devenir lui-même une copule lexicalisée.
C'est le produit du resserrement de deux coordonnées. Ainsi « La pluie
tombe ; (elle est) abondante » devient, par imitation de « La pluie est abondante »
La pluie tombe abondante. Ce même verbe tomber est une copule plus
pure encore dans « tomber malade, tomber amoureux », où il signifie positivement
devenir. Au contraire, l'origine coordinative est encore très visible
quand la pause médiane subsiste et que les deux termes ont des mélodies
semblables (71), comme dans « Il vit dans la retraite, indifférent à tout »,
par opposition à « Il vit indifférent à tout ».
166. La relation est un rapport entre deux objets extérieurs l'un à
l'autre 141, p.ex. livre et table dans « Le livre est sur la table », cerise et noyau
dans « La cerise a un noyau ». Ce rapport peut être établi en partant de
l'un ou l'autre des termes ; autrement dit, il est réversible : « Paul est près
de Pierre : Pierre est près de Paul. Cette maison appartient à mon père :
Mon père possède cette maison. Pierre bat Paul : Paul est battu par Pierre ».
Ce sont des raisons purement psychologiques qui font choisir l'un des
termes comme thème et l'autre comme objet de l'énoncé (61 ss.).
La relation est marquée linguistiquement par la syntaxe de rection.
Psychologiquement, celle-ci exprime toujours, au propre ou au figuré,
la position d'un objet par rapport à un autre : au propre, p. ex. « Une
chose est sur, sous, dans, devant, contre, près d'une autre » ; au figuré (espace
temporel) : « Un événement en précède un autre (ou lui succède, etc.) » ;
(espace conceptuel) : « Une chose appartient à quelqu'un, une chose ressemble
à une autre ». D'ailleurs, le mot « rapport » lui-même éveille une idée
de position spatiale. Mais les modalités de cette notion générale sont multiples.
C'est ainsi que, au propre et au figuré, la rection peut marquer
une position anticipée : s'approcher d'un endroit, c'est y être « en puissance »,
108s'en éloigner, c'est en être loin « par avance ». Tout mouvement dirigé est la
préfiguration d'un état. Cela est aussi naturel que, dans la syntaxe d'accord,
devenir vieux par rapport à être vieux.
167. Les exemples cités plus haut nous montrent que le rapport de
rection s'exprime naturellement dans nos langues par la préposition.
Abstraitement, la rection peut être signifiée par la copule rectionnelle « être à »,
dont le renversement est avoir (« Cette maison est à mon père : Mon père a
cette maison ») et par un complément d'objet, qui forme avec la copule le
prédicat de rection. Dans être à, la préposition à marque la position (matérielle
ou idéelle) du sujet par rapport à l'objet (position qui peut être concrétisée
de mille manières : être dans, sur, sous, appartenir, ressembler,
obéir, etc.). La copule avoir, qui désigne le renversement de ce rapport,
comporte elle aussi mille variétés : « avoir » = contenir, envelopper, tenir,
posséder, gagner, prendre, avaler, manger, etc. Ce renversement, toujours
possible logiquement, n'est pas consacré dans tous les cas par la langue ;
ainsi à côté de « Paul a la fièvre », « La fièvre est en lui, à lui » paraîtrait
étrange.
On voit que la copule de rection est beaucoup plus souvent lexicalisée
que la copule d'accord ; elle l'est même habituellement, et cette circonstance
masque l'aspect grammatical de sa nature. Pour le faire apparaître,
il suffit de constater que les verbes rectionnels ont la même propriété que
tout ligament grammatical (178) : ils sont inconcevables sans la représentation
des deux termes qu'ils relient ; s'approcher est vide de sens si l'on
ne se représente pas la personne qui s'approche et ce dont elle s'approche.
168. Ainsi la notion de copule rectionnelle recouvre celle de verbe transitif,
peu importe que l'objet soit relié directement au verbe (« manger du pain »)
ou qu'il le soit au moyen d'une préposition vide (« obéir à un maître, s'emparer
d'une ville ») ou lexicalisée (« passer par un endroit »).
Malgré sa forte lexicalisation, le verbe transitif est toujours réductible
(logiquement) à avoir ou être à. Il va sans dire que, appliquée au langage
usuel, cette réduction paraît souvent forcée, parce que l'action exprimée
par le verbe est entourée de nombreuses circonstances qui voilent le rapport
fondamental et ne le font apparaître que par associations successives :
cf. « manger, absorber, ingurgiter, faire entrer, avoir » ou « Paul s'approche
de Pierre, sera près de Pierre, sera à Pierre ».
C'est cette généralisation qui permet d'expliquer la nature de l'object
« affecté » et de le distinguer de l'objet « effectué », dont il sera question plus
109bas (171, 3) : « pétrir la pâte » (objet affecté), c'est agir sur la pâte, mettre,
comme on dit, la main à la pâte, être à la pâte.
169. La différence entre « La pluie tombe abondamment » et « La pluie
tombe abondante » (165) a son pendant en rection dans « Paul vit d'une vie
tranquille » et « Paul vit une vie tranquille ». Dans le premier cas, le verbe
vit (plus exactement : son radical) est un attribut déterminé par « d'une vie
tranquille », comme tombe par abondamment ; dans le second, vit est une
copule (lexicalisée) et « une vie tranquille » un complément d'objet, de même
que tombe est copule et abondante attribut d'accord. Les copules pures correspondantes
sont avoir et être : « Paul a une vie tranquille », « La pluie est
abondante ».
170. La transitivité est souvent rendue par la copule être suivie d'un substantif
ou d'un adjectif transitif, c'est-à-dire d'un mot qui n'exprime pas
une substance ou une qualité, comme p. ex. arbre et vert, mais un rapport
entre deux êtres ou deux choses (p. ex. : parent, frère, ami, etc. ; voisin, plein,
semblable, autre, etc.). Ainsi des tours tels que Paul est le frère de Pierre, Ce village
est voisin de la ville sont exactement comparables à ceux qui renferment
un verbe transitif avec ou sans préposition : être autre = différer, que,
par figure, on ramène à être loin de ; une bouteille pleine de vin est une bouteille
qui a du vin, c'est-à-dire que le vin est dans la bouteille ; Paul est l'ami
de Pierre = aime Pierre, est aimé de Pierre.
171. La syntaxe de causation se greffe sur celles d'accord et de rection.
La causation d'accord est régie par la formule : faire que A soit B, et celle
de rection par : faire que A soit à B (ou que B ait A). Exemples schématiques :
(accord) « Le vent fait que les feuilles tombent. La neige fait que les montagnes
sont blanches » ; (rection) « Paul fait que la chaise soit près de la table ».
L'étrangeté de ces tours montre que la langue emploie le plus souvent des
procédés implicites pour exprimer la causation ; ils sont multiples et variés ;
ils synthétisent tous, à des degrés variables, les deux notions complexes analysées
plus haut ; rappelons quelques-uns des plus usuels, sans insister sur
les détails de syntaxe :
1) Les deux verbes contenus dans la formule analytique peuvent être
rapprochés, et donner ainsi l'impression d'une idée globale : « Paul fait
travailler Pierre » ; ce rapprochement s'accompagne d'autres particularités :
« Paul fait faire un habit au tailleur », etc.
2) Faire être tel ou tel, faire avoir ou faire être à sont condensés en verbes
simples qu'on peut appeler copules causatives ; comme on doit s'y attendre,
110leur lexicalisation prend les formes les plus diverses ; ainsi faire être =
rendre (« Paul rend ses parents heureux ») ; faire avoir devient pourvoir,
munir, etc. (pourvoir du nécessaire = faire avoir le nécessaire). Pour faire
être à, on citera donner, adresser, envoyer, etc. (« Paul donne un livre à Pierre »
= « Paul fait qu'un livre soit à Pierre »).
3) La condensation maximale est offerte par les verbes dits causatifs, qui
englobent et la copule et l'attribut d'accord ou l'objet de rection : égayer,
c'est « faire être gai », blanchir = « faire être blanc » (causatifs d'accord) ; argenter,
dorer, colorer = « faire avoir de l'argent, de l'or, des couleurs » (causatifs
de rection).
Abstraction faite des syntaxes d'accord et de rection, la causation revêt
une forme plus simple répondant à la formule faire être ou n'être pas ; ainsi
faire être prend les formes créer, engendrer, etc. ; faire n'être pas = détruire,
anéantir, tuer. C'est une causation de cette nature qui rend compte de l'objet
« effectué » des verbes transitifs : ces derniers sont des causatifs de ce type,
mais ils insistent particulièrement sur les modalités de l'action, les moyens
qui la réalisent, etc. Ainsi cuire le pain, c'est « faire être le pain par la cuisson » ;
pour faire comprendre la différence de l'objet effectué et de l'objet
affecté, opposons cuire le pain : cuire la pâte, percer un trou : percer un mur
(v. encore 263).
Ces équivalences ainsi condensées dans un trop bref exposé peuvent paraître
artificielles ; en réalité, il s'agit d'un réseau d'associations supplétives
(287 ss.), d'équivalences fonctionnelles (36), qui sont à l'état latent dans
le subconscient des sujets.
172. Remarque. Le terme d'« accord » prête à confusion, parce que dans
l'usage ordinaire, il désigne deux choses différentes : d'abord, comme plus
haut, c'est l'expression grammaticale du rapport d'inhérence (c'est le seul
sens que nous retenions) ; mais il désigne aussi la concordance formelle entre
termes associés (quelle que soit la nature de cette association).L'accord est
marqué, comme on l'a vu, par la copule être ou ses équivalents, explicites
ou implicites ; la concordance se traduit par tous les procédés d'unification
formelle qui peuvent rapprocher des termes (en accord ou en rection !), p.
ex. la concordance en genre et en nombre (la terre est ronde), la concordance
des temps (Je croyais que vous étiez parti), en grec, la concordance
des cas dans l'attraction du relatif par son antécédent, p. ex. dans « Axioi
génesthe tês eleutherías hês kéktēsthe » (« Devenez dignes de la liberté que
vous possédez »). M. Frei, dans sa Grammaire des fautes, a fort justement remarqué
111que la concordance formelle, qu'il appelle conformisme, est le pendant
discursif de l'analogie ; j'ajoute que c'est le pendant de ce qu'est en
phonétique l'assimilation des phonèmes (lat. afferre pour adferre). Elle
n'est pas, comme l'accord, un ligament grammatical.
173. Si la concordance ne se confond pas avec l'accord, il n'en est pas
moins vrai que l'accord, avec ou sans le secours des formes de concordance
(165), est psychologiquement un rapport plus étroit que la rection ; grammaticalement,
l'accord est un procédé plus synthétique, la rection, un procédé
plus analytique. Il s'ensuit que l'accord entraîne plus aisément la concordance
formelle que la rection. Cf. lat. « Paulus vivit tranquillus » et
« Paulus vivit Romæ ». Mais ce caractère synthétique de l'accord peut avoir
pour effet, dans une langue portée à la synthèse, le passage d'une syntaxe
de rection à une syntaxe d'accord par voie de transposition. Le cas le plus
connu est celui des adjectifs de relation (147) ; chaleur solaire pour « chaleur
du soleil » (lat. bellum punicum pour « bellum contra Poenos », vespertinus
redit domum au lieu de « vespere » = « Il retourne le soir à la maison ») ; nous
verrons (357s.) que des rapports rectionnels ont la forme de l'accord dans
les déterminatifs (articles, démonstratifs, possessifs, adjectifs de quantité,
etc.), c'est-à-dire dans des formes traditionnelles qui résistent à la tendance
analytique des idiomes modernes.
174. Signalons enfin que les rapports d'accord et de rection n'existent
pas seulement entre les mots, mais se retrouvent à l'intérieur des mots eux-mêmes
(composés, v. § 141 s., préfixaux et suffixaux). La formation des mots
exige une étude statique beaucoup plus poussée qu'elle ne l'est actuellement :
il faudrait non seulement distinguer les syntagmes d'accord et ceux
de rection, mais encore tenir compte des éléments implicites. Bornons-nous
ici à quelques précisions sur les préfixaux et les suffixaux (v. 159).
A. Les préfixaux sont les uns d'accord, les autres de rection.
1) Dans la première classe, on trouve des préfixes équivalant à des adverbes
de manière et de quantité : re-(ré-), sur-, super-, extra-, pseudo-, mé-,
mal-, in-, etc. : relire = « lire de nouveau ou plusieurs fois », surfin = « extrêmement
fin », maladroit = « peu adroit », etc.
2) Les préfixes de la seconde catégorie sont des ligaments de rection à
valeur prépositionnelle : citons a(d-) = « vers », en- = « dans », en- « loin de »,
de-(dé-) (même sens), etc. Il faut alors distinguer deux cas : tantôt le radical
du mot fonctionne comme substantif régi par la préposition (159) : ainsi
embarquer, débarquer = « mettre en barque, hors de barque » ; tantôt le régime
112du préfixe prépositionnel est extérieur au mot, et pourvu d'une préposition
qui fait double emploi avec le préfixe : apporter (quelque chose) à
quelqu'un, introduire dans, s'interposer entre ; en outre, ce régime peut être
ellipsé : « Dépendez ce tableau » (de l'endroit indiqué par la situation) ; ou
bien il est généralisé et indéterminé, p. ex. emporter dans une phrase telle
que « L'âge emporte les plaisirs » (emploi « absolu », au même titre que les
transitifs, p. ex. manger dans « Il faut manger pour vivre »).
B. Les suffixaux sont en général de rection et le suffixe est le déterminé
encrier = « chose pour l'encre », règlement — « action de régler », potier = :
« celui qui (fait) des pots ». Seuls les suffixaux appréciatifs (diminutifs, péjoratifs,
etc.), dont il sera question § 396 ss. sont régis par l'accord, et le suffixe
est le déterminant : jardinet = « petit jardin », criailler — « crier désagréablement »,
vieillot = « un peu vieux ».
Catégories lexicales
175. Nous appelons catégories lexicales les classes de signes exprimant les
idées destinées à se combiner dans le discours au moyen des ligaments
grammaticaux.
Les catégories lexicales comprennent, dans nos langues, les mots, ou
plus exactement les sémantèmes (468) virtuels désignant des substances
(êtres et choses), des qualités, des procès et des modalités de la qualité et
de l'action, autrement dit : des substantifs (homme, pierre), des adjectifs
(rouge, bon), des verbes (march- [er]), et des adverbes (bien, très). Tous sont
prédestinés à être actualisés dans le discours ; à l'intérieur des catégories,
les termes eux-mêmes portent, à des degrés divers, le signe de leur actualisation.
Sous ce rapport, le verbe occupe une place à part, comme nous
l'avons vu § 116, parce qu'il ne peut figurer que sous forme actuelle (nous
marchons) ; march- n'est qu'un radical, marcher est un verbe transposé
(184, 2).
Les catégories lexicales n'ont d'existence dans une langue que si elles
sont caractérisées par des signes linguistiques internes ou externes. En
l'absence de tout signe différenciant les catégories, elles peuvent exister
dans la pensée, mais elles n'appartiennent pas au langage. Si une langue,
comme le chinois littéraire, permet à un même mot de fonctionner comme
substantif (p. ex. cheval), verbe (chevaucher), adjectif (chevalin), adverbe
113(à cheval), on ne saurait le ranger dans aucune de ces classes ; au contraire,
le mot français cheval ne peut être que substantif, parce qu'il figure dans
des syntagmes qui le caractérisent comme tel (le cheval, mon cheval, pour
un cheval, le cheval trotte, etc.) ; il en est de même pour rouge : il est adjectif
parce qu'il détermine toujours un substantif (fleur rouge) ; la flexion de chevaucher
est verbale ; l'adverbe très ne peut déterminer qu'un adjectif (très
bon), et ainsi de suite.
176. Les catégories lexicales sont caractérisées par leur valeur, et cette
valeur est inséparable de leur fonction. Un adjectif est prédestiné à servir
d'épithète au substantif, et le substantif ne peut être caractérisé que par un
adjectif (sur les cas de transposition, p. ex. dans (maison) de campagne,
voir § 190) ; le verbe ne se conçoit pas sans un sujet et le sujet, qui est le lieu
du prédicat, est inconcevable sans une détermination verbale ; enfin l'adverbe
est prédestiné à déterminer un adjectif ou un verbe.
Ce caractère complémentaire des relations entre catégories n'est que le
pendant mémoriel des rapports syntagmatiques réalisés dans le discours ; les
catégories supposent les syntagmes comme les syntagmes les catégories ; par
leur marque catégorielle, les mots sont des termes de syntagmes en puissance.
Tout syntagme consiste en effet dans un rapport de mutuelle dépendance
(signe x) établi entre deux termes (a et b) appartenant à des catégories
complémentaires (formule a x b ; exemple : Cette robe est rouge). Mais d'autre
part, chacun des termes du syntagme est déterminé par des associations
mémorielles spontanées avec d'autres termes de la même catégorie : Cette
robe est rouge : Cette robe est large, etc. — Cette robe est rouge : Cette pomme est
rouge, etc. (associations homocatégorielles, formule image {aʼ a x b bʼ}. Enfin le syntagme,
dans sa totalité, est fixé mémoriellement avec d'autres syntagmes
dont la matière est fournie par les mêmes catégories : Cette robe est rouge :
Cette table est carrée : Cette montagne est haute, etc. (associations homosyntagmatiques,
formule image {aʼ x bʼ a x b}).
177. Les interjections (abstraction faite des bruits purement imitatifs
excluant toute communication de pensée, v. § 40), constituent un cas-limite
des catégories lexicales. D'une part, en effet, elles expriment des notions
virtuelles de nature verbale : patatras ! rend l'idée d'une chute, gare ! celle
d'un avertissement, ouf ! désigne le soulagement, etc. En revanche, les interjections
ne sont employées que sous la forme de monorèmes (61 ss.), revêtus
114d'intonations qui confirment leur caractère de phrases (40) : Ouf ! = « Je
suis soulagé », Patatras ! = « Quelque chose est tombé », Gare ! = « Faites
attention ». De plus, alors que les mots-phrases de la parole (42), p. ex. La
pluie ! Un avion !, peuvent toujours reprendre leur fonction de mots proprement
dits (« La pluie tombe », « Voici un avion »), les interjections ne peuvent
devenir des mots que par transposition : un patatras = « une chute », crier
gare = « avertir », etc. Autrement dit, ce sont des mots-phrases de la langue.
Notons le parallélisme qui existe entre l'interjection et le verbe : ce dernier
aussi n'apparaît que sous sa forme actuelle, à l'intérieur d'une phrase,
ou même, dans certains cas, il équivaut à une phrase (Tu marches, Sortez !,
etc.) ; de même que l'interjection, il a ses formes transposées (infinitif, participe,
noms d'action). Ces deux caractères communs nous montrent l'affinité
des deux types (verbe et interjection).
178. Ce qui précède nous montre que les signes grammaticaux ou ligaments,
qui expriment des relations, ne forment pas une catégorie dans le
sens défini plus haut, puisque pour nous, il n'y a que des catégories lexicales.
Les ligaments (copules, prépositions, conjonctions, désinences, actualisateurs,
quantificateurs 142 et signes grammaticaux implicites) ont pour fonction
de grouper en syntagmes les signes appartenant à des catégories complémentaires
dans le rapport de déterminé à déterminant. Ils sont donc
extérieurs aux catégories. Leur caratère apparaîtra mieux à la lumière des
faits de transposition, dont il va être question.
Il faut noter cependant que les ligaments sont, dans leur grande majorité,
lexicalisés (135), c'est-à-dire que le rapport grammatical y est déterminé
par des notions spatiales, temporelles ou abstraites, et ces notions
relèvent des catégories. L'analyse doit donc, dans chaque cas, faire le
départ entre ligament et caractérisation lexicale ; ainsi de est pur ligament
de rection dans « la bataille de Leipzig », tandis que bel dans all. « die Schlacht
bel Leipzig » y ajoute l'idée spatiale de proximité. On sait d'ailleurs que
l'élément lexical peut prédominer au point de masquer le caractère grammatical
du ligament ; c'est le cas p. ex. des verbes transitifs (manger, tuer,
etc., v. 136), des copules modales (penser, affirmer, etc., v. 30).115
Syntagmatique et transposition fonctionnelle 143
179. Un signe linguistique peut, tout en conservant sa valeur sémantique,
changer de valeur grammaticale en prenant la fonction d'une catégorie
lexicale (substantif, verbe, adjectif, adverbe) à laquelle il n'appartient
pas. Ainsi les substantifs planète et campagne, sans changer de signification,
deviennent (fonctionnellement) adjectifs dans (système) planétaire
et (maison) de campagne ; la phrase tu mens conserve son sens en devenant
substantif et complément d'objet dans (Je sais) que tu mens. Ce système
d'échanges grammaticaux sera appelé ici transposition fonctionnelle.
180. La transposition fonctionnelle (qui relève exclusivement de la
grammaire) doit être soigneusement distinguée de la transposition sémantique,
qui intéresse aussi le lexique, par le fait que les signes changent
de signification (généralement par emploi figuré) en même temps que de
catégorie ; c'est le cas p. ex. lorsque sang devient adjectif dans sanglant
(comparez « vaisseau sanguin », transposition fonctionnelle), et glace dans
(un froid) glacial (comparez « la période glaciaire »). En outre, tandis que
l'échange des fonctions appartient à la synchronie, les changements de sens
relèvent de l'évolution. Sans doute, cette évolution peut être très proche
de l'état de langue considéré, et il est souvent difficile de décider si l'on a
affaire à l'un ou l'autre type ; d'ailleurs les échanges fonctionnels qui nous
intéressent ici comportent des différences stylistiques ; ainsi l'adjectif planétaire
présente une certaine nuance d'expression (terme technique !) qu'on
ne trouve pas dans (système) des planètes ; mais cela tient à la nature de
l'adjectif : la notion de planète est identique dans les deux cas, et c'est cela
seul qui nous importe.
Quoi qu'il en soit de ces cas-limite, la dominante fonctionnelle et la
dominante sémantique sont d'utiles normes de classement.
Il est intéressant de relever des exemples de mots qui appartiennent à
l'une ou à l'autre classe de transposés suivant leur emploi dans la parole :
la végétation tropicale est celle qu'on trouve sous les tropiques (transposition
fonctionnelle) ; une chaleur tropicale est une chaleur aussi forte que
celle qui règne dans ces régions (transposition sémantique). C'est que,
dans le premier cas, tropiques est pris en extension, comme une chose, et
116que dans le second on a extrait de sa compréhension un caractère particulier ;
on opposera de même une école enfantine et une naïveté enfantine ;
c'est encore la même différence qu'on surprend dans héroïne cornélienne, suivant
qu'on parle de Chimène ou de Charlotte Corday.
181. Dans cet exposé, il est fait abstraction des irrégularités de forme
qu'entraîne souvent la transposition. Le lecteur en trouvera la description
dans la seconde section (230, 243, 251, etc.). Il nous suffit que le mécanisme
des échanges, loin d'être obscurci, révèle au contraire l'identité des
signes en cause à travers l'altération de leur forme. Ainsi le suffixe du
verbe chevaucher est (statiquement) mal délimité ; la marche a un suffixe
zéro (248) ; dans (la question) impôts, le signe de la transposition n'apparaît
pas ; amabilité diffère de aimable par la forme de son radical ; équestre a un
radical échangeable avec cheval (supplétion, § 287) ; cette même supplétion
du radical combinée avec un suffixe zéro autorise à poser que succès transpose
le verbe réussir en nom d'action, comme meurtre le fait pour tuer
(cf. tuerie). Dans (Je crois) que tu réussiras et (Je doute) que tu réussisses,
les deux subordonnées ont la même valeur (fonctionnelle !) malgré les différences
de mode et de temps, etc., etc.
182. Nous n'avons pas l'intention d'exposer, même en traits généraux,
l'ensemble du problème de la transposition. Nous nous bornerons à décrire
quelques cas typiques, en vue de définir, dans la mesure du possible, les
caractères communs à tous les échanges fonctionnels et le rapport étroit
existant entre la transposition et la syntagmatique. Quant à l'application
de ces règles dans le détail, elle n'appartient plus à la linguistique générale.
183. Nous définirons tout d'abord, à l'aide d'exemples déjà cités, les
termes techniques dont nous ferons usage. Nous avons vu que le substantif
planète devient adjectif sous la forme planétaire au moyen du suffixe -aire,
et que la phrase Tu mens se substantifie dans (Je sais) que tu mens grâce
à la conjonction vide que. Nous appellerons transponend (du latin transponendum
« ce qui doit être transposé ») le signe destiné à subir la transposition 144
(ici planète et tu mens) ; le signe marquant la nouvelle catégorie
(ici -aire et que) sera dit transpositeur ou catégoriel : le premier de ces termes
désigne son action, sa fonction, le second sa nature, sa valeur ; ainsi -aire
117est un transpositeur de substantif et un catégoriel adjectif. Enfin le transponend
métamorphosé par le transpositeur est un transposé.
184. Dans le domaine des signes virtuels ou sémantèmes, la forme la
mieux connue de la transposition est la dérivation suffixale. Un suffixe
est le signe qui indique dans quelle catégorie nouvelle entre tel ou tel
sémantème — qui prend alors la forme d'un radical — et a pour fonction
de spécifier, de déterminer cette catégorie, comme l'espèce détermine le
genre : laboureur : homme — qui laboure, chevaucher : aller — à cheval,
rougir : devenir — rouge, actif : qui — agit (dont la qualité est l'action),
fermement : d'une manière — ferme, etc.
Ces faits sont trop connus pour qu'on y insiste davantage. Il est plus
important de signaler, à propos de la suffixation, deux faits généraux
qu'on peut constater dans tous les domaines de la transposition :
1) Un premier transposé peut donner lieu successivement à une ou plusieurs
autres transpositions greffées les unes sur les autres ; exemples :
riche, enrichir, enrichissement ; fleur, fleurir, floraison ; agir, actif, activement.
2) Comme on l'a déjà vu, un même sémantème peut passer simultanément
dans plusieurs catégories différentes : lent : lenteur, ralentir, lentement,
etc. Le verbe présente un cas remarquable de ces transpositions parallèles :
les participes, les infinitifs et le gérondif, qui transposent l'idée verbale
respectivement en adjectif, en substantif et en adverbe ; comparez nous
mangeons et mange-ant, mang-é, mang-er, avoir, être mangé, en mange-ant.
Ces transpositions sont moins apparentes que ce n'est le cas pour les autres
suffixaux, parce que ces transposés conservent la presque totalité de la
syntaxe verbale (cf. nous mangeons du pain et mangeant du pain, etc.) ; ce
n'en sont pas moins des transposés et des suffixaux. Ces transposés très
voisins du verbe conjugué, se distinguent par là d'autres transposés parallèles
qui n'admettent pas la syntaxe du verbe : « condamner un innocent : la condamnation
d'un innocent, oubliant sa promesse : oublieux de sa promesse, (on se
déshonore) en condamnant un innocent : par la condamnation d'un innocent ».
185. Remarque. Les exemples cités, et tous ceux qui le seront dans la
suite, montrent que le caractère essentiel de la transposition est d'avoir
un point de départ et un point d'arrivée ; sa marche est « à sens unique ».
M. H. Frei (CFS, 2, p. 18 ss.) oppose à ce type, qu'il appelle très justement
transposition dirigée, une transposition libre, qu'on trouverait par
exemple dans louer (un appartement 1) à un locataire, 2) à un propriétaire),
dans chinois cie4, qui (comme all. borgen) signifie « prêter » et « emprunter »,
118etc. Les deux emplois de chacun de ces mots s'échangeraient
librement, sans transponend ni transpositeur. Cette théorie me semble criticable
pour la forme et pour le fond. D'une part, l'emploi du terme « transposition »
dans cette acception est peu conforme à l'usage, qui désigne par
là un transfert unilatéral ; c'est ainsi qu'on transpose une mélodie de la
en si, mais le retour à la tonalité première ne serait pas une transposition.
En outre, il n'y a pas, selon moi, échange, mais seulement opposition entre
les deux verbes louer et les deux verbes borgen, etc. Il s'agit de signes qui,
sans changer de place, soutiennent entre eux des rapports memoriels oppositifs
et complémentaires. On s'en rendra mieux compte si l'on considère
que, dans cette question, l'identité de forme des deux mots louer, p. ex.,
n'a rien d'essentiel (pas plus que dans les homonymes). Le rapport existant
entre 1 et 2 est exactement le même qu'entre all. vermieten et mieten, où
il est souligné par une différence de forme. Or, on n'est pas tenté de parler
d'un libre-échange entre mieten et vermieten, pas plus qu'entre Wirt et Gast,
représentés tous deux en français par hôte (1. qui reçoit, 2. qui est reçu).
Il s'agit donc de notions contrastantes incluses dans une notion commune :
ce sont des espèces d'un genre.
En grammaire, M. Frei voit un cas de transposition libre dans le rapport
entre sujet et complément d'objet (« L'oiseau bâtit son nid » : « Je vois l'oiseau »).
Mais ces fonctions ne sont pas échangeables, puisqu'elles sont contrastantes
et aussi complémentaires ; l'oiseau n'a pas passé avec sa fonction
de la case du sujet à celle du complément d'objet ou vice versa. Là encore,
on s'en rend compte quand la différence est soulignée par la forme : comparez
« L'hiver est passé » et « Le printemps succède à l'hiver » (à côté de « suit
l'hiver »), « La ville est prise » et « L'ennemi s'est emparé de la ville », à côté de
« a pris la ville ». D'ailleurs, le passage du sujet à l'objet est, selon moi,
un cas de transposition dirigée (v. plus loin § 190 et surtout § 253).
186. Mais la dérivation suffixale n'est qu'un cas particulier de la transposition
des signes virtuels, qui se confond avec la caractérisation en
général, et plus spécialement avec la composition. Nous allons voir que
tout caractérisateur et tout terme tʼ d'un composé sont des transposés.
Pour s'en rendre compte, il suffit de remarquer que l'analyse des suffixaux
fait apparaître des équivalents fonctionnels qui sont des caractérisés ou
des composés : un laboureur est « un homme labourant, qui laboure », chevaucher,
c'est « aller à cheval », la chaleur solaire = « la chaleur du soleil,
qui vient du soleil ». Aux composés de l'allemand correspondent souvent
119des suffixaux français : Giesskanne : arrosoir, Tintenfass : encrier, etc., tandis
que Landhaus et maison de campagne présentent des formes de composition
indépendantes de la suffixation. On sait d'ailleurs que les suffixes dont
l'étymologie est connue ont été autrefois des déterminants de composés
et ceux-ci des déterminants de caractérisés : fr. clairement = lat. clarā mente,
all. (Kind)-heit = got. haidus « manière », etc.
187. L'actualisation, comme la caractérisation, ressortit à la transposition.
En effet, un actualisé n'est pas autre chose qu'un caractérisé de la
parole ; or, de même que tout caractérisateur est transposé (comparez
campagne et (maison) de campagne), de même le signe qui en actualise
un autre ne peut le faire que s'il est transposé : ce cheval = « le cheval
qui est ici, dans cet endroit » ; mon chapeau = « le chapeau qui est à moi, le
chapeau de moi ». Dans la phrase de Boileau « Enfin Malherbe vint », le
verbe est actualisé par la flexion temporelle du passé défini, qui détermine
l'action en la localisant dans un moment du passé ; ce moment du passé
est conçu comme un lieu, qui est transposé en déterminant la venue, de
même que le lieu spatial moi est transposé en déterminant chapeau. Soit
encore l'adjectif blanc ; par une première transposition (lexicale et virtuelle),
il devient verbe au moyen du radical des copules être, devenir, se faire,
sembler, etc., ou par un suffixe verbal dans blanchir. A son tour, le verbe
ainsi constitué est actualisé par son temps, au même titre que tourne :
(cette robe) est blanche, (mes cheveux) blanchissent (dans le temps présent).
188. La forme suprême de la transposition est celle qui s'empare des
phrases (les actualisés par excellence) pour en faire des substantifs, des
adjectifs et des adverbes actuels et virtuels.
Une phrase peut devenir une proposition-terme, proposition qui, par
une ou plusieurs autres transpositions parallèles, prend la forme du substantif,
de l'adjectif ou de l'adverbe. Je suis innocent devient complément d'objet
direct dans (J'affirme) que je suis innocent, puis (J'affirme) être innocent 145
(on a vu que l'infinitif a la fonction d'un substantif), et enfin (J'affirme)
mon innocence. Autres exemples : Le docteur est arrivé : (Je vous annonce)
que le docteur est arrivé : (Je vous annonce) l'arrivée du docteur. Ce problème
est simple : (Je constate) que ce problème est simple : (Je constate) la simplicité
de ce problème. De même : Que mon fils soit heureux ! : (Je veux) que
120mon fils soit heureux : (Je veux) le bonheur de mon fils. La phrase Je me
promène, insérée dans cette autre : Je lis pendant que je me promène, devient
une subordonnée échangeable avec le tour (Je lis) en me promenant, gérondif
qui équivaut à un complément circonstanciel pendant ma promenade,
c'est-à-dire à un adverbe (sur ces équivalences, voir encore § 194).
189. Il est impossible de poursuivre au-delà de ces vues générales une
étude qui met en cause la grammaire tout entière 146. Essayons plutôt de
dégager quelques principes qui pourront servir d'hypothèse de travail pour
des recherches ultérieures.
Tout transposé est un syntagme dont le déterminé est le transpositeur et le
déterminant le transponend.
En effet, tout transpositeur est un signe catégoriel général, un catégoriel,
c'est-à-dire un signe marquant abstraitement la catégorie d'emprunt ; et ce
catégoriel est spécifié, concrétisé, déterminé par le transponend. Ainsi
labour-eur a pour déterminé le catégoriel -eur, désignant un être en général,
spécifié par le signe indiquant l'activité exercée par cet être.
Il suit de là que tout transposé est un signe motivé : comparez poire et
poir-ier, campagne et (maison) de-campagne, rouge et roug-ir, cheval et
(aller) à-cheval, j'ai froid et (je tremble) parce que-j'ai froid, etc.
190. La contre-partie de la règle énoncée plus haut se formule ainsi : est
transposé tout déterminant de syntagme dont la catégorie n'est pas complémentaire
de celle du déterminé.
Or, le principe de complémentarité (176) nous a appris qu'un adjectif et
un verbe sont prédestinés à déterminer un substantif, qu'un adverbe est
prédestiné à déterminer un adjectif ou un verbe. Il s'ensuit que les syntagmes
dont les symboles sont terre tourn- 247, robe rouge, travaill- beaucoup,
très fort, excluent toute transposition. La syntaxe d'accord (avec ou sans
concordance formelle), qui relie le déterminant au déterminé, symbolise
bien le caractère spontané de cette union.
Inversement, tout déterminant transposé prouve que la catégorie du
transponend n'est pas complémentaire de celle du déterminé. C'est le cas
p. ex. lorsque un adjectif détermine un verbe (être blanc, devenir blanc,
121blanch-ir), ou vice versa (apte à travailler) ; de même lorsqu'un adjectif détermine
un autre adjectif (cf. horrible et horriblement laid), enfin lorsqu'une
phrase détermine un substantif (un homme que je ne connais pas) ou un
verbe (Je crois que je ne le connais pas, Je souffre parce que j'ai froid), etc.
Le cas le plus général et le plus important est celui du substantif, car le
substantif, prédestiné à la fonction de sujet 148, est le seul signe qui soit déterminé
sans être lui-même déterminant. Un substantif déterminant est donc
toujours transposé ; il peut déterminer un adjectif ou un participe (blanc de
poussière, poussiér-eux ; mort de faim), un substantif (étoile du pôle, étoile
polaire 249), enfin, et surtout, un verbe, soit comme complément circonstanciel
(couper avec une scie, sci-er), soit comme agent du passif (être tué par
un ennemi), soit comme complément d'objet direct (obéir à un maître, s'emparer
d'une ville, prendre une province), soit comme complément d'objet
indirect (donner (un livre) à un ami).
D'autre part, tout déterminant substantif est relié à son déterminé par
voie de rection, c'est-à-dire au moyen d'une préposition soit explicite
(maison de campagne) soit zéro (253) : prendre une forteresse, soit en cumul
et échangeable avec un tour explicite (scier = « couper avec une scie »). En
conséquence : toute rection implique transposition.122
191. Tout déterminant de syntagme à termes non complémentaires
étant un transposé, il s'ensuit que son catégoriel est en même temps un
ligament qui le rattache au déterminé. Ainsi, à l'exception des catégoriels
substantifs, qui ne peuvent déterminer un autre signe, tout transpositeur est
un ligament, et tout ligament de termes non complémentaires est un transpositeur 150.
C'est ainsi que les suffixes sont des transpositeurs qui relient un déterminant
au déterminé par voie d'accord (explicite ou implicite) : (route) pierreuse
transpose pierre en adjectif et relie cet adjectif au substantif par l'accord
en genre et en nombre ; (les cheveux) blanchissent transpose blanc en
verbe et unit ce verbe au substantif par l'accord en nombre 251 ; (agir) énergiquement
transpose énergique en adverbe et unit celui-ci au verbe en accord
implicite (comparez pour l'accord agir énergiquement et action énergique).
Il va sans dire que les suffixes substantifs ne sont pas des ligaments, puisqu'ils
forment des déterminés de syntagme (labour-eur, beau-té).
Le pronom relatif transpose une phrase en adjectif et relie celui-ci à un
substantif par voie d'accord. On sait en effet que le relatif s'accorde en
genre et en nombre avec son « antécédent », accord qui prend une forme
explicite dans le synonyme lequel, laquelle, etc. Par contre, si le relatif est
substantifié, il n'est plus ligament : Qui perd (gagne), Celui qui règne dans
123les cieux, Quiconque enfreint la loi, etc. Ici encore, la proposition relative
fonctionnant comme complément sera nécessairement transposée : On
punira quiconque enfreint la loi, On sévira contre quiconque l'enfreint, etc.
192. Les prépositions et les conjonctions ont des fonctions à la fois parallèles
et nettement différenciées. Toutes deux sont des transpositeurs et
font de leur transponend une détermination du verbe 152 ; mais les premières
transposent des objets (autrement dit des substantifs), les secondes des
procès, c'est-à-dire des phrases : (Je me promène) avec un ami, (Je travaille)
tandis que les autres s'amusent. Le temps étant assimilé à l'espace (113 Ib),
l'emploi de la préposition est aussi naturel dans pendant la nuit que dans
devant la maison.
Par transposition seconde, un groupe conjonctionnel peut devenir prépositionnel
(pendant que tu dors : pendant ton sommeil) mais la distinction
entre les deux types reste nette, car dans le premier la préposition régit un
substantif réel (un appellatif), dans le second un substantif abstrait (transposant
un procès : dormir : sommeil). Il s'ensuit qu'un terme prépositionnel
authentique ne peut se muer en conjonctionnel.
193. Les déterminations du verbe et de l'adjectif sont intrinsèques ou
extrinsèques. Les premières qualifient ou quantifient les procès (Je travaille
mal, Cette fleur est très odorante). Ce sont les seules qui puissent déterminer
le procès sans transposition ; encore cette faculté est-elle très limitée, car
le gros stock des qualitatifs et des quantitatifs est fourni par des adjectifs
mués en adverbes (énergiquement, grandement) ; en outre, il y a transposition
quand la qualité ou la quantité est fixée par comparaison (travailler
comme un nègre, Je lis mieux que je ne parle, J'ai moins d'argent que toi =
« que tu n'en as »).
Les déterminations extrinsèques, introduites, comme on l'a vu plus haut,
par des prépositions et des conjonctions, indiquent les circonstances dans
lesquelles le procès se produit (circonstances de lieu, de temps, de cause, de
condition, de but, de moyen, etc.). Toutes sont le produit de transpositions.
Une troisième classe comprend les déterminations modales, qui, par définition,
affectent la phrase dans son ensemble ; il en a été question § 152.
124Ex. : « Cette hypothèse est certainement erronée » (= « On ne peut pas douter
qu'elle le soit ») ; « Vous avez peut-être raison » ; « Ceci n'est nullement (n'est
pas) prouvé », etc.
Ce classement des déterminations du verbe ou déterminations adverbiales
montre combien la notion d'adverbe est mal fixée. Il est clair qu'elle
ne repose sur rien de fonctionnel et a pour principal fondement la forme du
déterminant : celui-ci est appelé adverbe dès qu'il est réduit, en apparence,
à un mot unique. Mais les équivalents fonctionnels percent à jour cette règle
empirique. On ne s'en rendra bien compte qu'après avoir lu la seconde
section, mais dès maintenant on voit aisément qu'un adverbe réduit à un
mot comporte une ellipse (« Tu as beaucoup d'argent, je n'en ai pas autant »
[que tu en as]), ou est un signe cumulatif (« Je demeure ici » = « dans cet
endroit »).
194. Remarque I. L'équivalence fonctionnelle des tours cités plus haut
(188) que le docteur est arrivé : l'arrivée du docteur, que ce problème est simple :
la simplicité de ce problème, pendant que je me promène : pendant ma promenade,
(un homme) que je ne connais pas : inconnu de moi est un cas de transposition
interversive.
Celle-ci consiste en ce que, de deux syntagmes parallèles transposés d'une
même base et fonctionnellement échangeables, l'un a pour déterminé le déterminant
de l'autre et réciproquement. Les exemples cités montrent combien
cette interversion est usuelle. D'autres cas sont moins généraux : ainsi (lutter
contre) la vie chère est une hypostase (c'est-à-dire une transposition à catégoriel
implicite) équivalant à « le fait que la vie est chère » ; or, on peut dire aussi
(lutter contre) la cherté de la vie. C'est de la même façon qu'on dit ab Urbe
condita et a conditione Urbis. D'ailleurs la syntagmatique interversive n'est
pas liée à la transposition, et il ne peut pas être question de développer ici ce
sujet. Rappelons seulement (v. 115 IIa) que tout rapport partitif, c'est-à-dire
toute quantification, s'exprime par un syntagme rectionnel dont le déterminé
est la partie et le déterminant le tout (ex. : une douzaine d'œufs) ;
mais on sait que, dans une large mesure, ce rapport a été inversé par la syntaxe
d'accord (douze œufs). C'est la même interversion qu'on trouve dans
les exemples suivants : le midi de la France : la France méridionale, le haut
de la ville : la haute ville, la moitié d'une livre : une demi-livre ; à fr. le
sommet d'une montagne, le pied d'un arbre, le latin répond par summus mons,
infima arbor. Il y a aussi interversion lorsqu'un adverbe modal prend la
forme d'un verbe dans un syntagme parallèle : La terre ne tourne pas : Je nie
125que la terre tourne — Il a d'abord nié, mais il a finalement avoué : Il a commencé
par nier, mais il a fini par avouer.
195. Remarque II. La transposition interversive nous aide à comprendre
pourquoi un substantif abstrait, même isolé, est réductible à une phrase,
au même titre qu'un appellatif tel que laboureur (= « homme qui laboure,
un homme laboure » ; v. § 161, 2). En effet, si l'on dit « Les misogynes ne
croient pas à la vertu des femmes », il y a, comme nous l'avons vu, équivalence
avec « ne croient pas que les femmes puissent être vertueuses » ; mais si
« Brutus ne croit pas à la vertu », cela signifie « à la vertu des hommes, de celui-ci
ou celui-là, de n'importe qui » ; vertu a un complément généralisé implicite,
et par interversion, on trouve « ne croit pas qu'on puisse être vertueux » ;
« on peut être vertueux » est donc la phrase qui équivaut au nom abstrait
vertu, et cette traduction est l'aspect linguistique du principe posé
par les logiciens : « Un concept est l'équivalent d'un nombre infini de jugements
virtuels » (v. Goblot, Logique, p. 85 ss.).
196. Cet exposé, forcément incomplet et schématique, suffit pourtant à
montrer quel rôle immense la transposition joue dans nos langues. Cantonnés
dans leurs catégories de base, les signes offriraient de médiocres ressources
aux multiples besoins de la parole. C'est grâce aux échanges intercatégoriels
que la pensée s'affranchit, que l'expression s'enrichit et se
nuance.
Notons encore que, quelle que soit la complexité des procédés transpositifs,
c'est la transposition qui prouve l'existence des catégories dans une
langue. On a douté qu'il y ait des parties du discours en français, et l'on
connaît les efforts faits par F. Brunot pour s'en affranchir : en vain ; il suffit
de passer en revue les exemples cités au cours de ce chapitre pour s'en convaincre :
c'est la transposition qui prouve l'existence des catégories lexicales.
D'autre part, les modalités de la transposition diffèrent de langue à langue
et constituent un critère de classement important. Nous aurons l'occasion,
dans la seconde partie, de marquer les différences qui séparent le
français de l'allemand à ce point de vue (310).
Enfin la transposition peut intéresser les pédagogues. Quand on s'est
rendu compte des complications inouïes qu'elle apporte au mécanisme de la
langue et des difficultés qui en résultent pour l'analyse, on est amené à penser
que le premier enseignement de la langue maternelle devrait reposer sur
126des formes non transposées — et si ce principe est difficile à appliquer dans
toute sa rigueur, il convient qu'on y recoure dans toute la mesure du possible
si l'on veut donner aux débutants une idée raisonnable du vocabulaire
et de la grammaire. En outre, dans un enseignement plus avancé, la résolution
des formes transposées et leur réduction à des formes dépouillées de
toute transposition doit être au premier plan de l'étude linguistique, de
même qu'inversement l'étude systématique des ressources qu'offre la transposition
est un point de départ tout trouvé pour la pratique de l'élocution
et pour l'enrichissement des moyens d'expression.
Le signe linguistique dans ses rapports
avec la syntagmatique 153
a) Signe arbitraire et signe motivé
197. L'opposition établie par F. de Saussure entre signes arbitraires 254
et signes motivés est une de celles qui jouent le plus grand rôle dans la
théorie des systèmes linguistiques. C'est elle qui fixe — de deux façons
différentes — la valeur des signes ; le mécanisme de l'arbitraire montre
notamment comment il se fait qu'un signe isolé, sans l'appui d'aucun
contexte, soit attaché à une notion déterminée. La chose nous paraît naturelle,
parce que l'usage constant de la langue nous donne le change ; mais
en fait, comment est-il possible qu'un mot tel que arbre exprime l'idée
d'arbre ?
On sait en effet qu'un signe arbitraire ne contient rien dans son signifiant
qui se rapporte au sens du mot. Quant au signe (relativement) motivé
tel que le conçoit Saussure, il résulte de la combinaison de deux signes
arbitraires (dix-neuf, petit-fils, vif-argent, poir-ier, coup-eret, etc.), il ne fait
donc que reculer la solution du problème ; car, si celui-ci ne se pose pas
pour l'ensemble du signe, il subsiste pour ses éléments. Quoi qu'il en soit,
il s'agit bien de deux classes différentes ; il est de fait qu'un motivé, à
l'état isolé, renferme quelque chose qui se rapporte à l'idée qu'il exprime,
peu importe que cette indication soit rationnelle comme dans dix-neuf,
127imparfaite comme dans petit-fils, ou simplement imaginaire comme dans
vif-argent ; peu importe, autrement dit, qu'il demeure arbitraire en dépit
de sa motivation relative.
Le théorie de l'arbitraire et de la motivation, telle qu'elle est formulée
par Saussure, exprime tout l'essentiel de la nature du signe linguistique,
où l'arbitraire règne en maître ; elle semble toutefois pouvoir être complétée
et systématisée.
198. F. de Saussure explique l'arbitraire du signe par la multiplicité,
théoriquement illimitée, des associations oppositives que le signe contracte
avec les autres signes de la langue (associations étroites ou relâchées, immédiates
ou médiates). Il précise en outre que c'est par deux jeux parallèles
d'associations que sont fixées les deux parties du signe ; autrement dit,
celui-ci est arbitraire dans son signifié et dans son signifiant (CLG3, p. 161 —
169).
Un signe arbitraire dans son signifié est déterminé par tous les signifiés
auxquels il est associé par différenciation, de même qu'un concept, selon
Bergson, est fixé par tout ce qui lui est associé et opposé du dehors. Mais
il n'en est pas autrement du signifiant : on peut dire, à un point de vue
purement théorique, que le mot arbre pourrait être échangé contre n'importe
quel son ou groupe de sons qui n'aurait pas de signification en français.
A un point de vue positif, et en termes phonologiques, arbre est déterminé
par tous les signifiants avec lesquels il contracte des associations différentielles :
ainsi il s'oppose non seulement à marbre, le seul mot qui rime
avec lui, mais à tous ceux qui ont avec lui des éléments communs, tels
que les assonances cabre, sabre, glabre, délabre, âpre, câpre, sable, câble, des
analogues plus distants tels que zèbre, guèbre, ténèbre, lèpre, etc., tous mots
qui à leur tour sont des centres d'associations du même genre, par exemple
lèpre : lettre, lettre : litre, litre : libre, etc. Ainsi, de proche en proche, arbre
se trouve relié et opposé à tous les signifiants de la langue 155.
199. Tournons-nous maintenant vers le signe motivé et demandons-nous
si le même parallélisme constaté dans les deux parties du signe arbitraire
se retrouve, mutatis mutandis, dans la motivation ; autrement dit, un signe
peut-il être motivé par son signifié, ou par son signifiant, ou par l'un et
l'autre ?128
Par son signifié : le cas est bien clair, c'est celui que Saussure a mis en
lumière, dans dix-neuf, poir-ier, etc. : deux concepts dont les signes linguistiques
sont purement arbitraires s'associent pour former une notion complexe
qui rappelle, de près ou de loin, la valeur réelle du signe total.
Mais le signe peut être motivé par son signifiant, lorsque celui-ci dégage
une ou plusieurs perceptions (acoustiques, parfois aussi visuelles, cf. 201),
qui soulignent la valeur exprimée par le signe. Ainsi le verbe croquer contient
dans ses sons quelque chose qui rappelle l'impression de cassure, de
broyage, qu'évoque l'idée de croquer.
Enfin, le signe peut être motivé de part et d'autre : ainsi croque-mort
(= « fossoyeur ») accouple deux notions, deux signifiés, qui déclenchent
une représentation macabre, et celle-ci est corroborée par l'effet sensoriel
du premier élément.
La constatation que le signe peut être motivé par son signifiant nous
semble compléter la théorie du signe ; aussi nous nous y arrêterons quelques
instants, bien qu'il s'agisse de faits — en partie — étudiés depuis longtemps
(que l'on pense seulement à la « symbolique des sons ») ; les questions de
principe qui s'y rattachent nous engagent cependant à y revenir.
b) Signe motivé par le signifiant
200. F. de Saussure l'ignorait volontiers (v. CLG3, p. 101), parce que
son attention se portait exclusivement sur les interjections (exclamations
et onomatopées) qu'il considérait — peut-être à tort — comme étrangères
au système de la langue.
Sans doute, une interjection est en marge de la langue quand elle est
la reproduction pure et simple d'un réflexe ou d'un bruit, lorsque, par
exemple, on dit tic tac, tic tac, pour imiter le bruit d'une pendule. Mais
une interjection appartient à la langue dès qu'elle a la valeur d'une phrase :
« Vos mains sont sales ; pouah ! » (pouah ! = « cela me dégoûte ») : « Je vise :
pif paf, et voilà mon lièvre par terre » (pif paf = « deux coups partent »).
Dans ces cas, les interjections sont des phrases à un membre comme toutes
les autres (40).
En outre, sans changer de forme, par transposition hypostatique (257 ss.),
elles peuvent entrer dans une catégorie lexicale bien caractérisée : le
brouhaha, un crincrin, crier haro, faire fi, marcher cahin-caha, répondre du
tac au tac, etc. Par transposition explicite (= dérivation suffixale), elles
129forment des mots tels que cliqueter, cliquetis, craquer, craquement, croasser,
miauler, etc. De plus, dans bien des cas, les sujets parlants n'ont plus le
sentiment qu'un mot expressif par ses sons est issu d'une onomatopée (si
tant est que l'histoire de la langue puisse prouver cette origine), en sorte
qu'il ne subsiste plus que l'intuition vive d'un rapport entre la forme phonique
et l'impression dégagée par le sens : cahoter 156, grincer, crisser, palpiter,
tinter. Enfin, certains sons et groupes de sons suscitent des représentations
sensorielles qui peuvent coïncider avec les effets produits par la signification :
l'occlusive k souligne l'impression d'une cassure (casser, craquer, croquer,
crever) ; p accentue celle d'une explosion (péter, pétiller). On connaît
la valeur expressive du redoublement (murmurer, susurrer), et des alternances
vocaliques qui souvent le renforcent (cancaner, barboter, farfouiller).
201. Il arrive aussi que l'articulation d'un son ou d'un groupe de sons
détermine des mouvements musculaires des lèvres, de la langue, des mâchoires,
où les sujets parlants peuvent voir un rapport symbolique avec
l'idée exprimée, et les modifications qui en résultent dans le masque facial
peuvent être interprétées de la même façon par les sujets entendants (qui
se trouvent être alors, du même coup, des sujets « voyants »). Ainsi les
labiales (p, b, f) emmagasinent de l'air dans la cavité buccale au cours
de leur émission, d'où gonflement des joues et coïncidence possible avec
une idée de plénitude : bourrer, boursoufler, empiffrer, gonfler, enfler, etc.
L'articulation des verbes happer et lapper reproduit grosso modo les actions
mêmes qu'ils désignent.
Les voyelles arrondies (ou, u) projettent les lèvres en avant ; or, ce
mouvement, même en dehors du langage, exprime la mauvaise humeur,
la dérision, le mépris 257 : cf. bouder, faire la moue ; aussi n'est-ce sans doute
pas un hasard si les mots en -ouille sont dépréciatifs ou burlesques (vadrouille,
fripouille, bredouille) ou le deviennent dans leurs acceptions figurées
(andouille, citrouille, nouille, grenouille) ; même remarque pour les
adjectifs en -u : bourru, grinchu, malotru, têtu, cocu, lippu.
Il faut noter encore qu'instinctivement nos organes vocaux exécutent,
mutatis mutandis, les mêmes mouvements symboliques que nos bras, nos
mains, etc. Nous les ouvrons pour marquer la grandeur, nous les rapprochons
pour signifier la petitesse ; la longueur nous les fait projeter en avant,
130et ainsi de suite. De même, nous tendons à exagérer l'ouverture de la
bouche pour prononcer vaste, large, grand, etc. ; nous avançons les lèvres
pour dire long et profond ; inversement, l'idée de petitesse, comme l'a
remarqué M. Jespersen, est exprimée dans une foule de langues par des
mots contenant la voyelle i, la plus fermée de toutes avec u (petit, minime,
miniature (par étymologie populaire), menu, ténu, pointu, minuscule, ital.
piccolo, angl. little, etc.) 158.
202. Ce n'est pas tout : l'accent et l'intonation attachés aux mots
peuvent prendre une valeur symbolique, autrement dit, motivante. On
connaît l'accent d'insistance (14, 367), qui peut frapper la première consonne
de tout mot ou groupe de mots prononcés avec émotion : « Mais
ttais-toi donc ! » ; « C'est ssi amusant ! » Notons bien qu'ici l'accent est indépendant
des mots, peut se poser sur n'importe lequel, et n'a par conséquent
rien de commun avec la motivation de tel ou tel d'entre eux pris
isolément. Nous sommes ici dans la parole. Mais si un mot est affectif par
lui-même, il n'est pas rare qu'il soit prononcé habituellement avec l'accent
d'insistance, qui, dès lors, le motive. Il est presque impossible de ne pas
souligner les premières syllabes de mots injurieux tels que canaille, scélérat,
pendard, etc. L'accent de cochon est oxyton quand il s'agit de l'animal
domestique, mais initial (et motivant) quand on affirme, avec Courteline,
que « Ciboulot est un ccochon ». Un professeur d'université est extraordinaire
quand il a un traitement inférieur, et extraordinaire quand son enseignement
est très remarquable. Comparez aussi : « L'homme est naturellement
égoïste » et « Cet incorrigible étourdi a naturellement manqué son train » 259.
203. A propos de l'intonation motivante, il faut faire les mêmes réserves
que pour l'accent. Dans nos langues, elle est un procédé essentiellement
syntaxique, c'est-à-dire autonome, réalisable uniquement dans la parole,
et applicable à un nombre théoriquement illimité d'énonciations. Sa valeur
est modale, autrement dit, elle exprime ou souligne la modalité sans laquelle
il n'y a pas de phrase ; elle actualise la phrase comme la pensée, telle que
nous l'avons définie au § 27, actualise la représentation. Dans tout cela,
rien qui rappelle la motivation des mots. Mais les choses changent lorsqu'une
expression modale a une valeur unique ou un nombre déterminé
et limité de valeurs ; dans ce cas, l'intonation motive dans la mesure où
131cette limitation est perceptible. Ainsi bah ! ne comporte que deux mélodies :
détaché sur une note haute, il signifie : « Ce qui vient d'être dit m'est indifférent » ;
prononcé sur une intonation descendante, il signifie : « J'en suis
profondément étonné ». Les mots dame ! sapristi ! diable ! mazette ! hélas !
ont une seule valeur modale fondamentale, et celle-ci serait inintelligible
sans l'intonation appropriée, qui fait, par conséquent, corps avec les sons
qui la supportent. Beaucoup de locutions stéréotypées se distinguent par
la seule intonation des tours syntaxiques libres qui ont la même forme ;
comparez « Que voulez-vous : du vin ou de la bière ? » et « Que voulez-vous !
Il n'y a rien à changer à cela » (v. pour d'autres exemples mon Traité, II,
pp. 188-193). Une étude approfondie, qui n'a jamais été faite, montrerait
que l'intonation modale s'étend bien au delà de ces cas, et, par exemple,
pénètre subrepticement dans les mots proprement dits ; ainsi il est presque
impossible de prononcer sur un ton grave des adjectifs tels que ravissant,
charmant, délicieux, et sur un registre aigu d'autres tels que sinistre, lugubre,
etc.
204. On aura remarqué que presque tous les cas de motivation par le
signifiant mentionnés jusqu'ici appartiennent à la langue expressive, autrement
dit, relèvent de la stylistique. Cela ne diminue en rien leur importance ;
Troubetzkoy n'a-t-il pas esquissé le programme d'une stylistique phonologique ? 160
On aimerait cependant trouver des exemples de valeurs purement
conceptuelles et logiques exprimées par des procédés phoniques.
La recherche est trop peu poussée pour que la récolte soit très abondante.
L'accent peut être, par exemple, un outil de transposition, et, par conséquent,
de motivation, puisque tout transposé est syntagmatique (189) :
ainsi des mots grammaticaux atones prennent un accent en devenant
substantifs (« des si et des mais »), ou adjectifs (comparez « une république »
et « république une et indivisible »). Inversement, les interjections perdent
leur intonation en s'hypostasiant (un coucou, le tictac d'une horloge).
M. Marouzeau a signalé (436 n. ) en français un déplacement de l'accent
sur l'initiale (avec coup de glotte (ʼ) devant voyelle), qui souligne des
oppositions logiques (exemple : « Cette nouvelle n'est pas ʼofficielle, mais
simplement ʼofficieuse »). Lorsque les deux termes de l'opposition figurent
dans le contexte, on ne peut parler de motivation des mots pris isolément ;
132mais on constate ce déplacement quand l'un des termes seulement est
énoncé : l'accent évoque alors implicitement le terme contrastant : « Bien
peu de personnes savent que la chauve-souris est un mammifère (et non
pas un oiseau) » ; « Donnez-moi un exemplaire broché (et non relié) ».
Hâtons-nous d'ajouter, en manière de conclusion, que si la motivation
par le signifiant est une réalité aussi tangible que la motivation par le
signifié, seule admise par Saussure (type poir-ier, etc.), elle ne compromet
en rien la conception fondamentale du signe, puisque cette motivation,
comme l'autre, est toute relative et ne révèle jamais la valeur essentielle
du signe, sans l'appoint de multiples associations externes 161.
c) Motivation implicite
205. Tout ce qui précède nous a montré qu'arbitraire et motivé sont des
notions relatives : de l'une à l'autre, on trouve tous les degrés possibles de
transition. Cela revient à dire que les associations déclenchées directement
par les signes sont en nombre variable ; peut-être doit-on admettre que plus
un signe usuel est motivé, plus l'attention se concentre sur sa constitution
interne, d'où diminution de la quantité et de l'importance des associations
externes de son « champ associatif » 262. Plus, au contraire, un signe, également
usuel, est arbitraire (p. ex. arbre), plus nombreux sont les rapports
qu'il contracte en dehors de lui pour fixer sa valeur. Cette variabilité semble
valoir pour le signifiant comme pour le signifié : nous avons vu (198) que le
signifiant arbre est fixé par tous les signifiants qui lui ressemblent de près
ou de loin sans lui être identiques. Inversement, un mot expressif tel que
craquer vit davantage sur son propre fonds ; son champ associatif est constitué
133essentiellement par les mots expressifs voisins (claquer, cracher, croquer,
etc.). Enfin on peut penser qu'une exclamation pure telle que aïe ! ou
boum ! existe plus ou moins par sa seule force évocatrice.
La notion de champ associatif est donc très élastique ; il n'en est pas
moins vrai qu'on peut parler d'associations privilégiées et d'associations
lointaines ; il est bien évident que ciel fait penser à étoile, nuage, bleu, etc.,
plutôt qu'à chemin ou maison.
206. Puisqu'il y a une hiérarchie dans le groupement des associations
constitutives d'un signe (même à l'intérieur du champ associatif), on peut
poser cette question : y a-t-il des associations préférentielles et privilégiées
qui se présentent avec un caractère tellement impératif et spontané qu'il
soit impossible de concevoir sans elles les signes qui les déclenchent ?
Distinguons d'abord soigneusement entre la langue et la parole. Selon
le caractère individuel des sujets parlants, selon la situation où se déroule le
discours, tel signe pourra évoquer tel autre à l'exclusion du reste : pour un
bûcheron, un arbre, c'est surtout du bois ; pour le voyageur accablé de chaleur,
c'est surtout de l'ombre. Dans la langue, au contraire, il s'agit d'associations
latentes qui, sans supprimer les autres, surgiraient nécessairement
en même temps que la représentation du signe, isolé de toute situation et de
tout contexte. Or, ces cas existent, et nous devons nous y arrêter, parce
qu'ils nous achemineront vers un aspect particulier de la motivation 163. Nous
ne mentionnerons d'ailleurs que quelques exemples pour fixer les idées.
Ainsi l'épithète de châtain s'applique seulement aux cheveux, camus et
aquilin au nez, hâve, blême et rougeaud au teint du visage ; il n'y a que le
cheval qui hennisse, le chien qui aboie, le chat qui miaule, l'oiseau qui gazouille ;
un animal ne peut pondre que des œufs, etc. Certains objets ne se
conçoivent que comme parties d'un tout : voile, gouvernail (bateau), brancard
(voiture), branche (arbre), etc.
207. Faisant un pas de plus, demandons-nous s'il existe des signes qui,
absolument simples dans leur constitution phonique, sont cependant motivés
par le fait qu'ils dégagent une association interne nécessaire, autrement
dit, sont des syntagmes implicites, et, par suite, des signes motivés.
Il s'agit de cas qui relèvent du « cumul des signifiés » (225). Or, le cumul
relève de la motivation lorsque le signe cumulatif unit implicitement deux
134notions lexicales reliées entre elles par un lien syntagmatique. Il est clair
qu'un Allemand distingue obligatoirement, dans le mot Schimmel, les idées
de « cheval » et de « blanc » ; l'anglais to starve contient celles de « mourir » et de
« faim » ; en français, une jument ne peut être que la femelle du cheval, la
biche celle du cerf. C'est que, dans cette langue, les noms désignant les femelles
d'animaux ont la forme suffixale (ânesse, lionne, chatte, louve, etc.),
et ce patron analogique s'applique tout naturellement sur les noms exactement
parallèles jument, biche (ajoutez hase, truie, laie, etc.) 164. En somme,
l'assimilation de jument à ânesse n'est pas plus artificielle que celle de tri
(avec signe zéro) à distribution, lavage, etc. On voit, par exemple, que si all.
Pflug est motivé parce qu'il est (en synchronie !) dérivé de pflügen par un
signe zéro, fr. charrue, qui exprime la même idée, est motivé par cumul.
208. Il faut réserver à une étude spéciale la classification des motivations
par cumul ; on en signale ici quelques-unes en passant.
Noms désignant des petits d'animaux : poulain, veau, poussin, etc. (cf.
lionceau, ânon).
Noms d'agent : boucher, boulanger, maquignon, vétérinaire (cf. bijoutier,
serrurier, et all. Fleischer, Pferdehändler, Tierarzt).
Noms d'instruments : charrue, sas (cf. tamis, avec signe zéro).
Noms de parenté : père, fils, frère, sœur 265.
Collectifs : forêt, verger (cf. sapinière, etc.).
Adjectifs privatifs : aveugle, borgne, manchot, etc.
Verbes négatifs : ignorer, refuser, nier, renoncer.
Verbes péjoratifs : puer (stinken) = « sentir mauvais », etc.
En passant en revue ces divers spécimens, on se rend compte, me semble-t-il,
qu'on ne peut plus parler simplement d'associations externes privilégiées :
l'association spontanée est nécessaire et fait corps avec le signe,
qu'elle motive implicitement. En outre, les deux termes qu'elle contient
forment syntagme ; le lien qui les unit est grammatical : l'un est déterminé,
l'autre est déterminant : jument = « femelle de cheval », vétérinaire = « médecin
d'animaux », etc. … Ce n'est pas tout : tandis que la motivation explicite
est, le plus souvent, comme nous l'avons vu, imparfaite ou puérile (cf.
135ébéniste, oiseau-mouche, rouge-gorge), la motivation implicite par cumul est
beaucoup plus naturelle et logique ; elle marque toujours un caractère essentiel
de la notion qu'elle désigne.
209. Il faut reconnaître qu'il s'agit ici d'un type privilégié, d'un cas-limite,
représenté d'ailleurs par un nombre de signes plus considérable qu'on
ne pourrait le croire au premier abord. Quoi qu'il en soit, on doit s'attendre,
comme partout dans le langage, à trouver des exemples d'incorporation de
plus en plus imparfaite, qui nous ramèneront insensiblement jusqu'au signe
arbitraire.
On s'éloigne déjà du type idéal lorsque le signe implicitement motivé
laisse le choix entre deux associations, toutes deux, il est vrai, nécessaires :
ainsi père fait penser aussi bien à enfant qu'à mère. En allemand, si reiten
signifie seulement « aller à cheval », en revanche fahren présente l'alternative
« naviguer » ou « aller en voiture ». Puis, pour d'autres signes, graduellement,
les associations deviennent plus nombreuses, donc moins nécessaires, et, en
outre, on ne distingue pas toujours si elles sont internes (type jument) ou
externes (typechâtain). A leur tour, les associations externes s'éloignent insensiblement
de ce type idéal ; ainsi on voit avec les yeux, on entend avec les
oreilles, mais on perçoit avec les cinq sens. Si une partie déterminée d'un
certain tout (par exemple gouvernail, locomotive, toit) évoque ce tout spontanément
(navire, train, maison), la réciproque n'est pas également vraie ;
la pluralité des parties nuit à la spontanéité de l'évocation ; même pluralité
d'associations spontanées pour certaines actions déterminées, par exemple
écrire (plume, crayon, encre, papier, etc.).
De fil en aiguille, on arrive à des signes qui déclenchent un nombre illimité
d'associations dont aucune n'est absolument privilégiée et où chaque
sujet peut faire son choix selon les hasards de la parole ; mais ces signes ne
sont autres que les signes arbitraires tels que les définit F. de Saussure.
210. On peut donc, en partant des deux pôles entre lesquels se meut la
vie des signes, poser le principe idéal suivant : le propre du signe totalement
motivé serait de reposer sur une seule association interne obligatoire, le propre
du signe totalement arbitraire d'être relié mentalement à tous les autres
signes par des associations externes facultatives. Grammaticalement, le signe
motivé idéal sera constitué par un syntagme unique, le signe arbitraire par
un nombre théoriquement illimité de syntagmes (arbre = « chose qui a des
feuilles, des branches, des racines, qui donne de l'ombre, qui est plus grande
qu'un arbuste, chose qui comprend des hêtres, des sapins », etc., etc.).136
On voit enfin que la motivation implicite oblige à reviser la notion de
« mot simple », qui est en réalité une notion simpliste, puisqu'un mot
« simple » n'est pas toujours arbitraire. Notons cependant soigneusement
qu'elle est une réalité typologique ; une langue qui, comme le français, a une
quantité considérable de mots simples (dans le sens usuel), a une autre
physionomie qu'un idiome tel que l'allemand, qui regorge de motivés explicites.
211. Appendice I. Signalons en passant la motivation par signe zéro,
dont il sera question plus loin (248) ; ex. : tri, marche, comparés à distribution,
travers-ée, etc.
Nous insisterons davantage sur l'hypostase, que nous verrons § 257 ss. En
effet, il faut distinguer ici deux cas, selon que le déterminant existe ou
n'existe pas comme mot indépendant. Il n'a aucune réalité dans rouge-gorge
= « (oiseau qui a) une rouge gorge ». Mais il n'en est pas de même pour
les figures proprement dites, constituées par des mots qui sont pris tantôt
au sens propre, tantôt au sens figuré.
Dans « une flotte de cent voiles » (synecdoque), voile = « bateau à voiles » ;
c'est un syntagme implicite, car, sans cette analyse, même inconsciente,
l'expression serait simplement absurde.
Soit encore « La ville est en révolution » (métonymie) : ville = « habitants
de la ville » (on ne saurait supposer que ce sont les maisons qui s'agitent).
Si enfin « Marie est une dinde », dinde signifie nécessairement « bête comme une
dinde » (métaphore) 166. Toutefois une différence essentielle (signalée par M.
Porzig, l. c., p. 76 ss.) sépare les figures des types représentés par jument,
aveugle, etc. : leur caractère syntagmatique est bien réel, mais le signe isolé
est incapable de le révéler ; le sens d'une expression figurée n'apparaît
137qu'avec l'appoint d'un contexte approprié ; c'est seulement par choc en
retour que ce contexte fait découvrir le complexe interne qui est la raison
d'être de toute figure. Une voile est … une voile ; c'est l'expression « une
flotte de cent voiles » qui permet de donner au mot une acception figurée.
Il s'ensuit qu'une figure n'appartient jamais entièrement à la langue et
relève toujours, au moins partiellement, de la parole ; elle lui appartient
même complètement lorsque l'image est totalement inédite, pure création
individuelle ; mais même devenue usuelle (pourvu qu'elle reste vivante),
elle ne peut se passer de la parole 167.
212. Appendice II. Il y a un parallélisme indéniable entre le système
phonologique et le système de la langue ; nous avons essayé de le montrer
tout au long de ce livre ; les faits que nous avons exposés plus haut à propos
des signes ont leur pendant dans le système phonologique. Mais si on limite
la comparaison aux éléments articulatoires, il importe de tenir compte de
deux différences essentielles qui séparent les deux notions : signe et phonème.
D'une part, les phonèmes sont en nombre restreint et défini, les signes
sont en nombre illimité, de sorte que les associations entre phonèmes ont un
aspect squelettique et rigide qu'on ne retrouve pas de l'autre côté ; ensuite,
il ne faut pas oublier que les phonèmes sont dépourvus de valeurs sémantiques,
et que, par suite, les associations mémorielles qu'ils contractent entre
eux n'ont pas ce caractère spontané et impératif que présentent les relations
entre signes.
Ceci précisé, on posera que, dans le système phonologique, ce sont les
phonèmes autonomes qui correspondent aux signes arbitraires du type
arbre, parce qu'ils donnent aux sujets l'impression de pouvoir figurer dans
n'importe quel syntagme phonique et de pouvoir contracter des associations
mémorielles avec tous les phonèmes de la même catégorie. C'est le
cas en français pour a bref ouvert accentué, qu'on voit apparaître dans
les mots les plus divers : cap, plat, trappe, apte, éclat, égal, syndicat, vertical,
etc., et qui, dans un syntagme donné, paraît pouvoir être échangé avec
n'importe quelle autre voyelle brève (cap, écoppe, occupe, coupe, campe,
équipe, etc.), impression qui demeure vivante même si elle n'est pas confirmée
par des mots existant dans la langue (comme c'est le cas, dans
l'exemple précédent, pour kèp, keup, komp).138
Plus, au contraire, l'emploi d'un phonème dépend du contact de certains
autres, plus il se rapproche du signe motivé. Ainsi en allemand x (achLaut)
n'est possible qu'après a, o, u (fr. ou), n guttural seulement devant
k ou g ; en français, o long ouvert ne se trouve que devant r (or, bord, cor,
remords, dort, etc.), et correspond par conséquent au type châtain (cheveux).
Quant à la motivation proprement dite, c'est-à dire interne, elle
aurait son pendant dans les phonèmes « marqués » des phonologues pragois,
si cette notion était à l'abri de toute critique, ce qui n'est pas le cas ; quand
un Français prononce une voyelle nasale comme an, il n'a nullement l'impression
que la nasalité est un caractère qui s'ajoute à l'orale a ; pour lui,
an n'a rien de plus complexe que a auquel il n'est nullement subordonné
hiérarchiquement. Même au point de vue phonétique, que le timbre soit
nasal ou oral, que l'air passe par le nez ou par la bouche, que le voile soit
relevé ou abaissé, il n'y a rien là qui attribue à an un caractère de plus
qu'à a. Tout au plus pourrait-on voir des complexités internes, c'est-à-dire
des cas de « motivation », dans les occlusives affriquées (pf, ts, dz, tch,
dj, kx), qui, tout en constituant des phonèmes uns, donnent l'impression
assez nette de deux éléments sinon juxtaposés, du moins distincts l'un
de l'autre. Il en est de même des occlusives aspirées (pʻ, tʻ, bʻ, etc.) qui
présentent aussi deux ingrédients assez nets. On pourrait donc dire que
les affriquées aspirées de l'arménien (tsʻ, tchʻ) sont doublement motivées,
d'abord en face de ts et de tch, ensuite vis-à-vis de t, de s et de ch, tous trois
représentés en arménien. Quant à une motivation implicite (type jument),
on ne saurait en chercher dans la constitution des sons.139
Deuxième section
Rapports entre signifiants et signifiés
Formes analytiques et formes synthétiques141
Généralités.
Analyse et synthèse
213. Nous avons jusqu'ici étudié les signes de la langue uniquement au
point de vue de la valeur. Mais comme tout signe consiste en l'union
d'une valeur ou signifié avec une forme matérielle ou signifiant, il importe
de connaître le rapport qui les unit, et ici nous touchons à la question
générale de la concordance et de la discordance entre les deux parties
du signe.
En étudiant cette question, il nous est apparu qu'elle offre une grande
analogie avec une autre : l'opposition entre les formes analytiques et les
formes synthétiques du langage. Nous commencerons donc par un examen
critique de ces deux notions.
214. Les termes de synthèse et d'analyse ont été employés dans des
sens si différents qu'il vaudrait mieux les abandonner ; si nous les conservons,
c'est pour les serrer de plus près et en dégager un principe à la fois
général et précis.
On peut aborder la question au point de vue génétique. La pensée non
communiquée est synthétique, c'est-à-dire globale, non articulée. Ce sont
les besoins de la communication qui poussent à analyser les éléments de
la représentation et à les regrouper organiquement. Un spectacle insolite
peut nous arracher un cri d'étonnement, mais cet étonnement peut aussi
s'exprimer par une phrase telle que « Voilà qui est étrange ! » ; le cri est
synthétique, la phrase analytique. On peut donc dire qu'un procédé linguistique
est d'autant plus synthétique qu'il se rapproche de la nébuleuse
primitive, c'est-à-dire de la pensée non communiquée.
Mais une pareille définition, admissible en théorie, n'offre guère d'avantages
pratiques ; c'est là un critère qui se dérobe à chaque instant à la
vue du chercheur, lorsqu'il s'attaque à une langue constituée, dont la
structure a perdu tout contact avec l'indistinction primitive. Il est facile
alors d'attribuer à la synthèse tel procédé qu'un autre baptiserait analyse
et vice versa.
Il n'y a pas non plus grand'chose à tirer de la parole et du fonctionnement.
On a dit p. ex. que la synthèse facilite la tâche du parleur et complique,
pour l'entendeur, l'effort de compréhension. C'est probablement
vrai ; mais ce sont là distinctions délicates, qu'il est difficile d'utiliser.143
Si la question reçoit des réponses incomplètes, c'est aussi parce qu'on
n'y applique pas le principe formulé au § 15, d'après lequel toute réalité
surprise dans le discours a son corrélatif dans les associations virtuelles,
mémorielles. Généralement, une pièce du système linguistique est considérée
comme synthétique parce qu'elle se présente telle in actu, dans les
réalisations de la parole ; mais le corrélatif mémoriel, qui servirait de
contrôle, est à peu près négligé.
215. Notre définition est la suivante : La synthèse est l'ensemble des faits
linguistiques contraires, dans le discours, à la linéarité, et, dans la mémoire,
à la monosémie.
Inversement, une forme est d'autant plus analytique qu'elle satisfait aux
exigences de la linéarité et de la monosémie.
Les signes sont linéaires lorsqu'ils se suivent, sans se compénétrer, sur
la ligne du discours. Il y a non-linéarité ou dystaxie 168 dès que les signes
ne sont pas juxtaposés, lorsque, p. ex., un signifiant contient plusieurs
signifiés, comme dans le français va !, où une seule syllabe renferme l'idée
d'aller, celles d'impératif et de deuxième personne, ou lorsqu'un signifié
est représenté par plusieurs signifiants, comme dans nous aimons, où l'idée
de première pluriel est exprimée deux fois ; ou encore quand les parties
d'un même signe sont séparées : elle a pardonné : elle ne nous a jamais plus
pardonné etc., etc.
Il y a polysémie lorsque, dans la mémoire, à l'état latent, un signifiant
a plusieurs significations (ainsi in- signifie non dans inconnu et dans dans
inscrire), ou qu'une idée est rendue par plusieurs signifiants, comme l'idée
d'aller, qui est représentée par trois radicaux différents dans va, allons,
j'irai.
On admet couramment que le langage est polysémique et que c'est
par exception qu'un signifiant a une seule valeur, et une valeur un seul
signifiant. Mais — chose curieuse — on considère comme allant de soi
que le discours est normalement linéaire, que les signes se succèdent sans
chevauchements, par simple juxtaposition, sur la ligne de la parole. Cette
croyance a sa source dans diverses conceptions erronées, p. ex. dans une
vue simpliste de ce qu'est la matière phonique (où l'on ne tient compte
que des sons articulés), dans des idées toutes faites sur la nature des
« mots » (on justifie la linéarité en disant qu'on ne peut pas prononcer
144deux mots à la fois !), enfin dans le prestige de l'écriture, qui isole arbitrairement
les éléments et juxtapose sur une ligne les blocs ainsi isolés.
Nous essaierons de montrer qu'en réalité la dystaxie est l'état habituel,
qu'elle est le corrélatif de la polysémie, et que par suite, la discordance
entre signifiés et signifiants est la règle.
Mais cette discordance a ses degrés. Reprenant donc notre définition
de tout à l'heure, nous posons qu'une langue est synthétique dans la
mesure où cette discordance est profonde et fréquente, ou au contraire
analytique dans la mesure où ce désaccord est faible et rare.
Nous donnons ci-après un aperçu des formes les plus caractéristiques
de la dystaxie et de la polysémie. Mais l'étude des types fondamentaux
ne doit pas faire oublier que les cas les plus fréquents de la synthèse se
trouvent dans les formes intermédiaires, dont nous signalerons quelques-unes
seulement.
216. Notons encore que les différentes formes de non-linéarité et de
polysémie ne comportent que des définitions statiques ; les explications
historiques qu'on y mêlerait fausseraient la perspective en faisant apparaître,
non ce qui est, mais ce qui s'est produit, en expliquant des procès,
au lieu de décrire des procédés. L'histoire montrerait notamment que ce
qui est synthétique dans un état de langue a été analytique dans un
autre, et vice versa. Ce que nous appelons synthèse et analyse, c'est l'ensemble
des procédés imposés, dans un état de langue, aux sujets par le
fonctionnement de cette langue, en l'absence de tout changement ; on
ne saurait trop insister sur ce caractère d'obligation ; aussi ne s'étonnera-t-on
pas de trouver, dans nos exposés, des expressions telles que « Douter oblige
le verbe de la subordonnée à être au subjonctif », « Le suffixe -ité demande
un radical d'adjectif », etc., toutes façons de parler absurdes dans l'explication
historique, mais parfaitement logiques en synchronie, vu la nature
impérative des systèmes linguistiques.
C'est aussi la raison pour laquelle la terminologie des types d'analyse
et de synthèse est strictement statique ; l'intrusion de termes désignant
les changements trouble la vue. On trouvera des exemples de ces confusions
aux §§ 217, 223, 226, etc.145
I. Non-linéarité ou dystaxie
Signe fractionné (« agglutination »)
217. Nous entendons par signe fractionné la répartition d'un signifié
unique sur plusieurs faux signifiants qui n'ont un sens que dans leur ensemble.
L'exemple le plus clair est celui des locutions toutes faites comme
tout-à-coup (= « soudain »), où les mots tout, à et coup, pris individuellement,
sont inintelligibles. L'incompréhension des fragments est donc le
critère du signe fractionné, et c'est là une différence essentielle entre la
synchronie et la diachronie : la linguistique historique cherche à expliquer
ce que le sujets ne comprennent pas ; la linguistique statique voit dans
l'incompréhension des sujets un principe d'explication. Or, dans tout-à-coup,
il y a dystaxie évidente, puisque l'idée unique de soudaineté est
exprimée par plusieurs blocs phoniques déguisés en signifiants.
On observe ce fractionnement dans toutes les formes de faux syntagmes,
p. ex. dans l'union d'un « préfixe » et d'un « radical » (prétendre = « affirmer »),
dans celle d'une « racine » avec un « suffixe » (firmament = « ciel »),
dans celle d'une « racine » et d'une « désinence » (« Vive le roi ! », où la finale
ne marque plus l'idée du subjonctif).
218. Dans ce fractionnement, les éléments présentent tous les degrés
d'oblitération ; les cas intermédiaires sont même les plus fréquents et les
plus importants. Comme il s'agit, historiquement, de la perte progressive
du sens des éléments, cette perte peut être incomplète à des degrés infiniment
divers, et rapprocher le signe fractionné du syntagme libre.
Ainsi la locution ouvrir les hostilités est moins bloquée, plus analysable,
plus intelligible dans ses éléments que avoir maille à partir avec quelqu'un
c'est-à-dire « être en désaccord avec lui », où maille et partir n'ont plus de
sens. Mais jamais le signe fractionné ne participe du caractère fondamental
du syntagme libre, dont chaque élément peut être remplacé par n'importe
quel autre de la même catégorie (cf. « ouvrir une porte, fermer une fenêtre,
boucher une bouteille, etc. », ce qui serait impossible pour ouvrir les hostilités,
puisqu'on ne peut pas même dire « ouvrir le combat, ouvrir la guerre »).
219. Remarquons que les fragments d'un bloc sémantique peuvent être
séparés, ce qui, comme on le verra plus loin (265), est un autre facteur
de synthèse ajouté au premier. En français, c'est le cas pour la négation
(Je n'ai pas faim) et pour les prépositions vides faisant corps avec certains
146verbes (jouer de la flûte, jouer à la manille, passer pour un honnête
homme, etc.) lorsqu'un ou plusieurs mots sont intercalés entre les deux
éléments (Paul joue très bien de la flûte, passe à juste titre pour un honnête
homme). La « tmèse » des préfixes verbaux en sanscrit védique et en grec
rentre dans cet ordre de faits ; ainsi dans Homère epì nēòn érepsa « j'ai
élevé un temple ». En sanscrit, une racine verbale comme yuj- « atteler »
est coupée en deux au présent par un infixe na : yu-na-j-mi « j'attelle ».
220. Nous verrons § 257 qu'il y a une forme implicite de signe fractionné :
c'est un des aspects les plus importants du changement de sens, et notamment
de l'extinction des figures. L'adjectif rose (un ruban rose) a signifié
d'abord « tel qu'une rose » (syntagme implicite, hypostase ; cf. un ruban
orange) ; puis, l'analogie des autres adjectifs de couleurs (rouge, vert, etc.)
a bloqué le syntagme, de sorte que rose a fini par désigner lui aussi simplement,
et non plus par métaphore, une couleur.
Il faut signaler encore l'agglutination de syntagmes implicites renfermant
originairement l'ellipse d'un des termes (245). Ainsi dans le vin blanc
et le rouge, le rouge est un syntagme elliptique, où le mot vin est nécessairement
suppléé. Mais il arrive souvent que l'ellipse soit très effacée lorsqu'elle
est suggérée par une situation permanente, dans un milieu stable. Ainsi au
café, la question « Voulez-vous du rouge ou du blanc ? » se comprend sans
contexte ni déixis. Enfin l'emploi du signe elliptique peut devenir usuel
même en dehors de son milieu ; il est alors autonome et simple ; c'est le
cas de capitale pour ville capitale, tailleur pour tailleur d'habits (on notera
que coupeur demande encore à être déterminé par son milieu, précisément
le même que celui de tailleur).
Enfin, puisque l'ellipse est un représentant zéro (127), on mettra en
parallèle avec le cas précédent celui où un représentant explicite ne représente
plus rien ; c'est ainsi que beaucoup de locutions verbales renferment
les pronoms le, la, en, y, sans aucune relation avec un substantif
quelconque : « Vous me le paierez » — « Vous me la baillez belle » — « Je ne
t'en veux pas » — « Je n'y tiens plus » (v. Bally, Traité II, p. 68 ss.).
221. La phonologie connaît des sons complexes qu'on peut considérer — à
un point de vue strictement statique — comme des agglutinations :
p. ex. les mi-occlusives ou affriquées qui, bien que composées d'une occlusive
et d'une spirante, sont senties comme des phonèmes simples : p. ex.
le tch et le dj de l'italien (cervo, giorno), le ts de l'allemand (Zeit), le dz de
l'arménien ; on pourrait citer encore dans cette classe le chtch du russe et
147les aspirées pʻ tʻ kʻ de l'allemand (Pute, Tier, Kauf) dont le souffle est
senti simultané à l'occlusive ; il y a même des mi-occlusives aspirées, p. ex.
tsʻ et tchʻ en arménien (v. 212).
222. Historiquement, l'engorgement progressif des charnières grammaticales
(l'agglutination) est plus ou moins simultané à la simplification
du sens. On est en présence d'un procès qui sape la grammaire au profit
du lexique, un procès de « dégrammaticalisation », de lexicalisation. En
effet, l'affaiblissement des articulations syntagmatiques rapproche le syntagme
du mot, et du mot simple, du signe arbitraire : tout à fait équivaut
à « complètement », prétendre à « affirmer », etc. Mais — nous le répétons — ce
procès comporte tous les degrés : prendre la fuite est plus locutionnel
que se mettre à fuir, à cause du sens très vague de prendre ; s'enfuir est plus
condensé que prendre la fuite, parce que se a perdu presque toute signification.
Il y a encore de la grammaire dans prévoir, il n'y en a plus dans
présumer, etc.
Si l'agglutination enrichit le vocabulaire aux dépens de la grammaire,
ce procès de lexicalisation peut être arrêté dans son cours lorsque des
influences analogiques donnent au syntagme défaillant une nouvelle vie.
Il peut retourner à sa signification première (ce cas, très fréquent, n'a pas
d'intérêt ici) ; mais il peut aussi recevoir une nouvelle valeur grammaticale.
A l'origine, le tour pendant le combat, pendant le sommeil, etc. reflétait
l'ablatif absolu latin pendente pugna, pendente somno. Mais à partir d'une
certaine époque, on n'a plus compris cette séquence, parce qu'elle place
le sujet après le verbe : pendant le combat aurait pu devenir une locution ;
mais la fréquence de ce tour (pendant le jour, pendant le dîner, etc.) et l'analogie
de dans le combat, etc. ont fait dependant une préposition ; un nouveau
type syntagmatique est né.
223. On constate une fois de plus la différence entre le point de vue
synchronique et celui de l'histoire ; pour celle-ci, le fait caractéristique
dans tout à fait, c'est le tassement des signes au fur et à mesure qu'ils
perdent de leur autonomie ; pour la statique, le fait typique est, au contraire,
la répartition d'un signifié unique sur plusieurs faux signifiants.
C'est pour cela que la linguistique historique parle ici d'agglutination,
et il nous est arrivé d'employer ce terme, bien qu'il désigne le procès,
et non l'état qui en résulte. Ajoutons que le mot « agglutination » prête
aussi à une autre confusion fâcheuse ; il suggère un rapport avec les langues
« agglutinantes » ; or, les signes qui « s'agglutinent » dans ces idiomes (hongrois,
148finnois, turc, etc.) sont mobiles et nettement distincts les uns des
autres, tant pour la forme que pour la valeur, qui est proprement grammaticale ;
si bien qu'on a dit des langues agglutinantes qu'elles se rapprochent
sensiblement de l'idéal de linéarité 169 : autrement dit, les langues agglutinantes
sont celles où les syntagmes agglutinés correspondent le moins à
des signes fractionnés.
224. De toutes les formes de la non-linéarité, la condensation des signifiants
dont il vient d'être question est la plus importante, celle dont les
manifestations sont les plus nombreuses. C'est aussi le type le plus aisément
saisissable de la dystaxie ; nous n'insistons donc pas davantage ici,
d'autant plus qu'on trouvera un exposé complet de la question dans mon
Traité, I, p. 31 ss.
Cumul des signifiés
225. Nous disons qu'il y a cumul des signifiés (ou par abréviation cumul)
quand un signifiant unique et indécomposable renferme plusieurs valeurs que
des associations mémorielles permettent d'analyser clairement.
Ainsi, en français, jument est défini spontanément « femelle du cheval »,
aussi spontanément que ânesse « femelle de l'âne ». Les mots de ce genre,
très nombreux, relèvent de la motivation implicite dont il est question § 205 ss.
L'allemand Schimmel se traduit nécessairement par « cheval blanc », et l'anglais
to starve par « mourir de faim ». Pire est synonyme de « plus mauvais », et
évoque, comme meilleur, moindre, etc. le type syntagmatique du comparatif.
Les mots que F. Brunot appelle des nominaux (P. L., p. 63 ss. ; cf. 117)
sont des substantifs actualisés cumulant les idées générales de personne
ou de chose avec un actualisateur : quelqu'un = « une personne », moi =
« la personne qui parle », cela = « cette chose », rien = « aucune chose », etc.
226. Dans la plume, l'article actualise le substantif virtuel plume ; mais
il indique en outre que ce substantif est du genre féminin (139) et qu'il est
au singulier. En français, cette double fonction est propre à presque tous
les actualisateurs.
Le cumul est fréquent dans les mots qui intéressent la grammaire : ainsi
dans « l'herbe des prairies » des équivaut à de les, comme le montre la comparaison
149avec « l'herbe de la prairie ». Notons en passant que les sujets ne
voient pas dans des une « contraction » : la contraction est un fait d'évolution,
étranger à la synchronie. Elle ne se justifie pas même historiquement
dans « se souvenir d'histoires étranges » (cf. « se rappeler des histoires
étranges ») où d' = « de des », pas plus que dans « se souvenir d'étranges
histoires » où d' vaut « de de » (cf. « se rappeler d'étranges histoires »).
Les adjectifs possessifs équivalent à la préposition de régissant un pronom ;
mon chapeau = « le chapeau de moi » (cf. le chapeau de Paul, et gr.
ho pîlós mou, où mou est un génitif). Le pronom relatif cumule les fonctions
de transpositeur adjectif (191) et de représentant : que, dans le livre
que je lis, transforme en adjectif la phrase je le lis ; on sait d'ailleurs (138)
qu'au lieu de « une femme dont le mari est mort », le peuple dit une femme
que son mari est mort (son = « d'elle »).
La plupart des adverbes de lieu et de temps (116), ainsi que tous les
ligaments grammaticaux lexicalisés (135), p. ex. les conjonctions coordinatives
(94), présentent des cas de cumul : ici = « dans ce lieu » ; alors =
« à ce moment » ; donc = « en conséquence de cela ».
Dans faire une chose par amitié, par cumule l'idée de rapport rectionnel
pur et simple avec celle de motif. Les signes les plus fortement lexicalisés
sont les copules transitives (tuer, vendre, etc. § 168), où le rapport de rection
est combiné avec l'élément lexical. Dans les transitifs à préposition vide
(s'emparer d'une ville, obéir à un maître), il y a une sorte de répartition
des deux idées, la préposition ayant une valeur purement grammaticale
et le radical verbal une valeur essentiellement lexicale.
227. Les désinences des langues flexionnelles cumulent régulièrement
plusieurs valeurs grammaticales : dans le latin am-o, la finale exprime les
idées de première personne, de singulier, de présent, d'indicatif, de voix
active. Dans domin-um, la finale signifie l'accusatif et le singulier. C'est là
une des formes les plus frappantes de la synthèse. En français même, dans
j'aim-ais, -ais cumule les fonctions d'imparfait et de singulier (cf. nous
aim-i-ons). Les langues même les plus analytiques conservent — on l'a
vu § 48 — l'habitude de fondre le modus et le dictum par l'emploi des modes,
notamment de l'indicatif.
228. Il y a des cas de cumul syntaxique. Soit (Paul est-il ici ?) — Oui. Oui
signifie « J'affirme que Paul est ici » ; il cumule donc modus et dictum (28) ;
le modus est fourni par la langue, le dictum par la parole. Dans la phrase
russe Oná ne lʼúbit svoegó múja « Elle n'aime pas son mari », múja est. au
150génitif d'abord comme complément d'objet du genre animé (cf. Oná lʼúbit
svoegó múja et lʼúbit múzïki « Il aime la musique ») ; mais de plus, la négation
demande que le complément d'objet, même de genre inanimé, soit au
génitif (cf. Ne lʼúbit múzïki) ; il y a donc deux raisons pour que múja soit
au génitif dans la première phrase 170.
229. L'apophonie vocalique, si répandue dans toutes les langues indo-européennes,
produit une importante variété de cumul ; dans l'allemand
Bruder/Brüder « frère(s) », dans l'anglais goose/geese « oie(s) », la différence
entre singulier et pluriel est rendue par le timbre de la voyelle qui, en
même temps, fait partie du radical. Le déclin de l'apophonie a très souvent
pour conséquence le remplacement de ses valeurs grammaticales par des
affixes. C'est la raison d'être de l'opposition entre verbes forts et verbes
faibles en allemand. Comparez celle des deux verbes pour « louer » : preisen,
pries et loben, lobte. Ainsi la flexion faible a pour effet de remplacer par
un procédé linéaire ce que la flexion forte exprime par cumul. En fait,
plus une langue indo-européenne devient analytique, moins on la voit
faire usage de l'apophonie pour rendre ses idées grammaticales. L'allemand
la cultive encore systématiquement ; le français l'a à peu près abandonnée.
230. Les formes les plus importantes du cumul sont des formes intermédiaires.
Ainsi, à côté de la fusion complète, il y a le simple engrènement.
Le cas est fréquent dans les langues flexionnelles ; souvent la désinence
se soude avec le radical en restant partiellement distincte ; pour le latin
rosae, la soudure est dans une diphtongue, pour le génitif manūs, dans
une voyelle longue. Là encore, on évitera de parler de « contraction » en
statique. En français, les élisions et les liaisons sont autant de cas d'engrènement ;
si p. ex. « du soldat » présente un cas de cumul absolu (du — « de le »),
« d'un soldat » juxtapose de et un dans la même syllabe ; les deux variétés
se rencontrent dans « l'opinion d'un des assistants ». La liaison produit le
même résultat : un n'ami, mon n'ami ; la finale du déterminatif fait corps
avec l'initiale du mot suivant. Ceci est dû surtout, comme on le voit, au
fait que la séparation des syllabes ne correspond pas à celle des éléments
significatifs ; et c'est là un des caractères essentiels du français (312).
On sait aussi (191 ss.) que toute transposition caractérisée par un signe
extérieur au transposé présente un cas de cumul partiel. On le constate
151p. ex. dans la transposition des virtuels (ou dérivation), lorsque le radical
du transposé est modifié par la transposition ; ainsi dans réaliser = « rendre
réel », le a du radical réal- contribue, avec le suffixe -iser, à marquer la
transposition. De même pour la transposition des actuels, p. ex. quand
une phrase, en prenant la fonction de proposition-terme, change la forme
de son verbe ; comparez « Vous êtes innocent » et « Je doute que vous soyez
innocent », où le verbe cumule l'idée verbale de « être » et celle d'un transpositeur.
231. Un type de cumul extrêmement important relève de la phonologie :
c'est celui qu'on peut appeler musico-articulatoire. Il s'agit de la combinaison
de signes articulés (c'est-à-dire formés de voyelles et de consonnes)
avec des éléments musicaux porteurs de valeurs significatives, le plus
souvent (mais pas toujours, v. 40) grammaticales.
Nous appelons éléments musicaux de la phonation tout ce qui relève
du chant, p. ex. la mélodie ou intonation, l'accent d'intensité, la durée
des sons, et, plus généralement, tout ce qui a un caractère rythmique,
comme les pauses ou silences et les répétitions.
Il y a donc cumul toutes les fois qu'un ou plusieurs de ces éléments
(nécessairement fondu(s) avec une tranche articulée !) a par lui-même une
valeur linguistique.
232. Voici quelques exemples. En allemand, un accent fort frappant
un mot en fait le propos de l'énoncé. Dans « Karl ist heute abgefahren »,
l'accent d'insistance fait de heute le « prédicat psychologique » : « C'est aujourd'hui
que Charles est parti ». Cet accent est bien distinct du mot avec
lequel il est combiné ; il y a cumul de deux signifiés dans un seul signifiant.
En grec ancien, phérômen veut dire « nous portons », et phérōmen « que
nous portions » ; la différence entre l'indicatif et le subjonctif est marquée
uniquement par la quantité de l'o. De même, en latin sequĕre veut dire
« tu suis » et sequēre « tu suivras ». En français et dans d'autres langues,
l'intonation peut à elle seule faire d'une phrase une énonciation positive
ou une interrogation. « Tu viens », prononcé sur une mélodie descendante,
est une affirmation, et sur une mélodie montante une question. On sait
qu'en chinois et en annamite, tout mot n'a un sens que par combinaison
d'un monosyllabe avec une intonation particulière, en sorte que le même
monosyllabe peut avoir des significations totalement différentes selon la
manière dont il est intoné. Dans ce cas, le cumul est purement lexical,
cas très rare dans les langues indo-européennes.152
Les répétitions et les pauses sont des formes extrêmes du cumul musico-articulatoire ;
une répétition est intérieure aux éléments répétés et plane,
pour ainsi dire, sur eux. En français, petit à petit, peu à peu, pas à pas, etc.
ont une valeur itérative concrète marquée par la répétition d'un même
mot ; mais — vérité trop évidente — cette répétition suppose la présence
de deux éléments répétés. De même pour la pause, bien que ce cas soit
plus subtil ; on sait (81) qu'elle est, avec la mélodie, un élément constitutif
de la phrase segmentée ; or il n'y a pas de pause entre les segments si ces
segments n'existent pas.
Le cumul musico-articulatoire est un des grands ressorts du langage
expressif ; c'est grâce à l'accent d'insistance et à la mélodie que les tours
les plus ordinaires peuvent prendre une teinte affective (cf. Bally, LV3,
p. 105 s., 130 s., etc.). La manière dont on chante une simple phrase
comme « Tu partiras » peut en faire non seulement une affirmation, une
question, un ordre, un acquiescement, etc., mais exprimer en outre les
nuances émotives les plus diverses ; p. ex. la question peut s'accompagner
d'une crainte, d'un espoir, etc.
233. Il semble que l'importance des facteurs musicaux dans la grammaire
d'une langue soit parallèle au caractère synthétique de cette langue
(v. Bally, Rythme). Mais nous sommes loin d'avoir les clartés suffisantes
pour prouver cette correspondance dans le détail. Qu'on songe cependant
au rôle de la place du ton en indo-européen, en sanscrit védique, en grec
et en russe, à celui de la quantité des syllabes en sanscrit et en latin, etc.
Par contre, le français n'accorde presque aucune signification grammaticale
à la durée des syllabes, et assez peu d'importance à l'accent ; seule, la
mélodie a une valeur syntaxique appréciable.
Pléonasme grammatical obligatoire 171
234. Le pléonasme grammatical obligatoire exige qu'une même notion soit
exprimée deux ou plusieurs fois dans le même syntagme. Il se distingue
donc, par ce caractère impératif, du pléonasme « vicieux » (prévoyance de
l'avenir) ou expressif (voir de ses propres yeux). Ainsi on ne doit pas dire
monter en haut, mais on est obligé de dire monter sur un arbre. Or, une
préposition régie par un verbe reproduit souvent l'idée verbale (174 A) : se
153diriger vers, entrer dans, passer à travers, tourner autour ; comparez heurter
contre un meuble et heurter un meuble ; all. in das Zimmer hineingehen, etc.
L'article est pléonastique dans les fruits les plus beaux (cf. les plus beaux
fruits). Dans nous aimons, l'idée de pluriel est signifiée deux fois (une
seule fois dans lat. amamus). Il y a double négation dans « Personne n'échappe
à son destin » ; « Je ne te reverrai jamais ».
Le pléonasme est donc la contre-partie du cumul des signifiés, et l'on
pourrait l'appeler cumul des signifiants si le terme de cumul n'était pas
ici légèrement impropre. Par son caractère obligatoire, il relève de la
langue ; les autres pléonasmes sont des faits de parole.
235. L'allemand pratique le pléonasme obligatoire sur une vaste échelle ;
cela provient de sa position intermédiaire entre l'analyse et la synthèse :
il est armé de flexions jusqu'aux dents, et pourtant celles-ci accompagnent
des signes préfixés tout prêts à les remplacer : cf. die Gäste, eines schönen
Gartens, du lügst, etc. Le cas classique, hérité de l'indo-européen, est
celui des prépositions accompagnées d'une forme déclinée (durch den Wald,
lat. per silvam, contre fr. par la forêt, anglais through the wood). On comparera
aussi Die tapferen römischen Soldaten rücken vor, où le pluriel est
signifié cinq fois, avec Les vaillants soldats romains s'avancent, où les est
seul à rendre cette idée pour l'oreille, les autres finales étant uniquement
orthographiques. Mais le français connaît aussi ces surcharges : « une ravissante
petite chatte blanche» marque cinq fois la notion de féminin, et,
dans La neige est blanche, elle est exprimée deux fois, tandis que l'allemand
ne connaît pas ce dernier pléonasme, l'adjectif prédicatif étant
invariable : Der Schnee ist weiss.
On le voit : l'accord souligné par la concordance des formes (172) est
le cas peut-être le plus fréquent du pléonasme grammatical ; c'est un puissant
facteur de synthèse ; ce n'est pas un hasard si les langues indo-européennes
s'en affranchissent au fur et à mesure que leur attitude devient
plus analytique. C'est d'ailleurs le contre-coup fatal de la perte
des flexions : tout se tient.
236. Remarque : Mentionnons en terminant un fait général d'une assez
grande portée :
Lorsque deux phrases coordonnées se fondent en une seule, les signes
qui représentent dans l'une des éléments énoncés dans l'autre, deviennent
asémantiques, ou tout au moins pléonastiques, quitte à recevoir une valeur
nouvelle.154
Dans i.e. *ei-ti « il marche », -ti a une pleine valeur de pronom-sujet de
troisième personne ; il l'a encore dans Eiti ! Ekwos ! « Il marche ; (ce qui
marche est) un cheval ». Mais il la perd dès que *eiti ekwos ou *ekwos eiti
ne forme plus qu'une seule phrase. De même en latin : -t est un vrai sujet
dans currit « il court », mais il est vide dans equos currit. En ancien français,
le -t de court (currit) a sa pleine valeur ; il fait double emploi dans
il court. En français moderne, ce même il a son sens plein dans Il trotte,
et aussi dans il trotte, le cheval ou le cheval, il trotte (phrases segmentées,
v. § 80) ; mais quand le langage populaire supprime la pause et unifie l'intonation
dans « Le cheval il trotte », il fait double emploi avec le cheval.
Peut-être il deviendra-t-il un ligament rattachant le verbe au sujet. Quand
la segmentée AZ « Ton frère, vient-il ? » se change en « Ton frère vient-il ? »
(333), il ne sert plus à rien ; ou plutôt, il devient une particule interrogative 172.
237. Dans le type « Regarde la pluie, comme elle tombe », elle conserve
sa valeur tant que « comme elle tombe » est une adjonction explicative de
« la pluie », mais en cas de fusion (Regarde la pluie comme elle tombe =
« Regarde comme la pluie tombe »), elle n'a plus de raison d'être. C'est
pour la même raison que le latin ille est un vrai démonstratif dans ille
canis, même avec l'adjonction explicative venatoris ; ille canis, venatoris
(avec pause médiane) signifie : « Ce chien, (à savoir celui) du chasseur ».
Mais cette valeur s'est perdue quand, en latin vulgaire, on a dit en un
seul énoncé ille canis venatoris, devenu en français le chien du chasseur,
où le prépare simplement l'actualisation, réalisée par le complément du
nom. Ainsi s'explique aussi la différence existant entre deux types de
propositions relatives : dans le chemin, où je marche péniblement (avec
pause médiane), le substantif est actualisé par son article, dans le chemin
où je marche péniblement (phrase liée), le substantif est actualisé par la
proposition relative, et l'article le n'actualise pas. Seulement l'origine coordinative
des relatives françaises se perd dans la nuit des temps, tandis
qu'elle est transparente pour les relatives allemandes : dans der Weg, den
ich betrete, le relatif était autrefois un démonstratif.
238. Cette vue générale peut apporter un élément de clarté dans la
question si controversée des verbes impersonnels.
M. W. Brandenstein (IF 46 (1928), p. 1 ss.) fait une distinction judicieuse
entre 1) Es regnet et 2) Es ist schade, dass du nicht gekommen bist
155et Es ritten zwei Reiter zum Tore hinaus ; mais quand il en conclut,
comme Brugmann, que le es de es regnet est un « Scheinsubjekt », il ne voit
pas que le type 2), qui admet pleinement cette dénomination, prouve,
par contre-coup, que es est un vrai sujet dans le type 1) ; nous avons vu
que es ist schade, dass du nicht gekommen bist est issu d'un plus ancien
es ist schade (= « das ist schade »), (nämlich) dass du nicht gekommen bist ;
ceci explique l'opposition entre es klopft et es klopft jemand, et finalement
celle — plus subtile sans doute — entre il pleut et il pleut du sang ; et nous
concluons 1) que es regnet ne diffère de es ist schade que par la plus grande
indétermination du sujet ; 2) que es, explétif quand il est repris par un
autre terme, a une valeur propre quand il n'a pas d'autre détermination.
Sur la valeur logique de il (es), v. plus haut § 236.
Conditionnement réciproque arbitraire
239. Le conditionnement réciproque est l'essence même de toute relation
grammaticale. Mais il s'agit ici d'un conditionnement arbitraire,
forme particulière du pléonasme et un des facteurs les plus efficaces de
synthèse.
Il consiste en ce que, dans un syntagme donné, un signe doit être employé
à l'exclusion d'un ou plusieurs autres qui ont pourtant exactement la même
valeur. Le conditionnement arbitraire a toujours été motivé autrefois ; mais
il a cessé de l'être, et c'est là une grande différence de point de vue entre
la linguistique statique et l'histoire.
240. Le conditionnement peut être imposé soit par un signifiant, soit
par un signifié.
Par un signifiant : en français, on doit employer le préfixe dé- devant
consonne et dés- devant voyelle (déraciner : désorganiser). Cette condition
n'est plus ni phonétique ni morphologique (cf. l'hiatus dans réorganiser,
préalpe, coadjuteur, etc.).
Par un signifié : l'adjectif valide demande — sans raison dans l'état actuel — que
le nom abstrait correspondant soit validité, et non p. ex. validitude,
bien qu'on dise ingrat : ingratitude. En outre- mais ceci n'est pas purement
arbitraire (522) — -ité ne s'ajoute qu'à des radicaux empruntés au latin,
et -té à des radicaux romans (comparez maturité, médiocrité, et bonté, volonté,
etc.). Enfin — condition plus importante — -ité et -itude ne peuvent
être précédés que de radicaux d'adjectifs, jamais de substantifs ou de
156verbes. Cette règle est générale en indo-européen en matière de suffixation :
un nom d'action a ses suffixes propres (-ment, -tion, etc.), qui ne servent
pas pour la dérivation d'un adjectif en substantif ; réciproquement, un
nom de qualité repousse les suffixes affectés aux noms d'action 173 ; ainsi
fabrication est normal, fabricité et fabricitude seraient des monstres. Pourtant
cette condition, héritée de l'indo-européen, est arbitraire : il suffirait
que le suffixe marque la fonction de substantif, le radical indiquant par
lui-même la nature du mot de base (fabric- verbe, stupid- adjectif, etc.).
Conditionnement réciproque implique donc pléonasme : la notion d'adjectif
se trouve à la fois dans stupid- et dans -ité, celle de verbe à la fois
dans fabric- et dans -ation, etc.
241. Le conditionnement arbitraire régnait en maître dans la flexion
indo-européenne.
a) Envisageons la question d'abord au point de vue des radicaux. Il n'y
a aucune raison (sinon historique) pour qu'en grec le mot pour « esprit »
ait trois radicaux : phrên- au nominatif singulier, phre- au datif pluriel
et phren- aux autres cas, pour qu'en sanscrit le mot pour « roi » râjan ait
aussi cinq radicaux selon la nature des désinences explicites ou zéro qui
y sont affixées : râjan, râjân, râjâ, râjñ, râja. Ce conditionnement est un
brevet d'archaïsme pour une langue de notre famille, car la tendance
analytique incline vers l'invariabilité des radicaux. L'allemand y est bien
moins soumis que le grec, le français beaucoup moins que l'allemand,
et l'anglais moins que le français. Pour l'allemand, on peut citer les nombreux
cas d'apophonie mentionnés à un autre point de vue au § 229 ;
dans Gast : Gäste, le pluriel demande l'umlaut sans que la cause phonétique
de cet umlaut subsiste. En français, le conditionnement du radical par la
désinence est extrêmement rare ; on sait que même dans le type décolleter,
l'obligation d'avoir la variante décollèt- devant une désinence zéro tend à
disparaître ; instinctivement on dit elle se décoll'te 274.
b) Si l'on s'attache aux désinences, le conditionnement arbitraire paraît
autrement tyrannique dans les langues flexionnelles. Les déclinaisons et
conjugaisons indo-européennes ne sont — au point de vue statique — qu'un
157vaste système de conditionnement réciproque arbitraire. Pourquoi, en
latin, le radical domin- a-t-il à l'accusatif singulier la désinence -um plutôt
que -em (cf. regem) ou -am (cf. scribam) ? Il n'y a aucune raison pour que
le radical verbal am- ait une 2e sing. ind. amās plutôt que amēs ou amis
(cf. monēs, legis). Il y a là une simple exigence imposée aux sujets parlants.
Inversement, la finale -um fait attendre certains radicaux (mund-, serv-,
etc.), à l'exclusion de certains autres (reg-, ros-, etc.).
242. Ce mécanisme éclaire la question du subjonctif français. Celui-ci,
on le sait, n'existe qu'en subordonnée ; c'est un outil de transposition
(191 ss.) ; le subjonctif de principale supplée simplement l'impératif (288) 175.
Si la phrase « Tu réussiras » est transposée en complément d'objet dans « Je
doute que tu réussisses », on constate que le verbe douter oblige le verbe
réussir à passer du futur indicatif au présent subjonctif ; cela est purement
arbitraire ; inversement, le subjonctif de subordonnée exige que le verbe
principal figure dans une liste où se trouve douter, ainsi que nier, craindre,
s'étonner, etc. Ici encore, conditionnement implique pléonasme : il y a
quelque chose du doute dans « que tu réussisses » aussi bien que dans « je
doute ». C'est d'ailleurs l'explication qu'on donne couramment de cette
syntaxe ; seulement on joue sur les mots : dans l'état actuel de la langue,
cette idée de doute qui est dans « que tu réussisses » tient moins
à la nature du subjontif qu'à une exigence de la syntaxe morte : c'est
aussi peu significatif que l'obligation d'affixer -ité à stupide plutôt que
-itude.
243. On le voit : rien ne permet de prévoir que valide formera validité
et non validitude, que je crois sera suivi de l'indicatif et je ne crois pas
du subjonctif, puisque le conditionnement est arbitraire ; seule l'histoire,
qui dans ce cas n'explique pas le présent, peut déceler l'origine de ces commandements
impératifs. Ainsi donc, le conditionnement conventionnel,
fait extrêmement général, est imprévisible, et c'est par là qu'il est générateur
de synthèse. S'il était raisonné, il laisserait à l'esprit toute liberté
dans les combinaisons ; étant arbitraire, il oblige la mémoire à intervenir ;
158celle-ci retient mécaniquement les combinaisons ; les charnières des syntagmes
ainsi formés sont moins mobiles que si les formations obéissaient
à des lois rationnelles.
Sous-entente
244. Un signe est sous-entendu lorsque le mécanisme de la langue, sans
le secours de la parole, permet de le rétablir (inconsciemment) grâce à l'association
avec un autre type linguistique où ce signe a une forme explicite revêtue
de la même valeur. Il y a, par exemple, sous-entente de la copule dans
latin Paulus aeger « Paul est malade », parce que le type parallèle « Paulus
aeger est » permet de la suppléer dans le premier. En anglais (au point de
vue de l'état actuel !), il y a sous-entente de la conjonction that dans
I think you lie « Je crois que vous mentez », et de daß en allemand dans Ich
denke, Sie lügen (sans pause interne !). Le pronom relatif est sous-entendu
dans The man we saw yesterday, The man I think of « L'homme que nous
avons vu hier, L'homme auquel je pense ». On peut parler de sous-entente
de la préposition pendant dans travailler la nuit (sur la différence aspective,
v. § 587) et de pour accompagnant certains verbes de mouvement, comme
dans Je viens vous demander un service.
Ellipse
245. Le mot ellipse a été employé dans des sens très différents. Ici,
nous appelons ellipse la sous-entente dans la parole, à une place déterminée
du discours, d'un signe figurant dans un contexte précédent ou suivant. En
d'autres termes, l'ellipse est, dans la parole, le pendant de la sous-entente.
Exemple : « Madame X. a deux enfants, l'un de six ans, l'autre de quatre
(c'est-à-dire de quatre ans) » — « Le vin rouge et le blanc » - « Où allez-vous ?
A l'Université » - « Irez-vous au théâtre ? Je pense » — « Dans un délai de
deux ou, au maximum, de trois mois ».
Cette définition de l'ellipse montre qu'elle est un représentant zéro (127).
On le voit aisément si l'on compare les cas où l'usage exige l'ellipse avec
ceux où la représentation est de règle : « Paul a quatre ans et Pierre dix » :
« Paul a quatre ans et Pierre en a dix ». On le voit mieux encore lorsque
le choix est libre : « Paul est plus intelligent qu'on ne (le) croit ».
On sait (126) qu'il y a une ellipse de situation. La phrase Regardez ! n'a
aucun sens si l'esprit ne supplée pas la représentation de l'objet ou du
159procès qu'on signale. En effet Regardez ! = « Regardez ceci ! », le geste
remplaçant un mot déictique. De même, au café, la question Voulez-vous
du rouge ou du blanc suggère immédiatement la représentation du vin.
246. On comprend dès lors en quoi diffèrent la sous-entente dans la
langue et l'ellipse dans la parole. La première a une valeur uniquement
grammaticale ; la seconde peut représenter, au gré des circonstances,
n'importe quel signe ou groupe de signes, pourvu qu'il soit de nature
lexicale. Enfin, l'ellipse, une fois caractérisée comme nous l'avons fait,
se distingue nettement de toute autre expression abrégée (brachylogique)
qu'on a pu appeler ellipse dans un sens plus vague, p. ex. les phrases
exclamatives sans verbe (Quelle horreur ! — Plutôt mourir !, etc.). Dans
ces cas-lè, on chercherait vainement dans le contexte ou la situation ce
qui permet de suppléer les signes déterminés et positifs que la grammaire
réclame, c'est-à-dire un verbe et une syntaxe « logique » (= « C'est horrible !
Je préfère mourir », etc.).
247. L'ellipse est plus fréquente dans la langue parlée que dans la
langue écrite ; cela est naturel : dans la langue parlée, le sujet peut broder
sur la situation ou sur les paroles de l'interlocuteur ; la langue écrite doit
se créer elle-même cette ambiance.
D'autre part, les langues, dans leur ensemble, diffèrent les unes des
autres par le rôle qu'elles attribuent respectivement à l'ellipse et à la représentation.
Le grec ancien, par exemple, pratique l'ellipse dans une foule
de cas où la représentation serait obligatoire en français (exemple entre
mille : faculté de sous-entendre un régime suppléé par le contexte, de ne
pas exprimer l'idée de possessif ; c'est comme si, en français, on pouvait
dire : « Le père aime le fils, mais punit pour les fautes »).
Signe zéro
248. Commençons par un exemple concret : les couples former : form-ation,
laver : lav-age, régler : règle-ment sont unis par le rapport de verbe à nom
d'action, et la notion de nom d'action est exprimée par les suffixes -ation,
-âge, -ment. Mais le même rapport existe entre marcher et marche, calculer
et calcul, etc. Or, d'une part, il est inconcevable que marche et calcul soient
réduits au radical verbal ; d'autre part, l'application mentale des patrons
form-ation, etc. crée le sentiment (inconscient) que les mots marche, etc.
ont un suffixe zéro de nom d'action.160
Un signe zéro est donc un signe qui, sans signifiant positif, figure avec
une valeur déterminée à une place déterminée d'un syntagme échangeable avec
un ou plusieurs syntagmes de même espèce où ce suffixe a une forme explicite.
249. Notre exemple nous fournit d'autres précisions encore. Il nous
montre d'abord que le signe zéro peut être déterminé par des associations
soit d'analogie (associations homocatégorielles), soit de complémentarité
(associations hétérocatégorielles), soit enfin par des associations de l'un
et l'autre type. En effet, le suffixe zéro de marche a la même valeur que
-ation, -ment et -age ; autrement dit, marche peut être remplacé par formation,
etc. dans un même cadre syntagmatique. En revanche, la relation
entre marche et marcher, comme entre form-ation et former, est nouée entre
signes appartenant à deux classes différentes et complémentaires, c'est-à-dire
susceptibles de figurer dans le même syntagme, mais à des places
différentes ; marche et marcher évoquent les fonctions respectives de sujet
et de verbe. Notons avec soin que si le suffixe de marche est semblable à
celui de lav-age, etc., et si rien n'empêche logiquement de concevoir un
march-age ou un mot marche-ment, cet échange est, de par l'usage, impossible.
C'est cette impossibilité qui sépare, dans ce cas, le signe zéro de la
sous-entente (Paulus [est] aeger), qui permet l'échange entre signe implicite
et signe explicite.
250. Nous donnons maintenant, à titre de spécimens, quelques autres
exemples :
Il y a des désinences zéro. En latin, vir, sans désinence, a valeur de nominatif
singulier parce qu'il est associé, par voie d'analogie, avec les autres
nominatifs domin-us, princep-s, manu-s, re-s ; par association complémentaire
à vir-um, vir-o, vir-ī, etc. ; comparez 1) vir bonus et dominus bonus ;
2) hic vir illi viro similis.
La désinence zéro de fr. je marche se déduit de la comparaison avec
je march-ais, march-ai, march-erai, march-erais, etc., et ainsi de tu marches,
il marche, ils marchent. A cela s'ajoute l'opposition je marche : nous marchons,
vous march-ez. Quant à l'impératif marche : -ons, -ez, il est caractérisé
par l'absence de pronom-sujet, car c'est la seule différence qui le sépare
de l'indicatif présent : marche : tu marches, etc.
En français, une vaste classe d'adjectifs à finale consonantique ont une
forme identique au masculin et au féminin : rouge, jaune, faible, calme, etc.
Mais beaucoup d'autres adjectifs sont caractérisés au masculin par l'absence
de la consonne finale du féminin ; ainsi la comparaison de eau tiède :
161bain tiède et de eau froide : bain froi(d) nous autorise à poser que les
masculins froi(d), ver (t), cour(t), dou(x), etc., etc. ont une finale zéro.
On peut en dire autant d'un certain nombre de substantifs, qui présentent
des variations analogues à celles des adjectifs : marchande : marchand, lionne,
lion, louve : loup, etc.
Cette hypothèse semble confirmée par le fait que les dérivés de l'adjectif
sont formés sur la base du féminin pris comme radical : grand(e) — grand-eur,
gross(e) — gross-esse, bavard(e) — bavard-age, blanch(e) — blanch-ir, vieill(e)
- vieill-ir, etc. Les adverbes en -ment sont particulièrement instructifs :
nouvelle-ment, heureuse-ment, etc., car ici, il y a coïncidence fortuite entre
un sentiment qui est en train de se créer et l'origine du type ; on sait
que le radical de ces adverbes a été autrefois un adjectif féminin (clairement
= clarā mente). On peut rappeler encore que la liaison de l'adjectif
masculin amène souvent une forme identique au féminin : bo-n' ouvrage,
heureux z époux, premie-rʼ ordre, etc.
251. Le signe zéro en finale de mot s'accompagne assez souvent de diverses
modifications sur lesquelles nous ne pouvons insister longuement.
Ainsi le radical peut être raccourci : jet, nom d'action de jeter, a amui
le -t- du radical ; dans achat, non seulement le -t- de acheter a disparu,
mais le timbre de la dernière voyelle est modifié ; dans les adjectifs du
type bonne : bon, l'n du féminin survit dans la nasalité de la voyelle du
masculin, etc., etc. En latin, le nominatif oratŏr a une désinence zéro,
mais le radical a un -o- bref en regard de l'-o- long de tous les autres cas ;
la désinence zéro de pater présente un radical augmenté d'un -e- qui ne
figure dans aucun autre cas, etc.
252. Le russe a une copule zéro être à toutes les personnes du présent
indicatif. Deux séries d'équivalences homocatégorielles le prouvent. Au
présent même, la copule s'explicite dès qu'elle est lexicalisée : on dit dom nov
« la maison est neuve », mais dom stanovitsʼa, kajetsʼa novïm 176 « la maison
devient, semble neuve ». D'autre part, la copule être elle-même est obligatoire
à tous les autres temps et modes (bïl, búdet, bïl bï, budʼ). On ne
confondra donc pas ce cas avec celui de la copule sous-entendue du type
latin Paulus aeger. Mais l'un et l'autre posent la question de l'existence
de la « phrase nominale ». On peut admettre qu'elle ne peut exister que dans
les langues qui ne connaissent pas la copule être ; partout ailleurs, notamment
en indo-européen commun et dans les langues indo-européennes, la « phrase
162nominale » est une forme implicite de la phrase verbale (ce qui n'empêche
pas la phrase sans copule d'être stylistiquement différente de l'autre).
253. Le régime des verbes transitifs purs (tuer, manger, etc.) a une préposition
zéro équivalant à un ligament grammatical 177, et marquant la
transposition du sujet en complément d'objet. Cette thèse qu'il est impossible
d'exposer ici en détail, suppose qu'on a défini la transitivité et qu'on
s'est rendu compte de la grande diversité des formes de l'expression transitive,
des compléments d'objet et des ligaments qui les relient au transitif.
Est transitive toute expression verbale simple ou complexe qui ne peut
se concevoir sans un complément d'objet : verbes « dictaux » (manger, cuire,
etc.), aspectifs (commencer, cesser), modaux (croire, louer, souhaiter). Pour
la forme, on range dans les transitifs des verbes réfléchis tels que s'étonner,
s'imaginer ; des passifs : être convaincu ; des périphrases : prendre possession
de, avoir droit à, etc. Quant aux compléments d'objet, il n'y a que les verbes
dictaux qui les aient nécessairement sous forme de substantifs (manger
du pain, etc.). Les aspectifs peuvent prendre l'infinitif (commencer à travailler,
apprendre à lire). Les modaux ont normalement des phrases-termes :
je sais que Dieu existe ; je ne sais si Dieu existe.
254. Si maintenant nous parcourons à vol d'oiseau ce vaste système,
nous voyons que le rattachement du complément au verbe se fait normalement
au moyen d'un ligament explicite (préposition pour les substantifs
et les infinitifs, conjonction pour les phrases-termes), en sorte que dans
les cas où le ligament est absent, il est du type zéro, parce que des associations
spontanées le relient à des formes explicites. Impossible d'énumérer
tous les cas qui se présentent ; tantôt il s'agit de verbes synonymes :
prendre une ville et s'emparer d'une ville ; tantôt de variétés telles que
heurter (contre) un meuble, pénétrer (dans) la pensée de quelqu'un tantôt
d'alternance entre infinitif et substantif : apprendre la lecture : apprendre à
lire ; alternance entre substantif et phrase-terme : j'affirme mon innocence :
j'affirme que je suis innocent 278. En outre, on se rappellera que des verbes
163transitifs peuvent être transposés en noms d'action, et que dans ce cas
leur complément d'objet prend la forme d'un terme prépositionnel : conquérir
une province : la conquête d'une province ; désirer plaire : le désir de plaire.
De plus, ces noms abstraits forment des périphrases verbales équivalant
aux verbes simples correspondants : faire la conquête d'une province, avoir
le désir de plaire : deux nouvelles correspondances entre complément d'objet
avec et sans préposition.
Si le complément d'objet substantif est relié au verbe par une préposition,
c'est que tout substantif est prédestiné à être sujet et que dans toute
autre fonction il est transposé (190) et ne peut l'être que par une préposition,
p. ex. en complément indirect : (donner un livre) à un ami ; en complément
circonstanciel : (mourir) pour la patrie ; en agent du passif : (être tué) par
un ennemi ; en complément du nom : (le chien) de la maison. Fait exception
l'emploi du substantif comme attribut, auquel cas il est transposé en
adjectif par la copule : (Cicéron est) un orateur ; cf. (cette robe est) rouge.
Si cette thèse est soutenable, on voit que ce n'est pas seulement par
la position du complément direct après le verbe que cette fonction est
déterminée (comme on le croit généralement), car cette position est celle
de tous les autres compléments prépositionnels.
255. Il est facile de voir que la notion de signe zéro, comme toutes les
autres définies dans ce chapitre, n'a de réalité que dans un état de langue ;
historiquement, le signe zéro remonte toujours soit à un signe explicite
amui par la suite (cf. vir de *viros), soit à une forme réellement dépourvue
de signe ; c'est le cas de l'impératif pré-indo-européen : *bhere ! « porte ! »
était à l'origine un pur radical sans désinence, par opposition au grec
phére !, qui, lui, est enchâssé dans le paradigme phére, pherétō, etc., d'où
le sentiment d'une désinence muette. On doit donc soigneusement distinguer
entre zéro signe (*bhere) et signe zéro (phére).
256. Constatons en terminant qu'il y a des phonèmes zéro. Ainsi en
français, l'h aspiré, inexistant pour l'oreille, a tous les caractères d'une
consonne initiale, mais est, naturellement, différent de toutes les consonnes
positives. Ainsi dans une haute montagne, l'h empêche la liaison de n,
comme p dans une petite fille ; dans la haute société, il empêche, par hiatus,
l'élision de la, comme b dans la bonne chanson, etc. D'autre part, tout
hiatus contient une consonne zéro, car tout se passe comme si une consonne
réelle séparait deux voyelles ; cf. haï et habit, j'ai ouvert et j'ai couvert,
etc.164
Hypostase
257. Nous avons dit (200) que l'hypostase 179, sous sa forme absolue, est
un mode de transposition implicite où la catégorie d'emprunt, en l'absence
de tout transpositeur, n'est marquée que par l'entourage syntagmatique. Des
conjonctions comme si et mais peuvent devenir des substantifs sans changer
de forme, en adoptant simplement des actualisateurs nominaux : un si,
des mais. Si l'on compare la beauté et la vérité avec le beau et le vrai, on
voit que dans le second cas les adjectifs beau et vrai n'ont subi aucun
changement apparent.
L'hypostase posant surtout des questions de forme, les développements
qui suivent ne font pas une distinction absolue entre la transposition
purement fonctionnelle et celle qui atteint partiellement le sens du transponend
(180).
258. Précisons tout d'abord que l'hypostase ne se confond pas avec le
signe zéro : tandis que celui-ci est rétabli mentalement à une place précise
de la chaîne parlée, la notion catégorielle impliquée dans le signe hypostasié
est, pour ainsi dire, fondue avec lui. L'hypostase diffère aussi du cumul,
parce que celui-ci ne sépare par aucun procédé matériel les éléments du
signifiant (cf. pire et plus mauvais) ; au contraire, l'hypostase est la combinaison
d'un signe explicite complet et autonome avec un autre qui,
sans être exprimé, est nécessaire au sens. L'hypostase est — répétons-le — un
syntagme dont la partie explicite est le déterminant, l'idée catégorielle
le déterminé : le beau = « la notion (t) de beau (tʼ) ».
259. Statiquement, l'hypostase apparaît comme une forme abrégée de
la transposition explicite ; mais au point de vue génétique, le rapport est
inverse : il est évident que l'hypostase a précédé la transposition caractérisée
et que, peu à peu seulement, par l'utilisation de faits fortuits, le
langage s'est créé des signes de transposition. On peut suivre les étapes
de cette création en observant les types hypostatiques demeurés vivants
dans telle ou telle langue. On se bornera ici à quelques brèves indications
sur ces procédés embryonnaires, qui mènent insensiblement de l'hypostase
pure à la transposition explicite. Ces procédés peuvent consister, par
exemple, en des restrictions d'emploi : en grec ancien, un adverbe, par
exemple nûn « maintenant », peut devenir, sans aucun changement, adjectif
et substantif : hoi nûn ánthrōpoi et hoi nûn « les contemporains », mais
165à la condition d'être précédé de l'article ; nûn tout seul, ou avec tines ne
pourrait pas signifier « des contemporains ». Ou bien il s'agit de caractères
négatifs : ainsi on voit que, en réalité, beau n'a plus sa vraie forme adjective
dans le beau, puisqu'il a perdu la faculté de se fléchir (beau, bel, belle) ;
quand enfant devient adjectif (un caractère enfant), il ne marque plus la
distinction du singulier et du pluriel ; l'orthographe reflète cette privation
(des manières enfant). Ailleurs on opère par soustraction : c'est le cas du
latin triumvir, issu de (unus) trium virum « (un) des trois hommes » : comme
un triumvir est en même temps un vir, le composé a adopté la flexion de
ce substantif ; si bien que désormais le tour (unus) triumvirum n'a plus
la même valeur qu'à l'origine, lors de la création du type.
260. L'hypostase syntaxique présente, elle aussi, des formes pures et
d'autres qui conduisent insensiblement à la transposition caractérisée :
dans la phrase « Il se demanda : Entrerai-je ? », l'interrogation est devenue
complément d'objet du verbe ; mais cette transposition n'a entraîné aucun
changement, pas même dans l'intonation. Le style indirect libre 180 conserve
aussi le tour interrogatif, mais change la personne et le temps : « Il eut une
hésitation : entrerait-il ? ». Enfin le style indirect ordinaire supprime l'inversion
et l'intonation interrogative, et utilise un transpositeur externe : « Il se
demanda s'il entrerait ». La transposition est nettement explicite.
261. Les éléments musicaux du système linguistique peuvent servir de
transpositeur à l'hypostase et l'empêcher d'être pure. Des conjonctions
et prépositions, atones dans leur fonction naturelle, prennent un accent
en fonction de substantifs : (v. plus haut : des si, des mais), le pour et le
contre. Les transpositions subies par des phrases entières peuvent être marquées,
sans autre changement de forme, par la modification ou la perte
des intonations modales qui les caractérisent. Voici deux phrases coordonnées :
« Où est-il ? Personne ne le sait » ; la mélodie de la première est descendante,
ce qui est de règle dans les interrogations partielles ; il suffit, comme
nous l'avons vu (83), qu'elle soit ascendante pour que la phrase devienne
le thème d'une segmentée AZ. La phrase anglaise You are wrong perd
toute intonation propre dans I think you are wrong, où elle devient complément
d'objet.
262. L'hypostase lexicale correspond souvent aux figures ou tropes de
la rhétorique (211). Soit p. ex. la synecdoque, qui prend la partie pour le
tout : dans une flotte de cent voiles, voile signifie bateau à voiles, syntagme
166explicite où voile est déjà transposé en complément rectionnel ; mais dans
cent voiles, il est transposé au second degré et hypostatiquement, puisque
la notion de bateau est absorbée par le déterminant. Il en est de même
pour la métonymie, fondée sur l'interversion de rapports naturels ou logiques :
dans la ville est en rumeur, ville = « habitants de la ville » (le
contenant pour le contenu). De même enfin pour la métaphore (assimilation
de deux notions au nom d'un caractère commun) : (Paul est) un âne,
c'est-à-dire « bête ou entêté comme un âne », ou simplement « tel qu'un
âne ». On voit que, dans tous ces cas, un terme intermédiaire, qui sert de
transpositeur, est totalement sous-entendu.
263. On peut, selon moi, expliquer par une figure, autrement dit par
l'hypostase, tout un ensemble de formations verbales très familières aux
langues germaniques et slaves, mais dont les langues romanes usent très
discrètement. Soit l'expression allemande eine Wunde schlagen, littéralement
« faire une blessure en frappant » : on voit qu'un verbe, non exprimé,
révèle sa signification — très générale : ici « faire » — grâce à la présence
d'un autre verbe qui détermine la manière dont l'action s'effectue ou le
moyen employé pour la produire. Ce n'est pas autre chose qu'une métonymie,
semblable à celle qu'on trouve en français dans trembler pour la vie
d'un ami (= « craindre en tremblant »), pleurer sa perte (=« la regretter
en pleurant »), etc. Mais si le français connaît cette forme, la plus simple,
il ignore les types plus complexes que nous offre l'allemand (et bien
d'autres langues : l'anglais, le russe, etc.). Ainsi le verbe déterminant (seul
exprimé) peut être intransitif : in die Stadt eilen (= « eilend gehen ») ; transitif :
schlagen (v. plus haut) ; il peut être composé avec un préverbe, et,
dans ce cas, sa transposition hypostatique entraîne une condensation et
un déplacement d'accent : einen Fussgänger überfahren (= « verwunden,
töten, etc. indem man über ihn fährt »). Quant au verbe déterminé, il est
souvent accompagné d'un complément qui est conservé par l'hypostase :
sich die Füsse wund laufen (= « laufend wund machen, verwunden »), ou
bien il renferme un préverbe qui, pour la même raison, reparaît dans la
forme condensée : hinabtosen (= « tosend hinabfallen »), sich emporarbeiten,
etc. (on ne confondra pas ce cas avec celui de überfahren). Ce préverbe
peut être inséparable : sein Geld verspielen (= « beim Spiel verlieren »),
etwas erarbeiten, erjagen (= « durch Arbeit, auf der Jagd erreichen, erlangen »).
On voit l'affinité de ce mécanisme avec celui des aspects (583).
D'autre part, si nous revenons à l'exemple eine Wunde schlagen, il est
167facile de voir qu'ici eine Wunde est un complément d'objet « effectué », et
l'on peut supposer que ce type, dans sa généralité, est issu de l'hypostase ;
cuire du pain, c'est faire du pain en cuisant (171, 3).
264. Il est clair que les figures, comme toutes les hypostases, ont un
caractère nettement synthétique ; le langage figuré est expressif précisément
parce qu'il a ce caractère ; chaque figure pose un problème à résoudre,
elle fait deviner plus qu'elle ne dit 181.
Mais d'autre part, l'hypostase offre l'avantage de permettre des échanges
intercatégoriels avec un minimum d'effort combinatoire. Parmi nos langues,
c'est l'anglais qui va le plus loin dans cette voie : une foule de verbes
anglais peuvent être, à volonté, transitifs ou intransitifs (to stop = « arrêter »
et « s'arrêter ») et, en se dépouillant de leur flexion verbale, d'ailleurs rudimentaire,
devenir substantifs ou adjectifs (a stop, a stop watch). Sans aller
jusque là, le français pratique largement la dérivation implicite dont il
sera question aux §§ 500-514.
Une remarque finale : puisque l'hypostase repose sur des associations
internes, celles-ci peuvent être effacées peu à peu par l'usage, comme les
associations entre signes explicites. Ce qui frappe alors avant tout, c'est
le divorce entre deux sens d'un même mot (une rose, une robe rose). Le
processus qui crée cette séparation est de même nature que l'agglutination
(217).
Disjonction
265. Deux signes sont disjoints quand, unis par le sens, ils sont séparés
dans la chaîne du discours. Ce peuvent être deux fragments d'un signe
unique, comme ne…pas (219) dans Ne parle pas !, ne…que (= seulement)
dans Ne dis que la vérité !, all. um…willen (= « pour » dans um eines Mädchens
willen, etc. ; deux sous-unités : dans les verbes inchoatifs et causatifs
du type agrandir (cf. grossir), amaigrir (cf. maigrir), embellir, élargir, rétrécir,
etc., la notion aspective est marquée à la fois par le préfixe et le
suffixe. Ou bien ce sont deux termes d'un syntagme lexical comme austrinken
dans trink dein Bier aus ! Il y a disjonction des termes d'un syntagme
grammatical dans J'ai beaucoup souffert (: j'ai souffert), dans « J'admire
ce tableau et j'en connais la valeur » (= sa valeur). La négation, étant
un signe modal, doit accompagner le verbe qui contient le mode (fr. Je ne
comprends pas) ; elle est souvent disjointe en allemand : Ich verstehe diese
168Erklärung nicht. La disjonction peut être complexe et aller jusqu'à l'enchevêtrement :
dans on n'a pas écouté, il y a disjonction de on a écouté et
de ne…pas.
266. Disjonction implique infixation. Est infixé tout ce qui sépare : on
peut dire p. ex. que me est infixé dans « tu m'abandonnes ». Cependant
on réserve le terme d'infixé à des signes isolés, courts et à valeur déterminée.
Certains « suffixes » sont en réalité des infixes : -aill- dans criailler, etc.
(: crier), -ot- dans clignoter (: cligner). La syllabe -ge- est un infixe dans
all. ausgetrunken, comme -zu- dans auszutrinken, et -n-, signe du présent,
dans le latin fundo (cf. parfait fudi). On pourrait prétendre que dans le
grec leip-ō « je laisse » et lé-loip-a « j'ai laissé », e et o de la racine sont (en
statique !) des infixes caractérisant l'un le présent, l'autre le parfait, le
reste de la racine (lip) ayant une valeur lexicale. En sémitique, les voyelles
des racines sont aussi, mais beaucoup plus systématiquement, des infixes
à valeur grammaticale.
L'infixation, dans un sens large, apparaît souvent là où la grammaire
traditionnelle ne voit que des signes successifs. C'est le cas des locutions
verbales, où les signes désinentiels séparent des éléments lexicaux qui devraient
faire bloc ; dans prendre peur = « s'effrayer », il est clair que c'est
seulement le radical verbal qui forme avec l'ancien régime direct un seul
tout que la flexion coupe en deux ; cf. mettre en place et placer, pêcher à la
ligne et all. angeln, etc. Dans pêcheur à la ligne, c'est le suffixe -eur qui
est un infixe.
267. Toute disjonction est, par définition, dystactique, et, par suite,
synthétique : l'esprit doit faire effort pour réunir ce qui est dispersé ; cet
effort se fait aux dépens de l'analyse de la partie intercalée, qui reste mal
différenciée du signe disjoint.
Cet effort est naturellement d'autant plus grand que les éléments disjoints
sont séparés par un plus grand intervalle. Il n'y a pas de comparaison
entre « J'ai beaucoup souffert » et des cas tels que all. « Gliederung einer
Gesamtvorstellung in ihre in logische Beziehung zueinander gesetzten Bestandteile »
ou« Aufdeckung von auf ganze Kontinente übergreifenden Sprachzusammenhängen ».
C'est là une des plus grandes différences qui séparent
la prose courante du français et celle de l'allemand. Le français procède
par déterminations successives, l'allemand ne craint pas de faire voisiner
des parties de l'énoncé qui se repoussent au lieu de s'attirer (comme dans
les exemples ci-dessus : in ihre in et von auf).169
268. Mais la disjonction jouait un rôle bien plus considérable encore
dans les langues classiques et, probablement, en indo-européen primitif ;
elle contribue puissamment à accentuer le caractère synthétique de ces
langues. En effet, en allemand, la disjonction est plus ou moins soumise
à des règles qui permettent de prévoir à quelle place apparaîtra le terme
qu'on attend ; en grec et en latin, la construction est libre, et si certaines
séquences sont fixées par l'usage, la plupart relèvent de la stylistique
et n'ont pas de caractère impératif ; elles sont donc imprévisibles.
Un des effets les plus évidents de la disjonction, c'est de consacrer et
de renforcer l'autonomie des signes ainsi séparés les uns des autres. L'attention
se porte sur chacun d'eux successivement ; leur individualité est plus
accusée, en sorte que, même lorsqu'ils sont groupés les uns à côté des
autres, ils demeurent distincts et ne risquent pas de s'agglutiner comme
c'est le cas en français, où la disjonction est peu en faveur. En conséquence,
et si paradoxal que cela puisse paraître, la disjonction peut devenir, dans
certaines circonstances, un principe de structure analytique. Cette vue
sera reprise du point de vue de l'allemand aux §§ 464 ss.
Anticipation
269. Il y a anticipation quand un signe nécessaire à la compréhension d'un
autre précède celui-ci au lieu de le suivre, p. ex. quand le prédicat vient
avant le sujet (Grand fut mon étonnement) ou le déterminant avant le
déterminé (lat. domini imperium, fr. archaïque sur un arbre perché). Nous
verrons (353) que l'emploi du pronom relatif (fr., all., etc.) offre un cas
typique d'anticipation (cf. « J'ai fait un travail » et « le travail que j'ai fait »).
La structure des mots en indo-européen est fondée presque entièrement
sur l'anticipation ; c'est le cas des composés (grec patroktónos « qui tue son
père », lat. signifer « porte-enseigne »), des préfixaux (latin praecurrere « courir
en avant »), des suffixaux (latin argent-eus « d'argent »), etc. La flexion
aussi repose tout entière sur ce même principe ; le radical est le déterminant,
la désinence le déterminé ; comparez reg-is et du roi, ambul-o et je marche,
etc.
270. Inutile de faire observer que la structure des syntagmes est encore
plus dystactique quand l'anticipation est doublée de la disjonction ; c'est
ce qui arrive constamment dans des langues à construction libre comme
le latin ; cf. Viri crescit in dies fortitudo et « La vaillance du héros grandit
170de jour en jour ». Or, cette liberté de construction (principe de synthèse)
est favorisée par la forme flexionnelle des mots (autre caractère synthétique).
271. Un cas particulier de disjonction amenée par l'anticipation se produit
lorsque celle-ci intervient en cours de route. Ainsi p. ex. l'ordre logique
des termes est respecté dans cet énoncé : « Paul a réussi ; (c'est une)
chose étonnante » ; il est complètement renversé par l'anticipation dans :
« Chose étonnante ! Paul a-réussi ». Mais-celle-ci peut n'être que partielle :
« Paul- chose étonnante-a réussi » ; c'est le procédé qu'on appelle incision ;
l'incise (70) est infixée dans l'énoncé sur lequel elle anticipe. C'est aussi
l'origine des constructions « enveloppantes » de l'allemand, dont il sera
question au § 321.
Il y a aussi anticipation toutes les fois qu'un représentant ou une ellipse
se rattachent à un signe énoncé postérieurement : « Paul, je n'en doute
pas, est innocent ».
272. Le pendant phonologique de l'anticipation est le rythme baryton,
qui accorde la première place aux éléments forts de la phonation : cette
force peut résider dans l'intensité, la durée ou la hauteur des sons, ou simplement
dans le volume des mots. Le rythme opposé, qui place à la fin
des groupes l'élément intense, est dit oxyton (315 s.). Les variétés intermédiaires
existent aussi, et rappellent l'incise, dont il a été question plus haut.
L'anticipation et le rythme baryton vont généralement de pair, de même
que le rythme oxyton et la séquence progressive. En effet, c'est le plus
souvent la partie importante, le propos, qui est rythmiquement intense
(cf. « Grand fut mon étonnement » et « Mon étonnement fut grand »). Mais
le rythme peut être indépendant de la valeur expressive du discours et
avoir sa valeur propre (315 ss.).
L'évolution des langues indo-européennes est dominée par la tendance
à rapprocher les signes unis par le sens, et à substituer la séquence progressive
oxytone à l'anticipation barytone. Nous consacrerons plus loin
(313-461) quelques développements à ce sujet, parce que le français et
l'allemand présentent, sous ce rapport, de grandes différences.
II. Polysémie
273. Nous avons posé (215) que la polysémie est la contre-partie mémorielle
de la non-linéarité. C'est ce parallélisme que nous allons essayer de démontrer.171
La polysémie présente deux aspects : tantôt un même signifiant a plusieurs
significations (plurivalence), tantôt un même signifié est rendu par
plusieurs signifiants (plurivocité).
Nous grouperons les faits autour de deux types extrêmes, entre lesquels
se rangeront les cas intermédiaires, les formes mitigées ; ces types extrêmes
sont, pour la plurivalence, l'homonymie, et pour la plurivocité, la supplétion.
Homonymie
274. Deux signes sont dits homonymes lorsqu'ils ont des signifiants identiques
et des signifiés hétérogènes : « louer un élève » et « louer un appartement » ;
« cor aux pieds » et « cor de chasse » ; « l'air qu'on respire » et « l'air
qu'on a », « l'air qu'on chante », etc.
Les homonymes absolus doivent avoir non seulement des significations
hétérogènes, mais aussi a) des signifiants identiques (homophones) et
b) des fonctions identiques. Cette double condition est rarement remplie ;
elle l'est p. ex. dans louer (laudare) et louer (locare), qui sont absolument
homophones et sont tous deux des verbes transitifs.
275. a) L'homonymie est partielle lorsque les signifiants présentent
quelque différence de forme, p. ex. une aire et une haire ; je l'ente et je le
hante ; pomme et paume. L'intonation peut ne pas être la même : bah !,
prononcé sur une note haute, exprime l'insouciance, et avec une mélodie
descendante, la surprise ; Parlez-moi de Balzac ! est chanté autrement
selon qu'on ajoute « J'aimerais connaître cet auteur » ou « Voilà un vrai
romancier ».
Un cas-limite est celui où la différence de forme est simplement orthographique :
conter : compter ; pois : poids.
b) En second lieu, l'homonymie est partielle lorsque les deux signes
de signification hétérogène appartiennent à des catégories différentes ;
ainsi un mot peut désigner un objet, son homonyme une matière ; comparez
« se regarder dans une glace » et « casser de la glace » ; l'ordonnance d'un officier
est une personne, l'ordonnance du médecin une chose ; in- privatif est un
préfixe d'adjectif (informe, inculte), in- signifiant « dans » un préfixe verbal
(inclure, insuffler), etc.
276. On n'étudie guère que l'homonymie des mots, mais la grammaire
connaît aussi des homonymes ; p. ex. des préfixes : in-corporel et in-corporer,
em-porter et em-poter ; des suffixes : aveugle-ment et aveuglé-ment ; des désinences :
172Vous viv-iez heureux : Je souhaite que vous viv-iez heureux. Mais
nos langues ne peuvent nous donner une idée du désordre qu'entraîne,
dans les langues flexionnelles, l'homonymie désinentielle : qu'on songe seulement
qu'en latin vir-o est datif et ablatif ; ros-ae génitif, datif et nominatif ;
civi-bus datif et ablatif ; amā-tor 2e et 3e personne ; amā-re infinitif, indicatif
et impératif, amā-verit indicatif et subjonctif, etc., etc.
Il y a des homonymes syntaxiques : Faites-le voir peut signifier « Faites
qu'il voie » ou « Faites qu'il soit vu » ; Pierre traite Paul en ennemi = ou
bien « comme le ferait un ennemi », ou bien « comme s'il avait affaire à
un ennemi ».
Dans conserver son teint frais, l'adjectif peut être épithète (= conserver
la fraîcheur de son teint), ou prédicatif (= conserver son teint de façon
qu'il reste frais). « J'ai trouvé ce fruit délicieux » présente la même ambiguïté,
accentuée par l'homonymie lexicale de trouver. Si j'achète un bijou à un
bijoutier, ce n'est pas la même chose que si je l'achète à ma femme. Tobler
a montré que la phrase « Toutes ces marchandises ne valent pas 50 francs »
peut avoir trois significations : elles n'ont pas toutes cette valeur, aucune
ne l'a, toutes ensemble ne l'ont pas 182.
277. Un cas très important d'homonymie lexicale est celui où l'un des
homonymes est un mot et l'autre le radical d'un mot : ferme : fermer ;
Maroc : maroquin ; bave : bavard ; fleur : effleurer ; ménage : ménagerie. Ces
discordances sont particulièrement abondantes en français, où les rapports
étymologiques sont très relâchés (554) ; cf. Bally, Traité II, Ex. 19.
Il y a encore homonymie quand une locution toute faite (217) a la même
forme qu'un syntagme libre ; comparez « Il fait trop chaud, je n'y tiens
plus » (locution), et « Je me défais d'un bijou de famille parce que je n'y
tiens plus » (syntagme). On peut ranger dans cette classe les locutions
plus ou moins stéréotypées et leurs correspondants au sens propre, p. ex.
mettre de l'eau dans son vin (à table) et mettre de l'eau dans son vin (= « se
modérer »).
De même pour l'homonymie syntaxique : dans « Pierre et Paul se battent
avec acharnement », se peut former un verbe réfléchi (ils se battent eux-mêmes),
ou bien marquer la réciprocité (ils se battent entre eux), et alors
173il y a homonymie totale ; mais se battre peut être aussi agglutiné et signifier
combattre.
278. L'homonymie, même partielle, mérite pleinement son nom tant
que les significations sont senties comme hétérogènes et ne sont rattachées
l'une à l'autre par aucun lien associatif ; tous les exemples cités jusqu'ici
remplissent cette condition. Au contraire, dès que les sens d'un mot, si
différents soient-ils, s'appellent l'un l'autre d'une manière quelconque, on
ne peut plus parler d'homonymie. Les formes et les degrés de ce rapprochement
sont infiniment divers ; nous ne les étudions pas ici ; en revanche,
nous signalerons deux cas typiques de relations dont le caractère sémantique
est bien marqué.
a) On parle d'antonymie lorsqu'un même mot a deux sens opposés se
détachant sur le fond d'une idée commune ; p. ex. un propriétaire loue
un appartement à un locataire, qui le loue au propriétaire ; l'hôte est tantôt
celui qui reçoit chez lui, tantôt celui qui est reçu. Or, il est évident que
ces contraires sont associés au nom d'une même notion (location, réception).
Le langage expressif rend souvent une idée par son contraire : c'est l'ironie
ou antiphrase : « Fiez-vous aux femmes ! » prononcé avec une intention
appropriée est une invitation à la défiance. C'est par l'antiphrase que beaucoup
de mots laudatifs deviennent péjoratifs ; cf. « La fameuse journée
où, sur le mont Sina, la loi nous fut donnée » (Racine) et « Où en est votre
fameuse tragédie en cinq actes ? »
b) Les figures ou tropes relèvent de l'hypostase (262). Il y a sans doute
deux sens totalement différents d'un même mot dans « La dinde est la femelle
du dindon » et « Marie est une dinde », c'est-à-dire « est bête » ; mais
tant que cette métaphore sera vivante, elle empêchera le mot en question
d'être homonyme de lui-même (comme c'est le cas pour tant de figures
mortes, p. ex. plume d'oiseau et plume d'acier, etc.).
279. Le cas des figures nous conduit naturellement aux transpositions
(190), et celles-ci nous enseignent que la grammaire connaît aussi l'antonymie,
que le sujet peut devenir prédicat (Paul est l'ami de Pierre, Pierre
est l'ami de Paul) ou complément d'objet (Mon ami est venu me voir, J'ai
vu venir mon ami).
De ces cas relativement définis, on glisse insensiblement dans le domaine
immense des nuances de sens qu'on désigne, faute de mieux, par le terme
de synonymie, pour faire entendre que de vagues analogies priment les
différences : cf. « se recueillir dans la prière » et « adresser une prière à quelqu'un » ;
174« le génie de Goethe » et « le génie de la langue française ». Et ainsi,
d'étapes en étapes, on saisit par intuition la nature vraie du système linguistique,
lequel consiste en un réseau immense d'associations analogiques
et différentielles.
280. L'homonymie absolue a-t-elle son pendant en dystaxie ? Oui, car
si deux homonymes représentent deux signifiés logés dans le même signifiant,
cela fait penser vivement au cumul (ex. des = « de les »), qui répond
à la même définition dans l'ordre discursif. L'homonymie improprement
dite (significations différentes, mais associées) suggère un rapprochement
analogue : quand un même mot a plusieurs sens reliés étroitement entre
eux, (cf. « Le jour de gloire est arrivé » et « Le jour n'est pas plus pur que
le fond de mon cœur »), on peut se représenter ces sens serrés les uns contre
les autres, et pourtant distincts dans la mémoire ; cela rappelle, dans l'ordre
discursif, cette forme atténuée du cumul que nous avons appelée engrènement,
resserrement ou condensation (type : d'un, v. 230). Comme la condensation
est une forme fondamentale du groupe syntaxique en français,
(exemple : je ne veux pas, donnez-le-moi, il ne m'a pas vu, etc.), ce n'est
peut-être pas un hasard si, parallèlement, les mots français sont chargés de
significations multiples (559).
Ce parallélisme entre homonymie et cumul se révèle aussi par la nature
des associations identificatrices. Le verbe louer peut se présenter à l'esprit
avec ses deux sens hétérogènes ; ce sont les associations discursives, en
contexte, qui déterminent le choix : louer une maison, louer un élève. De
même, le cumul est expliqué par des associations mémorielles : celui de
au (jardin) est résolu par le contact mémoriel avec à la (maison).
281. Enfin deux homonymes contenus dans un même mot peuvent
apparaître simultanément à l'énoncé de ce mot dans le discours ; alors le
cumul latent devient réel. Cela se vérifie dans les jeux de mots et autres
faits connexes. Quand on entend la phrase « La Méditerranée n'a pas de
marées, c'est une mer dénaturée », le mot mer évoque à la fois l'idée d'une
étendue d'eau salée et celle d'une femme qui a des enfants, et c'est cela
qui fait rire. On dit de certaine poésie que c'est de la prose où les vers se
sont mis, et un enfant s'étonnera que la mer ne soit pas noire, depuis le
temps qu'on y jette l'ancre ( l'encre). L'effet de contraste subsiste quand
l'homonymie est atténuée sous forme de figure, p. ex. « Cette domestique
a quitté le service d'un aveugle qui était trop regardant » : le dernier mot
signifie « avare », mais est aussi le participe présent du verbe regarder.175
Sous cette forme extrême, le jeu de mots n'est qu'un accident, mais il
peut prendre bien d'autres formes plus délicates ; lorsque Racine fait dire
à Pyrrhus « Brûlé de plus de feux que je n'en allumai », feux a deux sens
qui surgissent spontanément à l'énoncé de la phrase.
282. A côté des jeux de mots, on peut citer le cas pathologique des
paronymes. Il s'agit de quasi-homonymes tels que allocation : allocution,
collision : collusion, collationner : collectionner, infecter : infester, désaffecter :
désinfecter, etc. Or, comme chacun des couples en question renferme au
moins un mot savant ou peu usuel, les gens de demi-culture les emploient
l'un pour l'autre à tort et à travers : désinfecter une église (pour désaffecter),
collectionner des manuscrits (pour collationner), etc. C'est là, on le voit,
une forme de l'étymologïe populaire qui est en même temps un cas d'homonymie
« réalisée ».
283. On comprend sans peine pourquoi l'homonymie est un principe de
synthèse : elle exige dans l'usage un effort mémoriel et combinatoire supplémentaire,
dont la conséquence est une cohésion plus grande des combinaisons
réalisées. En effet, pour éviter les ambiguïtés résultant de la
similitude de forme, il faut que le contexte où figure le mot soit suffisamment
caractéristique, faute de quoi le sens homonyme peut surgir hors de
propos ; ainsi, toutes choses égales d'ailleurs, la composition du contexte
exige plus de soin que si les mots étaient de forme différente, et, toutes
choses égales d'ailleurs, il y a plus de cohésion dans les contextes ainsi
obtenus. Le fait que, dans la pratique, cet effort est souvent réduit à peu
de chose ou est inconscient ne restreint pas la portée générale de cette
vue. Ajoutons tout de suite que le besoin d'un contexte clair est beaucoup
plus urgent pour l'homonymie relative, ou impropre ; il est assez
facile de faire entendre qu'on veut employer air dans le sens d'atmosphère
ou dans celui de chanson ; il est plus difficile de rendre claire la distinction
entre le sens d'atmosphère et celui de vent (« Il y a de l'air, il fait de l'air »).
284. L'homonymie peut résulter de la convergence phonique de deux
signes différents (louer = laudare et louer = locare), ou de la divergence
sémantique des sens d'un même signe (l'air qu'on respire et l'air qu'on a),
ou enfin de l'introduction d'un sens d'emprunt dans un mot indigène
(« édifier un temple » et « édifier quelqu'un par sa conduite » ; ce second sens,
totalement différent du premier, est celui que les pères de l'Eglise étaient
arrivés à donner au grec oikodomeîn, et que les auteurs chrétiens avaient
introduit dans le latin aedificare). Ces explications valent aussi pour
176l'homonymie syntaxique : on sait que le si interrogatif, bien distinct du si
conditionnel, est à l'origine identique à celui-ci ; on s'en rend compte par
des phrases telles que Ecrivez-moi si vous comptez venir me voir, où la double
interprétation est possible.
Mais ces distinctions sont nulles au point de vue synchronique. L'antinomie
de l'étude statique et de l'étude historique se montre encore dans
le fait inverse, que des homonymes le sont devenus au cours du temps,
et que l'homonymie n'existe pas pour la diachronie. Les deux verbes louer
étaient encore de forme différente en vieux français ; on prouve que le second
sens du mot air dérive du premier (voir l'article air dans le Dictionnaire
Général) ; de même, la sémantique rattache sans peine le sens théologique
de édifier à son sens usuel.
285. Y a-t-il une homonymie phonologique ? Trouve-t-on, dans un même
état de langue, des phonèmes identiques, revêtus de valeurs hétérogènes ?
Je crois voir un cas de ce genre dans l'opposition entre phonèmes arbitraires
et phonèmes motivés (fonctionnels, conditionnés). Un phonème est
(relativement) arbitraire quand sa réalisation dans le discours est liée à
un minimum de conditions, ce qui donne aux sujets parlants l'impression
qu'il est tout à fait libre ; il est motivé si sa réalisation dépend d'un son
ou d'une classe de sons déterminés (212). Ainsi en latin, m est arbitraire
dans son emploi le plus ordinaire : « mater, amat, admiratur, filium, etc. ».
Il est motivé dans « im-portare », parce que là, il n'est qu'une variante,
une transposition de n, nécessitée par la présence d'une labiale suivante.
On peut donc dire que le premier m est quasi-homonyme du second.
L'homonymie est plus accusée quand l'un des phonèmes est emprunté
et l'autre inhérent au système. Ainsi en français, un z- initial de mot,
amené seulement par quelques mots d'emprunt (zèle, zone, etc.), est homonyme
de tous les autres ; p. ex. le z- de zone est homonyme de celui de
maison, pause, exiger, etc. En russe, un f- ouvrant de syllabe devant
voyelle n'apparaît que dans des mots empruntés (dont plusieurs, il est vrai,
ont passé dans l'usage courant) : família, figúra, fonárʼ, Filípp, Fédor, etc. ; il
est homonyme de l'f proprement russe, toujours écrit v, qui est le substitut, le
transposé (189 ss.) de v devant consonne sourde ou en fin de mot : comparez vsë
« tout », prononcé fsʼo, et vesʼ ; de même nov« nouveau », prononcénof, et nóvï.
286. Il y a une homonymie phonologique syntagmatique ; ainsi un
groupe de sons permet de placer à deux ou plusieurs endroits différents
177la frontière entre deux signifiants (il s'agit alors de la différence entre
phonologie interne et sandhi) : ainsi l + a peut valoir en français la ou l'a
(cf. la perception et l'aperception) ; dans œ̃ + n, la nasale peut être la fin
d'un mot ou l'initiale du mot suivant (cf. un avis et un navire). Cette possibilité
de couper les mots de plusieurs façons est extrêmement fréquente
en français ; nous montrerons (531) quelle en est la raison.
On voit que l'homonymie phonique syntagmatique est le principe du
calembour (« c'est la confédération » et « c'est là qu'on fait des rations »,
« l'admiration » et « la demi-ration »). On peut donc dire que le calembour
est le pendant phonologique du jeu de mots (281) : celui-ci est la réalisation
discursive de l'homonymie sémantique, le calembour la réalisation discursive
de l'homonymie phonologique.
Supplétion
287. Les signes supplétifs ont exactement la même signification, et des
signifiants hétérogènes dont le rôle est déterminé par un choix arbitraire.
Ainsi plusieurs radicaux de sens identique sont répartis entre les différentes
formes d'un même verbe : fr. allons, j'irai, va ; je suis, je serai,
j'étais ; lat. fero, tuli, latum ; d'un adjectif : lat. bonus, melior, optimus ; etc.
Ce cas, très fréquent en indo-européen, est le seul auquel on ait donné
le nom de supplétion. Mais il peut être appliqué à tous les signes répondant
à la définition donnée plus haut. Ainsi le rapport entre nom d'action
et verbe est normalement marqué par un suffixe (laver : lavage), qui
peut être zéro (marcher : marche), mais dans quelques cas, il est représenté
par des radicaux hétérogènes (dormir : sommeil ; tomber : chute ; jurer : serment ;
frapper : coup) ; ces radicaux se suppléent réciproquement. Le cas
analogue, mais non identique, de eau : aquatique ; foie : hépatique, etc. sera
repris §§ 291, 390.
Des pronoms se suppléent avec des valeurs identiques, p. ex. se et lui
dans « Paul s'admire et ne pense qu'à lui », que et quoi dans « Je ne sais
ni que faire ni à quoi me résoudre ». Le pronom celui, celle supplée l'article
dans « le chapeau de Pierre et celui de Paul ». On dit « Paul est très aimé »,
mais « Tout le monde l'aime beaucoup ». Il y a supplétion selon que le
régime d'un verbe transitif s'accompagne ou non d'une préposition vide
(168, 253) : décider de partir, apprendre à nager, désirer mourir.
288. Dès l'indo-européen, et de façons diverses suivant les langues, le
subjonctif comble les lacunes de l'impératif dont il adopte la valeur.
178Quelques exemples suffisent à prouver cette équivalence. En français
Qu'il meure !, qui a la forme d'un subjonctif, se traduit en grec par
apothnēskétō !, impératif authentique. Inversement Partons ! (impératif)
correspond à Elthōmen ! (subjonctif). Ainsi que je meure ! meurs ! qu'il
meure ! mourons ! mourez ! qu'ils meurent ! est un paradigme cohérent, qui
ne présente aucune variation de valeur d'une forme à l'autre.
Si, malgré tout, beaucoup de grammairiens croient voir des valeurs
différentes dans Meurs ! et Qu'il meure !, etc., c'est sans doute sous l'influence
de la syntaxe latine, qu'on s'imagine retrouver dans celle du français.
Le latin possédait en effet deux impératifs, l'un exprimant un ordre
(bibe !), l'autre, à forme subjonctive, la simple exhortation (bibas !). Dans
une de ses odes (I, 11), Horace donne des conseils à Leuconoé : d'abord
« Sapias, vina liques et spatio brevi spem longam reseces », puis finalement
« Carpe diem, quam minimum credula postero ». Mais c'est précisément
cet échange de formes et de valeurs dans une seule et même pièce du paradigme
qui n'est pas possible en français ; impossible de remplacer Meurs !
par Que tu meures ! ou de trouver l'équivalent « impératif » de Qu'il meure !
289. La syntaxe connaît aussi la supplétion : Je veux partir et Je veux
que tu partes. Le gérondif français (« en forgeant, en marchant ») est le
supplétif du type préposition + infinitif, car il remplace le tour aujourd'hui
inusité par + infinitif 183 (cf. « C'est en forgeant qu'on devient forgeron » et
« On ne devient pas forgeron sans forger »). Remarquons en passant que
le gérondif transpose le verbe en substantif (« Il lit en se promenant » :
« Il lit pendant sa promenade ») et diffère en cela du participe présent, qui
le transpose en adjectif (« Une femme aimant son mari » : « Une femme
aimante »). Le premier est le déterminant d'un verbe (lit), l'autre d'un
substantif (femme) (v. 184, 2).
En français, le passif a deux formes : La maison se construit et La maison
est construite (par des maçons) : le type se construire supplée être construit
quand le verbe n'a pas de complément circonstanciel, car dans ce cas,
être désigne l'état et non l'action. En russe, le génitif est supplétif de
l'accusatif dans la phrase négative : « On ne pródal dóma » = « Il n'a pas
vendu la maison » cf. « On pródal dom ». Il y a des séquences supplétives :
il me le donne : il le lui donne ; donne-le-moi : ne me le donne pas.
La flexion de l'indo-européen est un vaste système de signes supplétifs.
179Nous avons vu en effet (241b) que les cinq déclinaisons latines se suppléent
les unes les autres sans aucune nuance de sens ; de même pour les
quatre conjugaisons et les déponents. Les conjugaisons irrégulières du
français sont supplétives des régulières, et ainsi de suite. L'allemand a
conservé beaucoup de ces diversités : cf. les pluriels Aest-e, Hirt-en, Kälb-er,
Brüder, Keller (avec désinence zéro) ; le français tend au contraire à économiser
les variétés flexionnelles (407 ss.).
290. Comme l'homonymie, la suppletion peut être totale ou partielle
(on n'a pas tenu compte de cette distinction dans les exemples précédents).
Deux supplétifs parfaits doivent présenter, outre l'identité des
significations, une hétérogénéité complète des signifiants et une identité
absolue des fonctions. Il est rare que ces conditions soient toutes réunies.
Elles le sont pratiquement, p. ex., dans nous allons : ils vont, où deux radicaux
totalement différents apparaissent dans un même temps d'un même
mode, et au pluriel : la répartition est donc purement arbitraire. Elle l'est
déjà moins dans œil : yeux, l'opposition du singulier et du pluriel étant de
nature fonctionnelle. Inversement, dans nous levons : ils lèvent, la distribution
des radicaux lev- et lèv- ne rime à rien, mais ces radicaux ne diffèrent
que partiellement dans la forme. Aime a un e ouvert, aimez un e
fermé ; cf. bête et bêtise ; de même peur a un œ ouvert, peureux un œ fermé.
La différence peut être minime (mais porter en germe une opposition
plus marquée) : les radicaux de marche et marchons ne diffèrent que par la
place de l'accent, d'ailleurs très faible comme on le sait.
291. Le cas de la suppletion partielle est généralement passé sous silence ;
aussi nous y insisterons davantage. Quelques exemples préliminaires
en feront prévoir la nature.
En français, les liaisons, les élisions et les cumuls créent un grand nombre
de supplétions partielles : cf. la (femme) : l'(épouse), de l' (enfant) : du (fils),
les z (hommes) : les (femmes), neuf (enfants) : neuv (ans) : neu(f) (mois), etc.
On peut citer encore lat. ger-ere « porter », supin ges-tum ; all. ich trage :
du trägst ; français prouver : la preuve.
On sait que, dans beaucoup de ces cas, on parle d'« alternance ». Mais
ce terme a été employé dans des acceptions si diverses qu'il est devenu
inutilisable. En tout cas, la statique fait une distinction radicale entre
l'alternance asémantique (suppletion partielle) et l'alternance symbolisant
une valeur linguistique, et qui serait plus justement appelée opposition
significative (exemple : Gast : Gäste, où le singulier et le pluriel sont distingués
180par l'« alternance »). Ces oppositions significatives ne sont pas autre chose
que des cas d'antonymie grammaticale (v. plus haut).
La distinction entre supplétion et opposition significative est parfois
délicate, mais elle doit être observée, quitte à poser des cas-limite. En
voici un : le français a souvent, pour rendre la même idée, un radical
roman et un radical emprunté au latin : étrangle (ment) : strangul(ation),
œil : ocul(aire), etc. Supplétion partielle, évidemment ; mais les signifiés
sont-ils identiques ? Pas tout à fait, car les latinismes ont souvent une
valeur stylistique autre que les mots romans ; strangulation et oculaire
fleurent le style scientifique.
Les suffixes français de noms d'action -ment et -age semblent supplétifs
à première vue ; cependant -ment désigne volontiers l'aspect ponctuel ou
terminatif (acquittement, enlèvement), -age au contraire très souvent l'aspect
duratif ou itératif ; il s'agit d'une action qui comporte des opérations
successives (élevage, blanchissage, dallage, pavage, griffonnage, barbouillage),
en sorte que, quand ces mots prennent un sens concret, ils désignent
des collectifs (le collectif est la forme spatiale de l'itératif) ; cf. un pavage,
un griffonnage, un emballage, un échafaudage. En outre, comme on le
voit dans barbouillage, bavardage, etc., ce suffixe possède une nuance
péjorative étrangère à -ment (cf. tapage et bruissement).
Autre cas analogue, mais beaucoup plus général : le genre des substantifs.
Le masculin, le féminin (et le neutre) se suppléent réciproquement,
car il n'y a aucune raison pour qu'un substantif français (à part ceux
désignant des êtres sexués) soit du masculin ou du féminin ; cependant,
ici encore, une réserve s'impose : le genre, même arbitraire, donne aux
mots certaines valeurs résultant d'une personnification (117).
Ainsi la supplétion impropre, ou opposition significative, glisse insensiblement,
comme l'homonymie impropre, dans la vaste catégorie des synonymes
(sens large).
292. Toute transposition ou changement de catégorie (181) est supplétion
quand elle entraîne des changements de forme dans le transposé,
la valeur de celui-ci restant identique à celle du transponend. On trouvera
de nombreux exemples 1) dans la transposition des virtuels ou dérivation,
2) dans celle des actuels (échange de phrases avec des propositions fonctionnant
comme termes de phrase).
1) La dérivation est supplétive quand les radicaux changent de forme
sans changer de sens ; ainsi élégant : élégamment, par opposition à clair :
181clairement ; de même acheter : achat, comparé à reculer : recul. Le cas où les
radicaux diffèrent totalement est assez rare : dormir : sommeil ; se taire :
silence ; tomber : chute.
2) Pas de supplétion dans Tu mens : Je crois que tu mens, mais bien
dans Il viendra : Je doute qu'il vienne. Le subjonctif en subordonnée est
un instrument de transposition. Si l'on préfère lui attribuer une valeur
propre, alors il constitue un pléonasme (234), car l'idée de doute est
exprimée à la fois dans le verbe douter et dans le subjonctif.
Lorsqu'une phrase est transposée en proposition conjonctionnelle, marquant
une notion spatiale, temporelle ou abstraite (où, quand, parce que,
etc.), elle équivaut à un complément circonstanciel introduit par une
préposition ; comparez « (Je voudrais vivre) où je trouverais la paix » et
« dans un endroit paisible », « (J'irai vous voir) quand je passerai à Genève »
et « à mon passage à Genève », « (Il a été puni) parce qu'il a été négligent »
et « à cause de sa négligence ».
On sait qu'il y a aussi équivalence entre proposition conjonctionnelle et
proposition infinitive introduite par une préposition ; ainsi « (J'irai vous
voir) après que j'aurai soupe » et « après avoir soupé » sont deux termes
parallèles.
On a vu enfin (289) que le gérondif a la même valeur qu'un infinitif
précédé de par, avec, pendant : « (Il lit) en marchant » = « pendant qu'il
marche ». Il suit de là que les prépositions et les conjonctions dont les valeurs
sont pareilles forment des couples ou des trios supplétifs quand
leurs signifiants diffèrent, totalement ou partiellement. La supplétion est
totale dans « (Il a été puni) parce qu'il a été négligent, pour avoir été
négligent, à cause de sa négligence » ; elle est partielle dans « lorsque j'arriverai »
et « lors de mon arrivée ». Ce genre de supplétion était très fréquent
en indo-européen ; les langues les plus évoluées tendent à s'en débarrasser ;
ainsi en anglais, before et after fonctionnent comme conjonctions et comme
prépositions.
293. Mais le type le plus général et le plus remarquable de la supplétion
est celui qui résulte de la transposition de signes grammaticaux en signes
lexicaux (178) ; dans la majorité des cas, la forme des signes diffère totalement
ou presque totalement. Il s'agit donc de conjonctions, prépositions,
préfixes, suffixes, désinences, etc. dont la valeur est exprimée par des
substantifs, des verbes, des adjectifs ou des adverbes. Nous donnons
quelques exemples seulement de cette immense classe. Comparez donc et
182conclusion ; en sorte que et conséquence ; sous et inférieur, infériorité ; près
de et proximité, proche, voisiner ; vers et direction ; dé(-raciner) et ôter,
arracher, extraction ; (lav-)age et action ; non, ne…pas, in- et négation ;
(marche-)rai et avenir, futur ; (march-)ez et ordre, etc., etc. 184.
Des formes intermédiaires servent de pont : entre parce que et cause se
trouve à cause de ; vers a pour synonyme dans la direction de, etc. C'est là
une des formes fondamentales de la synthèse sous son aspect associatif
mémoriel.
294. Nous avons vu (282) que l'homonymie se réalise sous une forme
pathologique dans le discours par la confusion des paronymes. La supplétion
offre un pendant assez exact de ce phénomène dans certains cas de
croisement (ou contamination), qui fondent en un seul des mots de sens
très voisins. Si p. ex. une personne peu cultivée ne voit pas de différence
sensible entre tendance et intention, elle les amalgame en intendance ; le
speaker de la radio devient un expliqueur (prononcé esplikeur), etc. Se
rappeler qch et se souvenir de qch. sont à peu près équivalents en français
moderne : la syntaxe se rappeler de qch., qui résulte aussi d'un croisement,
est un autre cas de supplétion « réalisée ». De même, préférer et aimer
mieux concourent à la formation du type « Je préfère me taire que parler ».
295. Il y a une supplétion phonologique. Elle apparaît lorsque, au cours
du temps, un même phonème a pris des formes divergentes tout en remplissant
les mêmes fonctions, le choix entre l'une et l'autre étant senti
comme arbitraire, parce que les conditions du changement sont ignorées
des sujets parlants. Ainsi en indo-européen, les sonantes r et n fonctionnaient
comme voyelles (notées r̥ et n̥) quand elles étaient au point vocalique,
p. ex. dans des groupes tels que tr̥ta et tn̥ta, et consonnes dans toutes
les autres positions : tarta, tanta, tra, tna, etc. Pour les sujets parlants,
r et r̥ étaient un seul et même phonème, ainsi que n et n̥. Or, en sanscrit,
r̥ a subsisté, mais n̥ est devenu a ; l'identité de n et n̥ a été détruite, et a
est devenu le supplétif de n. Ainsi, tandis que dans tr̥ta et tarta on percevait
un même son r, dans tata (pour tn̥ta), on voyait un a fonctionnant
arbitrairement pour n̥. En indo-européen, les racines *bher « porter » et *ten« tendre »
183formaient, selon une règle générale, leur participe passé en -to
en amuissant leur e, d'où *bhr̥to- et *tn̥to- ; n et n̥ étaient compris comme
un seul et même son, ainsi que r et r̥. Mais en sanscrit, si bhar- a donné
bhr̥ta-, tan- a donné tata-. Il suit de là que le couple r/r̥, dans bhar-/bhr̥taest
le pendant phonologique de march(e)/march(ons), le couple n/a, dans
tan-/tata-, rappelle va/allons (avec deux radicaux supplétifs).
296. La supplétion est l'aspect mémoriel du pléonasme obligatoire (234),
car elle n'est pas autre chose qu'un double emploi appelé à être distribué
arbitrairement : nous march-ons présente un cas de pléonasme, puisque
l'idée de première pluriel est désignée par deux signes au lieu d'un. Mais
de même, par supplétion, le génitif singulier est exprimé en latin par plusieurs
signes hétérogènes et de valeur identique, qui sont emmagasinés
dans la mémoire, et dont le choix est fixé arbitrairement par l'usage :
« domin-i, ros-ae, reg-is, etc. ».
Pour la même raison, la supplétion est le pendant du conditionnement
réciproque arbitraire (239), et c'est par lui qu'elle se réalise dans le discours ;
all- est supplétif de i- ; mais all- ne s'affixe qu'à certaines formes,
p. ex. all-er, et i- à certaines autres, p. ex. i-rai ; inversement, -er de l'infinitif
exige la présence de all-, et le suffixe -rai du futur la présence de -i :
conditionnement réciproque implique supplétion et vice versa.
297. Il n'est pas difficile de voir pourquoi la supplétion relève de la
synthèse. Ses contacts avec la dystaxie suffiraient à le prouver, et le
seul fait, signalé plus haut, que toute la flexion indo-européenne entraîne
un vaste régime de supplétion est assez caractéristique. Mais en elle-même
et psychologiquement, la supplétion est génératrice de synthèse.
Deux supplétifs se partagent un domaine qui ne devrait avoir qu'un seul
maître. Or, plus la fonction d'un signe est restreinte, plus l'esprit s'attache
aux réalisations de cette fonction. En outre, celle-ci étant arbitraire, il en
résulte une surcharge pour la mémoire, et la conséquence est un resserrement
plus grand des syntagmes où figurent les supplétifs. Le radical march-,
qui se retrouve dans toute la conjugaison du verbe marcher, se détache
plus facilement des désinences et s'imprime mieux dans l'esprit que le
radical all- du verbe aller, qui n'occupe qu'une petite partie du paradigme,
et est en concurrence avec i- (irai) et va (il va).
Il en est de même de la supplétion transpositive. Le passage de « tu
réussiras » à « Je crois que tu réussiras » laisse apparaître le transponend
dans la transposition ; mais la correspondance est moins claire dans « Je
184doute que tu réussisses », et moins encore dans la traduction latine « Rem
feliciter geres » : « Credo te rem feliciter gesturum esse ». La syntaxe de transposition,
dans les deux derniers exemples, est plus serrée, et le contact
avec le transponend plus difficile à saisir.
298. Les origines de la supplétion, indifférentes pour la statique, sont
de trois sortes, et forment la contre-partie exacte de celles de l'homonymie
(284) : 1) deux signes de forme et de sens différents ont confondu leurs
significations tout en maintenant la différence de forme ; exemple : aller,
vais, irai ; latin fero, tuli ; 2) un même signe a subi deux évolutions divergentes
sans différencier ses significations : œil, yeux ; latin tuli, latum (pour
tlatum) ; 3) un même signe a pris une certaine forme par évolution, puis
a été emprunté, avec la même signification, sous sa forme originelle :
français père, pater-(nel).
Ce qui est vrai des mots l'est aussi des autres classes de supplétifs. Le
subjonctif qu'il meure a eu d'abord une valeur autre que celle de meurs !,
puis il y a eu unification de sens 185.
En remontant dans l'évolution, on arrive donc toujours à un état où
des signes devenus plus tard supplétifs ne le sont pas encore. Autrement
dit, la supplétion, comme toutes les notions étudiées ici (cumul, signe zéro,
homonymie, etc.) est une notion strictement statique.
III. Vue d'ensemble sur
la dystaxie et la polysémie
299. Si la synthèse recouvre réellement les notions de non-linéarité et
de polysémie, on peut dire qu'elle consiste à confondre ce qui doit être distingué,
et à disjoindre ce qui doit être uni. Ceci s'entend soit des associations
discursives, soit des associations mémorielles.
Dans l'ordre linéaire, le cumul est un cas évident de fusion, et la condensation
partielle s'en rapproche ; le conditionnement réciproque maintient
aussi une soudure arbitraire entre éléments qui ne sont pas liés
organiquement, etc. Inversement, quand on sépare des signes unis par
le sens, qu'on fractionne les parties d'un signifiant qui devrait être un,
quand on exprime plusieurs fois successivement une même idée, il y a
185disjonction illégitime. L'anticipation est aussi une dislocation. Même l'hypostase
et le signe zéro opèrent avec des éléments qui devraient être
unis et sont séparés, puisqu'ils obligent à rattacher à un élément du discours
une notion qui ne se trouve que dans l'esprit.
Cette définition convient également bien à la polysémie ; l'homonymie
confond ce qui doit être distingué, et la supplétion établit plusieurs signes
distincts pour une notion unique.
300. Toutes les opérations qui permettent aux sujets parlants d'analyser
un complexe synthétique se ramènent — on l'a vu — à des associations
mentales unificatrices ou différentielles. A ce sujet, il importe de dissiper
un malentendu. Dans le langage, tout repose sur des associations ; mais
les unes sont facultatives et en nombre illimité : elles appartiennent à la
parole ; les autres sont obligatoires et en nombre déterminé : celles-là relèvent
de la langue ; c'est sur elles que repose l'interprétation de la non-linéarité
et de la polysémie. F. de Saussure (CLG3, p. 173 ss.) a insisté
sur les premières : il a montré que le mot enseignement p. ex. peut évoquer
des synonymes (instruction, apprentissage, etc.), des formations de même
structure grammaticale (changement), des formes homonymes (le -ment de
clairement et même de clément, une enseigne, etc….) et le caprice individuel
peut en imaginer des centaines d'autres. Toutes différentes sont celles que
déclenchent les divers types de synthèse : qu'elles soient conscientes ou
non, elles s'imposent à l'esprit et sont, dans chaque cas, uniques, sans
choix possible. Un signe zéro doit être suppléé à une place déterminée
(cf. la marche), une hypostase suggère nécessairement l'idée d'un certain
transpositeur (cf. caractère enfant), les notions contenues par cumul dans
un signe unique ne peuvent être analysées que grâce à des associations
déterminées (cf. pire). De même un homonyme comme louer doit évoquer
deux significations ; inversement deux supplétifs comme all-er/i-rai doivent
suggérer l'identité des significations. C'est précisément la nature impérative
de ces opérations mentales qui caractérise la synthèse.
301. Il suit de là que si la synthèse permet au sujet parlant de rapprocher
l'énonciation de la pensée globale non exprimée (214), elle augmente
et complique l'effort de l'entendeur par son irrégularité. Tout travail
cérébral qui n'est pas commandé par une règle exige l'intervention de la
mémoire pure, comme c'est le cas partout où l'esprit ne peut pas prévoir,
et la prévision ne s'obtient que par la règle, qui donne à l'esprit la liberté
nécessaire pour le fonctionnement normal. De même, bien qu'à un degré
186moindre, une règle spéciale et arbitraire demande plus d'effort qu'une
règle générale et rationnelle. Le fait que le travail de mémoire est le
plus souvent automatique et inconscient ne change rien à la chose, car
dans la langue, cet effort porte sur une quantité énorme d'opérations.
Or, c'est la tradition irraisonnée et rigide qui, dans le langage, s'oppose
à la régularité mobile. Tradition et régularité sont les deux normes contradictoires
de tout fonctionnement linguistique.
Enfin — et ceci nous ramène à la synthèse — ce que la mémoire a une fois
soudé tend à se reproduire sans changement ; c'est la raison de toute
action synthétique. Soit l'idée grammaticale de nominatif pluriel : le
moindre effort demande que cette idée unique ait un signe unique ; mais
le latin a ros-ae, domin-ī, templ-a, vir-ēs, animal-ia, manūs, speciēs ; il
s'ensuit que l'analyse de domin-ī p. ex. est plus malaisée que si ce cas avait
une seule désignation, le syntagme radical + ī se réalise sept fois moins
que si -ī était le signe unique du nominatif pluriel ; par suite, il y a fusion
plus intime entre celui-ci et le radical. Si, au contraire, une langue, comme
l'arménien, a une seule désinence de nominatif pluriel, dans l'espèce -kh, la
correspondance mémorielle « -kh = nominatif pluriel » se réalise dans un
nombre infini d'occasions, d'où autonomie très grande de cette finale, et,
par suite, analyse plus aisée.
302. La non-linéarité et la polysémie sont des réalités linguistiques incontestables,
et les explications précédentes sont, semble-t-il, concluantes.
Hâtons-nous d'ajouter que la concordance des signifiés et des signifiants
existe toujours en réalité, fût-ce indirectement. On pouvait le prévoir
a priori ; on ne conçoit pas, en effet, par quelle opération magique un signifiant
pourrait contenir arbitrairement deux ou plusieurs signifiés, comment
un mot pourrait avoir deux sens entièrement différents qui se révéleraient
sans ambiguïté à l'énoncé de ce mot, etc.
En fait, tout ce qui, dans une langue, est implicite, arrive à s'expliciter
par voie d'associations. Parmi ces associations, les unes sont suggérées
par la langue même, les autres se produisent au cours du fonctionnement,
dans la parole.
303. Comment, par exemple, la linéarité reprend-elle ses droits ? Soit le
signe fractionné tout de suite (217) : la langue fournit des associations
virtuelles avec des mots proprement dits, tels que immédiatement, incontinent,
ou, ce qui revient au même, avec d'autres locutions bloquées :
sur-le-champ, sans coup férir. Soit encore l'impératif Venez ! : l'idée modale
187et le pronom-sujet y sont nécessairement contenus, grâce à la comparaison
incessante avec des tours connexes : Vous viendrez ! — Viendrez-vous, enfin ?
— Il faut venir. — Il faut que vous veniez. — Je veux que vous veniez !,
etc. Dans J'aimais, la finale -ais (227) cumule les fonctions d'imparfait
et de première personne ; mais l'association avec nous aimions, vous aimiez
suffit pour résoudre ce cas de synthèse. D'autre part, ces contacts éclatent
sans cesse dans la parole même. Si une personne à qui l'on a dit d'abord
« Sortez ! » n'obéit pas, on insiste : « Sortez, je le veux ! », ou « Je veux que
vous sortiez ! » ; la sommation restant sans effet, l'on s'impatiente : « Sortirez-vous,
à la fin ? » Autant de formes explicites commentant l'implicite
« Sortez ! ». Ou bien le -ais de l'imparfait est analysé par voie d'antithèse :
« Je vous aimais, mais vous ne m'aimiez pas ». Les trois termes inclus dans
l'adverbe y (= « à cet endroit ») se déroulent sans effort dans une phrase
telle que « Puisque vous allez au théâtre, j'y irai aussi ». Il va sans dire
que la situation suffit souvent pour rétablir la linéarité : à table, devant
une carafe, je dis à mon commensal : « Mettez de l'eau dans votre vin » :
il n'aura pas l'idée de voir dans cette expression une métaphore.
La linéarité arrive toujours à être satisfaite ; il n'en est pas moins
vrai que tous les cas où son rétablissement se fait indirectement relèvent
de la non-linéarité et font effet de synthèse.
304. De même que la dystaxie, la polysémie est supprimée par des
associations discursives ou mémorielles toujours prêtes à se nouer dans
la pratique de la langue. Patron est homonyme de lui-même, mais il suffit
de brefs contextes comme « patron d'une robe » et « patron d'un atelier »
pour dissiper toute ambiguïté ; la situation remplit le même office : « Voilà
le patron ! » n'aura pas le même sens dans une usine ou chez la couturière.
Les associations mémorielles entrent aussi en jeu : patron fait penser au
synonyme maître, à l'antonyme ouvrier, ou au contraire au synonyme
modèle et à l'antonyme copie, etc. Le problème posé par la supplétion ne
se résout pas autrement : dormir et sommeil sont sentis comme identiques
pour le sens, parce que cette identité est sans cesse confirmée par la
mémoire et même par la parole (« dormir d'un sommeil paisible, etc. »).
La monosémie peut donc toujours, comme la linéarité, reprendre ses
droits ; il reste cependant que la polysémie exige que ce rétablissement
se fasse par un détour, et c'est en cela qu'elle est génératrice de synthèse.
305. Dans le Traité de stylistique française, j'ai appelé délimitation l'ensemble
des opérations associatives par lesquelles la dystaxie peut être
188ramenée à la linéarité, et identification le mécanisme associatif qui permet
de rétablir la monosémie.
Les deux opérations sont solidaires ; on peut, pour la clarté, les traiter
séparément, mais en fait, on ne saurait identifier sans délimiter, et inversement.
N'importe lequel des exemples cités le montre : si la délimitation me
fait trouver dans le cumulatif meilleur deux signifiés, plus et bon, c'est que
je le compare à « plus mauvais, plus froid, plus tendre, etc. » : mais ces associations
elles-mêmes ne sont possibles que parce que j'avais déjà déterminé,
au moins approximativement, la signification de meilleur, en d'autres
termes, parce que je l'avais, au moins partiellement, identifié. Inversement,
si firmament me suggère le synonyme ciel, qui lui sert de terme
d'identification, cela suppose que je considère le premier de ces mots
comme simple, malgré son apparence syntagmatique ; autrement dit, je
l'ai délimité en même temps que je l'identifiais.
La délimitation et l'identification ont une importance telle qu'elles contiennent
en puissance toute l'étude statique. Un enseignement de la langue
maternelle fondé sur cette double technique aurait une orientation vraiment
rationnelle, car alors le lexique et la grammaire seraient fondés sur
les principes qui guident spontanément les sujets parlants dans la pratique
(v. Bally, Crise du français, p. 92 ss.).
306. Mais la délimitation et l'identification sont des procédés de linguistique
statique ; l'opposition avec la recherche historique est ici frappante.
Celle-ci aboutit, elle aussi, à supprimer la discordance entre signifiants
et signifiés, à satisfaire l'idéal linéaire et monosémique ; mais elle y arrive
par une tout autre voie : non en se fondant sur les associations synchroniques
entre signes qui s'appellent, mais en brisant, au contraire, ces
associations pour ramener à leur origine les signes ainsi isolés. L'histoire
montre p. ex. que tout de suite a été autrefois un syntagme libre ; mais
le sens était différent de ce qu'il est aujourd'hui. Nous savons que la finale
d'imparfait -ais remonte au latin -e-ba-m qui distinguait les deux valeurs
confondues aujourd'hui, celles d'imparfait et de première singulier ; mais
ce n'est pas le latin qui nous avertit que -ais cumule deux valeurs. L'étude
de l'indo-européen primitif nous enseigne que, si l'impératif viens ! n'a
pas de pronom sujet, c'est que, à l'origine, il se réduisait à l'expression
verbale toute nue (p. ex. : i.e. : *bhere, littéralement « porter »), la personne
visée par l'ordre étant identifiée par la situation seulement, et l'idée
modale par la mimique et l'intonation ; mais la valeur de l'impératif est
189devenue toute différente : il distingue nettement les personnes, l'idée modale
se dégage sans le secours de l'intonation, et tout cela est fixé par
contact avec les formes associées ; ainsi de tout le reste. De même pour
la polysémie : l'historien a tôt fait de réduire à néant l'homonymie des
deux verbes louer, en faisant remonter l'un à laudare, l'autre à locare ;
mais actuellement, cette différence est lettre morte, et la discrimination
se fait par les contextes où figurent ces mots.
307. C'est pourquoi — nous l'avons déjà dit (216) — la terminologie de
l'évolution ne peut s'appliquer au fonctionnement, et vice versa, puisque
l'histoire décrit des procès, et la statique des procédés ; un terme technique
de diachronie crée toujours une équivoque en synchronie, et réciproquement.
La statique ne connaît pas la contraction ; le mot « agglutination »
est pour elle un abus de langage. Les historiens doivent ignorer le
signe zéro, le cumul, le conditionnement arbitraire et même toute espèce
de conditionnement ; quand ils disent p. ex. que le grec thēr « bête sauvage »
a un suffixe zéro, ils font, sans le savoir, de la statique ; et quand ils disent
que c'est un thème racine, ils ne se doutent pas qu'ils usent de deux termes
qui jurent ensemble.
Ainsi ces deux procédures, également légitimes, diffèrent entièrement,
non seulement dans leurs démarches, mais surtout dans leurs résultats : la
recherche historique a pour principal effet de nous éloigner de la compréhension
des valeurs actuelles du système linguistique ; tout ce qu'elle peut
faire pour les éclairer, c'est de mieux marquer l'opposition entre le passé
et le présent, et, par contraste, les caractères propres de celui-ci.190
Deuxième partie
Le français d'aujourd'hui191
Vue d'ensemble sur l'état actuel du français
308. Après cette revue théorique, notre sujet nous invite à faire un
retour sur le français : il s'agirait de connaître l'attitude qu'il observe
vis-à-vis des lois générales de l'énonciation et des diverses formes de la
dystaxie et de la polysémie.
Beaucoup des faits généraux discutés dans ce qui précède visaient à
caractériser indirectement le français d'aujourd'hui, et c'est à lui que
nous avons emprunté la plupart de nos exemples. Les impressions détachées
qui ont pu se dégager de ces travaux d'approche doivent être maintenant
précisées et coordonnées.
Le français semble animé de deux tendances contradictoires : l'une engendre
des formes analytiques, l'autre les condense et rapproche la langue
du type synthétique. Voici, par anticipation, et en raccourci, une vue
sommaire de cette double proposition, qui sera reprise dans la suite, sans
cependant que tous les points soient développés avec une égale ampleur.
Le français, langue analytique : on sait à quoi on reconnaît ce caractère.
Au déclin de la flexion d'abord : la flexion présente toutes les variétés
de la dystaxie : cumul des fonctions dans un seul élément, notamment
sous forme d'apophonie (229), chevauchement des éléments les uns sur
les autres (230), pléonasme (234), conditionnement arbitraire (239), signe
zéro (248), disjonction (265), anticipation (269). La flexion est aussi
polysémique à un haut degré, à cause du rôle énorme qu'y jouent l'homonymie
(274) et la supplétion (287).
Or, le français s'est débarrassé de la plupart des flexions héritées du
latin : elles ont presque disparu du substantif, végètent dans l'adjectif
(distinction sporadique du genre et du nombre) et ne subsistent à l'état
de demi-système que dans le verbe, où d'ailleurs les désinences sont constamment
battues en brèche (remplacement de nous par on, abandon du
passé défini, de l'imparfait du subjonctif, déclin du reste de ce mode, etc.).
Tout ce qui est enlevé aux terminaisons est remplacé par des petits mots
préposés au sémantème (articles, prépositions, particules, pronoms, auxiliaires).
L'allemand, moins évolué, est dans la situation d'une langue qui a tout
pour se passer des flexions et qui cependant les conserve. Il possède les
mêmes substituts de la flexion que le français (cf. « die Hirten, von mir,
er leidet, hat gelitten, wird sterben, etc. »), et cependant il demeure fidèle
193à ses déclinaisons et à ses conjugaisons. De là une somme considérable
de pléonasmes grammaticaux. Il conserve à l'apophonie un rôle important ;
en français, elle n'en joue presque plus aucun (lève : levons) et n'est
plus qu'un poids mort dans la masse énorme des verbes irréguliers (peux :
pu ; veux : voulons, etc.).
309. En syntaxe, une des formes les plus caractéristiques de la dystaxie
est la disjonction (265). Elle est de règle en allemand ; le français a une
construction agencée de telle manière que les signes associés par la pensée
sont le plus possible rapprochés les uns des autres.
Enfin l'anticipation, autre forme capitale de la dystaxie, est abondante
en allemand ; le français a instauré presque partout l'ordre progressif.
Cette différence importante est la seule qui nous retiendra plus particulièrement,
car on peut la poursuivre dans toutes les parties du système, depuis
la construction des phrases jusqu'à la formation des mots et des syllabes.
C'est la structure entière du français qui apparaît quand on se place à
ce point de vue.
Il s'agit, en dernière analyse, de la liberté relative de la construction
des phrases. Or, celle-ci est, à son tour, fonction de l'autonomie plus ou
moins grande des éléments de la phrase, et cette autonomie, gravement
compromise en français, est garantie en allemand par le système touffu
des flexions. Le problème de l'autonomie du « mot » en français sera examinée
§ 466 ss.
Mais ces caractères ont leur pendant associatif. Les variétés infinies de
la flexion indo-européenne créaient des catégories très tranchées, à parois
étanches : catégories lexicales (parties du discours) compliquées de sous-catégories
nombreuses ; catégories morphologiques, dont la complication
maximale apparaissait dans le verbe, composé de sous-systèmes à peu
près autonomes (cf. gr. leipō, élipon, léloipa). Nos langues modernes n'en
sont plus là. S'il n'y a pas, sous ce rapport, une différence essentielle entre
le français et l'allemand, le verbe allemand reste cependant plus proche
du système indo-européen (type leipō) du fait de l'abondance de ses
verbes « forts » (type nehmen, nahm, genommen) ; le français ne présente
rien d'analogue, car ses verbes « irréguliers » sont des survivances où la
répartition des formes est chaotique (pouvoir, je peux, j'ai pu ; devoir, je
dois, j'ai dû ; etc.).
310. Dans le domaine de la polysémie, c'est le régime de la transposition
qui sépare le plus les deux langues ; les échanges entre catégories sont,
194dans l'ensemble, plus aisés, c'est-à-dire moins caractérisés, en français
qu'en allemand. Là, en effet, les classes de mots sont séparées les unes
des autres par l'armature des flexions et des suffixes, qui ont leur forme
propre ; un adjectif se décline autrement qu'un substantif, la conjugaison
place le verbe totalement à part ; des suffixes tels que -ung, -heit, -schaft
révèlent tout de suite des substantifs ; -ig, -lich, -isch n'appartiennent
qu'aux adjectifs ; -igen, -eln, -ieren qu'aux verbes. Les échanges sont plus
aisés en français ; notamment le substantif et l'adjectif sont interchangeables
avec un minimum de transposition (507) ; l'adjectif attribut n'est
pas séparé du prédicat par la flexion (cf. all. « ein guter Wein : dieser Wein
ist gut »). Il est vrai que l'adverbe de manière est plus éloigné de l'adjectif
qu'en allemand (cf. « Er arbeitet langsam » et « Il travaille lentement »). En
français, les composés se rapprochent beaucoup des groupes syntaxiques
(150) ; ils en sont beaucoup plus éloignés en allemand (comparez fils de
roi, composé, et le fils du roi, groupe syntaxique ; all. Königssohn et Sohn
eines Königs).
Dans la syntaxe même, le passage de la phrase indépendante à la fonction
de proposition-terme est, dans l'ensemble, moins laborieux qu'en
allemand, parce que, en subordonnée, le verbe a la même place qu'en
principale ; cf. « Cet élève travaille assidûment » et « Un élève qui travaille
assidûment » : (all. « dieser Schüler arbeitet fleissig » et « ein Schüler, der fleissig
arbeitet », ou « ein fleissig arbeitender Schüler »).
Sous le rapport de la transposition, le français est plus proche que l'allemand
de la liberté qu'on observe en anglais, sans y atteindre cependant ;
certaines entraves, comme le subjonctif (242), l'en tiennent encore éloigné.
311. Ces contrastes se retrouvent dans la structure phonologique des
deux langues : les sons du français sont simples et bien distincts les uns
des autres dans la chaîne ; ils ont donc, à leur manière, un caractère analytique.
L'allemand offre, au contraire, des phonèmes complexes (mi-occlusives,
aspirées) ; il a des diphtongues, le français les ignore ; les groupes
de consonnes sont nombreux en allemand, et fortement soudés les uns
aux autres : le groupe -ng- se confond presque avec -n- guttural (Engel).
La nasalité s'étend aux voyelles a et o précédentes (dans Anker, Onkel,
etc.). La distinction entre occlusives sourdes (p, t, k) et sonores (b, d, g)
est absolue en français, imparfaite en allemand, où b, d, g sont des sourdes
douces que l'oreille risque toujours de confondre avec p, t, k.
Le rythme est baryton en allemand, oxyton en français, et nous savons
195que ce contraste est parallèle à celui entre anticipation et séquence progressive
(272).
312. Tels sont les principaux traits qui donnent un caractère synthétique
à l'allemand et analytique au français.
Mais voici la contre-partie : le français tend de plus en plus à grouper
les mots en molécules syntaxiques serrées, reflétées dans la prononciation
par des mesures rythmiques compactes à accent unique (« J'ai donné un
beau livre — à mon ami ») 186 ; les mots, en tant qu'unités sémantiques,
perdent une grande partie de leur autonomie et se fondent avec leurs
déterminations et les ligaments qui les rattachent les uns aux autres.
Les mots eux-mêmes condensent leurs sous-unités, qui sont souvent difficiles
à analyser. Cette fusion est soulignée par des particularités phoniques,
telles que l'élision et la liaison ; la syllabe, qui a généralement une forme
simple (une seule consonne + une seule voyelle), ne coïncide que par
hasard avec la limite des unités et sous-unités : u-n(e)au-bai-n(e)i-nes-pé-rée
(v. 531). Le français est ainsi en marche vers une nouvelle forme de synthèse.
L'allemand suit une évolution opposée ; ses formes synthétiques sont
contrebalancées par le fait que les sémantèmes se détachent mieux des
morphèmes et que les groupes syntaxiques sont fragmentés, hachés. Les
mots sont fréquemment analysables dans leurs sous-unités. Ici encore,
les caractères phonologiques du discours sont parallèles aux caractères
du discours lui-même (cf. p. ex. l'accent radical et la coïncidence des
frontières de syllabes avec celle des mots et des sous-unités (548).
Donc, condensation d'une part, émiettement de l'autre. Autrement dit,
le français tend insensiblement vers le signe simple, l'allemand vers le
signe complexe. La forme générale de l'expression en reçoit un contrecoup.
En effet, signe simple équivaut le plus souvent à signe arbitraire
dans le sens saussurien ; le signe complexe est, par définition, motivé.
Mais le signe arbitraire se contente d'étiqueter les objets et présente les
procès comme des faits accomplis ; le signe motivé décrit les objets et
rend le mouvement et l'action dans leur développement. Le français est
une langue statique, l'allemand une langue dynamique.196
Encore une fois, nous ne comptons pas donner une égale importance
aux diverses parties de cette esquisse, préférant mettre en plein relief
trois traits fondamentaux seulement : la séquence progressive, qui souligne
la tendance analytique du français, la condensation des signes, qui tient
en échec l'analyse, enfin la tendance statique de l'expression.197
Première section
Séquence progressive199
Modalités de la séquence progressive
Conflit entre la progression et l'anticipation
313. Nous avons vu que l'ordre dans lequel se succèdent les éléments
de l'énoncé est un indice d'analyse ou de synthèse, parce que tantôt il
satisfait aux exigences de la linéarité, tantôt il y est contraire. La séquence
est synthétique et antilinéaire quand une partie de l'énoncé, dont la compréhension
dépend d'une autre partie, précède celle-ci au lieu de la suivre
(269). Or, le thème de l'énoncé est nécessaire à la compréhension du propos,
le sujet est indispensable pour l'intelligence du prédicat ; p. ex. rond est
une énigme si l'on ne dit pas à quoi l'on attribue la qualité de rond (la
terre, une orange, etc.). De même, dans les réductions de phrases en termes,
le déterminant ne doit être énoncé qu'après ce qu'il détermine ; comparez
de mon père et la maison de mon père.
Comment s'expliquer qu'on arrive à dire cependant, comme en allemand
littéraire, « Rund ist dieser Apfel. Meines Vaters Haus » ? ou en français
« Heureux les humbles ! Advienne que pourra ! »
314. L'anticipation découle soit du mécanisme de la pensée personnelle,
soit de la tendance au moindre effort (62).
Sans songer aux exigences de la communication, le parleur peut se
borner à énoncer ce qui fait l'objet de l'énonciation, par exemple Magnifique !
en parlant d'un tableau auquel il pense ; ou bien il juge la mention
de cet objet inutile parce que celui-ci se trouve sous les yeux des interlocuteurs.
Mais il peut aussi exprimer après coup seulement ce qui fait
l'objet de son énonciation, p. ex. « Magnifique, ce tableau ! » ou « Il est
magnifique, ce tableau ! » : c'est là l'origine de la séquence anticipatrice 187.
A son tour, l'anticipation syntaxique (prédicat-sujet) peut devenir traditionnelle
dans un idiome et constituer un de ses caractères fondamentaux.
La prédominance de la séquence anticipatrice est une des grandes
201différences qui séparent l'allemand du français. Elle est de nature égocentrique,
et demande à l'entendeur un effort d'interprétation. Au contraire,
présenter le thème avant le propos, le déterminé avant le déterminant,
comme le fait le français dans la séquence progressive, c'est ajuster
l'énonciation aux besoins de l'interlocuteur et faciliter son travail d'interprétation.
L'allemand est replié sur le parleur, le français est orienté vers l'entendeur.
Séquence et rythme
315. Le rythme du discours est en général la conséquence des tendances
psychologiques qui engendrent telle ou telle séquence, et c'est là un exemple
remarquable du parallélisme qui unit le système phonologique au système
grammatical (13).
Le rythme est en effet déterminé par le contraste entre éléments forts
et éléments faibles de l'énoncé. Les premiers sont les pièces maîtresses
du syntagme, les signes lexicaux ou sémantèmes (dans la phrase, les mots,
et dans les mots, les radicaux) ; les seconds sont les outils grammaticaux
et les signes catégoriels (prépositions, conjonctions, particules, actualisateurs,
quantificateurs, préfixes, suffixes, désinences). Or, les premiers sont
articulés nettement, relevés généralement par l'accent ou l'intonation ; les
seconds n'ont qu'un faible relief phonique et sont partiellement ou totalement
atones. Cette règle n'est pas absolue : il y a des pronoms personnels
toniques (moi, toi, etc.), des démonstratifs toniques (cela), etc.
Mais le rythme, issu originairement des mouvements de la pensée, — la
pensée, elle aussi, a son rythme — peut s'en affranchir et agir même
dans un sens opposé.
On peut désigner les éléments du rythme phonique par τ (prononcé :
tau), et τ' ; on représentera parallèlement les pièces de la séquence grammaticale
par t et tʼ ; tʼ et τ' figureront les parties fortes, t et τ les parties
faibles. La concordance de la séquence et du rythme répond aux formules
image ttʼ ∕ ττʼ et image tʼt ∕ τʼ τ c'est-à-dire : à la séquence progressive correspond le rythme
oxyton (ou oxytonie), à la séquence anticipatrice ou régressive le rythme
baryton (ou barytonie). Leur désaccord a, lui aussi, deux formes : image ttʼ ∕ τʼ τ et image tʼt ∕ ττʼ
qu'il est inutile de définir.202
D'une façon générale, c'est le rythme qui l'emporte sur la séquence
grammaticale en cas de discordance. Ainsi une langue à rythme oxyton
accentuera aussi bien un déterminé qu'un déterminant si ce terme est
final et l'autre atone ; ainsi je crois et mon chapeau ont le même rythme,
bien que le premier de ces syntagmes soit ttʼ et le second tʼt.
316. Un exemple capital de l'accord entre anticipation et barytonie
est fourni par les désinences latines. Ainsi dans amas « tu aimes », la désinence
renferme le sujet ; dans patris « du père », elle équivaut à une préposition,
c'est-à-dire à un déterminé. C'est une des raisons pour lesquelles les
désinences latines ont été entamées dès la première période de l'ancien
français et ont en grande partie disparu. La fin du mot, surtout si elle
est atone, est une position périlleuse ; elle s'use plus vite que le reste du
mot. Le rythme baryton a détruit les désinences avant que le rythme
contraire ait pu s'imposer et les galvaniser, comme celles qui subsistent aujourd'hui
en français sousl'accent oxyton : « nous marchons », « il marchait », etc.
La concordance inverse image ttʼ ∕ ττʼ comme on pouvait le prévoir, se vérifie abondamment
en français moderne ; c'est l'état normal. Dans « je marche », le
sujet je précède le verbe et est atone ; de même pour la copule : « (la terre)
est ronde », pour les prépositions : « par la force, de la ville, etc. », les conjonctions :
« quand vous voudrez ».
317. Des deux formes de discordance image ttʼ ∕ τʼ τ et image tʼt ∕ ττʼ la première n'est pas
habituelle en français, où le rythme oxyton prédomine, au moins dans le
langage non affectif. C'est seulement sous l'empire de l'émotion que, par
exemple, dans la phrase « Cette canaille a dupé tout le monde », le sujet
arrive à être accentué ; mais on peut tout aussi bien dire « Tout le monde
a été dupé par cette canaille » (202) ; l'accent affectif n'est donc pas proprement
grammatical.
La seconde forme image tʼt ∕ ττʼ est plus fréquente ; elle apparaît dans tous les cas
où un élément est à la fois atone et déterminant, p. ex. dans « mon chapeau »,
qui a la même valeur grammaticale que « le chapeau de Paul » et remplace
un inusité « le chapeau de moi » (cf. grec ho pîlós mou et fr. un chapeau à moi,
une invention de moi) ; mais le déterminant est contenu dans un possessif,
et les possessifs sont atones, parce qu'intérieurs de groupe. De même
dans « Ne le prends pas », parallèle à « Ne prends pas ce livre ». La concordance
est rétablie, au contraire, dans « Prends-le », parce que le est tonique.203
L'accent de mot présente un cas particulier ; le mot porte normalement
l'accent sur sa dernière syllabe, quelle que soit sa constitution syntagmatique.
Un préfixe est toujours atone, et pourtant il est tʼ dans relire (lire
de nouveau), et t dans entasser (cf. mettre en tas) ; enfin, que le radical
soit atone devant un suffixe, comme dans jardin-ier, cela est doublement
étrange, car un suffixe est un simple morphème et, de plus, a la fonction
de déterminé (174B). Mais tout cela signifie simplement que, pour le sentiment
des Français, le mot est une unité compacte, où les éléments
s'effacent devant l'ensemble. Cette supposition est en pleine harmonie
avec la prédilection du français pour les mots simples (559), en harmonie
aussi avec ce que nous dirons des préfixes, des racines et des suffixes au
double point de vue de leur structure grammaticale et de leur constitution,
phonique (380, 387, 404).
318. La prédominance du rythme sur la séquence est particulièrement
frappante dans les cas où les éléments d'un syntagme sont tous les deux
forts ; le volume l'emporte sur la valeur de déterminé ou de déterminant ;
c'est ce qui explique la place différente de personne et de rien dans « Je
n'ai vu personne » et « Je n'ai rien vu » ; comparez « J'ai vu toutes choses »
et « J'ai tout vu ». La place de l'adjectif épithète varie aussi selon le nombre
des syllabes du substantif : on dit maître indulgent et maîtresse indulgente,
mais indulgent maître est moins naturel ; on dit plutôt femme délicieuse
que délicieuse femme. Les monosyllabes jouent un grand rôle dans cette
répartition : un sourcilleux roc est plus dur que un roc sourcilleux. Ces
cas-limite de la règle rythmique présentent, naturellement, bien des fluctuations.
Mais la discordance entre groupe rythmique et syntagme va plus loin
encore ; ainsi la totalité de l'un peut correspondre à une partie de l'autre.
Dans « le loup, un gros loup », et une multitude d'autres types, l'unité
rythmique recouvre l'unité syntagmatique ; mais « le chien du jardinier »,
qui est syntagmatiquement un, renferme deux mesures accentuelles. La
phrase « La terre tourne » est à deux temps ; il n'y en a qu'un dans « Elle
tourne », qui est grammaticalement équivalent. Comparez « la tendresse
d'une mère » (2 temps) et « sa tendresse » (1) ; « un nuage sombre » (2) et « un
sombre nuage » (1) ; « Je ne lui en ai plus jamais parlé » (1) peut s'enfler
rythmiquement en proportions diverses, si l'on remplace les représentants
par des actuels pleins : « Je n'ai plus jamais parlé de cette affaire à mon
associé » (3), etc.204
Séquence progressive et densité syntagmatique
319. Si la séquence progressive est un des traits les plus marqués de
l'ordre des mots en français, elle n'a pas prévalu partout : quelles sont les
raisons des résistances qu'elle rencontre encore ?
Elle pénètre plus facilement dans un syntagme libre à éléments directement
interchangeables (160) que dans un syntagme cohérent, c'est-à-dire
formé de termes qui ne sont qu'indirectement interchangeables (218) ; or,
les plus mobiles sont les signes lexicaux, les mots proprement dits : la
maison de mon père est plus mobile que ma maison, cette maison, etc. Plus
un syntagme est pauvre en lexicaux, plus il est dense et résiste aux innovations :
« Je le lui donne » a conservé la construction anticipatrice, alors
que le type syntaxique correspondant a été infléchi dans le sens progressif,
p. ex. : « Le maître donne un livre à l'élève ». En latin, cum, de même que
la plupart des prépositions, était postposé à son régime (325) ; puis il l'a
précédé (cum amico) ; mais l'ordre ancien a persisté dans mecum, vobiscum,
etc.
A plus forte raison doit-on s'attendre à une résistance maximale de la
part des préfixaux et des suffixaux en tʼt (exemple : pré-voir et règle-ment).
La raison de cette différence — répétons-le — se trouve dans le fait que
les éléments lexicaux admettent des substitutions directes illimitées, tandis
que les autres signes impliquent seulement ces substitutions (160).
320. La réciproque n'est pas absolument vraie : une mobilité extrême
n'est pas compatible avec une séquence réglée une fois pour toutes. Plus
le groupe se rapproche de la phrase, et la phrase de la période, plus cette
liberté augmente. On a le choix entre « Je vais ce soir au théâtre » et « Je
vais au théâtre ce soir », entre « J'ai fait en Suisse un beau voyage » et
« J'ai fait un beau voyage en Suisse » (ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait
aucune différence entre les tours parallèles, ni qu'ils soient également
usuels dans la langue courante). La possibilité d'inverser le sujet du verbe
est aussi un critère de liberté relative, soit que cette inversion n'entraîne
aucun changement de sens (« Quand viendra le printemps »), soit qu'elle
donne aux tours des valeurs différentes (« Tu veux » : « Veux-tu ? »). Nous
verrons d'ailleurs que, actuellement, le français parlé est de moins en
moins enclin à l'inversion du sujet.
En somme, c'est la mobilité moyenne qui est la plus favorable à l'introduction
de l'ordre direct. Si p. ex. il s'est installé dans les composés (378 ;
205porte-plume, pot à lait, etc.), c'est que le composé, bien que syntagme
complexe, lexical, facile à former et à dissoudre, n'en est pas moins un
mot, c'est-à-dire le représentant d'une idée unique. Au contraire, la combinaison
d'un substantif et d'un adjectif épithète (367) n'a pas encore été
tout à fait enrégimentée dans la séquence progressive, parce qu'elle est
plus syntaxique ; dans sombre nuage et nuage sombre, on distingue nettement
les deux idées associées.
Dans le domaine de la phrase, même équilibre variable : l'ossature fondamentale
(sujet-verbe-attribut, sujet-verbe-complément d'objet) est définitivement
réglée par la séquence progressive, mais les à-côtés, p. ex. les
compléments circonstanciels, jouissent d'une plus grande indépendance
(« J'ai vu ce matin ton ami, J'ai vu ton ami ce matin, Ce matin, j'ai vu
ton ami »).
321. Le conflit entre progression et anticipation peut, naturellement, se
refléter dans un seul et même syntagme. De là des complications de
structure qui présentent tous les degrés : modérées en français, elles sont
extrêmes en allemand (271). Je vois est progressif, je le vois régressivo-progressif.
Paul hat geschlafen est direct, Paul hat letzte Nacht sehr gut
geschlafen ne l'est plus qu'à moitié, car en allemand le participe prend
devant lui ses déterminations.
C'est là le secret des constructions enveloppantes ou emboîtantes, si
caractéristiques de la syntaxe allemande ; le français y échappe en grande
partie, parce que la séquence progressive y occupe plus de place que dans
une langue conservatrice comme l'allemand.
322. Toutes choses égales d'ailleurs, l'accord est une syntaxe plus synthétique
que la rection (173). Celle-ci unit des termes extérieurs l'un à
l'autre, l'accord les fond l'un dans l'autre. En outre, le rapport de rection
est réversible : « Paul rencontre Pierre : Pierre rencontre Paul. Paul bat
Pierre : Pierre est battu par Paul » ; l'accord ne connaît pas ce renversement
(« Heureux les humbles » est une inversion grammaticale, non un renversement
du rapport logique). Il y a donc plus de mobilité dans les termes
du rapport rectionnel.
Le caractère de la rection apparaît d'autant mieux si elle est soulignée
par des procédés différentiels, p. ex. par la diversité des cas (latin « Pater
amat filium »). Inversement, l'unification opérée par l'accord ressort mieux
quand elle s'appuie sur la concordance matérielle des termes, p. ex. l'« accord »
en genre, en nombre et en cas (latin « rosa rubra est », mais anglais
206« The rose is white »). On sait que c'est là une forme du pléonasme obligatoire
(235). Ce fil d'Ariane de la concordance est particulièrement nécessaire
quand une langue a un ordre des termes relativement libre, comme
c'est le cas en grec, en latin, etc.
323. C'est sans doute la raison pour laquelle l'indo-européen a étendu
l'accord aux dépens de la rection (et de la logique), p. ex. en créant des
adjectifs de relation, c'est-à-dire dérivés de substantifs (147) : latin « statua
marmorea » : fr. « statue de marbre » ; « erilis filius » : « le fils de notre maître ».
Il y a une tendance générale à tout accorder avec le sujet (comme c'est la
règle dans les langues bantoues). Ainsi s'explique que des compléments
circonstanciels puissent être transformés en adjectifs accordés avec le sujet
(grec « chthizòs ébē » = « il est parti hier » ; lat. « vespertinus redit
domum » = « il revient le soir à la maison »).
C'est pourquoi les actualisateurs (démonstratifs, possessifs, articles, etc.),
qui supposent logiquement la syntaxe de rection (357), sont, dès l'indo-européen
et jusqu'aujourd'hui, accordés avec le substantif (« mon chapeau »,
logiquement « le chapeau de moi »). Même remarque à propos des quantificateurs.
Le rapport de la partie au tout est un rapport de relation et de
rection (115 IIa) ; la syntaxe d'accord de multi milites est donc plus illogique
que ne le serait multi militum, et que ne l'est multum vini ; en français,
beaucoup de vin a d'abord été rectionnel, mais par entraînement de la tradition
est redevenu conforme à l'accord (« beaucoup de soldats sont morts »).
Ce caractère synthétique de l'accord se marque par une résistance plus
forte à l'ordre progressif dans les langues modernes. En allemand, le type
de rection génitif + substantif a subi la transformation : das Haus des
Vaters (des Vaters Haus est archaïque et poétique), tandis que la séquence
épithète + substantif a tenu bon (der gute Vater). Le français est plus
évolué ; mais s'il a adopté définitivement l'ordre la maison du père, il
hésite encore pour le type d'accord sombre nuage : nuage sombre.
Comment la progression se réalise
324. La séquence progressive peut se réaliser de trois manières : par
permutation des termes, par permutation des valeurs, par innovation.
1. La permutation des termes est le cas le plus fréquent, surtout si l'on
y englobe les tours qui, libres autrefois, mais favorisant l'ordre tʼt, se sont
207stabilisés en ttʼ ; tous les exemples cités jusqu'ici sont de cette sorte :
« Paul bat Pierre, la maison de mon père, etc. ».
2. Dans la permutation des valeurs, les termes conservent leur place,
mais les valeurs changent ; le cas des quantificateurs, que nous venons
de citer, en est un premier exemple. Soient les prépositions durant et
pendant : « durant le combat, pendant le combat » étaient autrefois des tours
« absolus » signifiant « tandis que le combat dure, est en suspens ». Cette
syntaxe répugnait à la tendance progressive, et l'analogie des groupes
prépositionnels en ttʼ, tels que « dans le combat, au cours du combat, etc. »
a transvalué durant et pendant en prépositions ; de la sorte, la tendance
progressive a pu se satisfaire sans altérer ni la forme matérielle des mots,
ni l'ordre de ces mots. Le changement de valeur est consacré par l'orthographe
dans « vu les circonstances » 188.
3. Enfin il y a innovation quand la langue crée de l'inédit sans s'inspirer
du type antérieur. L'innovation est partielle ou totale. Ainsi une forme
comme ce chapeau s'adjoint simplement des particules dans ce chapeau-ci,
ce chapeau-là, particules qui suivent l'ordre progressif ; mais le changement
n'est pas radical. Au contraire, les composés romans (378) qui ont supplanté
les composés indo-européens en tʼt (lat. signifer, agricola) ne se
sont pas inspirés de l'état existant ; ce sont certains groupes syntaxiques
légèrement archaïques (153) qui leur ont servi de modèles.
L'ordre progressif dans les langues
indo-européennes
325. On sait que l'indo-européen et les langues indo-européennes anciennes
accordaient aux différentes parties de l'énoncé une grande autonomie,
et admettaient un choix assez libre pour les séquences. Le latin
permet des permutations telles que « Paulus Petrum verberat, Petrum
Paulus v., Petrum v. Paulus, v. Paulus Petrum, etc. ». Toutefois, cette
liberté a dû être beaucoup plus restreinte dans le parler usuel, et même
dans la langue écrite courante, que dans la langue littéraire, surtout celle
des poètes. Mais partout où ces langues présentent des indices sûrs de
séquences réglées, l'ordre anticipateur prédomine ; inversement, lorsqu'on
y surprend des innovations étrangères à l'i.-e. primitif, on voit s'implanter
peu à peu la construction progressive.208
L'exemple le plus remarquable est celui des prépositions. Elles font
double emploi avec les désinences casuelles (235), qu'elles sont destinées
à remplacer et qui forment avec le radical un syntagme régressif (316).
Les prépositions, par analogie avec ces désinences, se sont placées d'abord
de préférence après le nom (cf. sanscrit védique apsú á « dans les eaux »),
puis se sont peu à peu affranchies de cet usage (grec homérique Ilion eis
et eis Ilion « à Troie ») et ont fini par se fixer devant leur régime (latin
in urbe et non urbe in « dans la ville »).
326. L'ordre direct est donc une tendance générale en i.-e. Comme les
langues modernes perdent peu à peu leurs flexions et adoptent une structure
de phrase relativement réglée, il n'est pas étonnant que ce soit la
séquence progressive qui en bénéficie, si bien qu'on peut mesurer le degré
d'archaïsme d'un idiome i.-e. à la résistance plus ou moins forte qu'il
oppose à cette poussée.
On constate p. ex. que l'allemand, moins évolué que le français, présente
aussi moins de types syntagmatiques en ttʼ. S'il observe à peu près
la séquence progressive dans la phrase indépendante enonciative, le moindre
accroissement de complexité suffit pour donner prise à l'anticipation.
Ainsi le complément indirect précède le direct : « Paul gibt seinem Bruder
ein Buch » ; l'ordre français « Paul donne un livre à son frère » est plus direct,
car donner quelque chose à quelqu'un, c'est faire aller une chose vers
cette personne. Les auxiliaires rejettent leur verbe enfin de phrase : « Der
Sohn wird (würde, soll, muss) dem Vater gehorchen, hat dem Vater gehorcht,
wird vom Vater geliebt ». A plus forte raison quand on passe aux syntagmes
serrés : « fünf Meter hoch, ein runder Tisch », et à la structure interne des
mots : « Tinten-fass, schnee-weiss, zurück-springen, Lehr-er, wunder-bar », etc.
Quant au français, tant qu'il a maintenu sa flexion verbale touffue et
sa déclinaison nominale à deux cas, les termes de la phrase ont conservé
une allure assez mobile ; ainsi le sujet (S), le verbe (V), l'attribut (A) et
l'objet (0) pouvaient se distribuer selon l'un ou l'autre de ces ordres SAV,
VAS, SVA, SOV, VOS, SVO. Cf. « Halt sont li pui. — Blanche at la
barbe. — Cordres at prise, les tors en abatiet, molt grand eschac en ont
sui chevalier » (Chanson de Roland). Mais il est remarquable qu'il préférait
déjà l'ordonnance SVA, SVO, commandée par la tendance progressive,
et que celle-ci a prévalu définitivement quand la phrase a renoncé
à sa mobilité première. On trouvera tout l'essentiel sur cet état de transition
dans L. Foulet, Syntaxe, IVe partie.209
La séquence progressive en français moderne :
généralités
327. Pour décrire en détail le développement de la séquence progressive
en français, il faudrait passer en revue la presque totalité de la syntaxe
et de la morphologie. Nous glisserons rapidement sur les faits connus
pour nous attacher plus particulièrement à ceux qui, tout en étant caractéristiques,
sont moins bien étudiés. On ne doit pas se dissimuler qu'en
portant toute son attention sur cette tendance remarquable, on risque
de donner une idée imparfaite de la construction française, qui est restée
souple, voire capricieuse, rebelle aux règles inflexibles, accueillante pour
les exceptions et les variétés susceptibles de rendre les nuances délicates
de la pensée : quelle est la différence entre « même les rois » et « les rois
mêmes », entre « Il ne m'a pas même salué » et « Il ne m'a même pas salué »,
entre « Il a seul échoué » et « Seul il a échoué », entre « encore plus » et « plus
encore » ? Considérez aussi la place mobile de souvent dans la phrase « Ces
nobles sentiments qui (souvent) ont (souvent) fait (souvent) faire (souvent)
de nobles actions ». Des cas semblables ne sont pas insolubles, mais
ils débordent le cadre de notre étude ; nous laissons à d'autres le soin de
voir comment ils s'accordent avec le phénomène général, sujet de cet
exposé 189.
328. L'ordre des mots dans la phrase allemande a, au contraire, ce double
caractère d'être variable et d'une variabilité réglée, au moins dans le
style de la prose courante ; le verbe occupe la seconde place dans la phrase
énonciative : « Der Winter kommt bald, Bald kommt der Winter », il est en
tête de l'interrogative « Kommt der Winter ? », en tête d'une principale
précédée d'une subordonnée : « Als die Feinde sichtbar wurden, befahl der
General den Angriff » ; les participes ; les infinitifs, les particules verbales
et la négation ferment la proposition : « Ich habe es gern getan, Ich werde
es gern tun, Er stellt sich mir vor, Ich verstehe diesen Satz nicht, Die
Kälte nimmt heute morgen nicht zu, etc. ». La place du verbe en fin de
phrase subordonnée (« Als die Feinde sichtbar wurden ») est un exemple
remarquable de cette réglementation, car cet usage n'était nullement obligatoire
en ancien allemand et ne s'est imposé que peu à peu.
329. Entre les séquences du français et celles de l'allemand, il y a une
autre différence générale : l'expressivité, reflet des mouvements émotifs
210de la pensée, appelle une construction plus libre et favorise l'anticipation.
L'allemand peut, grâce à la liberté plus grande dont il jouit, opérer ces
déplacements sans les marquer autrement que par l'accent d'insistance :
« Heiss ist ja die Sonne heute », « Dir will ich gehorchen », « Den Brief habe
ich nicht erhalten », etc. Le français n'ignore pas ces transpositions, mais
il doit, pour ainsi dire, les excuser par une syntaxe spéciale. On connaît
la périphrase « C'est … qui, c'est … que » ; ses valeurs sont sans doute
diverses, et, pour les différencier, on est bien obligé de recourir aux procédés
musicaux, accent et mélodie : « C'est à toi que je veux obéir. — C'est
un trésor que cet homme-là ». Dans « C'est une femme que j'aime », si l'on
accentue femme, le sens est « une femme et personne d'autre » ; si l'accent
repose sur aime, on insiste sur l'amour qu'on ressent pour elle. Dans « C'est
mon ami, qui sera content »), si l'on accentue les deux mots soulignés, le
sens est « Mon ami sera très content » (108). Mais malgré tout, la présence
de « c'est … qui, c'est … que » donne à ces tours un caractère spécifiquement
français.
En outre, la langue moderne use largement de la phrase segmentée
(79), qui donne à la syntaxe une grande liberté d'allure ; mais on
observera que le ou les termes détachés sont repris le plus souvent par
des représentants : « Cette lettre, je ne l'ai jamais reçue », « Moi, de
l'argent, à ce filou, je ne lui en donnerai jamais ». Cet artifice conserve
à la phrase proprement dite son armature ; la dislocation n'est que dans
la périphérie.
330. Autre différence enfin, qui n'est qu'une forme automatisée de la
précédente : aujourd'hui, le mouvement de la phrase n'est pas, en français,
radicalement autre dans la prose et dans les vers. Ce n'a pas toujours été
le cas ; le style poétique a longtemps autorisé des libertés que la langue
courante n'admettait plus. Mais les inversions admises par la poésie
classique sont aujourd'hui reléguées dans le magasin des accessoires, et
un poète qui risquerait, même s'il avait le génie de Racine, des phrases
telles que : « De festons odieux ma fille couronnée, tend la gorge aux couteaux
par son père apprêtés. — Tu pleures, malheureuse ? Ah ! tu devais
pleurer lorsque d'un vain désir à ta perte poussée, tu conçus de le voir la
première pensée », encourrait le ridicule. Si enfin beaucoup d'inversions
poétiques moins vieillottes ont une valeur expressive, elles l'ont indirectement,
à travers la convention littéraire, parce qu'elles rejoignent les libertés
de la langue parlée (99).211
La structure de la phrase poétique allemande jouit au contraire d'une
étonnante liberté, qui contraste singulièrement avec les règles imposées
à la prose. Des constructions telles que « Röslein rot », « aus deinen Augen
liebevoll », « die Liebste mein », « Ich weiss nicht, was soll es bedeuten »,
« Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen
und Gefahr », sont tout à fait habituelles dans les vers. Elles sont favorisées,
naturellement, par ce qui reste des flexions, et aussi par la magie
d'un rythme poétique plus varié et surtout plus martelé que celui du
français.
La séquence progressive dans la phrase
331. Passons rapidement en revue quelques types de phrase où l'anticipation
persiste encore en français, et voyons comment l'ordre inverse
cherche à la supplanter.
Aujourd'hui, la séquence progressive, on l'a vu, est de règle dans la
phrase énonciative simple. Le sujet se place devant le verbe 190, le verbe
devant l'attribut, le complément direct précède le complément indirect
et le complément circonstanciel : « Le soleil luit. La terre est ronde. Paul
donne un livre à son frère. Le guerrier tue son ennemi d'un coup d'épée,
etc. » Les parties d'un même terme ne sont pas régulièrement disjointes
comme en allemand : les constructions « Vous avez mon amour méprisé »,
« Maître Corbeau sur un arbre perché » sont définitivement abandonnées par
la langue d'aujourd'hui.
332. Dans toute interrogation, le terme sur lequel porte le doute est
le but de l'énoncé, le propos (tʼ) ; le reste en forme le thème, le substrat (t).
Psychologiquement, il est naturel qu'on donne la première place au tʼ,
qui est l'essentiel pour le parleur ; l'entendeur a, au contraire, intérêt à
savoir d'abord de quoi il s'agit avant d'apprendre à quoi il doit répondre.
Quel est le point de vue qui l'emporte ?
L'interrogation est, en général, plus émotive que l'énonciation positive ;
les tendances du parleur y sont au premier plan. De là la prédominance de
212l'ordre tʼt : « Qui a fait cela ? Est-ce Paul qui a fait cela ? » On voit, entre
parenthèses, que le sujet grammatical peut fort bien être le « prédicat
psychologique » (105).
333. Une seule position est définitivement acquise à la séquence progressive :
l'interrogation portant sur le verbe, plus exactement sur le mode
du verbe (35 2a). En ancien français, on disait encore « Est la viande preste ? »
pour « La viande est-elle prête ? ». L'allemand en est au même point : « Ist
das Essen bereit ? ». Mais cette construction, que certains linguistes attribuent
d'ailleurs à une influence germanique, a disparu du français moderne.
L'inversion des pronoms-sujets a persisté parce que ces syntagmes
sont serrés et que les pronoms ont reçu l'accent de groupe : « Viens-tu ?
Venez-vous ? », etc. Seul, je n'a pas pu conserver l'accent ; de là le déclin
du type « Viens-je ? », qui ne se maintient péniblement que dans la première
conjugaison : « Rêvé-je ? » et dans quelques verbes irréguliers : « Puis-je ? »,
surtout dans des formules toutes faites : « Que sais-je ? ». D'ailleurs
ces inversions perdent, en général, beaucoup de terrain dans le parler
journalier.
Le tour « Viendra ton frère ? » est remplacé par « Ton frère viendra-t-il ? ».
Il s'agit du resserrement d'une phrase segmentée encore usuelle : « Ton
frère, viendra-t-il ? » (avec pause médiane et mélodie descendante-ascendante
(83). Ainsi la forme condensée « Ton frère viendra-t-il » est le pendant
du tour populaire « Ton frère il viendra » (236). Mais l'inversion reste
gênante et fait en outre pléonasme. Aussi le peuple, depuis longtemps
(Rousseau en cite un exemple dans l'Emile), considère ce t-il (prononcé ti)
comme une particule interrogative et dit p. ex. : « Tu viens-ti ? »
Mais c'est l'emploi de est-ce que, sans inversion (« Est-ce que ton frère
viendra ? ») qui satisfait à toutes les exigences de l'ordre progressif, et
tend à remplacer les autres types.
Pourquoi l'interrogation modale (dite « totale ») est-elle en avance sur
les autres tours interrogatifs ? Il semble que l'analogie des interrogations
indirectes ait précipité le renversement. En face de « Viendra ton frère ? »
on disait « Dis-moi si ton frère viendra » ; l'équivalence de valeur a fait disparaître
la discordance de forme. De plus, l'intonation suffit à interroger :
« Ton frère viendra ? ». Ici, l'analogie de la phrase positive est encore plus
visible.
L'ordre direct attaque aussi les interrogations partielles (35 1a). Dans
le parler usuel, elles ont conservé la séquence tʼt ; mais à côté de la tournure
213classique, p. ex. « Combien cela vous a-t-il coûté ? », la langue parlée
en propage activement une autre : « Cela vous a coûté combien ? »
334. Dérivée, en grande partie, de la phrase interrogative, la phrase
exclamative en suit les destinées. Ainsi à côté de « Est-ce possible ! », on
trouve en langage populaire « C'est-ti possible ! » et « Si c'est possible ! ». Au
lieu de « Que de gens ai-je vus mourir ! » on préfère dire « Que de gens j'ai
vus mourir ! ». Quant au tour « Que de dangers n'a-t-il pas courus ! », il est
aujourd'hui purement littéraire.
335. En dehors de l'interrogation, l'inversion du sujet est de plus en
plus reléguée dans la langue écrite, où certains adverbes la traînent encore
après elles : « Peut-être pourriez-vous … (cf. Peut-être que vous
pourriez) ; Du moins faut-il observer que … Tout au plus pourrait-on
objecter que … En vain alléguerait-on que … Sans doute y a-t-il des
raisons pour … Aussi ne puis-je pas accepter vos arguments … Encore
faut-il savoir si … A peine peut-il marcher … (cf. [C'est] à peine s'il
peut marcher) ». Toujours est-il que est une locution cristallisée équivalant
à en tout cas 191.
Les incidentes (« dit-il, dit le père ») ne conservent l'inversion que dans
le style écrit ; le peuple préfère qu'il dit, que le père dit. On sait que cette
inversion résulte de la précession du complément d'objet, dans des cas
comme « Ce dit Roland » ; « Oui dit Roland » équivaut à latin « Hoc illud
dixit 292 » (J. Haas, Neufr. Synt., § 395, p. 454 ss.).
L'incidente « paraît-il, semble-t-il » est concurrencée par « à ce qu'il paraît,
à ce qu'il semble ».
Place du ligament
336. Tout prédicat ou dérivé de prédicat est relié au sujet ou au déterminé
par une copule ou un autre ligament qui forme avec le prédicat ou
le déterminant un syntagme dont la copule est le terme t (154). L'ordre
progressif demande donc que la copule soit en tête du prédicat et fasse
corps avec lui ; comme la place de S et t est devant P et tʼ, la copule
doit s'insérer entre S et P ou entre t et tʼ.214
Mais tel n'est pas nécessairement l'ordre originel. La grammaire a
d'abord consisté dans le simple agencement des mots, avec l'appoint de
la situation et de certains procédés instinctifs, tels que le geste et les
inflexions de la voix : oiseau-nid pouvait signifier selon le cas : « l'oiseau
est dans son nid, sort de son nid, construit son nid, etc. ». Puis, lorsque
la langue a créé un ligament pour tel ou tel type de phrase, la tendance
anticipatrice a pu le reléguer derrière le prédicat ou l'objet, dont il est
le déterminé. La langue des enfants donne volontiers la dernière place à
l'idée verbale : Papa bébé panpan « Papa m'a donné une fessée ». C'est cet
ordre aussi qui semble hérité de l'indo-européen, là où il existe encore.
C'est lui qui explique en particulier que les idiomes archaïques de cette
famille placent le verbe de préférence en fin de phrase, c'est-à-dire après
l'attribut, l'objet ou les compléments circonstanciels : cf. latin « Errare
humanum est. Asinus asinum fricat. Miles fortiter pugnat, etc. » ; ce qui
ne veut pas dire que cet ordre fût obligatoire.
Les autres ligaments obéissent à la même tendance ; ainsi la préposition
peut suivre son régime (319) comme c'est encore le cas en grec (« toû
thanátou péri »), en latin (« vobiscum, pectore tenus »), en allemand (« der
Gesundheit wegen »), mais presque jamais en français. « Tout l'été durant »
est une survivance à valeur ambiguë.
Le cas le plus important de postposition du ligament est offert
par les désinences casuelles ; placées après le radical, elles ont pour
fonction de rattacher celui-ci à un autre mot : Caesar-is amicus =
« L'ami de César ». Inutile de rappeler le déclin de la flexion en français
et le remplacement des désinences par des mots antéposés au sémantème.
337. Les signes grammaticaux sont pensés plus inconsciemment et prononcés
plus faiblement que les termes qu'ils relient. Le verbe ne fait pas
exception à cette règle ; dans la majorité des cas, il joue le rôle de copule
(copule d'accord ou copule de rection, pure ou lexicalisée, voir 165, 168),
ou du moins s'en rapproche. Si donc dans les langues indo-européennes
anciennes (sanscrit, grec, latin, etc.), le verbe se place de préférence en
fin de phrase, il ne s'ensuit pas, comme on l'a dit, qu'il fût plus fortement
accentué ; cela serait contraire au rythme baryton ou semi-baryton de ces
langues (325). En sanscrit védique, le verbe de principale est atone en
toute position non initiale ; c'est sans doute une généralisation de sa
fonction de copule. Si, dans cette même langue, le verbe de subordonnée
215est tonique, c'est peut-être parce que la subordonnée précède le plus souvent
la principale, et comporte une montée de la voix, comme c'est la
règle pour le terme A des segmentées AZ (82) 193.
Modalité et séquence progressive
338. La fonction logique de la modalité est d'exprimer la réaction du
sujet pensant à sa représentation (28) ; le signe modal est une copule qui
relie le dictum au sujet du modus (Galilée affirme que la terre tourne).
Mais on sait que l'expression la plus usuelle de la modalité est le mode
du verbe dictal. La tendance analytique doit amener à créer des formes
périphrastiques séparant l'idée modale du verbe qui exprime le procès du
dictum, et la séquence progressive demande que ces signes modaux précèdent
le verbe dictal. C'est bien ce que semble nous montrer l'évolution
du français. Cette évolution a un aspect négatif et un aspect positif.
D'une part, en effet, l'idée modale est contenue dès l'indo-européen,
ainsi que le temps, la personne, etc., dans la finale du verbe dictal. Mais
les désinences sont partout en recul en français. L'aspect positif du phénomène,
c'est la création de signes autonomes qui rendent l'idée modale et
qui sont placés devant le verbe du dictum.
339. L'indicatif est le plus conservateur de tous les modes, parce que
c'est le plus usité. Il est caractérisé, dès l'indo-européen, par un signe
modal zéro, déduit des autres signes modaux explicites. C'est cela surtout
qui fait croire que l'indicatif n'est pas un mode, alors que c'est le mode
par excellence, le seul que reconnaisse la logique.
Le français d'aujourd'hui supprime presque entièrement la flexion du
présent indicatif de la conjugaison vivante, celle en -er : pour l'oreille,
il n'y a qu'une seule forme verbale dans je, tu, il, elle, on, ils, elles marche(s,
nt). Les Ie et 2e du pluriel résistent mieux, grâce à l'analogie de l'impératif :
marchons, marchez 294. Mais nous marchons est de plus en plus remplacé
par on marche ; vous marchez, dans une de ses fonctions, est compromis
par le tutoiement, très fréquent dans le peuple. Pour les mêmes raisons
et de la même manière, l'imparfait unifie ses finales : je, tu, il, elle, on,
ils, elles marchai(s, t, ent).216
En revanche, l'indicatif français ne s'est pas encore créé un auxiliaire
modal comme l'allemand tun (« Trinken tut er » = « Ah ! pour sûr qu'il
boit ! »), et surtout l'anglais to do (« I do like that ! »), qui, il est vrai, sont
propres au langage expressif ; mais to do est obligatoire avec la négation
(I do not like), et en outre to do not a un concurrent expressif dans to fail
(« He failed to appear » = « Il ne se présenta pas »).
340. Le passé simple est le paradigme le plus touffu du mode indicatif ;
chaque personne a sa désinence propre, et ces désinences ont une physionomie
à part, surtout -âmes, -aies, -îmes, îtes, âmes, -ûtes ; le r de la troisième
pluriel est unique en son genre. Nous sommes à l'antipode de la
tendance à l'unification des finales. D'autre part, la forme du radical
dans toute la conjugaison morte (trois cents verbes environ) sépare le
passé simple du présent (peux : pus ; veux : voulus, etc.), ce qui est contraire
à la tendance qui pousse le français à l'invariabilité du radical. La première
du singulier, je marchai, risque de se confondre avec je marchais ; la distinction
maintenue par l'école (é fermé au passé simple, è ouvert à l'imparfait)
est inopérante ; quand un homme du peuple rencontre par hasard une
forme du passé simple (qui est entièrement étranger à sa langue), il le
prononce avec è par analogie avec l'imparfait.
Pour toutes ces raisons et d'autres encore, la langue parlée a totalement
éliminé le passé simple et l'a remplacé par le passé composé (j'ai marché),
où le signe modal, partie intégrante de l'auxiliaire, précède le participe,
contenant le dictum.
341. L'impératif (marche ! marchons ! marchez !) maintient ses positions ;
cela s'explique par la fréquence de son emploi et sa valeur expressive,
soulignée par une intonation adéquate. Mais il ne faut pas oublier que,
dès l'indo-européen, il était suppléé par le subjonctif à certaines personnes,
différentes selon les idiomes ; en français, à la première singulier et aux
troisièmes des deux nombres : « Que je meure si je mens ! qu'il(s) entre(nt) ! ».
Or, la particule que est obligatoire en français moderne (« Vienne le printemps »
est archaïque, et « Vive (le roi) » n'est plus un subjonctif ; ainsi
soit-il est une locution). C'est là un progrès de l'analyse, bien que la particule
que fasse double emploi avec les désinences : comme elle porte l'idée
modale, il est logique que cette particule précède le verbe. Remarquons
en passant qu'elle ne caractérise nullement le subjonctif de subordonnée,
qui n'est pas un vrai subjonctif (51) ; c'est pourtant ce qu'enseigne la
grammaire de l'école, qui fait ânonner un paradigme uniforme : « Que je
217marche, que tu marches, qu'il marche, etc. ». En fait, « que tu marches,
que nous marchions, que vous marchiez » sont des formes inexistantes,
puisque, en principale, on les remplace par « marche, marchons, marchez »
et qu'en subordonnée, p. ex. dans la phrase « Je veux que tu marches »,
que n'appartient pas au verbe, mais est un signe transpositeur montrant
que la phrase indépendante « tu marches » a passé à la fonction de subordonnée
(179). On sait que le subjonctif de subordonnée est lui-même
un instrument de transposition, et nous verrons (416) que sa flexion tortueuse
a bien de la peine à se maintenir, même dans le langage des gens
cultivés.
Enfin les auxiliaires modaux antéposés au verbe n'ont jamais manqué à
l'impératif, qui est une forme éminemment expressive ; cependant il est
rare que l'un d'entre eux ait totalement supplanté les formes synthétiques ;
on peut citer en latin « noli me tangere », en anglais « let us go », en français
« vous devez obéir », « n'allez pas vous refroidir », etc.
342. Le conditionnel est encore bien vivant ; il a supplanté les subjonctifs
imparfait et plus-que-parfait 195 ; alors que ceux-ci ont une conjugaison
compliquée, le conditionnel a subi la même unification partielle
des finales que l'indicatif imparfait (partout -rè, sauf aux Ie et 2e du pluriel).
La première du singulier est un peu ambiguë, parce qu'elle se confond
aisément avec la même personne du futur ; la grammaire classique enseigne
que le conditionnel a un è ouvert (je marcherè) et le futur un é fermé
(je marcheré) ; mais cette distinction est artificielle : aujourd'hui -ai(s) se
prononce ouvert dans les deux formes, comme autrefois il se prononçait
fermé. Cette ambiguïté risque de nuire au maintien des ces deux flexions.
343. Quant au futur, c'est avant tout un temps de l'indicatif, mais sa
valeur modale est très accentuée : l'idée d'avenir entraîne constamment
des mouvements émotifs. Aussi des périphrases du futur surgissent-elles
constamment, et l'on sait que plusieurs ont réussi, dans diverses langues,
à se substituer aux formes désinentielles (cf. all. « ich werde schreiben »,
angl. « I shall write » ; en grec moderne, thà [= thélō nà] grápsō« j'écrirai »
a signifié autrefois « je veux écrire »). En français, bien des concurrents
guettent la succession du futur traditionnel, p. ex. devoir : « Je dois partir
demain » ; aller : « Vous allez vous ruiner, si vous continuez à jouer » ; vouloir :
« Il veut pleuvoir demain » (populaire), etc.218
344. Enfin le français, comme toutes les langues indo-européennes, possède
un ensemble de tours modaux très expressifs, consistant en des
phrases exclamatives qui débutent par une expression modale impersonnelle.
En voici quelques exemples : « A quoi bon espérer ? ( — Il est inutile
d'espérer : affirmation découragée). — Dieu sait s'il s'est donné de la peine !
(= affirmation renforcée, protestation). — Que n'étiez-vous avec nous !
(affirmation accompagnée de regret). — Qui sait si l'on ne renoncera pas
à la guerre ? (supposition mêlée d'espoir). — Libre à vous de refuser (= Je
vous autorise à refuser). — (Vous voulez la faillite ?) Va pour la faillite !
(= J'y consens) ».
On trouvera facilement la nuance modale des formes suivantes : « On
dirait qu'il va pleuvoir. — Qu'importe le crime, si le geste est beau. — Voilà
ce que c'est que de faire des dettes ! — Adieu veau, vache, cochon, couvée ! Malheur
aux fauteurs de désordre ! — A bas les anarchistes ! — Vive le roi ! »
(37).
345. La négation exprime une notion modale : c'est un refus d'assertion.
« Le soleil ne tourne pas autour de la terre » équivaut à « Je (on) nie, il est
faux que le soleil tourne autour de la terre ».
Le français n'est pas arrivé à rendre la négation par un auxiliaire de mode
précédant le verbe dictal, comme l'a fait l'anglais : « The sun does not turn
round the earth ». L'ancienne négation ne, étant atone, est demeurée à
l'intérieur du groupe rythmique ; elle ne subsiste plus que dans des expressions
à demi bloquées et propres à la langue écrite : « Je ne sais. — Il ne
cesse (de causer), etc. ». Lorsqu'elle a été renforcée par pas et point, ces
mots se sont placés naturellement après le verbe, puisqu'ils étaient primitivement
des compléments d'objet ou de circonstance : « Il ne marche pas =
Il ne marche (un) pas ». Ils ont en outre fait oublier la valeur négative
de ne, dont ils avaient pris la fonction ; en sorte que la langue familière
supprime ne : « Je sais pas ». Ce passage de je ne sais à je sais pas marque
donc une victoire de la tendance progressive. D'ailleurs la négation modifiant
le mode du verbe, il est naturel qu'elle soit jointe à la partie fléchie
de celui-ci (« Vous [ne] comprenez pas », « Vous [n']avez pas compris »),
puisque c'est la désinence qui exprime le mode ; l'allemand, qui traite
nicht comme une particule séparable et le rejette à la fin du groupe (« Ich
verstehe diese Erklärung nicht »), offre ici un cas de disjonction (265).
Avec l'infinitif, qui transpose la phrase en terme nominal, la négation
forme un syntagme plus cohérent que la phrase indépendante, ce qui
219explique l'antéposition de pas et de point : « Il dit ne pas vouloir céder » ;
mais la construction inverse : « Il dit ne vouloir pas céder » est possible aussi.
Notons en passant qu'on nie les adjectifs et les substantifs par non et
in- : « non-valable, non-acceptation, in-attentif, in-attention », tous syntagmes
serrés où l'ordre tʼt, habituel aux préfixes, s'est maintenu.
Permutation des valeurs de deux coordonnées
346. Deux coordonnées, quel que soit le lien qui les unit, sont normalement
la suite logique l'une de l'autre ; on dit également bien « Il fait
froid, nous restons à la maison » et « Nous restons à la maison, il fait froid »,
« Ma vie a son secret, mon âme a son mystère » et « Mon âme a son mystère,
ma vie a son secret », « N'y touchez pas, il est brisé » et « Il est brisé, n'y
touchez pas » ; cf. 68.
Mais il est des cas où le sentiment d'une anticipation s'impose, et où la
première phrase n'est intelligible que grâce à la seconde. Par exemple,
la première renferme un représentant qui se rapporte à un terme de la
seconde, comme dans « C'est bien entendu : nous partons par n'importe
quel temps » ; ou bien, ce qui revient au fond au même, la première est
une apposition de la seconde : « Chose étonnante ! Paul a réussi ! » (« Chose
étonnante » = « C'est une chose étonnante »).
Le principe général posé § 324 montre comment cette anticipation se
produit : le parleur, se fondant sur une pensée qu'il n'exprime pas, se
borne à énoncer ce qui est essentiel pour lui : C'est bien entendu ! Chose
étonnante ! Mais, constatant que l'entendeur ne peut comprendre la raison
d'être de ces formules, il y ajoute, dans une seconde phrase, en manière
d'explication, le motif de l'énoncé : « Nous partons par n'importe quel
temps » — « Paul a réussi ». Or, cet ordre (propos + motif) n'est pas celui
qui se présente naturellement à l'entendeur ; pour lui, la première phrase
est un problème dont la seconde est la solution : « Qu'est-ce qui est bien
entendu ? Que nous partons » ; « Quelle est la chose étonnante ? Le succès
de Paul ». En sorte que l'interprétation se rapproche de celle de phrases
telles que : « Il est bien entendu que nous partons par n'importe quel
temps », « Il est étonnant que Paul ait réussi », où l'on passe nettement du
motif au propos.
347. Cette permutation des valeurs est caractérisée quand la première
phrase renferme un ou plusieurs signes qui ne deviennent intelligibles
220qu'après l'énoncé de la seconde, p. ex. le ce de « C'est bien entendu ».
Pour le parleur, c'est le représentant de l'idée qu'il a dans l'esprit sans
l'avoir encore exprimée ; pour l'entendeur, c'est, au contraire, une pierre
d'attente, un signal avertisseur. Autrement dit : la succession des deux
propositions, de régressive qu'elle était, devient progressive. L'usage a
consacré cette interprétation ; on ne comprend pas autrement des tours
tels que : « Je l'avoue : je n'entends rien aux mathématiques » et, avec un
représentant zéro : « Je sais : il y a des gens qui méprisent la religion ». On
notera aussi la forme populaire : « C'est ce que j'ai dit à Paul : tu as tort
de refuser ».
Permutation des valeurs d'éléments attributifs
348. L'ancienne langue, on l'a vu (326), tolérait encore des phrases tʼt
du type halt sont li pui, où l'attribut précédait le sujet. Il en reste quelques
traces dans la langue littéraire : « Nombreux sont les hommes qui … »,
« Maudits soient les incrédules » ; le parler expressif en offre aussi des exemples,
surtout avec copule zéro : « Finie, la comédie », « A la porte, les gêneurs ! »
etc. (mais ceux-ci sont compromis, cf. A bas les profiteurs [149]).
Il est curieux de constater comment la langue a redistribué ces tʼt
indésirables par permutation des valeurs (324, 2). Elle a fourni des prépositions.
Exemple : « Tout le monde paie, excepté les enfants » (les enfants
exceptés). « Excepté(s) les enfants » et « Les enfants exceptés » étaient des
phrases indépendantes, coordonnées à une autre (= « Les enfants sont
exceptés »). Elles y ont été incorporées : « excepté lés enfants » a suivi l'analogie
de « sans les enfants », etc. ; excepté est devenu une préposition. La même
explication vaut pour sauf, hormis, etc. Le participe et l'adjectif sont devenus
naturellement invariables ; cf. « vu les circonstances » — « Cinq francs
y compris la finance d'entrée ». Il y a encore hésitation pour « étant donné(es)
les circonstances » ; il n'y a en a plus pour « Passé la trentaine (= après) » ;
« Il a de l'argent plein ses poches (= dans ses poches) ».
La permutation en ttʼ nous vaut tout un stock de phrases expressives
où l'idée modale est représentée, à l'initiale, par une locution impersonnelle,
autrefois prédicative, p. ex. Vive le roi !, autrefois « Que le roi vive »,
aujourd'hui = « Honneur au roi, nous acclamons le roi, etc. » ; cf. A bas
les profiteurs !221
L'autre solution est offerte par le type « les enfants exceptés ». Dans
ce cas, l'attribut a pu conserver sa valeur (« la finance y comprise, la trentaine
passée ») ; ce sont des tours « absolus » compris comme des propositions-termes ;
ainsi « la trentaine passée » = « après que la trentaine est
passée ». Le tour est demeuré syntaxique, c'est-à-dire libre (160) ; car les
deux termes peuvent varier : « la ville prise, le roi mort, le danger passé, etc. ».
349. Quelques prépositions (t) sont issues d'un passage de tʼ à t (voir
324, 2), sans qu'on puisse remonter à des phrases pleines : « durant, pendant
le combat » = « le combat durant, pendant encore » ; « boire à même la bouteille »
= autrefois « boire à la bouteille même », aujourd'hui simplement
« à la bouteille » ; « parmi la foule » = « par la foule divisée en deux », actuellement
« dans la foule » ; en plein marché, en pleine rue » ne signifient plus
« dans le marché qui est plein » mais simplement « au milieu du marché », etc.
Des adverbes ont pu naître de semblables renversements de valeurs :
p. ex. ci-inclus, ci-joint sont invariables quand ils précèdent le substantif
(p. ex. « Veuillez trouver ci-inclus votre facture ») ; c'est que ci-inclus a pris
le sens de « ici, dans ce pli ». Des adverbes « courts » comme haut, bas, etc.
sont d'anciens adjectifs qui ont pris leur nouvelle valeur par ce biais ;
cf. « mettre bas les armes », littéralement « les armes de manière qu'elles
soient basses » ; « porter haut la tête », à côté de « porter la tête haute », etc.
Des conjonctions subordinatives, donc à valeur t, sont parfois d'anciens
termes prédicatifs (tʼ), p. ex. tant dans « J'ai les doigts engourdis, tant il
fait froid » ; le sens ancien était « Il fait tant froid = si froid » : actuellement,
ce tour prend le sens de « parce qu'il fait très froid ».
Plus récemment, tel a pris à peu près la signification de comme : « II
souffle bruyamment, tel un phoque » ; le sens étymologique était « un phoque
est tel (tʼ) », mais l'interprétation en ttʼ l'assimile à comme un phoque, d'où
parfois invariabilité (tel une baleine).
Citons encore : « Il doit être ruiné, témoin les créanciers qui assiègent sa
porte ». L'interprétation « les créanciers en sont un témoignage (tʼ) » est
oubliée au profit de « à en juger par (t) ».
Place de la conjonction coordinative
350. D'après ce qui précède, il est clair que la place de la conjonction
coordinative est entre C1 et C2 ; mais cet ordre, devenu habituel dans nos
langues, n'y est pas obligatoire : dans les idiomes plus archaïques, les ligatures
222grammaticales sont considérées d'abord comme une sorte de luxe (336)
et sont souvent reléguées à l'arrière-plan. D'après Finck, Haupttypen des
Sprachbaus, p. 42, on dit, en grœnlandais : « Les ennemis furent vaincus,
la paix fut conclue et ». Comparez la place de *-kwe « et », *-we « ou » en indo-européen ;
le latin a encore des tours tels que Venit vicitque « il est venu
et il a vaincu », quod fuimus sumusve « ce que nous avons été ou sommes
encore » ; en latin classique, enim et autem ne peuvent jamais occuper la
première place. Mais ces particules se placent déjà après le premier mot
du second membre : « senatus populusque romanus ». Enfin des conjonctions
plus récentes, et différentes selon les langues, ont adopté l'ordre commandé
par la séquence directe : lat. et, grec kaí, ancien perse utā, gotique jah
(encore en concurrence avec l'enclitique -uh).
Dans les langues modernes, disions-nous, l'antéposition de la préposition
coordinative n'est pas absolue : « Paul m'a offensé ; je ne lui en veux pourtant
pas » (all. « ich nehme es ihm jedoch nicht übel ») ; mais toutes nos coordinatives
peuvent occuper la première place, et certaines doivent l'occuper
(comme mais, et, ou en français). Quant à la fréquence de la postpostition
et surtout de la postposition lointaine, l'allemand diffère du français, où
la postposition est plus rare et moins prononcée (cf. la place de aber dans
« Dièse mehr negative als positive Kritik vermag aber nicht, die falschen
Methoden zu verdrängen »).
On a étudié plus haut (94) l'origine de la conjonction coordinative.
Cette question intéresse celle de la séquence progressive, car on se rappellera
que cet outil grammatical est né de la permutation des valeurs d'un
syntagme tʼt devenant ainsi ttʼ.
Séquence progressive dans les subordonnées
351. Une proposition subordonnée est la transposition d'une phrase
indépendante en proposition-terme, c'est-à-dire en terme de phrase (sujet,
complément d'objet direct ou indirect, complément circonstanciel, complément
du nom) : cf. « (Je crois) que vous avez tort ; (Nous partirons) quand
vous voudrez ; (Paul est un homme) que j'estime, etc. ». Une proposition-terme
est naturellement plus resserrée que la phrase indépendante qui lui
correspond (Vous avez tort, je l'estime, etc.). Il est donc à prévoir (319)
qu'elle résistera un peu mieux que l'indépendante aux innovations. On a
remarqué que dans les langues classiques, la structure des subordonnées
223est moins libre que celle des phrases indépendantes. M. Behaghel 196 admet
qu'en i.-e. le verbe était plus souvent final en subordonnée qu'en principale ;
M. H. Frisk 297 a fait la même constatation à propos des prosateurs attiques.
Chez Tacite également, le verbe est plus souvent final en subordonnée
qu'en principale 398. En ancien français, la construction SOV : « Li rois le
peuple aime », rare en indépendante, était un peu plus fréquente en subordonnée :
« Si cum om per dreit son fradre salvar dift » 499.
352. Le français moderne construit de plus en plus la subordonnée
comme l'indépendante ; la langue écrite pratique encore des inversions telles
que « le livre que m'a donné mon père, — là où vit mon ami, — lorsque s'accomplissaient
ces événements, — quand reviendra le temps des cerises, quelque
riches que vous soyez, — si précaire que soit la situation » ; mais
elles sont reléguées dans la langue écrite et ne sont plus possibles si le
verbe a un complément : « Le livre que le maître a donné à l'élève ».
On sait qu'au contraire l'allemand s'astreint à placer le verbe des subordonnées
à la fin (influence du latin ?), ce qui suppose anticipation des
prédicats et des compléments : « dass du gesund bist, — da du das getan
hast, — welcher in dieser Stadt wohnte, etc., etc. ». C'est tomber d'une
inversion dans l'autre que de dire « als wäre ich schuld daran » au lieu de
« als ob ich daran schuld wäre ». Cependant le style indirect rapproche
l'énoncé de celui de la phrase indépendante : « Ich denke, du bist verrückt »
fait concurrence à « dass du verrückt bist ».
353. La phrase relative présente un obstacle sérieux à l'ordre progressif,
parce que le pronom relatif qui l'ouvre peut assumer non seulement la
fonction (normale pour ttʼ) de sujet, mais n'importe quelle autre, qui suppose
par conséquent une anticipation ; comparez « J'ai vu cette personne »
et « la personne que j'ai vue », « J'ai parlé de mon ami au ministre » et « l'ami
dont j'ai parlé au ministre », etc.
L'usage correct n'a pas éliminé cette discordance ; mais le langage populaire
s'y essaie. Tantôt, par croisement avec la phrase indépendante, il
double le relatif d'un représentant qui a la place qu'il occuperait en phrase
libre ; le pronom personnel, bien qu'antéposé, est plus rapproché du verbe :
« La journée dont il en gardera longtemps le souvenir », « le toit où il s'y
était perché » (syntaxe usuelle en roumain) ; tantôt il réduit le relatif à
224une particule passe-partout que (138) : « une femme que son mari est mort
à la guerre », « une femme que j'ai parlé à son mari ». Il est probable que,
même dans le type « un ouvrier qui n'a pas de travail », qui est interprété
par le peuple comme valant qu'i(l) : il renferme le même que uniforme
(cf. G. Cuendet, Mélanges Bally, p. 93 ss.).
Groupes prépositionnels :
genèse de la préposition et du préverbe
354. Les prépositions et les préverbes ont été, à l'origine, des adverbes
modifiant, complétant, précisant le sens, soit du nom, soit du verbe.
Ils avaient donc la fonction tʼ.
Soit la phrase grecque óreos káta baínō « Je marche — en bas — loin de
la montagne ». Selon les cas, on groupait en bas avec « je marche » ou bien
avec « loin de la montagne ». Puis ces groupements, sous l'influence de
mots simples de sens analogue, se sont resserrés et sont devenus usuels.
Alors p. ex. káta baínō prend le sens global de « descendre » ; káta, le préverbe,
reste d'abord distinct du verbe (c'est encore le cas chez Homère),
mais il se place plus volontiers devant lui qu'après. Si, au contraire,
c'est óreos et káta qui sont attirés l'un vers l'autre, deux possibilités se
présentent, suivant que le sentiment de la désinence du substantif est
fort ou faible : dans le premier cas, on aperçoit dans káta un moyen de
la renforcer en la doublant ; l'adverbe s'amalgame avec la finale ; c'est
ce que l'on constate p. ex. en ombrien (fratrusper = « pro fratribus »).
Le résultat final est une désinence complexe qui se simplifie par la suite.
355. Si, au contraire, la désinence est faiblement sentie, l'ancien adverbe
en prend la valeur et tend à se substituer à elle. C'est là l'origine de la
vraie préposition. Elle se plaçait autrefois plus souvent derrière le substantif
que devant lui (anticipation !). Ainsi le type grec óreos káta se
rapproche sensiblement du simple óreos. Mais il est doublement irrationnel :
1) comme káta tient lieu de désinence, celle-ci a de moins en moins sa
raison d'être ; pourtant sa disparition s'opère très lentement en indo-européen ;
le français l'a éliminé, l'allemand en conserve encore tout un
arsenal ; 2) la désinence casuelle étant le déterminé de son radical, il est
contre nature qu'elle suive son déterminant : la tendance progressive va
profiter de la mobilité de la préposition pour la placer devant son régime.225
356. La distance qui sépare le français de l'allemand est ici très grande ;
en français, et déjà en latin, la séparation du préverbe et de la préposition
est consommée ; le préverbe, loin d'être détachable, fait corps avec le
radical (survenir) ; la préposition, qui a chassé les désinences casuelles,
se place presque toujours devant son régime (pour mon ami, vers la ville,
etc.).
L'allemand, lui, reflète toutes les étapes du développement.
1. On ne sait pas toujours si l'on a affaire à un préverbe ou à une
préposition, p. ex. dans « dem Spiegel gegenüber stehen » ; ou bien la différence
est réelle, mais subtile ; comparez « Die Phantasie zaubert mir das
Glück vor » et « zaubert das Glück vor mir (hervor) ».
2. Le même mot peut figurer, avec les deux fonctions, dans un même
syntagme : « durch den Wald durchdringen ».
3. Le préverbe, caractérisé comme tel, est détachable, comme en grec
homérique : « Er liest den Brief durch ».
4. Le préverbe est soudé au radical (« die Wärme durchdringt den Körper »),
comme en grec attique.
5. La préposition est caractérisée comme telle, mais elle peut ou doit
suivre son régime : « dem Ufer entlang, den Tag hindurch, einen ganzen
Frühling über, meiner Meinung nach », etc.
6. Enfin — cas de beaucoup le plus fréquent — la préposition précède
son régime, mais celui-ci est encore fléchi : während des Krieges, vor dem
Tore, etc.
Le dernier stade, celui du français (préposition régissant le substantif
sans désinence), n'est pas représenté en allemand, sinon dans les tours
de style télégraphique tels que wegen Krieg, qui appartiennent au jargon
commercial.
Place des actualisateurs
357. Les actualisateurs sont d'anciens termes de phrase qui ont changé de
fonction par condensation de la phrase en terme (151). Ce livre remonte à une
phrase à copule zéro (252) qui correspond p. ex. à lat. illic liber « Ici est
un livre, Voici un livre » ou « Le livre est ici », puis à un terme signifiant
« le livre (qui est) ici », « le livre (que) voici ». De même mon livre équivaut
à « le livre de moi » et remonte à une phrase telle que gr. tò biblíon emoû,
avec le sens de « le livre est à moi ».226
Les actualisateurs de substantifs sont donc originairement des termes
liés (logiquement) en rection avec leur déterminé. C'est postérieurement
seulement qu'ils ont adopté en indo-européen la syntaxe d'accord : latin
ille liber, liber meus.
Le sanscrit donne une idée de l'état primitif dans le tour tatra nagare,
littéralement « là dans la ville », puis « dans la ville qui est là », qui a le
même sens que tasmin nagare « dans cette ville ».
358. Une innovation conforme à la fois à l'ordre direct et à la valeur
rectionnelle de l'actualisateur demanderait qu'il suive, en rection, l'actualisé.
Si le français a résisté à cette double tendance, c'est que les actualisateurs
sont atones et en contact étroit avec le terme suivant ; le rythme
oxyton a maintenu l'ordre ancien contre la tendance syntaxique moderne
(317).
Cependant les exemples de rection ne sont pas introuvables. Le latin
offre, à côté de suus liber, liber ejus (eorum, earum), structures dont l'une
est en accord, l'autre en rection. Pour se rendre compte de l'emprise de
l'accord sur la rection dans ce cas, on pensera au bas-latin illorum liber,
qui a repris l'accord en français sous la forme leur/leurs ; cet accord est
encore senti, puisqu'on prononce « leurs-z-enfants ».
Le langage expressif montre comment la rection et l'ordre direct pourraient
s'établir. Ainsi les démonstratifs sont étoffés de différentes manières
qui font apparaître l'idée déictique après le substantif, soit partiellement
(« cette maison-ci, cette maison-là, ce livre là-bas »), soit totalement
(« la maison que voici, les exemples ci-dessus », all. « das Buch dort »).
De même pour le possessif : « son père à lui, un ami à moi » (cf. angl.
« a friend of mine »). Le grec ancien disait déjà ho oîkos mou « ma maison »,
à côté de ho emòs oîkos (tour que le grec moderne a abandonné au profit
du premier). Le persan moderne place toujours le mot possessif après le
nom : aspi man « mon cheval ».
359. Remarque. On observe un cas de transvaluation en tʼ dans les
titres ou autres déterminations précédant les noms propres et leurs équivalents,
p. ex. dans « Sa Sainteté le pape, Monseigneur Duchêne, l'orateur
Cicéron, Monsieur le ministre, Monsieur Dupuis, et même Charles Lenoir ».
En effet, tous ces cas se ramènent à d'anciens groupes coordinatifs où
le second terme expliquait et complétait le premier (apposition, voir 74) :
« Sa Sainteté, c'est-à-dire le pape ; l'orateur (je veux parler de) Cicéron ;
Charles (je pense à celui qui est noir), etc. ». Mais ces groupes, une fois
227condensés, ont interverti les valeurs de leurs termes ; l'exemple le plus
frappant est le dernier, car « Charles Lenoir » signifie actuellement « celui
des Lenoir qui a pour prénom Charles », et se distingue par là de « Henri
Lenoir », etc. Autrement dit, tous ces premiers termes sont des actualisateurs
(« Monsieur le ministre » équivaut à « Le ministre que nous connaissons
et que je désigne poliment par le titre de Monsieur »), et, en qualité
d'actualisateurs, ils sont des termes tʼ. Ces précisions sont, il est vrai,
passablement voilées par le fait que les groupes en question sont usuels
et quasi agglutinés.
Un cas voisin est celui de l'article précédent un nom propre : la Voisin
(style juridique), la Marie (populaire), le Dante (italianisme). Le rôle de
cet article est le même que dans les exemples précédents, celui d'un actualisateur.
360. Quant aux syntagmes engendrés par l'actualisation explicite (131),
il est naturel qu'ils donnent prise à la progression, car ce procédé crée
des éléments beaucoup plus mobiles, variables d'un cas à l'autre de la
parole. Il y a donc, sous ce rapport, une assez grande différence avec
les syntagmes virtuels ; « fils de fonctionnaire » est plus serré que « le fils
de ce fonctionnaire ».
Il s'ensuit que les langues modernes, français et allemand y compris,
ont plié les actualisés explicites à l'ordre direct. Il y a longtemps qu'un
tour tel que li rei gonfalonier « les gonfalonniers du roi » (cf. li Deo inimi,
al Saint Denis mostier) a disparu, supplanté par le type l'espee Roland
(l'on sait en effet que cette syntaxe n'est possible qu'avec un actualisé
comme déterminant, cf. l'espee le rei), et par le tour plus moderne l'épée
du roi. Des inversions telles que « du Dieu vengeur la foudre meurtrière »
appartiennent à la syntaxe poétique conventionnelle (330). A plus forte
raison l'actualisateur suit l'actualisé quand il est une proposition-terme :
« l'homme dont je parle ».
L'allemand en est à peu près au même point que le français : le type
« desVaters Haus, des Meeres und der LiebeWellen » est un archaïsme poétique
et dialectal, le tour« dem Vater sein Haus » est, lui, dialectal et populaire ; « der
Rede kurzer Sinn » et beaucoup d'expressions analogues sont des clichés stéréotypés.
Seul le nom propre au génitif peut encore précéder son déterminé :
« Schillers Werke » et « die Werke Schillers ». L'allemand a aussi un type
syntaxique calqué sur le français : der Fall Wagner, cf. fr. l'affaire Clemenceau.228
Place des quantificateurs
361. Logiquement, tout quantificateur indique une partie d'un tout (115
II a) : cf. « la moitié d'une pomme, deux de nos soldats, deux soldats (= deux
parmi tous les soldats), des soldats (= une partie indéterminée de tous les
soldats) » ; cf. un peu de vin, de l'or (— une certaine quantité de tout l'or
existant). Par analogie, la totalité semble être considérée comme un cas-limite
de la partie : « tous les soldats = la totalité des soldats » (cf. angl.
all of it, all of you).
C'est la partie qui est l'objet dont on parle, le déterminé ; le tout est
le déterminant. Un quantificateur est donc (logiquement) le t du quantifié,
le tʼ désignant le tout ; t et tʼ doivent (logiquement aussi) constituer
un système de rection ; en outre, l'ordre progressif doit tendre à placer
le quantificateur avant le quantifié. Ainsi les actualisateurs sont des déterminants,
les quantificateurs des déterminés.
Cette opposition est le plus souvent masquée 1) parce que l'actualisateur
et le quantificateur se trouvent en cumul dans un seul signe ; 2) parce
que le tout dont on prend une partie est souvent traité en accord au lieu
de l'être en rection. Dans deux de nos soldats, il y a fusion de l'actualisateur
et du quantificateur (deux = certains au nombre de deux), mais
la rection est observée ; dans ces deux soldats, actualisateur et quantificateur
sont distincts, mais soldats est accordé et non régi ; enfin deux soldats
présente l'une et l'autre anomalie.
362. Les langues indo-européennes sont fort éloignées du traitement
idéal, et pour trois raisons : la flexion, l'accord et la construction mobile
des mots. Le mode usuel de quantification est la distinction du singulier
et du pluriel, exprimée par des désinences (latin lupu-s, lup-i, etc.) ;
puis les quantificateurs autonomes (trois, quelques, plusieurs, etc.), du
moins ceux qui se déclinaient, étaient accordés avec le substantif :
« tres, aliqui milites » ; enfin leur place n'était pas fixe (très partes,
partes tres).
Si les langues indo-européennes, ici comme ailleurs, négligent la flexion
et la remplacent peu à peu par des déterminatifs préfixés, en revanche,
elles maintiennent en général l'accord. En français, le singulier et le
pluriel sont signifiés, en accord, par l'article défini, l'indéfini, le partitif,
les possessifs, etc. : « Le loup, les loups, un loup, des loups, du vin, mes
amis, etc. »229
La rection a tenté, dès l'indo-européen, de pénétrer dans les groupes
quantifiés. En latin on dit mille homines, mais duo milia hominum, multi
milites, mais multum vini ; cf. russe odín mujík « un paysan », tchetïre
mujikí « quatre paysans » (accord), mais pʼatʼ mujikóv « cinq paysans »
(rection).
Le collectif, où le rapport entre la partie et le tout est plus sensible,
observe la rection : « une centaine d'hommes, un trio d'amis, une paire de
bas, etc. » et peut influer sur l'interprétation du pluriel.
Il est vrai que l'influence inverse se manifeste aussi, puisqu'on peut
dire : « une centaine d'hommes, une foule d'hommes, la plus grande partie
des hommes ont péri », et que le pluriel est obligatoire avec « la plupart,
nombre, quantité, beaucoup d'hommes », tours qui relevaient primitivement
de la rection.
Place des représentants
363. On sait (317) que le rythme oxyton oblige les éléments atones à
être intérieurs de groupe, même s'ils sont déterminants. C'est le cas de la
plupart des représentants dits « conjoints » : « Je le vois, j'y vais, j'en suis,
etc. », tandis que les représentants « absolus », étant toniques, peuvent terminer
la mesure rythmique ; comparez « je vous estime » et « je fais grand cas
de vous » ; « je le sais » et « je sais cela ». Dans « regardez-le », le est tonique.
364. Certaines gênes du fonctionnement montrent qu'il y a discordance
entre rythme oxyton et séquence progressive ; la langue y répugne, mais
elle n'a pas trouvé de solution. Ainsi le participe passé et l'adjectif n'admettent
pas la préfixation de en et y : « un bras couvert de sang » n'autorise
pas « un bras en couvert » ; comme on ne peut dire non plus « couvert de
lui » (ce qui ferait du sang un être animé), la langue est dans une impasse ;
en parlant de l'estomac, on ne dit pas « les aliments y ingérés ». L'expression
« les documents y relatifs » est archaïque ; « y compris » est locutionnel.
Le participe présent prédicatif permet encore qu'on dise (p. ex. en parlant
des ennemis) : « Les voyant approcher, le général commanda la charge »,
mais le participe épithète s'y refuse ; « un enfant négligeant ses devoirs »
ne peut guère être repris par « un enfant les négligeant », bien que certaine
230prose, surtout administrative et technique, tolère des tours tels que : « une
affirmation sans preuve l'autorisant », « l'interaction du milieu et des organismes
y vivant ». Cela est très dur.
Le datif de la personne intéressée n'existe que sous la forme de pronom
atone, et, naturellement, précède le verbe : « Je vous retiendrai une place »,
« Je lui ai obtenu un emploi » ; le substantif correspondant n'a pas la même
structure ; on ne dit pas « Je retiendrai une place à Paul », mais plutôt
pour Paul. Il y a aussi discordance entre « On lui passe devant, on lui
marche dessus » et « On passe devant un inférieur, on marche sur un ennemi »,
entre « Je lui ai saisi la main » et « J'ai saisi la main de mon ami ». Sur ces
faits, voir Festschrift Louis Gauchat, p. 72.
365. Le traitement des représentants après prépositions se complique
du fait que le français distingue ici entre le genre animé et l'inanimé.
Avec une préposition indiquant une position ou une direction, le représentant
explicite désigne un être animé ; l'inanimé est représenté en
cumul ou par ellipse (225, 245). Ainsi l'on dit « Le soldat, apercevant son
ennemi, s'élance sur lui », mais « Le chat s'approche de la table et saute
dessus ». De même « Le chien court vers son maître et gambade autour de
lui », mais « Il s'élance vers la table et gambade (tout) autour ».
Pour représenter un nominal inanimé, la langue a conservé des tours
archaïques en tʼt. Au lieu de « sur cela, sous cela, dans cela, contre cela »,
on dit là-dessus, là-dessous, là-dedans, là-contre. Mais cet usage est attaqué,
et on lit de plus en plus fréquemment (p. ex. à propos du cinéma) : « Le
théâtre ne peut pas lutter contre ça ».
Caractérisation et séquence progressive
366. En abordant cette question, on se rappellera les vues générales
qui nous ont guidé jusqu'ici : toutes choses égales d'ailleurs, la rection
est plus libre que l'accord (173) et, par suite, plus apte à adopter l'ordre ttʼ ;
d'autre part, la liberté relative est plus favorable à la fixation en ttʼ que
la liberté absolue (320). Dans la comparaison avec l'allemand, on se souviendra
de la tendance de cette langue à conserver l'ordre anticipateur.
Ainsi en français, les mots caractérisés par rection sont tous en ttʼ ;
l'allemand est en retard, il oppose « fünf Meter lang » à « long de cinq mètres »,
231« vor Hunger sterben » à « mourir de faim », etc. Les composés allemands
sont en tʼt, les français en ttʼ (378 ss.). Les groupes épithétiques d'accord
sont constamment tʼt en allemand, moins souvent en français : « düstere
Wolken : nuages sombres et sombres nuages », « (er hat) furchtbar gelitten :
(il a) horriblement souffert et souffert horriblement ».
L'adjectif épithète français appelle quelques observations.
a) Place de l'adjectif épithète
367. Régulièrement antéposé en allemand, et fréquemment en ancien
français, il est de plus en plus postposé en français moderne. Mais cette
tendance est loin d'avoir conquis toutes les positions.
On nous dispensera de reproduire ici le détail de la question. On sait
que l'adjectif suit le nom quand il spécialise le concept et l'oppose à
d'autres ; cheval blanc, par opposition à cheval noir, etc. L'ordre inverse
prédomine, au moins dans la langue littéraire, quand l'adjectif décrit
plus qu'il ne définit, quand il concentre l'attention sur la qualité en elle-même,
plutôt qu'il ne l'oppose à d'autres. De là aussi la valeur subjective,
appréciative, de l'adjectif antéposé. La qualité vraie cède le pas à l'intensité
de l'impression : « une large vallée » a quelque chose d'exclamatif ;
un magnifique tableau est un écho de la phrase à un membre (Magnifique !)
et de la segmentée (Magnifique, ce tableau !). Il s'ensuit que, contrairement
au rythme oxyton, l'accent de groupe passe volontiers sur l'adjectif,
et, conformément à une règle générale du langage affectif, se pose sur la
première syllabe commençant par consonne : « Une formidable explosion,
un abominable attentat ». Mais comme cette accentuation affective est possible
aussi avec l'adjectif postposé (une explosion formidable), la langue
courante peut se dispenser de l'inversion et marquer l'émotion par l'accent
seul.
Car l'antéposition est de plus en plus abandonnée par la langue parlée.
Mais, par instinct d'opposition, la langue littéraire s'y attache d'autant
plus, et met une sorte de coquetterie à pratiquer l'inversion, même sans
raison valable : « une démocratique institution, les jumelles tours de Notre-Dame »
(Th. Gautier).
368. Dans cette question délicate interviennent encore des considérations
de rythme. Le français évite, on le sait, la succession de deux syllabes
232accentuées dans le même groupe rythmique ; cette tendance est
d'autant plus accusée que les syllabes sont ouvertes, et que, étant ouvertes,
elles sont brèves (444). En effet, une syllabe brève est peu propre à porter
l'accent tonique, déjà si faible en français. On dit foll(es) dépenses, mais
non fous frais ; moll(e) couche, mais non mou lit ; laid visage, mais non
laid nez ; long mot est possible peut-être parce que long comporte un certain
allongement. De même grands mots.
Quand l'adjectif antéposé a plusieurs syllabes, le substantif monosyllabe
suivant peut être toléré grâce au déplacement d'accent (voir plus haut) :
« un vilain mot ».
Mais il faut encore tenir compte des restrictions imposées par la monotonie
de la syllabation française, qui crée soit des ambiguïtés (un laid mot)
allant jusqu'au calembour (un mot laid), soit des rencontres de sons
désagréables à l'oreille : un sec coup, un vif feu, etc. (563 ss.).
369. Certaines formes de syntaxe rectionnelle (et par conséquent progressive)
font concurrence aux syntagmes épithétiques et, par suite, à
l'épithète antéposée. Au lieu de « affaire importante », le français dit aussi
« affaire d'importance » ; « bijou de valeur » ou « de prix » remplace volontiers
« bijou précieux » (cf. « morale de convention »). La faveur de ces tours est
accrue par la prédilection du français pour le substantif (591). La langue
littéraire va jusqu'à dire « jardin de beauté » pour « beau jardin ». D'une
façon générale, la facilité des échanges catégoriels crée aussi des groupes
à compléments prépositionnels : « devoir à accomplir, faute à corriger,
exemple à imiter, merveille sans précédent, beauté sans égale » (cf. l'expression
populaire et incorrecte : « occasion à profiter »). Dans tous ces cas, un
renversement des termes est exclu, et l'ordre direct est assuré.
370. Enfin on sait que, à côté de « s'enfoncer dans les épais taillis » on
trouve « s'enfoncer dans l'épaisseur des taillis ». Ce type satisfait à la fois
la séquence chère au français et son goût prononcé pour le substantif ;
mais ce procédé a deux points faibles : il est purement littéraire, et il est
guetté par la permutation des valeurs, qui le ramène au schéma tʼt. En
effet, le parler courant glisse de cette forme de syntaxe à une autre, où
le premier des substantifs reprend une valeur d'adjectif : « une énormité de
maison, une splendeur de tapisserie » sont bien près d'équivaloir à « une
énorme maison, une splendide tapisserie », surtout quand le nom abstrait
est remplacé métaphoriquement par un concret qui symbolise la qualité :
« un bijou d'enfant, un diable d'homme » ; de là, dans l'usage populaire,
233des changements révélateurs de la permutation des valeurs, p. ex. « une
diable de femme, cette monstre de femme, un espèce d'idiot » ; on peut
même appliquer cette tournure à des adjectifs ordinaires, pourvu qu'ils
puissent passer pour substantivés : « cette folle de gamine ». Dans « une drôle
d'histoire » drôle est senti comme adjectif, bien qu'il ait conservé à côté
de lui le substantif dont il dérive implicitement : un drôle. Bref, dans tous
ces cas, la construction régressive a repris ses droits.
371. Mais l'adjectif antéposé peut aussi subsister en changeant de catégorie
et en prenant la valeur de mots qui précèdent normalement le substantif.
La séquence adjectif + substantif est, comme nous l'avons vu, essentiellement
littéraire ou légèrement archaïque. On sait que l'archaïsme conduit
à l'agglutination (217). Celle-ci peut aboutir à former des mots simples ;
dans le cas qui nous occupe, c'est ce qui est arrivé à blanc-manger, sagefemme,
rouge-gorge, rond-point, verjus, etc. Mais un autre résultat est possible ;
avant que la fusion des éléments soit achevée, le syntagme en voie
de resserrement peut subir l'analogie d'un type syntagmatique différent,
qui le transforme à son image (222).
372. De cette évolution, je relève deux cas qui concernent l'adjectif :
l'imitation des mots préfixaux, et celle des syntagmes d'actualisation.
a) L'adjectif antéposé — nous l'avons vu — ajoute presque toujours à
la qualité une nuance appréciative, c'est-à-dire qu'il exprime le plaisir ou
le déplaisir, implique l'éloge ou le blâme. Ces nuances peuvent prendre
le dessus ; le sens définitionnel est relégué dans la coulisse : « un vrai régal,
un faux air d'honnête homme, un brave enfant, un triste résultat » ; il
peut même disparaître ; cela est fréquent dans les formes allocutives :
« Petite mère ! Sale gosse ! ». Un vieil ami peut être très jeune. Ces adjectifs
sont généralement très courts et peuvent d'ailleurs subir, surtout dans
la langue populaire, des abrègements : « 'tit enfant (pour petit), pauv' femme,
cré(e) saleté de guerre (pour sacrée) ».
Ils prennent finalement la valeur de préfixes augmentatifs ou diminutifs,
laudatifs ou péjoratifs, et remplacent les suffixes de même signification
(« maisonnette, prêtraille, etc. »), que le français n'emploie plus systématiquement
(397) ; voir Brunot, PL. p. 639 ss. On remarquera que, comme les
suffixes appréciatifs de certaines langues (italien, etc.), ils peuvent être
accumulés sur un même mot : « grand beau garçon, bonne grosse plaisanterie,
pauvre chère vieille maman ». Comme tous les préfixaux (383 ss.),
234ils peuvent s'agglutiner avec le substantif et équivaloir à des mots simples :
ainsi bonne femme équivaut à « femme » dans le parler populaire ; petite
femme désigne une femme légère, bonhomme a pris pendant la première
guerre mondiale le sens de soldat, etc. Or, dans tous ces cas, c'est l'analogie
des préfixaux qui maintient l'ordre tʼt, parce que les préfixaux sont
encore assez vivants pour s'imposer comme modèles (381).
373. b) L'adjectif antéposé a parfois un sens voisin de celui d'un déterminatif
ou d'un quantificateur dont il occupe la place ; ces deux circonstances
finissent par le confirmer dans cette fonction, à laquelle il
ajoute une note expressive. Dans « une telle (une semblable, une pareille)
supposition n'est pas soutenable », les mots soulignés ont à peu près la
valeur de démonstratifs (= « cette supposition ») ; « un certain bourgeois »
signifie presque la même chose que « un bourgeois » ; le même roi qui condamnait
la guerre (a été le premier à la déclarer) = « le roi » ; « Faites de
cette lettre tel usage (= « l'usage ») qu'il vous plaira » ; « le présent (ledit,
le susdit) arrêté » (style de chancellerie) — « cet arrêté » ; dans « On a émis
l'idée que la guerre est une école d'héroïsme ; ce dernier argument mérite
qu'on s'y arrête », ce dernier argument = « cet argument » ; « X. a fait paraître
un nouveau roman » = « un autre roman, un second roman » ; « un
double avantage » = « deux avantages ».
Dès lors, l'adjectif peut remplacer complètement le déterminatif qui le
précède : on dit « semblable, pareille supposition » ; « diverses couleurs, différentes
couleurs = des couleurs » ; « certaines circonstances = des circonstances »
est plus détaché de la valeur adjective que « de certaines circonstances ».
On sait que le substantif présente des cas semblables : « (une)
quantité de gens, nombre de personnes, force moutons », et finalement
« beaucoup (= beau coup) de vin ».
374. Un mot, en passant, sur la syntaxe du comparatif : si nous comparons
lat. Paulus fortior Petro et fr. « Paul est plus courageux que Pierre »,
trois différences apparaissent, qui marquent un progrès de l'analyse dans
le second type :
1. La marque du comparatif (plus), au lieu d'être dans une désinence,
est un mot autonome ; il l'est en outre parce que plus courageux est parallèle
à moins courageux, ce qui n'était pas le cas en latin.
2. La particule plus précède l'adjectif ; or cette séquence, sans être progressive,
rappelle logiquement la syntaxe parallèle plus de force, etc., où
l'ordre ttʼ est évident.235
3. Le ligament de comparaison (que) est aussi une particule séparée
du second substantif, et, de plus, il a pris la place qu'il doit occuper naturellement,
soit entre les deux termes (336).
b) Place des adverbes et périphrases adverbiales
375. Les adverbes sont d'accord ou de rection (488), et l'on sait que
la rection résiste moins à la tendance progressive que l'accord (173).
En fait, les adverbes et expressions adverbiales de rection ont adopté la
séquence directe : « agir par intérêt, pâle de rage », etc. ; les adverbes d'accord,
dits « adverbes de manière », résistent davantage. Mais les adverbes d'adjectifs
ne sont pas ici sur le même pied que les adverbes de verbes.
Les adverbes d'adjectifs précèdent ceux-ci (très joli, horriblement jaloux).
On peut s'étonner que la progression ait échoué, puisque ces syntagmes
sont relativement libres. La raison en est sans doute que ces
adverbes ne peuvent désigner des qualités proprement dites (car alors ils
feraient double emploi avec l'adjectif), mais marquent seulement l'intensité
(extrêmement pâle), ou l'impression qui s'en dégage (affreusement
pâle). En somme, le type très pâle est sur le même pied que plus courageux
(374) : très pâle désigne un haut degré de pâleur ; très est (logiquement) un
quantificateur, et comme tel donne l'impression d'être le t du syntagme
(115 IIa), — valeur qu'il avait effectivement autrefois (381).
D'ailleurs, le plus souvent, la nuance appréciative est greffée sur l'idée
d'intensité, parce que l'impression agréable ou désagréable est déclenchée
par le haut degré de la qualité ; beaucoup d'adverbes et d'adjectifs font
la part égale aux deux notions : « affreusement pâle = si pâle qu'on en est
effrayé » ; le dosage peut être différent, surtout dans les mots très usuels :
dans « bien joli », c'est l'appréciation qui domine ; dans « très joli », c'est
l'intensité. On comprend dès lors que ces adverbes précèdent l'adjectif ;
c'est la même raison qui fait que l'adjectif lui-même précède le substantif
quand il est intensif et appréciatif (367).
376. L'adverbe de manière modifiant le verbe est beaucoup plus nuancé ;
il peut exprimer non seulement l'intensité et l'appréciation subjective,
mais toute sorte d'aspects objectifs de l'action : marcher lentement, combattre
courageusement.
De ce fait, l'adverbe, comme l'adjectif spécialisant (table ronde), a très
vite pris l'habitude de suivre le verbe, au moins le verbe simple ; dans
236les temps composés, la règle n'est pas aussi bien établie ; elle reflète les
tendances signalées plus haut : les adverbes intensifs et appréciatifs se
placent volontiers devant le participe (il a horriblement souffert) ; ceux
qui spécifient l'action le suivent (il a combattu courageusement) : cf. « J'ai
fort apprécié cette œuvre », mais « Il a frappé fort » ; « Il a parlé haut, bas,
il a refusé net ».
377. Ces adverbes posent une question générale concernant le rapport
entre la qualité et la quantité. Logiquement, la qualité est inhérente au
concept. Il s'agit de ce qu'on appelle caractérisation ou spécification du
substantif : cheval blanc ; de l'adjectif : heureux en affaires, blanc de neige,
bleu foncé ; du verbe : travailler avec ardeur. La quantification est tout
autre chose : elle indique (comme on l'a vu § 115 IIa) quelle portion d'une
chose on envisage, quelle est l'extension d'un concept dans un cas donné,
soit qu'il s'agisse de spécifier un autre concept (char à quatre roues), soit
de la quantification d'un actuel : un cheval, peu de vin, plus de courage,
deux soldats ; très fort, plus fort (= « qui a beaucoup de force, plus de force »).
Autrement dit — nous l'avons vu (135, 115 IIa) — les caractérisateurs
sont (logiquement !) des déterminants, les quantificateurs des déterminés ;
de plus, les caractérisateurs doivent être en accord avec leur déterminé,
et les quantificateurs en rapport de rection avec leur déterminant (cf. beaucoup
de vin rouge).
Mais psychologiquement, les choses se présentent différemment ; la
grande quantité et l'intensité créent des impressions qui se transforment
en concepts appréciatifs (louange, blâme) ; et l'expression naturelle de ces
appréciations se trouve dans l'adjectif et l'adverbe de manière (voir plus
haut). C'est un cas de permutation des valeurs (324 2). Ainsi le substantif
arrive à être quantifié par un adjectif, si bien que beaucoup d'amis (ttʼ)
devient de nombreux amis, beaucoup de douleur se change en une grande
douleur. Quant aux adjectifs et aux verbes, ils sont toujours quantifiés
par des adverbes ou expressions analogues (très heureux, marcher beaucoup).
c) Composés et séquence progressive
378. Dans cette question, il faut faire abstraction, bien entendu, des
copulatifs et collectifs, dont les termes ne sont pas dans un rapport de
dépendance, mais relèvent de la coordination (77), p. ex. les composés
énumératifs caractérisés par l'absence de l'article : « hommes, femmes, enfants
237(furent passés au fil de l'épée) », et les collectifs du type mes parents
et amis, mon oncle et tuteur. Parmi les adjectifs, mentionnons sourd-muet,
aigre-doux ; dans les verbes, aller et venir, qui est à moitié syntaxique, et
les verbes issus de deux impératifs conjoints comme virevolter, tournevirer,
qui ne sont plus guère analysés.
Ces cas mis à part, on constate que tous les composés français non
empruntés au latin et au grec (agriculture, anthropophage, etc., v. § 524),
suivent l'ordre progressif : porte-plume, brun foncé, pêcher à la ligne, etc.
C'est là une des différences fondamentales qui séparent le français et
l'allemand, plus généralement les langues romanes et les langues germaniques
(comparez porte-plume et Federhalter, brun foncé et dunkelbraun).
Les exemples fournis au chapitre relatif à la composition en général (141)
nous dispensent de plus longs commentaires.
379. L'opposition des séquences dans les composés français et allemands
est celle qui frappe le plus quand on aborde la question de l'ordre progressif
ou anticipateur. On sait d'ailleurs que les composés français sont
plus près de la syntaxe que ceux de l'allemand (cf. pot à lait et Milchtopf ;
voyez cependant carte-réponse) et c'est précisément l'ordre ttʼ qui est
le principal facteur de ce rapprochement ; l'ordre inverse aurait été un
obstacle sérieux.
En allemand, les exceptions à l'ordre régressif dans les composés sont
très rares. Ceux du type Muttergottes sont des calques ; de même ceux du
genre der Fall Wagner sont imités du français (l'affaire Dreyfus). Remarquons
enfin que les formations authentiquement allemandes ein Glas Bier,
ein Eimer Wasser, drei Pfund Zucker, etc. ne sont pas des composés : ein
Glas Bier est totalement différent de ein Bierglas, et s'explique comme
ein wenig Bier, viel Bier, etc. ; autrement dit, ein Glas, ein Eimer, drei
Pfund sont des quantificateurs ; en outre, ein Glas Bier est un syntagme
actuel, tandis que les composés sont virtuels par définition.
d) Préfixaux
380. Les préfixaux, comme les suffixaux, sont issus d'anciens composés
ou groupes syntaxiques par généralisation de l'idée qu'ils expriment (c'est
le cas p. ex. de ultra-, qui passe de l'idée spatiale de « au-delà » à celle
plus abstraite de « excessivement »). Les composés eux-mêmes étaient autrefois
238des groupes syntaxiques libres (cf. all. Mannesalter et des Mannes
Alter, § 153).
Le préfixe est tantôt, et le plus souvent, le déterminant du radical
(relire = « lire de nouveau »), tantôt son déterminé (embarquer = « mettre
en barque »). Mais l'un et l'autre ordre sont contraires à la séquence progressive,
parce que le complexe préfixe + radical est à son tour déterminé
par le suffixe et, dans le verbe, par les désinences, qui marquent
l'idée encore plus générale de catégorie. Exemples : (a-terr-)ir « descendre
à terre », (trans-alp-)in « qui est au-delà des Alpes ». Sans doute, le même
renversement se vérifie dans tous les mots français, puisqu'ils sont tous
marqués des signes propres aux parties du discours (138) ; mais pour les
mots simples, la difficulté d'analyse est moins grande.
381. En allemand, la préfixation a une vitalité considérable, et, sous
ce rapport, on trouverait difficilement un contraste plus violent entre
cette langue et le français, où ce mode de formation est dans un stade
intermédiaire. Comme les préfixes allemands intéressent à un autre point
de vue la caractéristique des deux idiomes, nous renvoyons le lecteur
au § 584.
Quant aux préfixaux français, ils résistent encore à la poussée progressive.
Cela se comprend, car les syntagmes où ils figurent sont extrêmement,
serrés, et eux-mêmes sont atones, puisque l'accent du mot est
oxyton. On constate la vitalité au moins apparente de certains préfixes
anciens (dé[s]-, en-, etc.). Le français moderne en a même forgé de nouveaux
(extra-, ultra-, archi-, etc.).
Enfin — chose curieuse — certains syntagmes en ttʼ fournissent des préfixes
par permutation sémantique en tʼt. Ce sont principalement les groupes
prépositionnels qui sont ici en cause (on se rappelle qu'une préposition
est le déterminé de son régime). Ce changement se vérifie déjà dans les
langues indo-européennes anciennes. En grec, hupóleukos a signifié d'abord
« qui est au-dessous du blanc », puis « un peu blanc ». En latin, un magistrat
fonctionnant pro consule, c'est-à-dire « à la place du consul », a été nommé
proconsul, puis l'interprétation a changé : le proconsul est un « consul par
procuration ». Vice domini a créé le mot vicedominus, d'où fr. vidame,
aujourd'hui mot simple ; plus récemment, vice régis a donné vice-roi, avec
une transvaluation toute semblable. L'officier qui est au-dessous du lieutenant
est un sous-lieutenant ; actuellement, on décompose le mot en
« lieutenant en sous-ordre ».239
On voit quelle est la double condition qui détermine ce changement
de valeur : c'est la communauté de radical dans le simple et dans le composé,
et la communauté de catégorie lexicale ; ainsi arrière-cour désigne
un espace situé derrière une cour ; mais comme cet espace est lui-même
une cour, on explique « cour située derrière une autre ».
Nous verrons (399) que c'est cette double condition qui a amené la
transvaluation des suffixes appréciatifs (diminutifs, augmentatifs, péjoratifs,
laudatifs) : ânon désigne originairement, et continue à désigner le
petit d'un âne ; mais il est naturel que la confrontation des deux substantifs
âne et ânon suggère l'analyse « petit âne ».
Le type une fois entré dans l'usage, l'analogie l'applique directement :
quand on a forgé le mot contre-attaque, il est peu probable qu'on ait d'abord
interprété « opération qui s'oppose à une attaque » ; tout de suite tʼt a
prévalu (« attaque opposée à une autre »).
Les préfixes quantitatifs ont tous cette origine : surfin, primitivement
« qui est au-dessus du fin », puis « extrêmement fin » (cf. super-, extra-,
ultra-).
L'adverbe très est issu de trans « au-delà », qui a fourni au latin et au
roman des groupes syntaxiques : cf. espagnol tras los montes ; puis, dans
les expressions du type trans calidum « au delà du chaud », on a vu l'occasion
de superlativer l'adjectif, d'où transcalidus. L'italien a encore cette
formation (tracaldo, trafreddo, trabasso, traavaro). En français, très a été
bien près de fournir un préfixe ; mais il a été attiré par l'analogie d'adverbes
tels que fort, bien, plus, moins, etc., et a fini par se détacher de
l'adjectif. Ainsi le trait d'union (très-froid) qui était encore obligatoire
au cours du 19e siècle n'est plus en usage.
382. En revanche, la préfixation montre certains signes de fléchissement ;
la langue semble se résigner à effacer, ou tout au moins à obscurcir
la valeur propre du préfixe, qui, par suite, s'agglutine avec le radical ;
ou bien elle admet, sans raison suffisante, des préfixes divers pour une
même valeur (enrichir, appauvrir). Non seulement certains préfixes sont
improductifs : for-, pour-, de- (par opposition à dé [s]-, exemple : demander),
mais ceux qui forment de nouveaux mots sont soumis à toutes sortes de
restrictions ; des préfixes tout à fait vivants se livrent à des caprices
imprévisibles.
383. A cet égard, le préfixe re- (ré-) est particulièrement caractéristique,
car il passe pour une pièce régulière du système lexical. Et pourtant
240quel contraste avec l'allemand wieder et zurück, dont la signification
est nette, la forme bien déterminée, l'autonomie absolue. Rien de semblable
pour re-. La forme est fluctuante, oscillant entre re- (revenir),
r- (rouvrir), ra- (par agglutination de re- et a- : rafraîchir), ré- (agglutiné
de re- et é- : réchauffer « chauffer de nouveau ») ; sans compter l'autre ré-,
celui des emprunts savants (comparez rénover avec renouveler), mais qui
tend à s'infiltrer dans le lexique hérité. On dit rouvrir et réouverture,
refuge et se réfugier ; on hésite entre rentendre et réentendre, entre revision
et révision. Le danger des cacophonies est une entrave : ravoir est permis,
mais qui oserait risquer, sinon par manière de plaisanterie, je rai, je
r aurai ; rattirer, qu'on lit parfois, est choquant.
Les significations de re-, elles aussi, sont extrêmement variées. A côté
de celles qui correspondent à wieder et à zurück (relire, revenir), il offre
des nuances aspectives délicates ; ainsi remplir exprime l'aspect terminatif
(« remplir jusqu'au bord »), par opposition à emplir, qu'il a d'ailleurs
supplanté dans l'usage courant. Le parler populaire propage cette valeur
aspective : « La porte était fermée, je n'ai pas pu rentrer », c'est-à-dire
« réussir à entrer ». Une nuance voisine est celle qui marque l'importance
de l'action, l'effort, l'attention, le soin qu'elle nécessite : « recouvrir une
table d'un tapis, revêtir les insignes royaux » ; mais cet emploi, déjà archaïque,
est entouré de toutes sortes de restrictions.
Enfin, et très fréquemment, re- n'a plus aucun sens : regarder, réjouir,
recueillir ; il marque parfois une différence purement conventionnelle entre
le simple et le préfixai (« tarder à venir : ma montre retarde »). Ou bien,
dans le même mot, tantôt il aura un sens, tantôt il sera asémantique :
comparez représenter un plat et représenter une comédie, reconnaître quelqu'un
dans la rue et reconnaître ses torts, repasser une leçon et repasser du
linge.
384. Les préfixes verbaux à valeur prépositionnelle (type embarquer)
présentent des fluctuations analogues. La formation est encore vivante :
encapuchonner, empoter, etc., mais l'agglutination la guette. Elle est très
avancée dans les inchoatifs et les causatifs du genre de embellir, appauvrir ;
embellir ne signifie plus « entrer ou faire entrer dans l'état de beau, de
beauté », mais simplement « devenir ou rendre beau » ; dès lors, le préfixe
fait double emploi avec le suffixe -ir, qui a le même sens (cf. grossir).
De là l'arbitraire qui règne dans ces formations, notamment dans le choix
des préfixes, et dans la distinction entre inchoatif et causatif : blanchir,
241grandir/agrandir, enrichir, maigrir/amaigrir, appauvrir, élargir, rétrécir ;
durcir est transitif et intransitif, endurcir transitif seulement, et avec un
sens uniquement figuré, etc., etc.
385. Innombrables sont les formations où les préfixes sont absolument
vides de sens : promettre, permettre, commettre, compromettre ; demander, commander,
recommander ; déterminer ; respirer, etc. Une conséquence bizarre
de cet état de choses est que souvent la différence de sens entre un simple
et un préfixal, ou entre deux préfixaux, ne tient pas à la valeur propre
des préfixes, ceux-ci étant devenus de simples étiquettes conventionnelles :
ainsi, outre plusieurs cas déjà cités ci-dessus : paraître, apparaître, comparaître ;
conférer (un grade), déférer (à une demande) ; tendre et étendre (le bras).
Il va sans dire que tout ceci se vérifie particulièrement dans les mots
empruntés globalement au latin ; c'est le fait de tous les emprunts globaux
(521) ; on en trouve plusieurs dans les listes précédentes ; ils sont
légion (accident, incident, colloquer, concéder, occurrence, obtenir, expérience,
compétent, etc.)
Une variété curieuse de cet effacement de toute signification analytique
est celle où le préfixe seul a un sens, tandis que le radical n'en a aucun ;
ce cas est naturellement fréquent dans les latinismes : s'évader (é- désigne
bien la sortie, mais le radical vad- ne représente plus rien) ; dé-pouiller,
é-merger (im-merger, sub-merger),
at-tacher (dé-tacher), sont du même
genre. Citons enfin certaines initiales de mot interprétées comme préfixes,
ce qui amène le radical à ne plus rien signifier : agrafe est parent d'agrafer ;
a- étant compris comme préfixe, on a créé un contraire dé-grafer ; amarre
a donné d'abord amarrer, puis démarrer, etc.
386. A-t-on des indices que certaines formations de l'ordre ttʼ pourraient
supplanter les préfixes ?
Le moyen le plus simple de faire triompher ttʼ serait de changer les
préfixes en particules placées après le mot, de muer les préverbes en « postverbes ».
On trouve des exemples de ce renversement dans d'autres langues ;
le français a-t-il des velléités d'opérer cette permutation ?
L'allemand la pratique largement avec ses verbes séparables dans la
phrase indépendante : trink aus, komm mit, steh auf ! Mais cette permutation
ne se produit pas dans les formes nominales du verbe : austrinken,
austrinkend, ausgetrunken ; elle est en outre masquée par la disjonction
et la construction enveloppante qui régissent la syntaxe de l'allemand :
Steh morgen früh auf ! (321).242
Seul l'anglais est parvenu à faire passer certains préverbes après le
verbe sans les en séparer : to get up, « Get up earlier tomorrow ». Remarquons
que le cas d'un préverbe (tʼ) transporté après le verbe (t) est exactement
l'inverse de celui d'une postposition (t) arrivant à précéder le substantif
(tʼ) : vobiscum : cum hostibus ; mais dans les deux cas on obtient un
syntagme ttʼ. M. Frei a fort bien montré ce parallélisme et la solidarité
des deux transpositions dans une communication faite au IIe Congrès
international de linguistes (voir Actes, p. 187 ss.).
Le français offre quelques amorces d'un semblable changement. Le
langage populaire et négligé, qui répugne à l'emploi de mots savants tels
que collaborer, superposer, introduire, succéder, précéder, les remplace couramment
par des tours à postverbes : travailler avec, mettre dessus, mettre
dessous, mettre dedans, venir après, venir avant (cf. Frei, Gr. des f., p. 206ss.)
D'une manière moins brutale et sans blesser la correction, la langue
arrive à placer après le verbe, par voie de périphrase, l'équivalent de certains
préfixes ; le verbe, dans ce cas, est généralement « vide » : comparez
« procéder » et « prendre les devants », « succéder » et « venir à la suite », etc.
Nous verrons (395) que, inversement, le français, par d'autres périphrases,
arrive à créer des équivalents de suffixes, et que ces équivalents
ordonnent leur syntagmatique comme le demande l'ordre progressif.
e) Suffixaux
387. De même que les préfixes, les suffixes dérivent de composés ou de
groupes syntaxiques (153) ; seulement ils y occupaient la seconde place et
avaient la valeur de déterminés : deux caractères qui persistent dans les
suffixaux constitués. Mais la suffixation étant un procédé très ancien en
indo-européen, il est souvent impossible de dépister l'ancien composé et,
à plus forte raison, le groupe syntaxique qui est à la base du syntagme suffixal.
Un cas très net de cette origine est fourni par les langues romanes :
les adverbes en -ment (clairement) étaient primitivement des syntagmes
du type clarā mente. L'allemand possède plusieurs suffixes dont l'origine
syntaxique est prouvée : -heit, -tum, -lich, -bar, etc. (153, 186).
Les suffixaux sont des syntagmes à séquence régressive, puisque le
suffixe désigne une idée générale et catégorielle, déterminée par le radical
qui précède : chanteur = « celui (-eur) qui chante », lavage = « action (-age)
de laver », fertiliser = « rendre (-iser) fertile », pierreux = « qui a (-eux) des
243pierres », clairement = « d'une manière (-ment) claire », etc. Sur les suffixes
appréciatifs, voir la note annexe ci-dessous (396 ss.).
388. En allemand, la suffixation est un procédé tout à fait vivant ; cela
n'est pas étonnant : une langue qui a beaucoup de composés a naturellement
beaucoup de suffixaux. L'on sait (498) que la limite entre composés
et suffixaux est flottante ; beaucoup de seconds termes de composés font
impression de suffixes sans en être à proprement parler : Kaufmann,
Machthaber, Uhrmacher, Schlafsucht, Seewesen, wundervoll, fruchtlos, vorwurfsfrei,
etc. En français, ce type intermédiaire est rare ; tout au plus
en trouvera-t-on des exemples dans les composés savants : agriculture,
liquéfier, sténographie, etc.
389. La suffixation proprement dite est-elle en déclin dans le français
d'aujourd'hui ? Elle paraît très vivante, et il est naturel qu'elle le soit
restée, d'après le principe de la persistance des syntagmes serrés (319).
Or, les suffixaux sont encore plus cohérents que les préfixaux. En outre,
la langue écrite courante, surtout celle des journaux, fait une orgie de
mots très complexes (dénationalisation, solutionner, etc.).
Et pourtant, un examen plus approfondi semble démentir la supposition
que les suffixaux sont en progrès. Si, par exemple, on compare la suffixation
française avec celle de l'allemand qui, elle, est maximalement productive,
on est étonné de la difficulté qu'on a à trouver des équivalents
français pour une foule de suffixaux allemands. On s'aperçoit vite que
les formations de cette espèce sont liées à toutes sortes de restrictions.
Tout d'abord, les suffixes romans sont souvent difficiles à manier.
Beaucoup de suffixes hérités du latin vulgaire, qui ont pourtant une forme
bien caractérisée (-eau, -aud, -elle, etc.), sont devenus improductifs ; ainsi
une petite poutre est une poutrelle, mais comment généraliser ? Ruelle,
tourelle sont consacrés ; cela ne va guère loin.
D'autre part, les mots du vocabulaire roman se prêtent souvent mal à
la dérivation, parce que beaucoup se terminent par voyelle, comme p. ex.
eau, seau, feu, roi, etc. Ou bien le contact entre la forme du simple et
celle du dérivé n'est pas étroit : tonneau : tonnelier, sceau : sceller, etc.
Les suffixes ont souvent une valeur purement arbitraire, et p. ex. distinguent,
comme de simples étiquettes, des mots étymologiquement parents.
Ainsi éclairer : éclaircir, colorer : colorier.
390. La dérivation la plus abondante est fournie par les éléments empruntés
au latin et au grec. Or, ce sont presque uniquement des substantifs
244et des adjectifs, tandis que les verbes formés en français avec des matériaux
grecs ou latins sont rares (cf. cependant les verbes en -fier et -iser :
latiniser, liquéfier). Il en résulte un mélange bizarre de formations romanes
et latines dans la même famille de mots : éteindre et extinction, poitrine et
pectoral, eau et aqueux, brûler et combustion, cœur et cardiaque, foie et
hépatique. Cette bigarrure des familles de mots, qui a encore d'autres formes,
contribue beaucoup au relâchement des associations sémantiques (554).
391. Les caprices de la formation des suffixaux sont innombrables ;
il vaudrait la peine d'en faire une étude serrée ; nous nous bornerons à
quelques spécimens.
Soit le suffixe -itude : avec quels adjectifs forme-t-il des noms de qualité ?
Sans doute béatitude dérive régulièrement de béat, promptitude de
prompt, et ainsi de quelques autres. Mais solitude est accroché à solitaire,
certitude à certain ; servitude correspond, non à serf, mais à esclave ; gratitude
à reconnaissant, multitude à nombreux, turpitude à honteux, et sollicitude,
vicissitude … à rien.
Il y a une grande variété, et purement arbitraire, dans le choix des
suffixes concourant à caractériser une même classe de mots, et le français
est, en cela, assez éloigné de l'allemand. Soient les noms d'agent : le suffixe-type
est -er en allemand, -eur en français ; mais dans les mots usuels, la
proportion des mots allemands en -er est bien supérieure à celle des mots
français en -eur. Ainsi le français dit ferblantier, commerçant, fabricant,
forgeron, charron, peintre, tisserand, apprenti, locataire, héritier, écrivain,
juge, critique, poète, assassin, traître ; sur ces seize mots de formation arbitraire,
onze se traduisent en allemand par des mots en -er.
392. Enfin ce n'est peut-être pas un hasard si le français a permis que
quatre suffixes (-au, -aud, -eau, -ot 1100) se confondent en un seul dans la
prononciation en vertu de la loi des finales (448) : tuyau, badaud, chapeau,
vieillot. Cette confusion est corrélative au peu de vitalité de la suffixation
française. Il se peut que, par choc en retour, les adjectifs et substantifs
en -al et -ail redoutent de former un pluriel en -aux, qui risquerait de
se confondre avec l'un ou l'autre de ces suffixes : « des sons nasaux (naseaux),
des mots finaux (finauds), des monuments tombaux (tombeaux),
des procès mentaux (manteaux) ».245
393. Les adverbes en -ment sont une formation en apparence très vivante
et productive ; en fait, celle-ci est liée à plusieurs conditions qui la
gênent et l'appauvrissent.
C'est d'abord la forme extérieure : tantôt la finale est -ement, tantôt
-ément, sans règle prévisible. Ainsi on dit sourdement, mais aveuglément.
La finale est mal fixée pour intime-(mé)ment et quelques autres mots.
On sait que -ément résulte de l'extension de la finale des adverbes de participes
adjectivés : modérément, obstinément, posément, etc. ; ainsi obstinément
a entraîné opiniâtrément. Mais, chose bizarre, ces mêmes participes refusent
actuellement de former des adverbes, ou du moins il faut toujours
consulter l'usage arbitraire pour savoir qu'on peut dire sensément, résolument,
mais qu'il est interdit de risquer variément, blasément, etc. Il est
certain que la convergence de forme avec le suffixe des noms d'action
a contribué à propager -ément (aveuglément distinct de aveuglement) ; inversement,
l'existence des substantifs en -ment n'est pas étrangère à la vitalité
amoindrie des adverbes en -ment. Même embarras pour les adverbes tirés
d'adjectifs et de participes présents (-ent, -ant) ; deux d'entre eux ont
seuls la forme attendue (présentement, véhémentement) ; tous les autres
présentent un abrègement du radical, explicable historiquement, mais sans
raison d'être statique : négligemment, savamment, obligeamment. Il faut
s'attendre à d'autres surprises : pourquoi traître fait-il traîtreusement et
journalier journellement ? De quoi dérive outrageusement ?
394. En outre et surtout, l'usage ne laisse aucune liberté réelle pour la
formation d'adverbes réguliers de ce type ; on dit joliment, mais bellement
est proscrit ; à longuement ne répond pas courtement, qui d'ailleurs a été
en usage ; on dit ravissamment, mais non charmamment, etc.
Prenons au hasard, dans un vocabulaire idéologique, les adjectifs désignant
les diverses formes de l'intelligence ; on constate que les suivants
se refusent à former des adverbes : perspicace, sagace, avisé, pénétrant,
inventif, débrouillard, apte, capable, compétent, entendu, rusé, madré, matois,
futé, roué, finaud, roublard, fourbe, etc.
Les tentatives d'innovation sont vouées à l'insuccès. Plattner, Ausführl.
Gr. der fr. Sprache, IV, p. 75, en cite plusieurs : « dîner muettement,
vivre catholiquement ». Plusieurs produisent un effet comique qui
prouve indirectement la stérilité du type : « boire théologiquement (Th.
Gautier). Il descendait talmudiquement d'Othoniel » (Villiers de l'Isle-Adam).246
La formation en -ment est encore désorganisée du fait que la valeur n'est
pas uniquement celle d'adverbe de manière (longuement, brièvement). Un
grand nombre de ces adverbes prennent un sens quantitatif et appréciatif :
fortement, immensément, énormément, formidablement ; d'autres ont une
valeur modale : heureusement, naturellement, franchement : « Il a naturellement
manqué son train. — Heureusement qu'il a échappé à la catastrophe ! Franchement,
l'aimez-vous ? »
En résumé, les adverbes en -ment ne forment pas une classe aussi une
et productive qu'il semble à première vue. Ceci est en accord avec la générale
irrégularité de la dérivation en français. On constate, là comme ailleurs,
un contraste saisissant avec l'allemand, et pour une raison bien simple :
en allemand, il suffit de donner à un adjectif la forme sans désinence pour
en faire un adverbe : « Der Wein ist gut ; er schmeckt gut ».
395. Comment le français parvient-il à remplacer la suffixation déficiente ?
Une étude générale sur ce sujet manque encore ; M. H. Frei l'a
amorcée (Gr. des f., p. 193 et 209). Signalons seulement les deux procédés
qui conduisent à ce but.
D'abord la dérivation implicite par hypostase (257) et signe zéro (248),
qui permet aux mots de changer de catégorie sans augmenter de volume ;
citons au hasard : la curiosité : une curiosité, monter au grenier : monter des
hardes au grenier, jeter : le jet, etc. Ces formations jouent un grand rôle
en français ; mais comme elles ont pour effet de rapprocher les dérivés des
mots simples, nous en reparlerons plus en détail dans le chapitre consacré
à la tendance condensatrice (500).
Un autre procédé se rattache plus directement à l'étude de la séquence
progressive : il s'agit des formations qui remplacent les syntagmes suffixaux
tʼt par des équivalents en ttʼ. En voici quelques exemples :
Nombreuses sont les périphrases verbales où l'équivalent du suffixe est
un verbe plus ou moins vide (avoir, être, devenir, faire, rendre tel ou tel,
etc.), suivi d'un adjectif ou d'un substantif : « devenir pâle = pâlir, avoir rerecours
= recourir, faire impression = impressionner, prendre feu =
s'enflammer, entrer en jeu, en scène, etc., se mettre en branle, en route, etc. ».
D'autres formations remplacent des adjectifs : « voyage sur mer, affaire
d'importance, arbre en fleurs, amour sans espoir », etc. Pour les substantifs,
citons « homme de lettres, de science, femme de chambre », etc.
Les adverbes en -ment, assez peu maniables, comme on l'a vu, sont
abondamment suppléés par des tours en ttʼ ; ainsi sévèrement peut être
247remplacé, selon le cas, par « d'un œil sévère, d'un ton, d'un air sévère, etc. »,
ou plus abstraitement par « d'une manière, d'une façon sévère ». Ces tours
rappellent le clarā mente du latin vulgaire remplaçant les anciens adverbes
en -e et en -iter ; seulement le procès n'est pas aussi avancé en français.
On obtient des substituts commodes de -ment au moyen des prépositions
avec, sans, en : « avec cruauté = cruellement, sans utilité = inutilement,
traiter en ami = amicalement, argument valable en théorie », etc. On voit
que ces tours en ttʼ sont liés à moins de restrictions que les adverbes de
manière ; aussi sont-ils les bienvenus dans tous les cas où les adverbes en
-ment font défaut ; exemples : avec entrain, sans appétit, etc. En outre, leur
vogue tient en grande partie à la prédilection du français moderne pour
les constructions substantives, dont il sera question § 591.
Enfin nous avons vu plus haut (372) par quoi les suffixes appréciatifs,
dont l'emploi est si capricieux, peuvent être remplacés ; certains adjectifs
régulièrement antéposés au substantif ont pris des valeurs sensiblement
équivalentes à ces suffixes : « petit garçon, gros succès, sale gosse, grand
menteur, vieil original, sacré farceur » ; de même les tours du type « bijou
d'enfant, monstre de femme, diable de fille », etc., sont en train de prendre
le même chemin.
Nous ajoutons ici, comme spécimen d'une étude sur les suffixes français,
quelques détails relatifs aux
f) Suffixes appréciatifs
396. Nous appelons ainsi les suffixes qui expriment des sentiments ou
des jugements de valeur déclenchés par l'idée contenue dans le radical.
On distingue en général deux classes de mots appréciatifs : les diminutifs
et augmentatifs d'une part, les laudatifs et péjoratifs de l'autre. Mais ces
deux groupes de notions sont solidaires.
Les diminutifs et augmentatifs expriment l'impression agréable ou désagréable
associée soit à la dimension d'un objet, soit à l'intensité d'un
phénomène, d'une action, d'une qualité. Un coutelas est un couteau qui
étonne ou effraie par sa grandeur, un jardinet est un joli petit jardin ; un
sermon longuet est ennuyeux à cause de sa longueur, etc. Il va sans dire
que les diminutifs et augmentatifs sans valeur émotive n'entrent pas en
ligne de compte, p. ex. tablette, cigarette, etc.248
Les appréciatifs de la seconde classe semblent exprimer sans autre le
plaisir ou le déplaisir, la louange ou le blâme, p. ex. les mots en -ard :
faiblard est péjoratif, débrouillard laudatif. Mais en fait, les appréciations
bonnes ou mauvaises sont provoquées par la grandeur ou la petitesse d'une
chose, par la forte ou la faible intensité d'une représentation ; on est
faiblard quand on est trop faible, débrouillard quand on se débrouille
facilement.
397. Les suffixes appréciatifs ne sont pas rares en français ; mais ils
partagent le sort de tous les éléments formatifs de cette langue : leur
emploi est capricieux et arbitraire.
On sait que l'allemand peut former des dérivés en -chen ou -lein avec
n'importe quel substantif, même si cette formation n'est cataloguée dans
aucun dictionnaire (Federchen de Feder, etc.). Il n'en va pas de même
en français : seul l'usage m'avertit que jardin a un diminutif et que pierre
n'en a pas ; le choix du suffixe est imprévisible : jardin-et, tour-elle, fort-in,
frér-ot, négr-illon ; longu-et, vieill-ot, roug-eaud, pâl-ichon ; saut-iller, chantonner,
trott-iner, touss-oter. Parfois, le simple n'existe pas (fredonner, frétiller).
De plus, les suffixes de cette espèce peuvent servir à d'autres usages :
lac-et, caill-ot, cul-otte, etc.
398. Parmi les suffixes appréciatifs, -ard est le seul qui soit vraiment
productif (criard, braillard, chauffard, etc.), et encore ne peut-on l'employer,
sans ménagement. Les autres sont d'un maniement difficile ;
l'usage peut seul nous dire quels mots comportent une nuance appréciative
par l'adjonction de tel ou tel suffixe ; on dit finaud, mais non
sotaud, bêtaud ; certains appréciatifs, on l'a vu, n'ont pas ou n'ont plus
à côté d'eux de mots simples correspondants : rustaud, badaud, penaud,
maraud, etc.
On remarque, d'autre part, que plusieurs suffixes qui ne sont pas spécifiquement
appréciatifs, comme -erie, -ée, -age, -ade (sonnerie, cuillerée,
lavage, colonnade), forment quantité de mots à valeur péjorative (diablerie,
engueulée, tapage, verbiage, algarade). C'est là une nouvelle gêne pour la
formation de mots sans valeur affective, parce qu'ils risquent toujours
d'en prendre une par contagion. Ainsi noyade et sauvetage désignent des
idées sérieuses d'une façon qui l'est peu (cf. les tragiques noyades de
Nantes sous la Révolution) ; mais on ne sait par quoi les remplacer. Tout
cela prouve que le mécanisme de la suffixation appréciative n'est plus
très régulier.249
Signalons en passant que l'irrégularité d'une formation renforce souvent
sa valeur expressive. L'abondance des diminutifs allemands leur
donne quelque chose de banal et de puéril ; au contraire, presque chaque
suffixal français à valeur appréciative, étant plus ou moins inattendu,
frappe d'autant plus.
399. Chose curieuse : un suffixe appréciatif est le déterminant de son
radical, car il est naturel que l'idée subjective ait valeur de prédicat et
s'exprime par un adjectif ou un adverbe : un jardin-et est un petit (-et)
jardin, longu-et veut dire un peu (-et) long, vol-eter voler faiblement (-et-),
etc. Il y a là une exception à la règle qui attribue au suffixe une valeur
catégorielle générale et en fait le déterminé (t) du radical (tʼ) : jardinier =
« homme (-ier) qui travaille au jardin ».
Cette exception tient à une cause générale déjà signalée § 381. Les noms
des petits d'animaux nous éclairent sur ce point, car les petits d'animaux
sont eux-mêmes de petits animaux. Un ânon est le petit d'un âne et aussi
un petit âne ; ânon désigne soit une espèce du genre âne, soit le genre
âne sous une forme spéciale, altérée, diminuée. Il s'agit donc d'une permutation
des valeurs (324, 2) ; celle-ci a été favorisée par la convergence
de deux facteurs : l'élément commun contenu dans les signifiés (p. ex.
l'idée générale d'âne dans âne et ânon), et l'élément commun contenu dans
les signifiants (ân-). On a ici la contre-partie de la transvaluation des
préfixes comme sous-, sur-, extra-, ultra- (381).
En latin vulgaire, patraster a désigné le beau-père (Stiefvater) 1101 ; c'est
une espèce (hybride) du genre père ; parallèlement matrastra désignait la
belle-mère, une espèce (imparfaite) du genre mère. Mais de même qu'en
français « une espèce de mère » peut glisser au sens de « mauvaise mère »,
marâtre a fini par prendre aussi ce sens ; du coup, l'idée de « mauvais »
s'est trouvée exprimée par le suffixe. Il est probable que le latin poetaster
« mauvais poète » et d'autres mots en -aster ont été créés analogiquement
sur le type une fois consacré, et cette remarque vaut pour tous les autres
suffixes appréciatifs.
400. La double formation des substantifs diminutifs en indo-européen
est instructive à cet égard. On sait qu'en grec, en allemand, etc., le diminutif
est uniformément du genre neutre (grec ho paîs : tò paidíon ; all. der
Baum : das Bäumchen), tandis que dans d'autres langues, comme le latin
250et le français, le diminutif adopte généralement le genre du simple (oculus-ocellus,
mulier-muliercula, jardin-jardinet, maison-maisonnette). Il semble
que le premier type soit plus proche de la racine psychologique des formations
appréciatives (paidíon = « quelque chose qui est du genre enfant,
qui ressemble à un enfant », etc.), tandis que le second s'explique par le
renversement de l'interprétation : ocellus = « petit œil ».
401. Les adjectifs appréciatifs ne font pas exception. Sans doute, vieillot
veut dire « un peu vieux » ; mais le suffixe a dû être à l'origine le déterminé
d'un radical substantif ; le type des adjectifs de couleurs verdâtre, blanchâtre
le montre bien, car l'interprétation hésite encore maintenant entre « un
peu vert, imparfaitement vert » et « tirant sur le vert », « de la nature approximative
du vert » ; or, cette seconde analyse est bien celle qui prédominait
à l'origine, comme pour les substantifs tels que marâtre ; cette analyse est
à rapprocher de celle des préfixaux du type gr. hupóleukos, fr. surfin,
etc. (381).
402. Les adjectifs diminutifs posent une question qui touche à celle des
comparatifs et superlatifs indo-européens. Ces formations sont pratiquement
ttʼ ; mais l'ont-elles toujours été ?
Les suffixes -eros et -mos avaient la valeur de déterminés : en sanscrit,
úpara veut dire « qui est en haut », upamá « qui est en haut par rapport à
plusieurs ». En grec, agróteros a signifié « qui est de la campagne », comme
fr. campagnard. En sanscrit, -tara est le suffixe ordinaire du comparatif
comme -teros en grec, mais açvatará veut dire « qui est approximativement
de la nature du cheval (âçva), c'est-à-dire mulet » ; en latin matertera =
« qui est à peu près de la classe de la mère », c'est-à-dire tante. Il est donc
possible que tous les comparatifs et superlatifs aient une origine analogue ;
ils ont dû avoir d'abord un sens absolu, comme en latin durior « un peu
dur », durissimus « très dur » ; il faut supposer en outre que le radical avait
primitivement une valeur substantive : albior signifiait « qui appartient
plus ou moins au blanc », de même que fr. blanchâtre veut dire « qui tire
sur le blanc ». Plus tard, la permutation des valeurs en ttʼ, devenue générale
comme pour les appréciatifs, a fait oublier cette origine.
403. Quant aux verbes à suffixes appréciatifs (bavarder, criailler, toussoter,
etc.), il faut sans doute y voir des dérivés : bavarder a dû signifier
« être bavard », s'encanailler « tomber dans la canaille », etc. Puis les suffixes
verbaux sont devenus autonomes et ont pu se greffer sur des verbes :
buvoter, pleuviner, etc.251
Il est probable que les substantifs appréciatifs sont eux-mêmes des
adjectifs substantivés : comparez marâtre avec blanchâtre, sanscrit açvatará
« mulet » avec çvetátara « plus blanc ». Seulement le passage de l'adjectif
au substantif est si aisé qu'il reste inaperçu, tandis que la transposition
en verbe est très apparente.
Il suit de là que toute la classe des appréciatifs aurait une origine adjective ;
rien de plus naturel, puisque l'appréciation subjective s'exprime
spontanément par des adjectifs (agréable, désagréable, bon, mauvais, etc.).
g) Constitution des racines
404. Si les préfixes et les suffixes du français se distinguent mal du
corps du mot, il serait étonnant que celui-ci, c'est-à-dire la racine, eût
une forme bien caractérisée ; si, d'autre part, les préfixes et les suffixes
de l'allemand ont une forte individualité, on doit s'attendre à ce que la
racine soit elle-même bien distincte 1102. Les faits confirment cette double
supposition, à condition, bien entendu, qu'on se fonde sur l'état actuel
de la langue et que l'on admette comme racine ce qui est compris spontanément
comme tel, et non ce que l'étymologie fait trouver en remontant
au latin ou au germanique primitif.
405. Les racines du français (actuel !) ne sont soumises à aucune règle
qui détermine leurs dimensions, leurs formes et leurs variations. Elles
peuvent avoir une ou plusieurs syllabes : gât-er, jou-er, pénétr-er, commenc-er,
félicit-er, etc. Leur constitution phonique est livrée au hasard ; les quelques
exemples cités suffisent à le montrer. Rien ne règle le choix et la disposition
des voyelles et des consonnes. Quant aux variations, elles sont réduites à
presque rien ; on sait que le français marche vers l'invariabilité du radical.
Les alternances régulières sont en déclin : celles du type jette : jeter, appelle :
appeler est toujours plus négligée dans la prononciation populaire : l'allongement
des voyelles finales au féminin, dans les substantifs et les adjectifs,
a presque disparu dans le français commun (amie se prononce comme ami,
pensée comme pensé). Les alternances de la conjugaison morte sont chaotiques :
reçois : recevons, prends : prenons, veux : voulons, vaux : valons, peux :
pouvons, etc.
Il est curieux de constater que certaines alternances assez régulières ne
jouent encore aucun rôle et ne sont pas aperçues, p. ex. celle qui est créée
252par le passage de è ouvert à é fermé sous l'influence d'un é fermé ou d'un i
suivants : aimons (è) : aimez (é), bête (è) : bêtise (é) ; et aussi la distinction
entre a long et grave des substantifs en -age et a bref et aigu des verbes
en -ager : un voyage (ā) : il voyage (ă) ; de même pour ménage, ravage, fourrage,
présage, ombrage, outrage, etc.
406. Le contraste avec l'allemand est saisissant. Les racines allemandes
ont une physionomie nettement accusée ; leur constitution est réglée par
des lois simples et rigides. Elles sont normalement monosyllabiques
et se terminent soit par une consonne (lieb-, mal-, bell-, tauch-, setz-,
stopf-), soit par deux consonnes d'aperture décroissante (erb-, helf-), soit
par une voyelle longue ou une diphtongue (seh-, zieh-, tau-, reu-). Elles
sont donc soumises aux mêmes lois que les mots monosyllabiques (437).
Les alternances vocaliques classent les verbes forts en catégories déterminées
(binden, band, gebunden ; reissen, riss, gerissen, etc.), et elles ont
conservé une valeur grammaticale, car elles servent à distinguer les temps
(nehmen : nahm), les modes (band : bände), et fournissent des dérivés
(trinken : Trank). Ce n'est pas tout : la racine porte en général l'accent,
et celui-ci est intense ; enfin elle est isolée de son entourage, car elle commence
toujours une syllabe (er-halten, ver-arbeiten, etc.), et est souvent
distincte du suffixe ou de la désinence (ge-lieb-ter, er lieb-te).
Aspects pathologiques de la flexion
en français actuel
407. Tout a été dit sur la décadence progressive du système flexionnel
latin au cours de l'évolution du français ; nous n'y reviendrons pas. Mais
il est intéressant de remarquer que les vestiges qui subsistent dans la
langue actuelle sont compromis à leur tour. Pour nous en rendre compte,
nous recourrons à la pathologie de la grammaire « sans fautes », dont il a
été question dans l'introduction (20). Il s'agit des ambiguïtés, des gênes,
des impasses auxquelles l'usage correct conduit les sujets parlants. Ces
entraves — avons-nous dit — permettent de surprendre les conflits entre
la tradition et les tendances qui poussent la langue à s'en affranchir.
Ici, il s'agit plus particulièrement de signaler les cas où la règle de
grammaire est fondée sur les désinences sans que celles-ci soient en état
de remplir leur office, soit à cause de leur faiblesse, soit à cause de la
répugnance qu'on éprouve à les employer.253
a) Substantifs et Adjectifs
408. On sait que le pluriel est le plus souvent marqué par les déterminations
précédant le substantif et l'adjectif : « un homme, des hommes ; un
gentil garçon, de gentils garçons ». L's du pluriel n'est opérant, pour l'oreille,
que dans les cas de liaisons : « enfants z obéissants, bons z enfants » ; mais
les liaisons deviennent de plus en plus rares 1103.
Enfin il reste un dernier vestige de la désignation interne du nombre
grammatical : ce sont les mots en -al, -ail : -aux 2104. Mais les pluriels en -aux
sont fortement compromis.
409. Les substantifs en -ail, peu nombreux, sont livrés aux caprices de
l'usage ; la répartition des pluriels en -ails et en -aux ne rime plus à rien
(éventails : vantaux) ; ail : aulx n'est plus qu'une fiction ; bail : baux n'est
maintenu que grâce à la langue administrative.
Le type cheval : chevaux résiste mieux, parce qu'il comprend davantage
de mots usuels. Mais les formations récentes montrent qu'il n'est plus
productif. Ainsi idéal (subst.), employé autrefois au singulier seulement,
a reçu un pluriel sous l'influence de l'allemand (die Idéale) ; mais doit-on
dire des idéals ou des idéaux ? On lit tantôt l'un, tantôt l'autre ; le second
est correct, mais évidemment gênant. Inversement, la langue de chancellerie
a créé récemment un pluriel les nationaux (par opposition aux étrangers) ;
mais qui oserait parler au singulier d'un national ? Cela signifie que -aux
n'est plus associé spontanément à -al, et vice versa. On sait que le peuple
tranche le débat tantôt en faveur de -al (« des journals, des amirals, des
caporals »), tantôt en faveur de -au (« un bestiau, du cristau, du matériau »).
Cf. Frei, Gr. des f., p. 207.
410. Le pluriel des adjectifs en -al est instable ; -aux perd du terrain :
conjugaux, sociaux, moraux et d'autres résistent assez bien, parce que la
plupart appartiennent à la langue écrite ; mais les adjectifs qui ont quelque
contact avec la vie pratique abandonnent peu à peu cette finale ; c'est
dans un dialogue de comédie qu'on a agité, au XVIIIe siècle, la question
de « combats navaux » ; navals a fini par triompher. Aujourd'hui, pour
254d'autres mots, on hésite, et le plus souvent on renonce à employer le
pluriel de beaucoup d'adjectifs en -al (392) : on recule devant « styles triviaux
et banaux », mais on n'ose risquer trivials et banals ; c'est un appauvrissement.
Cf. encore : des délateurs vénaux, de joviaux gaillards, des soldats
bancaux, des délits pénaux, des édits papaux.
Il va sans dire que l'avance de -als est plus forte dans le langage populaire.
« Puisqu'on est en République, on devrait tous être égal » (Dorgelès,
Croix de bois, p. 121) ; l'orthographe égal est une concession à la tradition ;
cf. « On n'est pas des princes ». Mais -als pénètre peu à peu dans la langue
littéraire ; Vigny a risqué rocs fatals (Maison du Berger), et Alain Fournier
de glacials coups de vent (Le grand Meaulnes, p. 20).
Une curiosité : on sait que des plus (=très) demande logiquement
l'adjectif au singulier, tandis que la tradition le veut au pluriel : « un
conte des plus leste(s) » ; il faut donc dire « un conte des plus immoraux » ;
mais cela est particulièrement dur, et -al l'emporte le plus souvent ; cette
circonstance peut contribuer au déclin des pluriels en -aux. Dans un cas
précis, l'adjectif ne peut être qu'au singulier : c'est lorsque le sujet est
indéterminé : « Cela est des plus immoral ».
411. Bien qu'un stock considérable d'adjectifs n'aient qu'une forme au
masculin et au féminin, le français a encore le sentiment de leur accord
en genre ; comparez : un pauvre garçon, une pauvre fille avec un bon garçon,
une bonne fille. Mais la formation du féminin est livrée à tous les caprices
imaginables ; elle est le plus souvent imprévisible sans le secours de l'écriture ;
l'usage seul, c'est-à-dire la mémoire, m'avertit que le féminin de
rond est ronde ; il pourrait aussi bien être ronne (: bon, bonne) ou ronte
(: prompt, prompte) ; voir § 250.
Dans plusieurs cas, le français recule devant l'emploi du féminin : on
hésite à dire hagarde, encline, châtaine, etc. La marche à l'invariabilité
est favorisée par certaines circonstances, p. ex. l'emploi régulier de l'adjectif
au masculin quand il est caractérisé : « étoffevert pâle, vert bouteille »,
et celui des substantifs en fonction d'adjectifs : « style gendarme, manières
ogre », etc.
412. Si l'immense majorité des substantifs sont invariables dans leur
radical, et remplacent la variabilité désinentielle par la variabilité initiale
(comparez latin lupus, lupo, lupi, luporum et fr. le loup, au loup, du loup,
des loups), encore faut-il que ces éléments préfixés ne fassent pas défaut ;
or la syntaxe comporte encore nombre de tours où le substantif n'est précédé
255d'aucun déterminatif, où il est (en apparence !) autonome. Nous reprendrons
la question § 471 ss. La distinction des nombres souffre de cette
carence, cf. « rapports entre mari(s) et femme (s), sans difficulté(s) », etc.
Dès lors, la différence n'apparaît que dans l'écriture, et pour fixer l'orthographe,
on doit se livrer à un jeu souvent compliqué d'associations mentales
(p. ex. « des noms de lieux » d'après « des noms d'animaux »).
413. Mais il faut distinguer deux cas assez différents : tantôt le français
a encore le sentiment net du singulier et du pluriel, tantôt il l'a perdu ou
est en train de le perdre. Dans le premier cas, l'absence de déterminatif
crée une fâcheuse ambiguïté ; dans le second, la fixation artificielle du
nombre est gênante pour celui qui écrit, car l'orthographe ne s'appuie ici
ni sur le témoignage de l'oreille, ni sur l'interprétation grammaticale.
Dans la première catégorie, il s'agit de substantifs à déterminatif zéro
(477). Les cas douteux sont peu nombreux, du moins en apparence ; car
la limite entre les deux classes est mal définie, comme nous le verrons.
Ici, il s'agit surtout du vocatif : l'oreille ne peut distinguer si, dans une
prosopopée, le substantif est au singulier ou au pluriel, p. ex. « 0 chère(s)
pensée(s) que je porte en moi comme un trésor ! ». On peut mentionner
aussi les titres d'ouvrages ; si un conférencier parle d'un livre intitulé
Péché(s) mortel(s), comment identifier le nombre ? On ne mentionnera
que pour mémoire les enseignes, écriteaux, etc., puisqu'ils sont faits uniquement
pour l'œil, p. ex. à la poste : Mandats, Remboursements, etc.
414. La seconde classe comprend les composés, où la distinction du
singulier et du pluriel porte sur l'ensemble du mot, tandis que les composants,
étant virtuels, sont en général indifférents à l'égard du nombre
(143). Ainsi en allemand, Schule n'est pensé ni au singulier ni au pluriel
dans Schullehrer, pas plus que liqueur dans verre à liqueur : c'est le mot
entier qui a un nombre.
Malheureusement, les composés se rapprochent beaucoup des groupes
syntaxiques qui leur sont parallèles (cf. « pot à lait, pot au lait, pot pour
le lait »). Aussi hésite-t-on dans bien des cas entre composé et groupe, et,
par suite, entre distinction et indistinction du nombre. Ainsi tailleur pour
messieurs, coiffeur pour dames sont de vrais composés, et pourtant le second
terme, quoique virtuel, est réellement au pluriel. La distinction est déjà
plus artificielle dans nom d'animal, noms d'animaux, car ici, la variabilité
du second composant est réglée sur celle du premier (un nom peut être
appliqué à plusieurs animaux). Enfin dans les composés du type porte-plume,
256il ne devrait pas y avoir de doute ; mais la tradition orthographique
maintient des pluriels qui ne correspondent plus au sentiment actuel
(un cure-dents). Comme ces précisions n'ont de valeur que pour l'œil, non
pour l'oreille, on comprend à quel supplice est condamné celui qui tient
une plume et a souci de son orthographe. Ce serait un soulagement de
pouvoir écrire « un porteplume, des porteplumes », comme on écrit, par
une trop rare exception, « un portefeuille, des portefeuilles ; un passeport,
des passeports ».
415. Voici une liste d'exemples où l'ambiguïté subsiste ; j'ai respecté
l'orthographe de ceux qui sont empruntés à des textes ; pour ceux que j'ai
recueillis oralement, la marque du pluriel est indiquée entre parenthèses.
Si l'on veut traiter ces exemples expérimentalement, il est bon de se les
faire lire ou de les dicter à quelqu'un.
Salle de billard et de jeux du Foyer des étudiants — Confiture de groseille(s) — On
entend des cris de coqs dans le lointain — Pousser des cris de coq — Salle
de bain(s) — Le français, langue de chancelleries (Dauzat, Les patois, p. 31) — Un
toit d'ardoises (Maupassant) — Question de principe(s) — Livre de classe(s) — Plusieurs
îlots de maison gauloise ont été relevés le long des Cévennes (Nature,
26-1-24) — Il s'est servi des éléments de toutes natures que le progrès lui apportait
(Paris-Soir, 29-3-24) — Rassasiés de nourritures et de prières, les pèlerins
se dispersèrent (Tharaud, Ombre de la croix, p. 72) — Vous ayant retrouvée
veuve, libre, pleine de séductions, je vous ai tout de suite désirée (Hervieu,
Course du flambeau, I, 15) — Aimer la littérature, c'est se passionner pour les
classiques … en dehors de toute préoccupation d'écoles (Albalat, Comment on
devient écrivain, p. 156) — Le manque d'instruction et de lectures explique très
bien ce désaccord entre critiques littéraires (Ibid., p. 156) — Faire provision(s)
de force(s) — Ils ont l'air calme et détaché (Duhamel, Le Miracle) — Un meuble
à tiroir(s) — S'absenter pour raison(s) de santé — Changer d'habit(s) — De sources
russes, la délégation géorgienne reçoit l'information suivante (J. de Genève,
5-9-24) — Etre à couteau(x) tiré(s) avec quelqu'un — Habit sur mesure(s) — Prendre
une affaire en main(s) — Mots imprimés en italique(s) — Traversée du
lac Baïkal en traîneaux — Un arbre en fleur(s) — Une route en lacet (A. Daudet,
Tartarin sur les Alpes) — Certains actes en rapports directs avec les sentiments
(Bousquet, Précis de sociol., p. 104) — Le subjonctif n'existe qu'en proposition(s)
subordonnée(s) — L'Art nous apparaissait, sans distinction d'arts, comme une
figure une et sublime (Mauclair, Semaine littéraire, 1924, p. 448) — Bien des
sources d'erreur(s) — Sans acception de personne(s) — MM. Paul et Victor Attinger
à Neuchâtel ont été désignés comme imprimeur et éditeur du Glossaire (Glossaire
des patois de la Suisse romande, 25e rapport, p. 4).257
b) Verbes
416. Dans la flexion verbale, nous nous bornerons à quelques remarques
sur le subjonctif, dont le déclin a été souvent signalé, et en partie expliqué ;
puis nous y joindrons quelques cas plus particuliers. Comme précédemment,
c'est la pathologie de la « grammaire sans fautes » qui nous servira de
critère.
Les deux temps simples du subjonctif n'ont de formes bien nettes que
dans les verbes irréguliers ; ceux-ci sont improductifs, mais beaucoup sont
très usuels (être, avoir, faire, etc.) ; ici, pas de confusion possible (suis, sois,
fusse ; tiens, tienne, tinsse ; fais, fasse, fisse). C'est une barrière contre l'envahissement
du type marcher, qui donnerait au verbe une uniformité dont
le français a horreur. Cependant, aussitôt qu'un verbe est d'un emploi
moins abondant, la répugnance pour le subjonctif, surtout l'imparfait,
réapparaît, et cela tient avant tout aux variations que subit le radical ;
ainsi un Français d'aujourd'hui a de la peine à rattacher que je busse à
boire, que je misse à mettre. Des formes telles que « il fallait que vous
tinssiez, acquissiez, conquissiez, vinssiez, crussiez, dissiez, mussiez, prissiez,
pussiez, vécussiez » sont à peu près impossibles dans la langue parlée. La
faiblesse de cet ensemble de formes provient de ce qu'il ne s'agit pas d'un
mode autonome, susceptible de figurer en phrase indépendante ; il n'apparaît
qu'en subordonnée, et fait le plus souvent double emploi avec le
verbe modal de la proposition principale (« Je doutais que vous eussiez
raison »). Quant au type de l'ancien français « Si j'eusse de l'argent, je vous
en donnasse », — il est depuis longtemps périmé. Les autres formes sont
maintenues dans la langue écrite par une tradition à la fois tenace et
capricieuse ; mais le parler usuel s'en désintéresse de plus en plus au profit
de l'indicatif.
417. Certaines défectuosités morphologiques permettent en outre de
confondre le subjonctif avec le mode concurrent.
En effet, dans la première conjugaison, la seule vraiment productive,
le subjonctif présent ne se différencie du présent indicatif qu'aux première
et deuxième pluriel (les deux personnes les moins employées, la première
remplacée par on, la seconde compromise par le tutoiement) ; cf. indicatif
présent nous marchons, vous marchez, subj. prés, nous marchions, vous
marchiez 1105, formes qui, de leur côté, ont le désavantage d'évoquer parfois
258l'imparfait indicatif. Une phrase telle que « Je suppose que Paul arrive
demain » est ambiguë, car on peut interpréter ou « que Paul vient » ou « que
Paul vienne ». Je lis dans un journal : « L'essentiel est que l'Allemagne paie » :
un contexte précis me permet seul de savoir s'il s'agit d'un fait ou d'une
condition. Même ambiguïté dans « Je comprends que cet accusé affirme son
innocence » — « Je ne vois pas que la situation s'aggrave » — « Il arrive que
la pensée reste mouvante et nébuleuse » — « Paul construit un mur qui
l'abrite contre le vent, qui le met(te) à l'abri du vent ».
Même aux première et deuxième pluriel, le subjonctif présent n'a rien
qui le distingue du présent indicatif dans les nombreux verbes en -ier et
-yer (-ayer, -ailler, -eiller, -iller, -uyer, -uiller, -ouiller, -gner, -rier, -vier, etc.) ;
l'i que l'orthographe maintient aux première et deuxième pluriel du subjonctif
ne se prononce pas. Dans « L'important est que vous travaill(i)ez,
gagn(i)ez », il y a complète équivoque. L'imparfait de l'indicatif se confond,
pour la même raison, avec le présent : « Combien payez-vous ? » et « Combien
payiez-vous ? » ne se distinguent en rien à l'audition.
418. Dans la deuxième conjugaison, la plus abondante après la première,
le subjonctif présent se confond avec l'imparfait du même mode, sauf
à la troisième sing. (présent : qu'il finisse, imparfait : qu'il finît). Cela n'est
pas fait pour prolonger la vie du second de ces temps ; ainsi dans « Je
voulais que tu finisses ton travail », finisses peut être interprété comme un
présent, contrairement à la règle de concordance des temps.
On trouverait aussi dans la conjugaison irrégulière des contacts entre
l'indicatif et le subjonctif : cf. nous cueillons et (que) nous cueillions ; je
vois, je crois se prononcent presque comme (que) je voie, (que) je croie, etc.
419. Voici qu'à son tour l'imparfait du subjonctif se confond avec le
passé simple de l'indicatif à la 3e sing. de toutes les conjugaisons ; d'où
de fâcheuses ambiguïtés dans des cas tels que « On lui envoya un messager
qui le prévint (prévînt). — Les assiégés voulurent résister jusqu'à ce que
l'ordre leur parvint (parvînt), ou leur arriva (arrivât), ou leur fut (fût)
transmis de capituler. — L'armée se décida à chercher une position qui
contraignit (contraignît) l'ennemi à quitter la sienne ». C'est la raison pour
laquelle la 3e sing. du passé défini est parfois imprimée avec circonflexe,
même là où il n'y a pas de doute sur son identité : « Lorsqu'il fût parti … ».
Remarquons seulement que dans le tour « Après qu'il fût parti … », il y a
plus qu'une faute d'orthographe ; la syntaxe de « avant qu'il fût parti »
a déteint sur celle de après que.259
La confusion s'étend au delà de la 3e sing. ; les gens qui emploient sans
aucune conviction l'un et l'autre temps arrivent à écrire « Il fallait que
l'écrivis, que tu obéis », etc. Le pluriel est atteint à son tour : on lit chez
Barbusse : « Il nous occupa, sans que d'abord nous nous défiâmes, comme
n'importe quel tiers ».
420. Le subjonctif imparfait doit sa défaveur avant tout à ses désinences
touffues ; mais d'autres facteurs sont en jeu : d'abord le fait qu'il dépasse
souvent la dimension normale des mots français (495), quand p. ex. il crée
nous mortifiassions, vous entremêlassiez, etc. Ensuite, il offre des analogies
avec des suffixes péjoratifs, verbaux et nominaux ; ainsi je traînasse appartient
à traîner et à traînasser, je rêvasse à rêver et rêvasser, etc. ; je lavasse
fait penser à la lavasse, je filasse à la filasse. Sans compter les calembours,
cette plaie du français (453, 563) : je susse (suce), reçusse (resuce), je traquasse
(tracasse), je menasse (menace), je mêlasse (la mélasse), je pusse
(la puce), je visse (voir et visser).
421. La 2e pl. impératif a un concurrent dans l'infinitif qui donne à
l'ordre une nuance spéciale : comparez « Voyez au verso » et « Voir au verso ».
Mais la première conjugaison rend cette distinction inexistante pour
l'oreille ; si un professeur de mathématiques dicte à ses élèves « Démontré
que les trois angles d'un triangle sont égaux à deux droits », il est impossible
de savoir s'il faut écrire démontrez ou démontrer. Comparez cette fin
de lettre qu'un chef dicte à la dactylo : « Veuillez excuser ma démarche
et agréé mes salutations distinguées » (agréez ? agréer ?).
Dans les verbes de la première conjugaison, il est souvent impossible
de différencier l'infinitif du participe passé, quand ils peuvent l'un et
l'autre dépendre d'un même verbe conjugué. Ne rappelons qu'en passant
l'histoire de ce factionnaire qui, rompant la consigne, était allé casser
la croûte au café voisin, laissant sur son képi une feuille de papier avec cette
note lapidaire : « Le sapeur a été mangé ». Mais — ambiguïté plus sérieuse — ces
formes de la première conjugaison effacent parfois une différence
aspective très fine qui ressort bien de l'opposition entre « Je l'ai vu pendre »
et « Je l'ai vu pendu », mais qui est effacée pour l'oreille dans « Je l'ai vu
abandonner (abandonné) », « Le rêve qu'on croit réaliser (réalisé) ».
Ajoutons en passant une autre équivoque, purement syntaxique celle-là,
provoquée par la valeur tantôt active, tantôt passive de l'infinitif : « Je
l'ai vu peindre ». On connaît l'anecdote de ce maquignon qui avait vendu
un cheval aveugle en l'accompagnant de cette attestation : « Je garantis
260avoir vendu à M. X. un cheval gris pommelé à tous crins ; qu'on le fasse
voir ; je le garantis sans défauts ». On constate donc qu'une phrase prononcée
de vive voix sous la forme « Je la vois dessiné » peut avoir trois
sens différents : « Je vois qu'on la dessine, qu'on l'a dessinée, qu'elle
dessine ».
c) Déterminatifs
422. L'usure des désinences, disions-nous, a été compensée par la création
de morphèmes préfixés au mot. Mais il peut arriver que cette compensation
soit insuffisante : ainsi l'expression du nombre en souffre, les actualisateurs
ne l'indiquant pas par eux-mêmes, ou ne l'indiquant que dans
une partie des cas.
Les nombreuses ambiguïtés qui en résultent sont supprimées par l'orthographe,
mais elles subsistent pour l'oreille. Nous conseillons donc de procéder
pour les exemples suivants comme pour les précédents (415), c'est-à-dire
de les prononcer à haute voix devant une personne de langue française
et de lui demander comment elle les interprète. Inutile d'ajouter
que l'allemand, grâce à ses flexions, ne présente presque jamais d'équivoques
de ce genre ; comparez « Pas de rose(s) sans épine(s) » et« Keine
Rose ohne Dornen ».
423. Devant consonne, il et elle ne se distinguent pas de ils et elles ;
le singulier et le pluriel sont confondus dans une foule de verbes de la
première conjugaison, au présent et à l'imparfait de l'indicatif : « ll(s)
marche(nt), elle(s) marchai(en)t », etc. Lui signifie « à lui » ou « à elle » :
« M. Durand a remis à Mme Dupont une somme de 20000 fr. qui lui appartient ».
Le peut être masculin ou neutre : « Votre argument est valable, mais
je l'ignorais » (l'argument ? le fait qu'il est valable ?). Nous peut être pluriel
ou singulier ; une très fine nuance, familière aux écrivains, mais aussi
aux conférenciers, est celle qui existe entre le pluriel de participation
(ex. : « Nous avons vu dans ce qui précède, dans la leçon d'hier, que … »),
et le pluriel de modestie (« Nous avons pensé que ce sujet mérite quelque
attention ») ; mais la confusion est possible, p. ex. : « Le langage nous amène
à penser que l'enfant raisonne sans rigueur logique ».
Quand un substantif peut être des deux genres, certains déterminatifs
ne permettent pas de reconnaître le genre : « Mon élève, ton enfant, son
esclave, cet(te) artiste, l'ours(e) ». Le cas de mon ami(e) est particulièrement
délicat.261
424. Le pluriel est signifié par l's final du déterminatif, mais cet s
n'apparaît que par liaison avec une voyelle initiale ; un mot commençant
par consonne ne se trouve donc pas quantifié ; c'est ce qui arrive avec
leur(s), quelque(s), maint(s), au(x) et celle (s). Exemples :
Monsieur et Madame Durand viendront dîner avec leur(s) fils et leur(s)
fille(s). — De jolies chambres claires, avec leurs poêles, leur canapé, leurs étagères
(J. de Genève, 21-1-26). — Les membres sont priés d'adresser à l'administration
leurs changements d'adresse (Circulaire d'une société). — Oh ! ces pauvres êtres
abandonnés, comme ils doivent haïr leurs mères ! (Maupassant). — Pouvez-vous
me donner quelque(s) conseil(s) ? — Il (Huysmans) m'avait toujours traité avec
amitié. Même je lui devais quelques bons avis et quelque recommandation
administrative (P. Valéry, Nouv. litt., 2-1-26, p. 1). — Nous avons lu maint(s)
récit(s), mainte(s) nouvelle(s). — Mes frivoles compagnons couraient aux plaisirs
et aux jeux. — Je songe aux lieux que je ne dois jamais revoir. — Trois gars bien
découplés, aux regards décidés (Theuriet). — S'intéresser au(x) grec(s) (Grecs,
Grecques). — Aux temps de ma jeunesse (R. L. P., J. de Gen., 10-1-26). — Cette
cravate me plaît mieux que celle(s) que j'ai vue(s) à l'étalage.
On sait que le style technique ne recule pas devant une solution telle
que « Cette consonne s'assimile à celle (s) qui la précède(nt) », qui est un
défi à la langue maternelle.
425. Les quantificateurs pas de, point de, plus de, moins de, peu de,
beaucoup de, combien de, que de, n'indiquent pas le nombre : « Sa fureur
ne connaît plus de borne(s). - Notre civilisation, en s'imposant à ce vieux
monde, lui a apporté jusqu'à présent plus de laideurs que de beauté (sic !
Dorgelès, Route mandarine, p. 57). — Je n'ai pas d'idée(s) bien arrêtée(s)
sur ce sujet. — Paul se présente à l'examen ; mais il a peu de chance(s). II
y avait trop d'amours-propres froissés. — Ce marin a vu beaucoup de
pays (du pays ? des pays ?). — Il n'y a pas d'exemple(s) de ce cas. — Sur ce
point, il y a peu de chose(s) à dire. — Que de grâces ! que d'esprit ! que de
ruse ! que d'amour ! » (Beaumarchais, Barbier, I, 6).
426. Tout peut être, sans que rien ne l'indique, adjectif singulier ou
pluriel, pronom masculin ou féminin, enfin adverbe. « C'était par un doux
soir d'automne, où les feuilles sèches, bruissant mélancoliquement, disaient
la fin de toute(s) chose(s). - Passage interdit à tous véhicules (style
administratif). — Toute(s) sorte(s) de questions. — Selon toute(s) probabilité(s).
- Je suis tout(e) à vous » (phrase prononcée par une femme !).
Ajoutons que l'oreille ne peut distinguer si même est adjectif ou adverbe
dans des tours tels que « Les rois même(s) ne sont pas à l'abri de la mort. »
262Dictez à quelqu'un cette phrase : « Nous avons scrupuleusement respecté
le texte de cet écrit, dans ses invraisemblances, ses anachronismes, son
orthographe et sa ponctuation mêmes, plus originales qu'exactes. »
Enfin on sait quelle importance le français attache à la séquence pour
marquer les fonctions grammaticales. Mais parfois cette indication est
insuffisante et ne compense pas la perte des flexions, par exemple pour la
distinction entre cas-sujet et cas-régime ; il suffit que le verbe soit ellipsé
pour qu'une équivoque se produise, comme dans « Cette femme aime son
fils plus que son mari » ou dans « Elle l'aime plus que lui » : on ne sait si
mari et lui sont sujets ou compléments d'objet. De même « Pierre traite
Paul en ennemi, Sophie quitte Anna rassurée (21, 276) ».
d) Fausses relations entre les termes de l'énoncé
427. La séquence progressive souffre aussi du déclin des flexions et
présente, par contre-coup, certains aspects pathologiques. L'obligation de
procéder par déterminations successives est si tyrannique que des équivoques
peuvent surgir dès qu'on cherche à s'en affranchir. Dans la phrase
« La fille du fermier nous vend des légumes », aucun doute n'est possible sur
l'identité du sujet ; mais cette autre : « J'ai vu la fille du fermier qui nous
vend des légumes », ne montre pas qui est le vendeur, le fermier ou sa fille.
Il y a donc équivoque quand un déterminant peut se rapporter soit au
syntagme entier qu'il détermine, soit à son second terme seulement ;
exemple : « Les fils de fonctionnaires morts à la guerre ». Dans la plupart
des cas, l'obsession de la séquence progressive nous incline à la seconde
solution, tandis que l'intention du parleur était peut-être de le rapporter
à l'ensemble. Même lorsque l'interprétation est claire, la construction
paraît étrange, parfois même burlesque : « montre de dame dont le dos
est émaillé ; bicyclette de dame ayant peu roulé ».
On voit que l'absence de flexions est pour beaucoup dans ces équivoques ;
aussi sont-elles moins fréquentes dans les langues comme l'allemand, qui
conservent encore des déclinaisons et des conjugaisons organisées : comparez
« la fille du fermier qui … » avec « die Tochter des Pächters, der (ou
die) … ». Les composés allemands, avec leur structure en tʼt, sont aussi
un remède aux fausses interprétations : comparez « die Pächterstochter,
die … ; Damenuhr, deren … ».
Le syntagme en question peut être de plusieurs espèces : un groupe
actualisé : le fils d'un fonctionnaire, travailler pour sa famille, un virtuel
263caractérisé : fils de fonctionnaire, vivre en paix, un agglutiné susceptible
de quelque analyse : fils à papa, rendre service. On comprend qu'il n'y a
d'ailleurs pas à insister sur les différences entre ces divers types, qui se
compénètrent souvent.
428. La détermination se fait par accord ou par rection ; dans l'un et
l'autre cas, il peut y avoir hésitation sur le déterminé ; a) accord : « bicyclette
de dame usagée » ; b) rection : « concours de beauté d'enfants, champion
du monde de tennis ».
a) L'adjectif épithète est souvent en cause. Les équivoques du genre
de « un professeur de droit allemand » sont fréquentes, et apparaîtraient
plus nombreuses si l'on faisait abstraction de l'écriture, comme dans « le
conseil des ministres italien ».
Dans beaucoup de cas, l'ambiguïté est dans la pensée même. Quand on
parle d'un bonnet de coton blanc, il est difficile de ne pas rapporter la qualité
au bonnet aussi bien qu'au coton. C'est cette même distribution qu'on
observe en allemand dans englische Literaturgeschichte.
Ailleurs, ce dédoublement de l'accord est impossible et il faut opter ; mais
la langue parlée nous laisse dans le vague quand cette séquence est employée
sans précautions suffisantes. Exemples : « Jugement de valeur
esthétique ; système de procédés propre(s) à une communauté linguistique ;
groupe d'études catholique ; feuille d'avis officiel(le) ». On risque constamment
de toucher à faux. Seulement cette erreur reste cachée, tandis qu'elle
éclate en allemand grâce à la flexion ; de là des tours tels que « goldene Hochzeitsreise,
reitende Artilieriekaserne », et le trop fameux « vierstöckiger Hausbesitzer »,
etc.
429. Le français use de différents remèdes pour supprimer l'équivoque ;
par exemple, il isole l'adjectif entre deux pauses que la graphie symbolise
par des tirets, des virgules ou des parenthèses : « une base — très utile de
discussion ; une richesse, étonnante, d'érudition ». Cependant M. Alf
Lombard (Constructions nominales, p. 117 ss.) montre que cette intercalation
est usuelle surtout dans les groupes rectionnels : « arrestation,
à Pantin, d'une bande d'apaches internationaux ». On connaît par le § 70
la nature de ces intercalations : elles dérivent de la coordination, et ne
sont guère en accord avec les traditions de la langue écrite, où ces constructions
se rencontrent.
La langue littéraire recourt à l'antéposition de l'adjectif pour supprimer
les fausses relations ; on parle de « la générale impudeur des politiciens » ;
264on lit dans R. de Gourmont, Culture des idées, p. 140 : « les partielles origines
païennes du catholicisme ». Mais la langue usuelle répugne à l'antéposition
de l'adjectif, surtout quand celui-ci a une valeur spécialisante (367).
430. Les fausses relations sont à craindre quand deux adjectifs se rapportent
au même substantif au pluriel, comme dans « les littératures française
et anglaise » : les adjectifs sont instinctivement pensés au pluriel,
même si cette interprétation est absurde ; la détermination de proche en
proche des signes en contact l'emporte sur la logique. A l'audition, « les
dialectes dorien(s) et ionien(s) » est équivoque pour un helléniste ; et que
penser de cet exemple : « Monsieur X., professeur de langues grecque et
orientales » ! Aussi la langue actuelle répugne-t-elle à employer cette syntaxe.
La variante « la littérature française et l'anglaise » ne vaut guère
mieux : le second adjectif risque de passer pour un substantivé.
431. Inversement, un adjectif peut qualifier deux substantifs. Alors
l'habitude des rapports par juxtaposition amène à attribuer l'adjectif au
second substantif seulement : « une dame et une demoiselle très aimable (s) ».
L'orthographe tranche la question, mais l'audition laisse des doutes.
Si les deux substantifs sont de genres différents et que l'adjectif distingue
le masculin et le féminin, la difficulté est encore plus grande : quand
l'adjectif suit le substantif féminin, on a le sentiment d'un barbarisme :
« un monsieur et une dame élégants », « La musique devient besoin et denrée
internationaux » (Nouv. litt., 28-3-31). Il n'est pas rare qu'on s'en tire
par un accord unilatéral illogique : « Tout l'ensemble rayonne autour de
ce sommet avec un ordre et une symétrie parfaite » (Grammont, Le Français
moderne, 6, p. 51).
Si l'on renverse les termes (« une dame et un monsieur élégants », on
pense instinctivement que le second substantif est seul qualifié. Cf. « Manuel
de langue et de style français », « Le langage de la politesse repose en grande
partie sur des conventions et des tabous sociaux ».
L'amphibologie est moindre quand les deux substantifs forment un collectif
(146) : « les parents et amis invités à la noce ; les mandats et colis
postaux » ; mais dans « grammaires et travaux spéciaux relatifs aux langues
slaves », spéciaux semble se rapporter à travaux et relatifs aux deux
substantifs !
432. Rappelons que les fausses relations sont particulièrement dangereuses
dans l'accord du relatif avec son antécédent, dès que celui-ci n'est
pas dans son voisinage immédiat. On connaît trop les obscurités du genre
265de « tendances à l'acte qui avortent », les pataquès comme « empoisonnement
du sang dû à un remède pour les cors aux pieds dont on a trop abusé ».
Comme pour l'adjectif intercalé, l'isolement entre deux pauses peut ici
rendre des services : « Il y a un acte, dans cette tragédie, qui nous a fait
verser bien des larmes. — Il y a une foule d'usages, dans nos provinces,
qui sont ridicules ». Le tour « Celui-là est un misérable, qui trahit un ami
dans le danger » n'est pas dangereux, le relatif se rapportant naturellement
au démonstratif ; mais seule la langue littéraire en fait usage. Il
en est de même de la répétition du substantif, procédé d'ailleurs peu élégant :
« On a enfin réalisé le projet de simplifier l'administration, projet que
l'on discutait depuis si longtemps ».
433. b) La rection à distance ne ménage pas moins de surprises désagréables :
« Vocabulaire par l'image de la langue française, par Pinloche. Ecole
secondaire et supérieure des jeunes filles de Genève. -Ramener les
esprits égarés par la douceur. - On cherche une jeune fille qui couche chez
elle pour prendre soin d'un enfant. — Les Egyptiens avaient grand besoin,
pour leurs palais et leurs temples, de bois. — Flavius Josèphe et la reine
Bérénice tenaient des propos agréables à Titus, destructeur de Jérusalem
(A.France, Pierre blanche, p. 147). — Le prochain numéro de la nrf
contiendra une lettre sur les faits divers d'André Gide » (nrf du 1-3-27).
434. Ces fautes sont en partie la rançon du style substantif qui sévit
aujourd'hui en français (591). L'accumulation des substantifs aligne des
séries de groupes prépositionnels qu'il est souvent difficile de concilier
avec la séquence progressive. Parmi les prépositions, l'une est plus fréquente
que toutes les autres, c'est de, qui est devenu un pur outil grammatical
(maison de pierre, maison de rapport, maison de Dieu, aimé de ses
parents, s'emparer d'une ville). De là des séquences particulièrement embarrassées,
comme : « record du monde de hauteur ; cours du soir des commis ;
livre d'images d'animaux, etc. ».
Comment la langue met-elle de l'ordre dans ce fouillis ? Elle emploie
d'abord le procédé, déjà signalé au § 429, de l'isolation intercalaire : « arrestation,
à Pantin, d'une bande d'apaches internationaux ». Mais elle use
d'un remède plus général : les adjectifs de relation, dérivés de substantifs,
c'est-à-dire transposant des groupes rectionnels (147) ; chaleur solaire pour
« chaleur du soleil », monde stellaire pour « monde des étoiles », etc. L'abondance
de ces faux adjectifs va de pair avec celle des substantifs ; il y a
solidarité entre les deux classes. Il s'ensuit qu'on évite la succession des
266groupes prépositionnels en les transposant en adjectifs : au lieu de « histoire
du temps présent de toutes les nations », on dit « histoire universelle
contemporaine » ; au lieu de « revue des universités de Suisse », « revue universitaire
suisse ». De cette façon, l'on peut commodément faire alterner l'accord
et la rection, comme dans « société coopérative de consommation ». Mais
il est facile d'abuser du procédé, et de remplacer l'entassement des compléments
de rection par l'accumulation des compléments d'accord :« société
coopérative suisse de consommation », « union pédagogique suisse de musique ».
On se moque beaucoup de ce « style adjectif » greffé sur le style substantif 1106.
435. Le besoin des relations par juxtaposition a une conséquence plus
lointaine : on rapporte instinctivement les représentants aux mots les plus
rapprochés, sous peine d'équivoques souvent graves ou ridicules : « La
tâche serait belle ; et, à moins que notre société soit destinée à un effondrement
prochain, il faut qu'elle ne soit pas impossible. — Ses yeux restent
obstinément fixés sur le papier et l'on n'en peut saisir ni la nuance, ni
l'expression. — Mme A. a étudié les divers exercices qui ont été proposés,
et, à la suite d'une recherche poursuivie sur quelques centaines d'enfants,
elle en a confectionné un à sa façon (J. de Genève, 13-7-27) ».
Les possessifs donnent lieu, naturellement, aux mêmes ambiguïtés : « La
cour d'assises de la Haute-Vienne a eu à juger un sinistre individu, le
nommé B., poursuivi pour avoir tué le chauffeur d'automobile Faure et
son ami P., auquel l'unissaient des liens inavouables (J. de G., 11-6-29) ».
La séquence progressive et le système
phonologique du français moderne.
Structure de la syllabe
436. Nous avons déjà signalé (315 s.) la correspondance, au moins relative,
qui existe entre l'ordre des mots et le rythme accentuel ; nous disions
que, dans la règle, la séquence anticipatrice a pour corrélatif un système
baryton ou descendant, et la séquence inverse un rythme oxyton ou
ascendant ; ce qui n'empêche pas le rythme de se désolidariser de la
structure grammaticale, surtout dans les syntagmes serrés.
Le rythme oxyton du français et le rythme baryton de l'allemand se
retrouvent dans toutes les formes syntagmatiques. La phrase française
267porte l'accent sur le prédicat : « La terre tourne. — La terre est ronde. »
Dans les parties de la phrase et les mots, l'accent frappe le déterminant :
« quand il pleut ; du haut des monts ; un chapeau gris ; pot à lait, porte-plume,
etc. », ou au moins, le plus souvent, l'élément lexical s'il n'y en a
qu'un : « mon chapeau ».
Enfin le mot porte aussi l'accent sur la syllabe finale, cette fois sans
égard à la séquence ; c'est, comme nous le verrons § 495, l'indice de la
faiblesse de ses articulations internes (préfixe, racine, suffixe), et de la
prédilection du français pour le mot simple 1107.
La syllabe elle-même est oxytone (ou ouverte), au moins dans la couche
romane du vocabulaire, car dans la majorité des cas, elle se termine par la
voyelle, qui porte l'accent syllabique ; exemple : « un jo-li cha-peau grisfon-cé ».
437. Si le régime accentuel du français reflète assez bien la tendance
progressive de la structure grammaticale, l'accent allemand accuse avec
plus de régularité encore la séquence anticipatrice qui domine sa grammaire,
et cela d'autant mieux que cet accent est beaucoup plus intense
qu'en français.
En effet, dès que l'on quitte la phrase indépendante simple (« Dieser
Apfel ist rund. — Der Vogel fliegt »), cette concordance se vérifie, au moins
sous la forme mitigée de l'enveloppement (321). Ainsi dans les composés,
le déterminant précède le déterminé (cf. Stallknecht et valet d'écurie), et
c'est le déterminant, ici Stall, qui porte l'accent principal, le déterminé
n'ayant qu'un accent secondaire.
Dans les mots qui ont un préfixe fort et détachable, c'est lui qui, en
qualité de déterminant, est accentué : « abschneiden, austrinken, umziehen ».
Dans les suffixaux, c'est la racine (tʼ) qui porte l'accent : « Krankheit,
Maurer, Liebe » (sur l'accent suffixal des emprunts, voir 526). Les mots
simples ont l'accent initial : « Gabel, Messer, Hose ».
Enfin la syllabe est aussi barytone, car la voyelle, porteur de l'accent
syllabique, est « entravée » ou « fermée », c'est-à-dire suivie d'une ou plusieurs
268consonnes ou de leur équivalent rythmique (second élément de diphtongue
ou de voyelle longue) ; cf. « ein hüb-scher dun-kel-grau-er Hut ».
Ce régime de la syllabe a lui-même son pendant dans la forme des
mots proprement dits : les monosyllabes se terminent soit consonantiquement
(Storch, erst, Rand, Bad), soit par diphtongue (Tau, Ei), soit par
voyelle longue (Kuh, roh, See, nah, sieh), mais jamais par voyelle brève 1108.
On sait qu'en français cette voyelle doit être brève (450).
438. Etudions de plus près la syllabe française, afin de préciser certaines
modalités de la règle générale posée plus haut. Il faut se rappeler
avant tout que l'unité syntaxique française n'est pas le mot, mais le
groupe, et que les lois de correspondance qu'on peut établir entre la séquence
et le rythme ont pour base le groupe. Il va sans dire que les contacts
phoniques entre les mots ne produisent pas exactement les mêmes combinaisons
que le groupement des phonèmes dans le mot ; il n'en est pas moins
vrai que le régime de la syllabe française — nous allons le voir — s'étend
aussi aux groupes. En allemand au contraire, le mot conserve une grande
autonomie dans les complexes syntaxiques, et le régime syllabique peut
être étudié, beaucoup mieux qu'en français, sur la base du mot.
439. La syllabe française est — répétons-le — essentiellement vocalique :
elle est normalement constituée par une voyelle précédée d'une seule
consonne (qui peut faire défaut, à l'initiale : ami, ou à l'intérieur : créé).
Les syllabes où une voyelle (brève) est suivie d'une des consonnes légères
l ou r (celle-ci très peu perceptible dans le grasseyement normal) sont
déjà moins fréquentes (calmer, terne) ; s est relativement rare à cette
place (attester) ; historiquement, l et s à cette place n'appartiennent pas
à des mots de la couche romane, mais beaucoup d'entre eux sont d'un
usage courant. Les occlusives n'y apparaissent que dans les latinismes
(aptitude) dont quelques-uns sont, il est vrai, très usuels (excepté).
On ne peut imaginer d'opposition plus frappante entre le français et
l'allemand. La syllabe allemande, presque toujours barytone, tolère de
une à quatre consonnes à la fermante : Hut, Sitz, Wuchs, erst, Herbst,
selbst, etc. L'ouvrante, toujours consonantique (548), admet une ou plusieurs
consonnes : Heil, Tod, Tropf, Platz, Stuhl, Strich, des mi-occlusives :
zehn, Zwirn, pfeifen, Pfriem, Qual, des aspirées : Pʼute, pʼrahlen, Tʼon,
Kʼerl, Kʼrone, etc.
Il est intéressant de constater qu'en français l'évolution spontanée de
269la prononciation aurait pu faire triompher presque complètement le régime
syllabique oxyton. Les r fermants étaient en train de s'amuir à
l'époque de la Renaissance, p. ex. dans la finale -ir (finir, etc.) ; une réaction
puriste les a rétablis ; l avait été changé en u, puis la diphtongue
qui en résultait s'était monophtonguée (alteru → altre → autre → ótre) ; les
emprunts au latin l'ont fait reparaître (cf. altérer) ; c en fin de syllabe
avait créé, en s'altérant, des diphtongues simplifiées plus tard (factum → fait,
prononcé fè) ; s fermant s'était amui aussi (bestia → bête) ; il a été réintroduit
dans les mêmes circonstances que l (bestial). Les nasales fermantes
ont disparu de bonne heure après avoir nasalisé la voyelle (infantem
→ ãfã « enfant »). La nasalisation produite par nasale ouvrante a été
supprimée (bõ-ne est devenu bo-ne, écrit bonne). Les mi-occlusives, si
caractéristiques de l'ancien français (tch, dj, ts), sont aujourd'hui des
spirantes simples (chant, jour, cendre), cf. 446.
440. L'unité rythmique étant non le mot, mais le groupe, l'initiale et
la finale du mot sont traitées de façon à le lier aux autres ; il s'ensuit que
la syllabation du groupe reflète approximativement celle du mot.
A l'initiale, les groupes autres que consonne + y, w, ẅ, r, l (pied, poids,
puits, prix, pli) sont exceptionnels et n'apparaissent que dans les emprunts.
Dans ce cas, la coupe de syllabe est variable : tantôt la première
consonne peut être rejetée dans la syllabe précédente, qui est alors fermée
(un p-neu) ; tantôt — et c'est la règle dans la prononciation normale selon
M. Grammont, Traité de phonétique, p. 97 — les deux consonnes ouvrent
la syllabe, la précédente restant ouverte (un-pneu). Même possibilité
double pour le groupe s + consonne, assez bien représenté ; la prononciation
populaire favorise le rejet de s (la s-tatue), et, après consonne, une
voyelle fuyante ménage la transition ; cette prononciation, déjà connue
du latin vulgaire (spata, espata, fr. espée, épée), est encore familière au
parler populaire : une estatue. Mais la prononciation correcte favorise l'autre
coupe : la- statue, une- statue, régime qui augmente le stock des syllabes
ouvertes.
441. Les groupes consonantiques dont le second élément est une sonante
(w, ẅ, y, r, l) ne font pas position, autrement dit, appartiennent
entièrement à la syllabe qu'ils ouvrent, sans empiéter sur la précédente,
qui demeure ouverte. Ainsi aloi, écuelle, acier, après, éclat se prononcent
a-lwa, é-cẅel, a-syé, a-prè, é-cla ; la syllabe précédente se termine donc
par voyelle.270
On sait d'ailleurs que le groupe ly s'est encore simplifié en y (railler
se prononce ra-yé) ; il n'est maintenu, dans le langage correct, que par
contact étymologique ; ainsi rallier a ly parce qu'il est associé à lier,
comme million à mille, etc. L'orthographe contribue aussi à perpétuer
cette fluctuation : p. ex. le groupe ill (non suivi de i) symbolise le son y,
tandis que les graphies li et lli sont propres aux latinismes d'emprunt ;
cf. famille : familier.
442. Le français, on l'a vu, n'a pas de diphtongues, si l'on appelle ainsi
des groupes de deux voyelles dont la première occupe le sommet vocalique
et porte l'accent syllabique, comme p. ex. au dans le latin aurum et ai
dans all. Kaiser. La diphtongue (qu'il est superflu d'appeler diphtongue
« descendante » comme on le fait souvent) 1109 crée donc des syllabes barytones :
il est naturel qu'elle répugne au français.
L'ancien français a connu des diphtongues, par exemple éu, óu, éi, (ói),
úa ; il les a toutes éliminées par monophtongaison ou renversement. Ce
dernier cas est significatif : rói est devenu rwá (écrit « roi ») ; on peut dire
que le passage de ói à uá est le pendant phonique du passage séquentiel
de tʼt à ttʼ.
De nouvelles diphtongues surgissent cependant dans la prononciation
rapide de deux voyelles atones en hiatus : caïman, paysan, aéré, réussir, etc.
443. On a vu qu'en allemand, les diphtongues sont des pièces importantes
du système phonologique (exemple : tauchen, täuschen, weichen).
L'histoire nous apprend que cette langue a même connu des diphtongues
contraires à la succession naturelle de sons dans la syllabe. La seconde
voyelle d'une diphtongue est normalement plus fermée que la première ;
au contraire, dans des groupes comme ío, úo, la seconde est plus ouverte
que la première. Or, l'ancien allemand a dit líoban « aimer », múotar « mère »,
et ce genre de diphtongues est fréquent encore aujourd'hui dans les dialectes.
Il y a là une intervention de la volonté inconsciente, avec le concours
de l'accent d'intensité, en vue de satisfaire le rythme baryton 2110.271.
444. En français, les voyelles longues le sont très peu, et la longueur
varie selon la position dans le groupe. Autrement dit, la durée des syllabes
n'est pas un élément rythmique primordial. Au contraire, les longues normales
sont rythmiquement sur le même pied que les diphtongues : leur
seconde partie est toujours légèrement plus fermée que la première, elle
tend vers la diphtongue en accentuant sa durée, et vers la monophtongue
en la diminuant. En anglais, day, low, etc., prononcés d'abord dē, lō, sont
devenus plus tard dēi, lōu. En allemand, les longues se distinguent nettement
des brèves ; elles accentuent leur premier élément : lieben équivaut à
líiben. D'ailleurs, elles sont toujours prêtes à se changer en diphtongues :
Hūs est devenu Haus, Wīb Weib.
Mais si l'allemand possède des voyelles brèves, il n'a pas de syllabes
qui le soient réellement comme en français ; on le comprend aisément en
comparant la prononciation de la première syllabe de bouteille et de Butter.
En français, la voyelle se détend avant la tension de la consonne (« loser
Anschluss »), celle-ci appartient tout entière à la syllabe suivante. En allemand,
au contraire, la consonne est prononcée pendant la tenue de la voyelle
brève ; elle est, pour ainsi dire, attirée dans la syllabe précédente, qui se
trouve ainsi partiellement barytonée. Le même phénomène s'observe en
anglais, où capital se prononce presque cap-ital. L'orthographe allemande
double la consonne précédée d'une voyelle brève (Hütte, essen, irren,
bellen) : cet usage symbolise en quelque mesure la prononciation réelle,
et la séparation des syllabes dans l'écriture et la typographie reflète cette
particularité : l'allemand coupe « die Prob-leme des Lebens », le français
« les pro-blèmes de la vie » ; l'anglais sépare cap-ital, le français ca-pital.
C'est sans doute cette anticipation qui explique que dans l'allemand
commun le son écrit ch se prononce x guttural après voyelle d'arrière
(a, o, u : Bach, Loch, Buch), mais se palatalise en ç après voyelle d'avant
(e, i, ö, ü : Bäche, sicher, Löcher, Bücher). Notons qu'en grec moderne
cette même alternance x/ç existe, mais dépend de la qualité de la voyelle
272suivante (échō, échi « j'ai, il a » sont prononcés éxo, éçi) ; cela semble indiquer
que l'ouvrante n'empiète pas, comme en allemand, sur la syllabe
précédente.
445. L'allemand a des sonantes voyelles ; le français les ignore, au moins
à l'intérieur des mots. Nous appelons sonantes les phonèmes r, l, m, n,
fonctionnant comme voyelles, ce qui veut dire, en réalité, que les consonnes
r, l, m, n sont précédées d'une voyelle réduite que nous assimilerons,
faute de mieux, à notre e caduc (ə). Ainsi un groupe tel que vlk se prononce
vəlk si la sonante est voyelle (comme p. ex. en tchèque). On comprend
que des syllabes de ce type, sans cesser d'avoir un sommet vraiment
vocalique, font l'impression de ne contenir que des consonnes, et la syllabe
est nécessairement barytone, la voyelle étant toujours suivie de la
sonante.
Les sonantes voyelles sont abondantes en allemand ; cf. la prononciation
de « allerlei, Rittertum, Adelstand, Atemzug, Gerstenmehl ». En français,
au contraire, jamais de sonantes voyelles, qui compromettraient le
caractère vocalique de la syllabe ; l'ordre des éléments est inverse ; on
prononce krəvé (crevé) ; kərvé est une prononciation dialectale ; cf. ãpləmã
(amplement).
D'une façon générale, l'e caduc français termine toujours la syllabe à
l'intérieur des mots ; une syllabe fermée ne tolère que é ou è : comparez
levons et lève, lèv(e)rai, Genève et Gèn(e)vois (la prononciation Gen(e)vois
est particulière au parler local). Ce n'est qu'en sandhi (c'est-à-dire dans
la phonétique de groupe) qu'apparaissent les groupes e caduc + consonne
fermante, comme dans je l(e) vois, que d(e)mandez-vous ?, etc. Si l'on prononce
dev(e)nir, rel(e)ver, etc., c'est que l'e caduc est contenu dans un
préfixe ; c'est un cas-limite de sandhi.
446. Le français d'aujourd'hui n'a pas de mi-occlusives telles que ts,
pf, tch qu'on trouve en allemand (sitzen, hüpfen, Deutschland), et dont
les éléments risqueraient de se répartir entre les deux syllabes. L'ancienne
langue — on l'a vu — connaissait tch, dj, ts (qui se prononçaient, il est vrai,
en une seule émission) ; ainsi les formes correspondant à chèvre, jour, cerf
étaient alors tchièvre, djour, tserf. La langue française s'est débarrassée
de ces sons complexes, en sorte que, actuellement, leur présence dans la
chaîne parlée ne peut provenir que du contact des mots entre eux, et
constitue un indice de sandhi : cf. tout(es) ces choses, tout(es) choses,
grand(e) joie, troup(es) fraîches, etc. (voir 539).273
447. La tendance au type de syllabe oxyton e pousse à reproduire de diverses
manières les groupes de consonnes fermants, qui se présentent presque exclusivement
dans les emprunts, d'ailleurs très nombreux, au latin et au grec.
L'un des procédés employés à cet effet est la prononciation explosive
des consonnes fermantes ; ainsi actif, aptitude, abcès, etc. sont souvent
prononcés akʼtif, apʼtitude, apʼsè, l'apostrophe désignant l'explosion de la
consonne, qui équivaut, en somme, à une voyelle embryonnaire ; cette
particularité apparaît bien si on l'oppose à la prononciation allemande
des mêmes-groupes ; p.ex. aktiv réduit le k à l'implosion et le soude au t
suivant (cf. Roudet, Elém. de phonét. générale, §§ 92-94). Dans un groupe
plus touffu, c'est-à-dire quand la syllabe se termine par deux consonnes,
cette explosion devient un vrai e caduc : le peuple prononce exprès comme
eksəprè. A cela vient s'ajouter l'opposition signalée plus haut à propos
de fr. bouteille et all. Butter : il s'agit de la détente relâchée des voyelles
devant consonne, qui sépare nettement la prononciation française de celle
de l'allemand et de l'anglais : dans un mot comme capter, un Allemand
prononcerait le p pendant la détente de l'a, avec lequel il a l'air de se
fondre ; le français relâche l'a avant l'émission du p, qui, par suite, ouvre
une syllabe dont la voyelle naissante est fournie par l'explosion, de sorte
que la prononciation exagérément française du mot serait ca-pə-té. On a
vu (440) qu'une autre solution, radicalement différente, consiste à rejeter
le groupe entier dans la syllabe suivante, la précédente étant, par suite,
ouverte (a-pti-tude). Cette prononciation, la seule normale selon M. Grammont,
n'est cependant pas seule en usage.
448. La fin de mot est constituée généralement, dans les mots usuels,
par une voyelle, ou par une consonne unique (pas, clé, cri, mot, vu, repas,
décidé, ami, dépôt, rebut ; pâte, râpe, aile, art, pose, masse). Si les groupes
occlusive + r et l sont relativement fréquents (ombre, table), r et l dans
cette position sont prononcés à voix chuchotée, et souvent amuis devant
consonne : quat(re) soldats, tab(le) carrée, etc. Mais le fait capital est que
la ou les consonnes finales tendent à être ouvrantes à la pause ; les occlusives
sont suivies d'une légère détente : tête se prononce têt' ; cap = cap' ;
les consonnes continues explosent aussi, ou plus normalement s'allongent :
ainsi fr. bal se prononce autrement que l'allemand Ball ; l, dans le premier
cas, est un peu prolongé.
Il s'ensuit 1) que les consonnes finales tendent à former syllabe par
elles-mêmes ; 2) qu'elles se lient très facilement avec une voyelle initiale
274suivante, de sorte que la syllabe précédente se termine vocaliquement ;
cf. tê-t'à lʼévent, ta-blʼà tiroirs. Il va sans dire que la présence ou l'absence
d'un e final dans l'orthographe ne joue aucun rôle dans la question ; cap
et cape se prononcent de la même façon, c'est-à-dire kape.
449. Les liaisons sont de règle dans l'intérieur des groupes. De ce fait,
une consonne finale se trouve rejetée dans la syllabe suivante et fait
corps avec le mot auquel cette syllabe appartient : « les hommes, trop
aimable » se prononcent lé-zom, tro-pèmable ; la syllabe précédente est donc
le plus souvent ouverte. Entre deux modes de liaison, la langue d'aujourd'hui
évite celle qui fermerait cette syllabe ; ainsi -rs se lie plutôt par r
que par z ; « vers elle » se prononce vèr èl et non vèrz èl ; « toujours actif » =
toujou-ractif. (Sur le cas de vers z harmonieux, voir § 408 n.). Le -t de la
troisième pluriel ne se lie, dans le parler usuel, qu'après voyelle : ils von-t à
Paris ; après consonne, cette prononciation paraît lourde ; on dit Ils
march(ent) en mesure et non ils march't en mesure. Dans ce cas, la versification
classique lie bien le t, mais elle conserve l'e caduc qui précède, ce
qui produit quand même une syllabe ouverte : « Toutes les passions
s'éloignent avec l'âge » (= s'éloignə-tavec).
450. Toute voyelle en finale absolue est brève (cf. là, échalas ; las, prélat ;
moi, émoi ; pré, diapré ; si, ici ; tôt, paletot ; pou, époux ; vœu, neveu ; lin,
malin ; son, chanson ; un, alun ; etc.). L'e caduc, amui après une voyelle
finale, et qui l'allongeait autrefois, la laisse brève aujourd'hui, au moins
dans la prononciation parisienne : jolie ne se distingue plus guère de joli.
Une preuve indirecte de la quantité brève des voyelles finales, c'est que
conformément à une tendance générale des brèves, elles sont fermées
ou cherchent à le devenir. Elles y parviennent dans la mesure où leur
aperture propre est moins grande (échelle à, œ, è, à). Ainsi tout ò ouvert
a passé à ó fermé (pot, dévot) ; de même, tout œ est fermé en finale absolue
(pierreux) ; è ouvert passe de plus en plus à é fermé : mai, quai, je sais,
j'ai ; des prononciations telles que biyè pour « billet », pé pour « paix »
gagnent du terrain ; è est maintenu dans les grandes catégories grammaticales,
telles que les désinences verbales -ais, -ait, -erait ; pour a, l'évolution
est encore incertaine.
451. On comprend qu'un régime syllabique qui pratique l'oxytonie,
qui ne distingue pas rigoureusement les voyelles longues des brèves, et
qui fait une grande économie de consonnes, doit aboutir à réduire le nombre
des types syllabiques possibles, malgré la diversité des timbres vocaliques
275(un des caractères fondamentaux de la phonologie du français : à á, è é,
i, ò ó, u, ou, œ̀ œ́, ã ẽ õ œ̃). Or cette uniformité des syllabes françaises
contraste violemment avec la variété infinie des syllabes allemandes.
Une curiosité, qui semblera puérile, fait éclater cette différence : on peut
former un grand nombre de mots, de groupes de mots et de phrases avec
les noms des lettres de l'alphabet ; c'est que tous, à l'exception de x, y, z,
se composent d'une consonne suivie d'une voyelle, ou vice versa. Exemples :
a-b, a-c, a-g, e-p, a-t ; g-u, g-e-t-a-b-c, etc. Une petite biographie plaisante
de la belle Hélène commence ainsi : Lnneopy ; liatt ; liavq, etc. Ce petit
jeu serait évidemment impossible dans une langue à syllabation variée.
452. On doit s'attendre à ce que cette uniformité de la syllabation ait
des aspects pathologiques : il est clair que des combinaisons de sons taillés
sur un petit nombre de patrons (dont le plus ordinaire est tatata) peuvent
amener dans la chaîne du discours des rencontres désagréables, ou créer
des ambiguïtés, grâce à l'abondance des mots qui se ressemblent. On se
moque des gens qui risquent dans la conversation « Je n'aime pas ton ton ;
c'est cet été qu'il a le plus plu ; j'aime les mûres mûres », etc., sans songer
que c'est la langue qui nous tend constamment ces pièges. On connaît
l'obligation d'employer tantôt on, tantôt l'on selon que l'un ou l'autre
amènerait des concon ou des lonli (« Ce n'est pas un secret qu'on confie à
tout le monde. — C'est un roman que l'on lit avec plaisir. — Il mérite que
l'on l'en loue », etc.).
453. Il est facile de voir, d'autre part, que l'uniformité syllabique contribue
à créer des homonymes, particulièrement nombreux dans les monosyllabes
(le monosyllabisme est un effet ultime de la condensation, dont
il sera question au § 495) : cf. un ver, vert, un vers, vers (moi), verre, vair ;
air, aire, ère, erre, hère, haire ; sceau, seau, saut, sot, etc. C'est encore cette
structure de la syllabe qui fait que des mots longs peuvent être coupés
en plusieurs tronçons : l'admiration (la demi-ration), marraine (ma reine),
désavantages (des avantages). De là la plaie des calembours, qui seraient
impossibles, à ce degré, dans une langue à syllabes diversifiées : calorifère
(qu'alors y faire), une tentation (une tante à Sion), etc.
Ainsi nous constatons une fois de plus que les formes pathologiques du
langage correct peuvent servir de réactifs pour déceler les tendances générales
d'un idiome.
454. Faut-il ranger dans la même catégorie la prononciation artificielle
du vers français ? On en a beaucoup parlé ; ainsi la conservation de l'e
276caduc (Je ne te reverrai jamais en huit syllabes !) a fait couler des flots
d'encre. Cette tradition, qui est un défi à la prononciation vivante, est
certes une anomalie, une exagération pathologique ; mais elle doit avoir
une raison d'être plus profonde.
Le conservatisme de la prosodie française ne se justifie pas seulement
par la force, d'ailleurs réelle, de la tradition et par le besoin instinctif
d'établir un contraste avec le parler banal. Il est certain que le maintien
persistant de l'e caduc, dans une foule de cas où la prononciation moderne
le supprime, a pour but (et pour effet) d'empêcher la formation de syllabes
fermées (barytones) telles que mon ch'val, un'mère, cap'de moine, etc.
(cf. Meillet, BSL, XXIV, p. 106). On connaît le vers de Victor Hugo :
Donne-lui tout de même à boire, dit mon père.
M. Vendryès a montré plaisamment que la prononciation actuelle du
français permettait de l'allonger de trois mots sans augmenter le nombre
des syllabes :
Donn'lui tout d'mêm'à boir' un'goutt'd'eau, dit mon père.
La diérèse, parfois si éloignée de l'usage actuel (cf. nation prononcé
na-si-on), concourt au même résultat, en maintenant ou en créant des
syllabes ouvertes ; en effet i, u et ou, en devenant y, ẅ et w, produisent
des groupes consonantiques qui risquent de fermer la syllabe précédente ;
comparez « dé-di-er et dé-dyer (ou déd-yer), nous lou-ons et nous lwons,
la bu-ée et la bẅée », etc.
La conséquence est évidente : la prononciation archaïque de la poésie
permet de multiplier les syllabes ouvertes, qui sont un des traits caractéristiques
de notre langue, et dans lesquelles la variété des timbres vocaliques
prend toute sa valeur. Dans la première strophe du Lac
Ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages,
Dans la nuit éternelle emportés sans retour,
Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges
Jeter l'ancre un seul jour ?
on compte, sur 42 syllabes, 32 ouvertes, 5 terminées par r et une seule par l ;
en outre, les quatre consonnes terminales de vers peuvent être comptées
comme mi-ouvertes, puisqu'en français une consonne finale se détend à
la pause et crée une syllabe embryonnaire (448) ; la voyelle qui précède
n'est donc pas réellement entravée.277
Ainsi la prosodie traditionnelle n'est que la systématisation d'une tendance
profonde du rythme français, et un garde-fou contre les dangers
qui menacent son intégrité.
455. Or, ces dangers existent ; certains indices montrent que le régime de
la syllabe française est compromis. Trois facteurs principaux sont en jeu :
1. Les latinismes reflètent la syllabation du latin ; le type syllabique
le plus fréquent dans cette langue, outre les syllabes brèves, était constitué
par voyelle + une fermante, celle-ci étant ou une consonne : « aptus, altus,
ar(c)tus, etc. », ou le second élément d'une diphtongue : « laetus, aurum »,
ou d'une longue : « tōtus, fāri », ou le premier élément d'une consonne géminée :
« collum, vacca », etc. La couverture syllabique est en outre épaissie
par voie de pré- ou de suffixation ; or, la plupart des mots formés en français
avec des éléments latins sont des préfixaux ou des suffixaux ; de là
des vocables tels que ex-clure, sug-gérer, abs-trac-tion, im-mix-tion, si contraires
à la coupe syllabique usuelle. On sait que les latinismes authentiques
ne sont pas seuls responsables, et que l'orthographe latinisante du
XVe et du XVIe siècles a laissé sa trace dans la prononciation (cf. obs-cur,
autrefois os-cur ; voir FM II, 1, 60 ss.). Le peuple montre, en toute occasion,
sa répugnance pour ces accumulations de consonnes : il prononce
oscur, escursion, artisse, sétembre, cataplasse (ou cataplame). Ce sont notamment
les latinismes qui ont introduit chez les gens cultivés l'habitude
des consonnes doubles, ou longues, que le français ordinaire ignore. On
en vient à prononcer col-lègue, gram-maire, et ainsi pour tous les mots
qui ont une saveur technique ou un air de distinction. On ne double pas l
dans collation quand ce mot désigne un repas léger, mais on parle de
la col-lation d'un grade.
456. 2. Le langage affectif menace aussi le rythme oxyton, comme il
bouscule la séquence progressive grammaticale ttʼ. De même qu'il tend
à anticiper par le déterminant sur le déterminé (« Magnifique, ce tableau ! »),
de même il fait remonter l'accent vers le début du mot. Ainsi dans les
mots à nuance affective (tours exclamatifs, jurons, etc.), l'accent frappe la
première syllabe commençant par consonne, et cette consonne est allongée
et risque toujours de devenir géminée, d'où déplacement de la frontière
syllabique : la ccanaille, ce ssalaud, l'imbbécile, etc. (voir Grammont, Tr.
de phon., p. 53 ss.).
Une tendance affective moins violente a pour effet de modifier aussi,
mais différemment, la coupe de syllabe dans les groupes consonne + r, l
278(pr, pl, br, bl, fr, fl) : la tension musculaire marquant le début de la syllabe
passe du premier au second élément du groupe ; une prononciation caressante
et légèrement artificielle amène des coupes syllabiques telles que
« La b-rise eff-leure la b-lancheur éb-louissante des roses ». Dans ce cas
aussi, création de syllabes fermées.
457. 3. Enfin l'amuissement de l'e caduc est en train de modifier profondément
l'aspect de la syllabe. Bien que cet amuissement soit entravé
par une très forte tradition, il étend sans cesse ses ravages. Sur l'état actuel,
on consultera Grammont, Prononciation, p. 105 ss., et F. Leray, Revue
de philol. fr., 42, p. 161 ss. ; mais les règles proposées ne semblent pas entièrement
satisfaisantes. Quoi qu'il en soit, il suffit de citer au hasard :
un ch'val, nous j'tons, am'ner, je n'vois rien, etc., pour montrer que la
disparition de la voyelle crée de nouvelles syllabes fermées.
458. Le traitement de l'e caduc n'est pas simple. Il faut tenir compte
des différences régionales (l'amuissement est plus étendu dans l'Est, et, par
exemple, à Genève) ; le parler populaire a ses particularités ; la rapidité
du débit et l'affectivité entraînent des changements spéciaux ; enfin l'analogie
crée des généralisations arbitraires, notamment des « groupes figés » :
je n(e), de n(e), c(e) que, etc. Toutefois, en se fondant sur la prononciation
moyenne du parler parisien, on peut, semble-t-il, énoncer la règle
générale suivante : l'e caduc est maintenu après un groupe de consonnes,
et tombe partout ailleurs. Exemples : emball(e)ment : emportement, pur(e)té :
propreté, mercredi 1111.
Le groupe de consonnes qui arrête la chute de e peut résulter de l'amuissement
d'un premier e : ell(e) me croit, j(e) te l(e) donne, etc.
En outre, e final de mot tombe en toute position ; on opposera donc « le
gouvernement » et « les lois qui gouvern(ent) mon pays ». Sur les finales
du type quatre et table, voir plus haut § 448.
459. Le nombre et la qualité des consonnes suivant un e caduc n'ont
aucune influence sur son maintien ou sa disparition ; de sorte que, s'il
tombe, sa chute peut faire surgir des groupes de deux, trois, ou même
quatre consonnes. Nous ordonnons les exemples d'après la nature des
groupes consonantiques suivant le e :279
1) ell(e) vient (l-vy), nous n(e) voyons rien (n-vw), cett(e) cuisine (t-cẅ),
paill(e) fraîche (y-fr), dans c(e) trou (s-tr), vign(e) vierge (ñ-vy), un(e)
cloison (n-clw), quell(e) froideur (l-frw).
2) un(e) statue (n-st), cett(e) spirale (t-sp), grand(e) sphère (d-sf), dans
l(e) square (l-skw).
3) un(e) pneumonie (n-pn), gentill(e) tzigane (y-ts), l'époux d(e)
Xanthippe (d-gz).
Comme e ne tombe qu'après une seule consonne, celle-ci, d'ouvrante
qu'elle était, devient fermante (u-ne-fois → un'-fois). Ainsi la disparition
de l'e caduc a pour effet de créer en français des syllabes barytones à consonne
fermante unique. Seuls les groupes consonne + e + r, l sont entièrement
ouvrants, la syllabe précédente est fermée par voyelle : il fon-d(e)ra
(de fonder, comme Il fon-dra, de fondre), il é-p(e)la comme il est plat,
tu t(e) lè-v(e)ras comme lé-vrier, etc. 1112
460. Si ce régime se stabilise, on peut penser que le français rejoindra
le régime syllabique du latin, qui, lui aussi, ne tolérait guère qu'une
fermante ou ses équivalents rythmiques (diphtongues, voyelles longues ;
voir § 455, 1 et Actes du IIe Congrès internat. de ling., p. 116) ; régime
qui subsiste, sous une forme simplifiée et, pour ainsi dire schématisée,
en italien. Cette langue n'admet, au moins sous l'accent (sauf en finale
vocalique : città, udí, troveró), aucune syllabe brève, mais seulement des
voyelles suivies de s, l, r, m, n (festa, alto, tomba, sponda), des voyelles
longues (tela, cielo, cuore), enfin, et en grand nombre, des voyelles brèves
suivies de consonnes géminées (bella, notte, assai).
Mais la structure syllabique résultant de la chute de e diffère de ce régime
par un caractère important : les groupes de consonnes ainsi créés
sont disparates et admettent la rencontre de sourdes et de sonores (lr, jt,
chv, qu'd, gn'z, etc.), chose inouïe en italien ; en outre, tandis que dans cette
280langue la frontière de syllabe montre un parfait accord des tensions et
détentes avec l'aperture relative des phonèmes (voir § 443 n.), le français
n'observe pas cette concordance : haqu'née, en ch'min, je m(e) veng(e)rai,
etc.
461. L'amuissement de l'e caduc nous permet enfin de voir au travail
la tendance qui, depuis toujours, pousse le français à réduire le volume
de ses mots. Comme il s'agit là de l'aspect phonétique d'une tendance
générale, la tendance condensatrice, nous sommes amenés par une transition
commode à envisager cette dernière sous un angle plus large. Ce
sera l'objet de la deuxième section.281
Deuxième section
Tendance condensatrice283
Vue d'ensemble
462. Nous avons étudié dans les pages précédentes les faits qui montrent
le français orienté vers l'idéal analytique sous ses deux formes fondamentales :
la lutte contre les signes non linéaires (surtout le système
désinentiel) et la prédominance de la séquence progressive.
Conformément à notre plan (308), nous aborderons maintenant les caractères
du français qui le rapprochent du type synthétique ; ils ont été
esquissés au § 312, et plusieurs passages de ce livre ont précisé des points
de détail. Nous insisterons avant tout sur un fait principal : le passage
de l'autonomie du mot à l'autonomie du groupe syntaxique, dont le corrélatif
est le groupe rythmique à accent oxyton (436) ; il s'agit d'un fait
général de condensation dont les effets se font sentir dans toutes les
parties du système et rejaillissent sur l'expression de la pensée par la langue.
463. Nous voyons ce processus de tassement à l'œuvre dès les origines
du français. Mais tant que l'ordre des mots est demeuré relativement
libre (326), les groupes syntaxiques n'ont pas été sérieusement atteints
par cette tendance ; elle s'exerçait surtout sur les unités. L'évolution phonétique
de l'ancien français se résume dans une vaste opération de resserrement
des mots ; il suffit de rappeler le sort général des consonnes intervocaliques
pour montrer à quel point les syllabes ont pu se fondre les
unes dans les autres : auca → oie, patrem → père, securum → sûr, pavorem →
peur,
etc. Aucune autre langue romane ne présente des réductions comparables
à aqua et altu → o (« eau » et « haut »), medium → mi, augustu → ou
(« août »), rotundu → rõ (« rond »), etc.
Les sous-unités s'agglutinent au sein des mots, de sorte que ceux-ci
deviennent peu à peu des unités simples, indécomposables ; c'est-à-dire,
selon la terminologie saussurienne, arbitraires.
En français moderne, les mots restés analysables sont eux-mêmes attaqués,
bien que les emprunts latins opposent une assez forte résistance.
Mais ce sont surtout les groupes syntaxiques qui s'agglutinent à leur tour,
comme on pouvait s'y attendre, à cause de la fixité des séquences. Tout
un ensemble de faits prouve que les mots perdent leur autonomie au sein
des groupes.
464. En face de cet état de condensation des groupes en français, nous
voyons l'allemand donner aux éléments de la phrase une très large autonomie.285
Pour la syntaxe, cette individualité plus grande des parties résulte
d'abord de la conservation des flexions. Il est clair qu'un groupe de mots
caractérisés par leur finale, p. ex. « eines grauen Huts », ne peut pas être
aussi cohérent que « d'un chapeau gris », dont les parties s'appuient les
unes sur les autres faute de caractéristique interne.
Mais un autre trait de la syntaxe allemande diminue le volume des
groupes et donne aux fragments isolés un relief particulier : la disjonction
des éléments unis par un lien grammatical (267). C'est ce que nous avons
appelé la syntaxe d'emboîtement ou syntaxe enveloppante (321). Elle
est si habituelle dans la prose courante, et d'une telle fréquence, qu'elle
constitue un trait fondamental, d'ailleurs bien connu, de la syntagmatique
allemande. Aussi l'article et les déterminatifs peuvent être séparés du
substantif par un plus grand nombre de mots qu'en français : « ein fünf
Meter langes Brett » ; les auxiliaires renvoient leur verbe à la fin : « Der
Arbeiter ist vom Dach eines vierstöckigen Hauses heruntergefallen ». Comparez
aussi l'autonomie des préverbes : « Lesen Sie diesen Brief durch »,
de la négation : « Ich begreife das Benehmen dieses Mannes nicht », et les
innombrables cas plus particuliers que les grammaires enregistrent. On
sait p. ex. que cette tendance arrive à disloquer les mots composés : « Gold- und
Silbermünzen, Gasheizung und -beleuchtung », les préfixaux : « ab- und
zunehmen », et même, exceptionnellement, les suffixaux : « Gesund- und
Krankheit ».
Or, ce style emboîtant, qui est d'origine synthétique, a cet effet paradoxal
de donner aux éléments de l'énoncé une grande indépendance, car
l'attention est contrainte de s'y attacher en même temps qu'elle cherche
à les relier entre eux. N'importe quelle phrase de journal éclaire ce double
caractère : « Der Zeppelin bricht seinen Flug über Spanien ab und schlägt
infolge des Schadhaftwerdens dreier Motoren den Rückweg ein ».
465. Tandis que les tendances phonétiques du français ont, dès le début,
amenuisé et réduit les mots dans une proportion considérable, les mots
allemands n'ont pas été altérés au même degré, et leur structure interne
n'a pas été obscurcie dans la même proportion. Pour ne citer qu'un seul
trait, il y a un contraste frappant dans le traitement des consonnes intervocaliques
en français et en allemand. Le germanique les a sans doute
souvent affaiblies, p. ex. spirantisées, sonorisées, etc., mais sans les faire
disparaître systématiquement ; les lois de Rask-Grimm et de Verner ont
changé la physionomie du système consonantique, mais c'est une « Lautverschiebung »,
286non une « Lautzerstörung » ; comparez Bruder et frère, Vater
et père ; dans certains cas, les consonnes ont même grossi leur volume,
p. ex. par la création de mi-occlusives : sitzen, hüpfen, etc. (voir Meillet,
Caractères généraux des langues germaniques, ch. II).
En bref, l'allemand nous offre le tableau d'une syntaxe hachée, à groupes
restreints, où les mots conservent une liberté relative, et sont eux-mêmes
analysables dans leurs éléments : autant de traits qui rapprochent l'allemand
de la linéarité et de la forme analytique.
Pour nous rendre compte de la dépendance du mot vis-à-vis du groupe
en français, le mieux est d'attaquer le côté négatif du problème en montrant
que le mot français n'est pas autonome.
Non-autonomie du « mot » français 1113
Qu'est-ce qu'un mot ?
466. La notion de mot passe généralement pour claire ; c'est en réalité
une des plus ambiguës qu'on rencontre en linguistique.
Le malentendu vient de ce que, pour définir le mot, on se place tantôt
au point de vue du lexique, tantôt à celui de la grammaire. Dans le premier
cas, on appelle mots les signes exprimant les idées énoncées dans le discours,
les choses dont on parle : loup, chaise, marcher, rouge, etc., sont des
mots. Dans le second, on considère comme mots les unités du discours
inanalysables dans leur forme (telles que l'impératif marche !), ou composées
d'éléments incapables de figurer dans le discours comme pièces
autonomes (comme l'impératif march-ons, l'adjectif noir-âtre, etc.).
Cette confusion est aggravée encore par des fautes de méthode. D'abord
le mot est délimité d'après sa forme phonique et non d'après sa valeur ;
on ne tient pas compte de la discordance, toujours possible, entre signifiants
et signifiés ; ensuite on ne s'attache qu'aux signes positifs, audibles
et visibles (dans l'écriture), alors que d'autres, sans représentation matérielle,
ont autant de réalité que les premiers, parce qu'ils sont nécessairement
pensés et que leur absence dans l'esprit rendrait le discours inintelligible.
Ainsi loup est, il est vrai, irréductible à des éléments plus simples ;
mais il n'en est pas de même pour marche !, car les associations spontanées
qui fixent sa valeur (Marcheras-tu ? Veux-tu bien marcher ? Marche, toi !
Marche, Paul ! Je veux que tu marches, etc.) montrent que, outre l'idée
287de marcher, ce « mot » exprime la notion de pronom-sujet singulier, de
seconde personne, et celle, modale, d'impératif (225 ss.). L'italien piove
est aussi bien caractérisé comme troisième singulier que le latin plui-t
et le français il pleut.
A tout cela s'ajoutent les erreurs suggérées par la manière dont l'orthographe
délimite les mots ; c'est ainsi que marche ! apparaît comme un mot,
tandis que tu marches est censé en contenir deux.
467. Ainsi ce qu'on appelle mot désigne tantôt un signe purement
lexical, sans aucun ingrédient grammatical (loup), tantôt un complexe
indécomposable de signes, susceptible de fonctionner dans le discours parce
qu'il est muni d'actualisateurs et de ligaments grammaticaux. Le latin
lupus représente donc deux « mots » très différents suivant qu'on le lit
en tête d'un article de dictionnaire ou dans la phrase Triste lupus stabulis.
Seulement c'est par pure convention que le mot a la forme du nominatif
dans les dictionnaires, car la désinence de cette forme est un signe grammatical
qui enlève à lupus sa qualité de signe lexical pur, qualité que possède
en réalité le français loup. Ce qui correspond à loup, ce n'est pas
lupus, mais le radical lup- ; mais ce radical, on le voit, n'a aucune autonomie
syntaxique ; seules les formes fléchies lup-us, lup-i, lup-o, etc. en ont une.
C'est par une convention analogue que les dictionnaires français enregistrent
les verbes à l'infinitif, ce qui donne l'illusion que celui-ci exprime
l'idée verbale sous sa forme la plus pure. En réalité, dans marcher, l'idée
de marche est dans le radical ; le suffixe -er est le signe que le verbe fonctionne
comme substantif.
Ceci posé, on peut se demander si le français loup possède, lui, cette
autonomie que semble lui conférer sa forme écrite en le séparant de tout
autre mot dans la phrase. En fait, loup n'est guère plus indépendant
que le radical lup-, car il ne peut jamais figurer à lui seul dans une phrase
où il doit remplir une des fonctions du substantif actualisé (sujet, complément
d'objet, complément de nom, etc.) ; impossible de dire « Loup est
vorace. — J'ai vu loup. — La fable de loup et d'agneau, etc. ».
468. Il faut donc s'affranchir de la notion incertaine de mot ; nous
appelons ici, comme § 175, sémantème un signe exprimant une idée purement
lexicale, simple ou complexe, quelle que soit sa forme (radical :
lup-, march- ; mot simple : loup, rouge ; mot suffixal : louveteau, rougeâtre ;
mot composé : loup-cervier, faim de loup, rouge foncé ; etc.), et nous désignerons
par le terme de molécule syntaxique tout complexe actualisé formé
288d'un sémantème et d'un ou de plusieurs signes grammaticaux, actualisateurs
ou ligaments, nécessaires et suffisants pour qu'il puisse fonctionner
dans une phrase. Ainsi ce loup est une molécule, parce que sans ce, le
sémantème loup n'est pas un rouage syntaxique ; un gros loup est aussi
une molécule, où le sémantème gros loup est actualisé par l'article indéfini.
De même, le radical verbal march- ne devient une molécule que par l'adjonction
de la désinence -ons à l'impératif marchons ! et de la désinence
zéro (250) dans l'impératif marche !
469. Les éléments d'une molécule peuvent être disjoints (265) sans cesser
de former une unité indivisible pour la valeur ; que l'on dise Je le vois
ou Je vois, je et vois forment une unité malgré leur séparation. De même,
les éléments peuvent permuter (Il vient. Vient-il ?), mais la permutation
des termes ne compromet pas l'unité de l'une ou l'autre des molécules
en cause. Il convient de reconnaître que la permutation et la pénétration
possible de la molécule donnent à celle-ci un caractère plus analytique
qu'à la molécule latine. Mais nous avons vu qu'en français la disjonction
et l'inversion sont de moins en moins usuelles (335). Ainsi le tour « Alors
vint le roi » est encore en usage dans la langue écrite, mais « Alors vint-il »
est impossible.
En outre, la molécule ne correspond pas nécessairement à la mesure rythmique
ou unité accentuelle (318) ; il y a correspondance dans Je vois le
loup (deux mesures et deux molécules), mais non dans Je te vois, où te
forme à lui seul une molécule insérée dans une autre (je vois).
470. La question de l'autonomie du mot se ramène donc à celle du
sémantème ; elle peut être posée de deux manières : 1) un sémantème
peut-il être en même temps, et sans changement, une unité fonctionnelle,
une molécule ? (p. ex. loup est-il à la fois sémantème et molécule ?), ou bien
2) si ce n'est pas le cas, le sémantème est-il senti comme absolument
indépendant du ou des signes qui en font une molécule ? (p. ex. march-,
dans tu marchais, est-il indépendant de tu et de la finale -ais ? ).
En fait, les langues indo-européennes archaïques enchevêtrent régulièrement
le lexique et la grammaire et noient le sémantème dans la molécule.
Quand on dit que le latin domini est un mot, « mot » a le sens de
molécule ; le sémantème est dans le radical et n'a aucune indépendance :
c'est là un facteur primordial de synthèse.
On pourrait penser que le français, dans la mesure où il s'est désintéressé
des désinences, a affranchi le sémantème ou radical en le dégageant de
289sa gangue grammaticale ; en effet, les désinences ont été remplacées par
des pronoms-sujets, des auxiliaires, des prépositions, des particules diverses
qui devraient libérer le sémantème. Malheureusement, la tendance
condensatrice a pour effet d'asservir le sémantème à ces éléments au fur
et à mesure qu'il s'affranchit lui-même des désinences ; en sorte qu'on ne
trouve aucun type de mot français qui soit totalement indépendant ou
des désinences, ou des déterminations préfixées. Seulement cette dépendance
est plus ou moins rigoureuse selon les classes de mots.
C'est le mécanisme de cet équilibre instable que nous étudions dans
les pages suivantes, en insistant surtout sur le substantif, parce que
son autonomie semble plus réelle que celle d'autres classes de mots.
a) Substantif
471. Le substantif s'est dépouillé, il est vrai, de ses finales caractéristiques,
sauf la petite classe des mots en -al, -ail : -aux, et les mots œil,
œuf et bœuf, mais les déterminations préfixées qui remplacent les désinences
ont subi l'action du resserrement syntaxique et se sont agglutinées 1114
avec le sémantème ; celui-ci retombe ainsi à un état sensiblement identique
à celui du radical latin (un loup, le loup : lupus, du loup : lupi, etc.).
L'isolement du sémantème dans l'écriture contribue grandement à créer
l'illusion de son indépendance ; des graphies telles que leloup, duloup,
etc. donneraient tout de suite l'impression contraire.
C'est aussi le prestige de l'écriture isolante qui crée l'idée erronée que
le mot français tend à devenir invariable ; il est plus juste de dire que la
variabilité s'est reportée de la fin à l'initiale du sémantème ; et cette variabilité
est plus grande qu'en latin. En effet, à lupus correspondent à la fois
le loup et un loup, à lupi, du loup et d'un loup ; de plus, tandis que hic lupus,
meus lupus, etc., sont des groupements libres, en français ce loup, mon
loup, etc., sont aussi agglutinés que le loup, un loup, et il en est de même
de plusieurs autres molécules. Autre caractère commun avec le latin :
les éléments constitutifs de la molécule se suivent dans un ordre fixe ;
de même p. ex. que la désinence de lupi suit obligatoirement le sémantème,
les prépositions et les déterminatifs le précèdent nécessairement : du loup,
au loup, etc.290
On a vu plus haut que la séparabilité des éléments conserve au substantif
une certaine autonomie, bien amoindrie, il est vrai, par l'unité d'accent ;
mais on pense surtout aux innombrables cas où le substantif figure dans
la phrase sans déterminatif (« Loups et agneaux vivaient en bonne intelligence.
- Cicéron, orateur romain. — Enduire de graisse. — Couronne de roi. Paul
est professeur », etc.).
Ces cas seront examinés plus bas ; mais le fait capital est que le substantif
seul, nous le répétons, est incapable de remplir aucune des fonctions
syntaxiques dévolues à sa catégorie : sujet, objet direct et indirect, complément
du nom (actualisé), etc. Pour figurer dans une phrase, il doit
porter les signes (explicites ou implicites) de l'actualisation et du rapport
qui l'unit aux autres termes actualisés. Exemple : à un chien, de ce chien,
le chien (est l'ami de l'homme), (j'entends) un chien. Seuls les noms propres
(Napoléon, Paris, etc.) sont autonomes parce qu'ils sont actuels par définition
(116).
472. Cette solidarité du sémantème et de ses déterminations est révélée
par un critère dont on ne semble pas comprendre la portée : l'obligation
de répéter le complexe entier dans des groupes coordonnés.
On sait qu'en latin, comme dans toutes les langues indo-européennes
flexionnelles, deux termes coordonnés sont liés explicitement par la communauté
de leurs désinences : lupum et leonem, lupo et leoni, videt et audit,
prudentior et sapientior, pessimus et turpissimus. Or, dans les mêmes cas,
et dans d'autres encore que le latin ne connaît pas, le français est astreint à
la répétition des actualisateurs ainsi que des prépositions et des conjonctions.
Le substantif est naturellement soumis à cette règle générale. La répétition
des ses actualisateurs est obligatoire ; c'est le cas pour l'article défini :
« les hommes et les femmes », pour l'indéfini : « un homme et une femme » ;
pour le démonstratif : « cet homme et cette femme », le possessif : « leurs
hommes et leurs femmes », l'interrogatif : « quel homme et quelle femme »,
les actualisateurs quantifiés : « quatre hommes et quatre femmes, tous les
hommes et toutes les femmes, quelques hommes et quelques femmes, des
hommes et des femmes, du vin et de l'eau ». La règle s'étend aux substantifs
qualifiés : « un grand homme et une grande femme, ce grand homme et
cette grande femme ».
Lorsque la répétition n'a pas lieu, c'est l'indice que les substantifs
forment un composé copulatif : « mes parents et amis, notre oncle et tuteur »,
etc. (146).291
La répétition de la préposition dans les termes coordonnés présente
une remarquable analogie avec le régime des désinences et des prépositions
en latin. Le français répète la préposition quand elle est un pur
ligament non lexicalisé (136), comme de et à dans « s'emparer d'une ville
et de sa citadelle, obéir à son père et à sa mère » ; mais elle est facultative
quand elle porte une détermination lexicale (spatiale, temporelle ou abstraite) :
« dans les plaines et (dans) les montagnes, pour mon pays et
(pour) ma famille ». Cela rappelle vivement une distinction non pas identique,
mais parallèle, que fait le latin : les rapports purement grammaticaux
sont généralement exprimés par les désinences sans l'appoint de prépositions :
« mores luporum, parēre patri », tandis que les rapports lexicalisés
sont confiés aux prépositions ; or la répétition des désinences est naturellement
inévitable : « mores luporum et leonum, parēre patri et matri », mais
celle de la préposition (toujours lexicalisée !) est facultative : « in campis
et (in) montibus ».
473. Il n'en est pas moins vrai que, dans des cas très nombreux, le
substantif est employé seul, sans aucun signe de détermination avec lequel
il serait agglutiné. Sont-ce des infractions réelles à la loi de la non-autonomie
du sémantème français ? Nous ne le croyons pas. Dans ces cas,
ou bien le substantif a changé de catégorie (A), et n'est plus un vrai
substantif, ou bien ses déterminations sont implicites (B). Il sera nécessaire
de juger le degré de vitalité de chacun de ces emplois ; s'ils sont
usuels et productifs, ils prouveront une avance dans le sens de l'autonomie ;
si au contraire ils sont en marge de la langue, ou si leur emploi est surtout
réservé à la langue écrite et littéraire (nous essaierons de montrer que
c'est le cas), c'est qu'ils sont plus ou moins archaïques et tendent à sortir
de l'usage, d'où l'on pourra conclure que le français penche toujours plus
vers le régime du sémantème radical dépendant des éléments préfixés.
474. A. Tout substantif change de catégorie et prend la fonction d'adjectif
(virtuel) quand il fonctionne comme prédicat ou épithète sans être
accompagné de déterminatifs. En effet, c'est seulement avec un déterminatif
que le substantif prédicat conserve sa valeur originelle : « Paul est un
artiste, Paul est l'artiste que j'ai vu à Paris ». Dans le cas contraire, il
prend valeur d'adjectifs : « Paul est artiste » se traduit par « Paul est habile
dans son art ». Aussi, dans cette position, le substantif n'admet pas volontiers
l'adjonction d'un adjectif qui le rebaptiserait substantif ; on ne dit
pas « Paul est grand artiste », mais « Paul est très artiste ». On n'alléguera
292pas des phrases telles que « Je suis grand amateur de musique », car là,
le substantif a une valeur verbale et « être grand amateur », c'est « aimer
beaucoup ». Quoi qu'il en soit, le substantif est ici virtuel, et n'est actualisé
que par l'appoint de la copule, avec laquelle il fait corps.
Le mode de représentation du substantif devenu prédicat révèle aussi
le changement de catégorie ; comparez « Etes-vous la reine ? Je la suis »
et « Etes-vous reine ? Je le suis ». Il est vrai que cette distinction a peu
d'occasions de se manifester ; elle est aujourd'hui négligée.
Dans « une femme enfant », on sait que enfant forme, en qualité d'adjectif,
un syntagme de caractérisation avec son substantif (femme enfant
= « femme naïve »). Dans le type « une couronne de roi », l'absence d'article
s'explique aussi par le changement de catégorie ; de roi fonctionne comme
déterminant de caractérisation et a une valeur d'adjectif épithète (= « royale »).
Il en est de même du type « Cicéron orateur est supérieur à Cicéron
philosophe » ; on y voit ordinairement une « apposition » ; en fait, le substantif
fonctionne ici comme adjectif épithète (= « Cicéron avec ses qualités d'orateur
et de philosophe »). L'absence de pause médiane sépare ce cas de la
vraie apposition : « Cicéron, orateur romain », dont il est question ci-après,
§ 478.
475. Le substantif change aussi de catégorie quand il fonctionne comme
élément de composé : porte-plume, mon oncle et tuteur, les lettres et paquets,
prendre peur, enduire de graisse, etc. Les développements fournis § 141 ss.
nous dispensent d'insister ; il suffit de rappeler qu'un élément de composé
est virtuel, et que c'est dans son ensemble qu'il doit être examiné
au point de vue de l'autonomie syntaxique.
Le substantif perd aussi sa valeur propre quand, privé d'article, il est
précédé d'une préposition qui en fait une expression adverbiale ; exemples :
vivre en paix, mourir de froid, agir par intérêt. La préposition peut être
zéro : voyager sac au dos, tête nue, etc.
Le critère de la représentation montre s'il y a ou non changement
de valeur ; on admet « Je vais en ville, où je compte rencontrer
des amis », parce que où se rapporte à l'expression adverbiale en
ville ; mais il est incorrect de dire « Je vais en ville, qui est près de notre
village » 1115.
Le substantif sans article forme aussi, avec des verbes vides, des tours
verbaux impersonnels réductibles à des verbes simples. Exemples : Il y a
293erreur = « On se trompe » ; Ordre a été donné de relâcher le prévenu — « On
a ordonné … ».
476. Le substantif sort encore de sa catégorie quand il désigne le mot
en soi, en dehors de tout fonctionnement ; ainsi eau désigne le signifié
dans « Comment dit-on eau en allemand ? ou : Wasser signifie eau en allemand »,
le signifiant dans « eau a plusieurs sens », et le signe tout entier
dans « eau est un mot français ». Ces emplois non fonctionnels sont soulignés,
quand il y a lieu, par l'hiatus : « Quels sont les différents sens
de eau ? ». C'est encore cet emploi du substantif qu'on trouve dans les
expressions « appeler quelqu'un menteur, le traiter de menteur ».
477. B. Restent les cas d'actualisation implicite du substantif proprement
dit. L'essentiel a été dit § 121 ss. De ces tours, les uns (comme les
titres et le vocatif) sont en marge de la syntaxe de la phrase, les autres
appartiennent à la langue écrite, ce qui leur enlève une partie de leur vitalité.
Les substantifs figurant dans les titres, les enseignes, etc., sont actualisés
par association. Ainsi Traité de chimie équivaut à « (Ceci est) un traité
de chimie » (l'anglais emploie souvent l'article dans ce cas : « A vedic
grammar for students »). Entrée veut dire « Ceci ou ici est l'entrée ». D'ailleurs
nous sommes ici en dehors de la syntaxe normale et de la langue
proprement dite. Il en est de même du style télégraphique : « Paquet
expédié. Lettre suit ».
Le vocatif est actualisé par le fait qu'il est un nom propre de la parole
(116). Maître ! Patron !, etc., sont sur le même pied que Monsieur
Dupont !, etc. Patron ! veut dire « Vous qui êtes le patron (que la situation
détermine) ». L'absence d'article devant le vocatif n'est pas plus
étonnante que l'absence de pronom-sujet devant l'impératif : Viens ! =
« Je veux que tu viennes ». En outre, le vocatif est en marge de la phrase,
comme un titre est en marge du texte.
478. L'apposition (coordinative) de mot ou de phrase 1116 a un actualisateur
zéro qui se déduit des tours similaires et interchangeables. Le type
« Cicéron, orateur romain » (qui est d'ailleurs de plus en plus confiné dans
la langue écrite) est inséparable de « Cicéron, un orateur romain », ou
de « Cicéron, l'orateur romain », qu'on emploie de préférence dans la langue
parlée. En outre, pour la logique grammaticale du français, « Cicéron,
orateur romain » n'est pas la condensation d'une phrase telle que « Cicéron
était orateur romain », mais de « Cicéron était un orateur romain ».294
L'apposition anticipée ne fait pas plus de difficulté : « Nature droite, Paul
répugne au mensonge » équivaut à « Comme c'est une nature droite ». L'apposition
anticipée est du reste essentiellement littéraire ; la langue parlée
n'en fait aucun usage.
L'apposition de phrase est de même nature que celle de mot : dans
« Il partit : résolution qui décida de son avenir », l'apposition a un actualisateur
zéro, comme le montre la forme concurrente une résolution qui …,
seule usitée réellement dans la langue parlée ; de plus, ce tour correspond
obligatoirement à la phrase « C'est (ce fut) une résolution qui … », où la
suppression de une est devenue impossible.
479. Certaines tournures conventionnelles du style administratif ou
commercial s'expliquent de même : le jeu des associations révèle une actualisation
implicite : ainsi Dumas père est un tour conventionnel équivalant
à « Dumas le père », par opposition à « Dumas le fils ». Le peuple dit le fils
Durand au lieu de Durand fils. La formule de raison commerciale Durand
et fils équivaut à « Durand et son fils » ; preuve en est que si Durand est
associé à plusieurs de ses fils, la formule admise aujourd'hui est « Durand
et ses fils ». Encore des tours qui sont en marge de la syntaxe de la
phrase.
480. Enfin un substantif peut être actualisé par des mots qui ont par
ailleurs d'autres fonctions. Ainsi certains adjectifs jouent ce rôle : semblable
et pareil remplacent des démonstratifs : Semblable faute, pareille
impudence (mérite un châtiment) = « Cette faute, cette impudence » ; certain
renard = « un renard », certaines gens = « des gens ». Ajoutons que des
substantifs sont devenus des quantificateurs : « quantité d'oiseaux, nombre
de personnes, force moutons, beaucoup de vin » (373). Jamais suivi d'un
substantif sous-entend nécessairement le déterminatif aucun : « Jamais
homme ne fut plus heureux = Jamais aucun homme … » ; parallèlement :
« Si jamais homme fut heureux … = Si un homme … ».
Dans le tour « Adieu veau, vache, cochon, couvée », l'absence de déterminatif
s'explique soit par la valeur de composé énumératif des trois substantifs
(146), soit par le sens actuel de adieu, équivalent à « Il n'y a plus de » :
« Plus de veau, de vache, de cochon, de couvée », enfin par ce qui subsiste de
l'emploi de ces mots au vocatif.
481. De là aux emplois tout à fait archaïques, le passage est aisé. Le
substantif sans actualisateur explicite apparaît dans des proverbes et des
locutions conventionnelles en fonction de sujet, d'objet, etc.295
a) « Noblesse oblige. Comparaison n'est pas raison. Pierre qui roule
n'amasse pas mousse. Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée ».
b) « S'entendre comme larrons en foire. Il n'y a pas âme qui vive. Jusqu'à
ce que mort s'ensuive ».
Ici, l'impression d'archaïsme s'impose immédiatement, et forme un tel
contraste avec la syntaxe vivante qu'il contribue à la confirmer, car celle-ci
reprend ses droits dès qu'on s'avise d'interpréter le proverbe ou la locution :
« Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée » signifie « Une bonne
conduite est préférable à la richesse » ; comparez « pas âme qui vive » et
« pas un être vivant ».
D'ailleurs cet emploi archaïque est, par sa nature même, soumis à des
restrictions : a) en général, il faut que le substantif soit spécifié : ceinture
dorée, pierre qui roule, chat échaudé, femme fardée ; c'est ce grossissement
qui masque l'étrangeté de l'absence d'article ; b) en second lieu et surtout,
le substantif, sauf de rares exceptions, est employé dans le sens générique,
c'est-à-dire fonctionne sous une forme personnifiée (117), comme une sorte
de nom propre, et un nom propre se passe d'article. C'est là une fonction
que l'ancien français a longtemps conservée, et qui s'est perpétuée jusqu'aujourd'hui
en anglais, sans doute sous l'influence de l'anglo-normand
(« Virtue is a name », etc.).
482. En résumé, le substantif français qui aurait pu, grâce au déclin
des désinences et avec l'appui des déterminations préfixées, devenir un
pur sémantème, s'est agglutiné avec ces déterminations. Dans les formes
où il apparaît à nu, ou bien il a des déterminations implicites, ou bien il
n'est plus substantif.
Il est certain que ces cas sont nombreux ; ils peuvent donner l'impression
que le substantif est autonome, et cette impression est une réalité (relative)
pour les sujets parlants. Mais nous avons constaté que les emplois
où la détermination est implicite sont généralement relégués dans la
langue écrite ; cela n'indique-t-il pas que le substantif redevient peu à peu
ce qu'il était en latin : un radical ?
b) Infinitif
483. L'infinitif est, comme on sait, une transposition du verbe qui
permet à celui-ci de jouer le rôle de substantif. Ce substantif est-il autonome ?
Il l'est dans la fonction de sujet ou d'objet, mais il tend à s'agglutiner
avec un signe qui l'actualise ; c'est la particule de, dont il a été question
296au § 124 : « De mentir est odieux. Il est odieux de mentir ». En outre, l'infinitif
employé aux « cas obliques » est presque toujours précédé d'une préposition,
et celle-ci fait corps avec le verbe quand elle est un pur ligament
grammatical. On peut ici faire jouer le même critère que pour le substantif :
le traitement des termes coordonnés. Quand la préposition est purement
grammaticale, on doit la répéter : « Il hésite à se lever et à parler. — II
tente de s'évader et de fuir ». La répétition est facultative seulement
quand la préposition est lexicalisée : « Il part pour oublier les soucis et
(pour) vivre en paix ». On répète le de des prépositions composées : « avant
d'entrer et de se mettre au travail », ce qui rappelle la répétition de que
des conjonctions composées : « Avant que le soleil se lève et que les oiseaux
s'éveillent ». C'est cette obligation de répéter la préposition qui fait l'incorrection
des tours tels que : « Le gouvernement tenta et parvint à discipliner
la presse ».
c) Adjectif
484. Tout ce qui concerne la non-autonomie des adjectifs vaut pour
les participes purs ou adjectivés ; p. ex. « problème résolu : caractère résolu,
écolier négligeant ses devoirs : écolier négligent ».
L'adjectif est un virtuel incapable de former par lui-même un terme
de phrase ; il doit être actualisé par la copule pour constituer un prédicat :
« cette robe est rouge » (154) ; comme épithète, il forme avec son substantif
un virtuel complexe (robe rouge), qui ne peut être actualisé que dans son
ensemble (110).
485. On se rappelle que, la copule faisant corps avec le prédicat, l'union
du verbe être avec l'adjectif est très étroite ; on s'en rend compte par la
liaison : « ce crime est abominable ; cette entreprise est impossible à réaliser »
(154 ss.).
Cette copule est implicite dans les syntagmes dérivés de la phrase :
Buvez votre café chaud = « pendant qu'il est chaud ». Mais dans certains
tours où une idée de quantité est en jeu, comme dans Il y eut trois hommes
blessés, la langue d'aujourd'hui cherche à marquer la valeur prédicative
de l'adjectif ou du participe en le faisant précéder de de : « Il y eut trois
hommes de blessés », où de fait pendant à la copule être : cf. « Trois hommes
furent blessés ».
486. Mais surtout, l'accord du participe et de l'adjectif en genre et en
nombre avec le substantif est marqué dans beaucoup de mots par la désinence,
en sorte que le sémantème est encore senti comme un radical non
297autonome. La distinction du singulier et du pluriel est sans doute faible ;
elle n'existe qu'au masculin dans le type moral — moraux (408). Mais celle
du masculin et du féminin est beaucoup plus accusée : à côté de très
nombreux adjectifs invariables (rouge, possible, magnifique, etc.), la langue
conserve l'opposition des genres dans une quantité de qualificatifs dont
beaucoup sont très usuels : bon, nouveau, vieux, etc., et parmi les participes
passés : fait, mis, etc. ; tous les participes présents adjectivés sont
variables : négligent, -ente, etc.
Ces formations sont capricieuses, et prouvent que ce rouage n'est pas
tout à fait normal ; pourtant il fonctionne ; et en fait l'opposition de forme
dans vert : verte, bon : bonne, etc., déteint sur les adjectifs invariables, dont
les sémantèmes font encore l'impression d'un radical (voir à ce sujet § 250).
Le sentiment de la distinction du genre par la finale doit être bien vivant,
pour que l'orthographe la maintienne si opiniâtrement dans tant de cas
où elle n'existe plus pour l'oreille : fier — fière, sûr — sûre, etc.
487. Au comparatif et au superlatif (relatif et absolu), l'adjectif est
inséparable des particules plus, le plus, très, fort. Leur répétition, obligatoire
dans les termes coordonnés (472), prouve une agglutination au moins
partielle. De même qu'en latin les suffixes -ior et -issimus ne peuvent
être ellipsés dans le second terme de couples tels que « prudent ior et sapientior,
prudentissimus et sapientissimus », le français est obligé de dire
« plus avisé et plus sage, le plus avisé et le plus sage, très avisé et très sage ».
De même pour moins, le moins, aussi, etc. En sorte que les degrés de comparaison
nous présentent un cas de déterminations finales anciennes
combinées avec des déterminations initiales modernes (plus forte). Ce
double procédé de détermination rapproche l'adjectif du verbe (cf. « plus
forte » et « nous marchons », 234, 491).
Bref, dans l'ensemble, l'adjectif est encore un radical grâce à ses désinences,
et se rapproche de la nature du radical par l'agglutination de ses
déterminatifs externes.
d) Adverbe
488. Les adverbes sont actuels ou virtuels selon qu'ils actualisent ou
caractérisent leur déterminé (verbe ou adjectif).
1) Les adverbes virtuels sont d'accord ou de rection. La classe la plus
importante des virtuels d'accord est constituée par les adverbes en -ment
et leurs divers substituts : clairement, fréquemment ; net, haut (dans refuser
298net, parler haut) ; très, beaucoup, etc. Exemples de virtuels de rection :
« mourir de froid, souffrir par amour, voyager sac au dos » (193). Ces expressions
peuvent former avec leur déterminé de véritables composés :
parler français, pêcher à la ligne, chasser le renard (141).
489. D'après une règle générale (132), un adverbe virtuel ne peut caractériser
qu'un verbe ou un adjectif lui-même virtuel, c'est-à-dire qu'il
se rapporte à l'adjectif attribut (sans copule) ou au radical du verbe.
On le voit par le parallélisme de « cette femme est très belle » et « elle a
une grande beauté », « Il travaill-ait beaucoup » et « Il faisait un grand travail », etc.
Ce parallélisme montre aussi que le suffixe -ment joue le même rôle
grammatical que les désinences de l'adjectif, c'est-à-dire qu'il est le signe
grammatical de l'accord entre l'adverbe et l'adjectif ou le verbe ; dans
« souffrir affreuse-ment » et « affreuse-ment douloureux », -ment a la même
fonction que la finale du féminin dans « douleur affreu-se ». Ainsi ces
adverbes ne sont pas des sémantèmes autonomes, et pour la même raison
que les adjectifs, qui, comme on l'a vu, ont encore un radical et des désinences.
Les adverbes « courts », comme haut dans « parler haut », ont un
suffixe d'accord zéro ; enfin les adverbes simples en apparence, tels que
très, beaucoup, assez, trop, etc., sont sentis inconsciemment comme pourvus
d'un suffixe implicite en cumul. L'absence d'accord explicite est donc
comparable à l'invariabilité des adjectifs du type brave, jeune, etc.
A cela s'ajoute, pour certains adverbes virtuels, le danger de l'agglutination.
L'emploi des adverbes courts « parler haut, frapper fort » est
très limité ; chacun d'eux ne peut s'unir qu'à un petit nombre de verbes
déterminés (p. ex. net évoque spontanément le verbe refuser, haut et bas
ne s'emploient guère qu'avec parler) ; il s'ensuit qu'ils sont bien près
de former des locutions (à dire vrai en est une). Les adverbes d'adjectifs,
surtout s'ils sont monosyllabiques (très, fort, plus, moins, si) sont sur le
point de devenir des préfixes (cf. « très chaud », et italien « tracaldo », 381).
490. 2) Les adverbes actuels sont des mots qui renferment par cumul (226)
un ligament d'actualisation (116) reliant l'adjectif ou le verbe actuels à un
actuel fourni par la situation ou le contexte. Ils sont d'accord ou de rection ;
exemples d'accord : ainsi, pareillement, autrement = « comme ceci ou pas comme
ceci » ; exemples de rection : ici = « à cet endroit », alors — « à cette époque ».
En définitive, les adverbes de l'une et l'autre catégorie sont pourvus de
signes grammaticaux qui leur enlèvent tout caractère de sémantèmes
autonomes.299
e) Verbe conjugué
491. Le verbe conjugué est actualisé à la fois par ses déterminations
initiales (ses auxiliaires de temps et de mode), et par ses désinences, qui
réduisent le sémantème à l'état de radical, ce qui lui enlève toute autonomie,
comme au radical latin ; cf. march-ons et ambul-emus, nous av-ons
march-é et ambul-avimus.
En outre, les pronoms-sujets sont si indispensables au verbe que, dans
la langue parlée, des formes telles que « Paul et moi sommes amis, Mlle X.
et vous êtes fiancés » ont actuellement quelque chose d'insolite.
La séparation des éléments ne compromet guère leur rapport intime,
parce que la plupart du temps les signes infixés font eux-mêmes corps
avec l'ensemble ; comparez Il souffre et Il ne souffre pas, Il est parti et
Il n'est pas parti. On constate seulement que la séparation des éléments
de la molécule verbale est plus fréquente et a des formes plus variées
que ce n'est le cas pour la molécule substantive : il a tout vu, il n'est pas
venu, il n'a plus jamais reparu, je ne le connais pas, il a courageusement résisté,
etc.
492. La cohésion des molécules verbales est prouvée, elle aussi, par le
traitement des coordonnées. La répétition du pronom-sujet est de plus
en plus usuelle : « Je lis et j'écris », etc. Son omission indique que les verbes
forment un collectif : « je lis, écris et calcule », ou bien il s'agit d'un syntagme
qui fleure la langue écrite : « Je lis un livre intéressant et prends des notes
à chaque page ». Avec le verbe être, l'euphonie oblige souvent à répéter
le pronom : on ne dit guère « Il a pris son chapeau et est parti », « Il est venu,
mais est reparti aussitôt ». L'omission du sujet peut créer une équivoque :
« Paul et moi nous comprenons ».
Quand le pronom-sujet est accentué et forme le terme A d'une phrase
segmentée, la langue le reprend en Z, selon la règle énoncée § 89 : « Moi,
je dors ; toi, tu dors ; lui, il dort». Pour la troisième personne, la langue
écrite a aussi la forme sans reprise : Lui dort ; mais cette tournure est de
plus en plus évitée ; un tour tel que « Lui, malin, n'a rien dit » paraît forcé.
Ensuite, par resserrement de la phrase segmentée, on arrive à dire sans
pause médiane « Moi je dors, Charles il dort ». Ainsi je, tu, il, etc., deviennent
de plus en plus flexionnels, et dans Charles il dort, il fait double
emploi avec Charles, comme -it avec Carolus dans Carolus dormit (236).
Peut-être est-ce le germe d'un ligament unissant le sujet à son verbe.300
La répétition des pronoms-objets est obligatoire : « Je le lirai, (je) le
corrigerai et (je) le compléterai ». Dans la variante « Je le lirai, corrigerai
et compléterai », les trois verbes forment une sorte de verbe collectif unique.
Enfin la particule que doit aussi être répétée : « Qu'on lui ouvre la porte
et qu'il entre ! ». En subordonnée : « Il faut qu'on lui ouvre la porte et qu'il
entre ». Dans « Il faut que tu cèdes et obéisses », les deux verbes forment
de nouveau un collectif.
Il suit de tout cela qu'en français le sémantème verbal est complètement
noyé dans les désinences et les déterminations grammaticales ; le verbe
est, de toutes les parties du discours, celle qui a le moins d'autonomie
sémantique. Ce caractère est si apparent qu'on a voulu établir une distinction
radicale entre le verbe et le substantif ; ce qui a été dit de ce dernier
montre sans doute qu'il s'agit d'une différence de degré et non d'espèce.
493. Les développements qui précèdent prouvent d'une façon générale
la non-autonomie du sémantème au sein de la molécule ; dans des proportions
diverses, il reste ou est devenu l'équivalent d'un radical auquel sont
soudés soit des déterminations finales (héritage du latin), soit des morphèmes
préfixés (innovation romane), qui prennent de plus en plus le
dessus. Le français s'achemine donc vers un régime flexionnel qui, par
l'effet de la séquence progressive, est le renversement du régime flexionnel
latin et indo-européen. En définitive, la molécule syntaxique française
est en train de redevenir aussi synthétique que la forme fléchie indo-européenne
et latine ; seule sa pénétrabilité relative (319 et 469) lui conserve
un caractère de condensation moyenne. Ici reparaît ce jeu de bascule,
un de ces retours en arrière que l'on constate si souvent dans l'évolution
linguistique, et dont nous avons donné des exemples dans LV3, p.70ss.
En outre, ces unités syntaxiques françaises sont beaucoup plus protéiques
que les formes fléchies du latin, où la flexion restreignait le nombre
des combinaisons possibles ; en français, elles sont infiniment plus nombreuses
(471).
494. La condensation se poursuit, au delà de la molécule, du côté de
la phrase. En effet, les pauses et les accents qui séparent les molécules
sont peu apparents dans la phrase cohérente ; la pause disparaît même
complètement dans la phrase liée (100, 104) ; du moins les sujets n'en
ont pas conscience : cf. « Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon
cœur », où pourtant l'on compte jusqu'à cinq groupes rythmiques. Le
301nombre des groupes eux-mêmes n'est pas fixe, il dépend de la rapidité
du débit, réglée elle-même d'après les intentions du parleur. Tout cela
prouve la cohésion très grande des parties de la phrase.
On sait que la syntaxe moderne réagit contre cette tendance en donnant
une place toujours plus grande à la segmentation (99).
L'allemand, lui, distingue nettement les parties de la phrase par l'intensité
de son accent. D'autre part, on a vu (464) qu'il pratique sur une vaste
échelle la séquence disjonctive (« Trink dein Bier ganz aus », etc.), et
que celle-ci confère une autonomie spéciale aux éléments dispersés, en
sorte que le complexe ainsi constitué résiste à l'agglutination.
Condensation des sémantèmes
495. D'autre part, la tendance condensatrice pénètre dans l'intérieur
des mots et coagule progressivement leurs sous-unités.
Pour cette partie de l'étude, il suffit de se reporter aux §§ 380-405, où
il a été question, à propos de la séquence progressive, des préfixes, des
suffixes et des racines ; car on constate, une fois de plus, l'étroite connexion
entre la tendance à la condensation et l'ordre progressif des signes. Ici,
on se bornera à faire entrevoir l'état final dont le lexique français usuel,
dans sa couche romane, se rapproche : mots simples de longueur moyenne
(deux ou trois syllabes) et à accent uniforme oxyton. Les vocables plus
longs appartiennent en grande partie aux langues spéciales (science, technique,
administration, droit, etc.). Un mot long doit être analysé pour
être compris ; si donc le français courant en avait beaucoup, la structure
générale de son vocabulaire serait plus analytique.
Quant aux monosyllabes, ils sont l'aboutissement dernier de ce procès
de resserrement ; le français en a un assez grand nombre, mais il cherche
à grossir leur volume (ours, mœurs, août, but, legs), parce qu'ils risquent
de se noyer dans les groupes où ils se détachent mal ; nous reviendrons
(562 ss.) sur les conséquences pathologiques qui en découlent.
496. Les abrègements du type auto, etc., s'arrêtent à la limite fixée
par la moyenne des mots usuels ; l'anglais, qui tend vers le monosyllabisme,
réduit zoological garden à zoo, popular concerts à pops ; mais le français ne
tolère que des tronçons de trois ou deux syllabes : cinéma (mais ciné Pathé),
radio, vélo, moto, etc. Ce n'est peut-être pas par hasard qu'on dit séisme
en regard de sismique.302
Le contraste avec le vocabulaire allemand n'a pas besoin d'être longuement
démontré. La structure des mots allemands rappelle vivement celle
des mots du grec ancien : mots armés de toutes pièces, gorgés de nuances
de détail (grâce à la composition et aux préverbes, grâce aussi à l'aisance
de la dérivation suffixale).
Nous ne retenons ici que deux faits généraux qui font paraître, par opposition,
la préférence du français pour le mot simple : 1) son attitude vis-à-vis
des composés de l'allemand ; 2) les procédés qu'il emploie pour éviter la
dérivation suffixale.
497. 1) La prédilection de l'allemand pour la composition est bien
connue. Or, on sait aussi que dans une foule de cas le français répond aux
composés allemands soit par des mots simples, soit par des suffixaux
dont la finale n'a aucune signification concrète. Par des mots simples :
Erdteil : continent, Handschuh : gant, Fingerhut : dé, Schlittschuh : patin,
Lebensmittel : vivres ou denrées, Hungersnot : famine, etc., etc. Par des
suffixaux : pèlerin-age répond à Pilger-fahrt, prêtr-ise à Priester-stand, oreill-er
à Kopf-kissen, pomm-ier à Apfel-baum. Comparez encore les adjectifs
menschenscheu et sauvage, leichtgläubig et crédule, alleinstehend et isolé, etc.
Les verbes composés sont particulièrement instructifs ; le français recourt,
pour les rendre, soit à des verbes simples ou difficilement analysables,
soit à des constructions périphrastiques et nettement syntaxiques : ainsi
sich krank arbeiten se traduit ou bien par « se surmener » ou bien « se rendre
malade à force de travailler » ; lobsingen par « exalter » ou par « chanter
les louanges de quelqu'un » ; comparez encore trocken legen et « assécher »,
schlittschuhlaufen et « patiner ».
498. 2) L'allemand établit imparfaitement la limite entre composés d'une
part, suffixaux d'autre part ; le français cultive fort peu ce type hybride.
N'oublions pas qu'il s'agit de juger l'état actuel : nous savons que les
types de préfixaux et suffixaux remontent ou à des groupes syntaxiques
ou à des composés qui ont été précédemment des groupes syntaxiques
(153) ; mais ce qui importe ici, c'est que l'allemand tend à maintenir
cet état intermédiaire, le français à le supprimer. Non seulement des suffixes
proprement dits tels que -heit, -tum, -lich, -bar, -haft, -sam se ramènent,
par des étymologies certaines, à des mots proprement dits, anciens
éléments de composés et de groupes syntaxiques, mais de nombreux types
de composés, en généralisant la signification de leur second terme, prennent
valeur de suffixes tout en conservant une signification semi-lexicale.303
Voici une liste de ces suffixes concrets ; elle ne prétend pas être complète :
-mann, -frau, -macher, -händler, -sucht, -werk, -wert, -würdig, -mässig,
-gemäss, -reich, -arm, -voll, -frei, -los, -fertig, -wendig, -weise. Quelques
exemples montreront le contraste avec le français : Kaufmann : marchand,
Seemann : marin, Waschfrau : laveuse, Uhrmacher : horloger, Räderwerk :
rouages, Gelbsucht : jaunisse, sehenswert : remarquable, bewunderungswürdig :
admirable, gesetzmässig : légal, zeitgemäss : opportun, wundervoll : magnifique,
inhaltreich : substantiel, blutarm : anémique, vorwurfsfrei : irréprochable,
fruchtlos : stérile, friedfertig : pacifique, auswendig : extérieur, teilweise : partiellement.
Les préfixes présentent aussi un caractère plus concret que ceux du
français, les mots préfixaux se rapprochent souvent des composés : hoch- (hochwichtig),
voll- (vollgültig), grund- (grundfalsch), wunder- (wunderschön),
neben- (Nebensache). Le français ou bien périphrase syntaxiquement
(grundfalsch = « radicalement faux »), ou bien simplifie (wunderschön
= « magnifique »).
499. Les emprunts confirment aussi cette tendance de l'allemand à
motiver les mots par adjonction de particules. Il n'est pas rare qu'un
verbe emprunté s'affuble d'un préfixe allemand (einexerzieren). Les
calques (ou emprunts par traduction) diffèrent parfois de leur modèle
par quelque détail surajouté ; comparez : « tiré par les cheveux » et « an den
Haaren herbeigezogen », « ne rien laisser à désirer » et « nichts zu wünschen
übrig lassen », « mener par le bout du nez » et « an der Nase herumführen »,
« cela ne compte pas » et « das zählt nicht mit », etc.
Dérivation implicite
Définition
500. Nous avons signalé à plusieurs reprises les défaillances de la dérivation
suffixale en français (276, 389 ss.). Cet état de choses se complique encore
de la multiplicité des fonctions dévolues à un même suffixe. Ainsi attention
n'est pas seulement un nom d'action ; il désigne aussi les manifestations
de l'action (« avoir des attentions pour quelqu'un ») ; curiosité, nom abstrait,
est aussi un concret : « magasin de curiosités» ; on ne parle pas seulement
de l'autorité d'un savant, un savant est lui-même une autorité, etc.304
Mais ce n'est là qu'une des formes d'un procédé de dérivation implicite
qui existe dans toutes les langues et qu'on appelle généralement changement
de sens ; mais le français en fait un usage particulièrement abondant ;
grâce à cette dérivation interne, un mot simple peut passer dans une autre
catégorie sans changer de forme (« une femme enfant, monter une caisse
au grenier », etc.).
Par là, le français satisfait sa tendance à l'économie des mots, dont il
sera question plus loin, et surtout son goût pour les mots simples. Ces
divers procédés contribuent au resserrement syntagmatique et produisent
un effet synthétique ; car, d'une manière générale, tout syntagme transposé
est plus condensé qu'avant la transposition. On le constate p. ex.
dans le passage d'une phrase indépendante à la fonction de proposition-terme ;
comparez La terre tourne et « Je sais que la terre tourne » ; mais
cela se vérifie aussi dans la dérivation : Je m'en fiche est plus analysable
que jemenfichisme. A plus forte raison dans la dérivation implicite : comparez
« Il habite à côté » et un à côté. C'est pour cela que les figures, qui sont
des formes de dérivation implicite, sont plus synthétiques que les mots
dont elles dérivent : « ce serpent est une vipère : cette femme est une vipère »
(264).
501. Nous appelons donc implicite toute dérivation où le signe de transposition,
le suffixe, n'apparaît pas sur la ligne du discours, en sorte que
le dérivé a, en apparence, la même forme que le mot dont il dérive, ou
même une forme plus brève (249).
A l'exception du type la marche (248), caractérisé par un suffixe zéro,
les diverses formations énumérées dans ce qui suit relèvent de l'hypostase
(257) ; celle-ci est une dérivation interne en ce sens que le signe de transposition
est, pour ainsi dire, caché dans l'intérieur du transposé ; mais
c'est, à un autre point de vue, une dérivation externe, car la catégorie
nouvelle à laquelle appartient le mot est révélée surtout par des signes
fonctionnels qui lui sont extérieurs (la curiosité des femmes : des curiosités
de femme ; une situation tragique : le tragique d'une situation).
Nous donnons ci-après un aperçu de ces formations en les classant
d'après la catégorie des transposés. Si nous y insistons, ce n'est pas pour
refaire — d'ailleurs de façon incomplète — un chapitre de lexicologie française,
mais pour marquer un caractère important de la langue.305
a) Substantifs
502. On sait que, sans rien changer à la forme des noms de matière
(le cuivre) ou des noms d'abstraction (la gloire), le français peut en faire
des concrets désignant des choses (un cuivre) ou des personnes (Pascal,
une des gloires de la France), des mots désignant des cas divers où une
abstraction se réalise (des pluies continuelles, des bruits de pas), d'autres
désignant les manifestations perceptibles des états intérieurs (des bontés,
des attentions, les grâces d'un jeune chien, des piqûres visibles sur la peau).
La difficulté qu'on éprouve à distinguer nettement les diverses nuances
de ces dérivés, fort nombreux, prouve le large emploi qui en est fait.
Il s'agit, dans tous ces cas, de la figure (c'est-à-dire du type d'hypostase)
appelée métonymie (262).
On sait combien l'allemand, en revanche, est rebelle à ces passages
hypostatiques ; il leur préfère des dérivations franches, telles que Kupfergeschirr,
Regengüsse, Schneefälle, Todesfälle, etc. Une étude comparative
de ces faits s'impose ; il y aurait lieu de voir si les exceptions ne sont pas
des calques du français, comme c'est sans doute le cas pour Aufmerksamkeiten
« des attentions ».
503. Le français répugne à la formation de féminins par suffixes :
doctoresse est admis (mais Mme X. est docteur es lettres, est porteur d'un
diplôme de docteur) ; cochère a eu une existence éphémère, chefesse paraît
dur ; on préfère, malgré la violence faite au bon sens, des expressions
telles que : « Mme X., artiste peintre, sculpteur, décorateur ; Marie-Thérèse,
successeur de Charles VI ; MmeX., officier d'Académie ». De là des inconséquences
curieuses : « Mme L. est une romancière magnifiquement romanesque
et un conteur infiniment souple. — Mme X. est appelée à faire
sa déposition ; le témoin affirme qu'il n'a vu l'inculpé qu'une seule fois ».
504. Les substantifs à suffixe zéro sont nombreux ; leur formation est
capricieuse et contribue d'autant à leur donner l'aspect de mots simples.
Exemple de masculins : tri, cri, appel, retour (: retourner), gain (: gagner),
élan (: s'élancer). Les féminins sont plus réguliers : marche, gêne, estime,
greffe, etc. Tous ces substantifs sont, naturellement, susceptibles de subir
les changements de sens énumérés plus haut (502) ; cf. butin, traîne, train,
qui désignent des choses.
Remarquons que les anciens participes passés de la conjugaison morte
qui forment des noms d'action ont une origine hypostatique, mais leur
306forme irrégulière les fait interpréter actuellement comme de simples
mots-racines ; exemple : ponte de pondre, fait de faire, crue de croître ;
de sorte que vente p. ex. est sur le même pied qu'achat.
Quant aux participes substantivés de la conjugaison vivante, ils ont
donné naissance au suffixe féminin -ée, qui s'est détaché du participe et
est actuellement autonome (rangée, entrée, assemblée, renommée), si bien
qu'il est arrivé, il y a longtemps déjà, à former des dérivés de substantifs :
potée, verrée, cuillerée.
En allemand, les substantifs verbaux à suffixe zéro sont le plus souvent
caractérisés par le timbre de leur voyelle, qui fait contraste avec celle
du verbe ; ces oppositions apophoniques, malgré leur variété, sont réglées
et limitées à certaines possibilités ; elles contribuent ainsi à donner l'impression
nette de substantifs dérivés : finden : Fund, singen : Sang, kneifen :
Kniff, binden : Band et Bund, etc. En français, les variations vocaliques
sont imprévisibles, parce que l'apophonie n'y joue presque aucun rôle
grammatical (405) : acheter : achat, donner : don, jouer : jeu, gagner : gain,
soigner : soin, etc. Ainsi ces variations, loin de rattacher le dérivé à son
mot de base, l'en éloignent et le rapprochent du mot simple.
505. Des adverbes, des expressions adverbiales, des conjonctions, des
phrases stéréotypées, etc., peuvent beaucoup plus facilement qu'en allemand
prendre, par hypostase, la fonction de substantifs sans changer de forme :
le dessus, le dessous, le devant, le derrière, l'avant (d'un navire), le dedans,
le dehors, l'ensemble, les alentours, un à côté, un vis-à-vis, un sous-marin,
un sous-bois, un à peu près, les si, les mais, les pourquoi, le pour et le contre,
un corps à corps, l'après guerre, l'entre deux guerres, le trop-plein, les moins
de vingt ans, les on-dit, le qu'en-dira-t-on, un va-nu-pieds, etc. On sait que
cette formation libre est à la base du type de composés porte-plume,
cure-dents, etc. Le tour « Je mets de l'argent de côté pour quand je serai
vieux » hypostasie aussi une phrase en substantif.
Un cas plus général est celui où un adjectif ou un participe joue le rôle
d'un substantif abstrait : « Rome conquise ouvrait à Hannibal les portes
de l'univers » = « La conquête de Rome » ; « Pourquoi tant de consternation
pour un sou perdu ? » = « la perte d'un sou » ; « la lutte contre la vie chère » =
« la cherté de la vie », etc. Le latin connaissait aussi ce tour : ab urbe condita
= a conditione urbis. Comparez aussi « sitôt le soleil levé » et l'emploi
des phrases avec des prépositions : « pour quand je serai vieux ».307
b) Adjectifs
506. Quelles ressources le français possède-t-il pour enrichir la classe
des adjectifs sans recourir aux suffixes explicites ? Ici nous retrouvons
l'adjectif épithète, dont il a été question § 367 ss. ; nous n'y revenons
que pour souligner la somme énorme de nuances sémantiques obtenues
par le procédé si économique qui consiste à placer l'adjectif devant ou
après le nom. Tantôt apparaissent deux significations différentes : « un
enfant pauvre, un pauvre enfant ; un âge certain, un certain âge » ; tantôt
il s'agit de la différence entre sens propre et sens figuré : « une robe noire,
une noire ingratitude », ou bien l'un des tours est plus expressif que l'autre :
« un nuage sombre, un sombre nuage », et inversement « mon cher ami, mon
ami cher ». C'est là une ressource dont l'allemand est à peu près complètement
privé, puisque l'épithète est toujours antéposée ; le type Röslein rot
est une rareté. Sans doute cet avantage du français est-il acheté au prix
de durs efforts ; ces distinctions sont fixées par un usage à la fois tyrannique
et capricieux, qu'un étranger arrive rarement à dominer complètement.
Mais nous verrons § 603 que plus un procédé est instable, irrégulier,
plus il a chance d'être expressif, parce qu'il est imprévisible. Un seul
exemple montrera jusqu'où peut aller la complication : une ancienne bibliothèque
est une bibliothèque qui n'existe plus ; une bibliothèque ancienne
existe depuis longtemps ; mais si elle existe depuis très longtemps, c'est
une très ancienne bibliothèque !
507. Un substantif peut, avec la plus grande facilité, devenir adjectif
(474). Il suffit pour cela qu'il soit privé d'actualisateur (110 ss.) et qu'il
adopte les conditions d'emploi de l'adjectif : orateur est à moitié adjectif
dans le type « Paul est orateur » (« vraiment orateur »), artiste l'est tout à
fait dans « Paul est très artiste ». En fonction d'épithète, le passage est
d'autant plus marqué : « un habit marron, des rubans jonquille, un chou
géant, le style gendarme, des manières peuple, la question argent », etc.
Comparez, pour la variété de ces nuances : « le travailleur, un travailleur,
Paul est travailleur, très travailleur, plus travailleur que moi, un écolier
travailleur ».
L'hypostase n'est plus absolue quand le substantif prend la marque du
genre mobile : roman paysan : manières paysannes, logements ouvriers : questions
ouvrières, etc.
508. Inversement, les adjectifs se substantivent sans aucune difficulté.
308Le fait est trop connu pour qu'on y insiste : un sage, un paresseux, les deux
timides, les miséricordieux. Notons spécialement la nuance moderne : « Paul
est un timide, un sentimental ». On sait que l'allemand est obligé, dans ce
cas, de marquer la transposition par les désinences : arm, der Arme, ein
Armer.
L'adjectif forme aussi des substantifs neutres qui se répartissent en
deux classes :
1. Dans le vrai, le beau, etc., le substantif désigne la qualité sous sa
forme la plus abstraite, plus abstraite même que dans la vérité, la beauté,
etc., qui sont susceptibles, comme on l'a vu § 502, de tomber dans le concret.
2. Dans le bas, le haut (d'une tour), l'intérieur, l'extérieur, le piquant
(de la chose), le curieux (de l'affaire), le plus drôle (de l'histoire), l'ancien
adjectif désigne une partie d'un tout, un aspect particulier d'une idée, il a
un sens partitif. On distinguera donc « le comique de situation » et « le comique
de la situation », et l'on admirera que le français obtienne cette différence
à si peu de frais.
509. Les participes présents et passés s'adjectivent aisément : « une
femme aimant son mari : une femme aimante ; un écolier négligeant ses
devoirs : un écolier négligent ; décidé à partir : un caractère décidé ». Le
participe devenu adjectif peut se substantiver : « les vivants et les morts,
une voyante, un blessé, un naufragé ; Paul est un résolu, un raté ».
On connaît aussi le curieux emploi hypostatique du participe présent,
qui consiste à lui donner une valeur impersonelle : thé dansant, café-chantant,
carte payante, étoffe salissante, rue passante, avocat consultant, roman palpitant,
etc.
510. Une expression prépositionnelle fonctionnant originairement comme
complément circonstanciel (« Je lis un livre sans intérêt ») prend très facilement
la valeur d'un adjectif predicatif ou attributif (« Ce livre est sans intérêt.
C'est un livre sans intérêt »). Cf. Il est à désirer, à regretter que … =
« désirable, regrettable » ; une lettre à écrire, un devoir à remplir, une
pensée à méditer. L'allemand est obligé de marquer lourdement la transposition
par un suffixe : « erfolglos, ein zu schreibender Brief ». On a vu
§ 369 que ces tours permettent au français d'adopter la séquence ttʼ.
Les adverbes prennent aisément la valeur d'adjectifs : « L'étage au-dessus,
la chambre à côté, l'année avant, le mois après ».
511. Les échanges entre adjectif et substantif sont si fréquents qu'un
Français d'aujourd'hui a souvent de la peine à décider si le point de
309départ doit être cherché dans l'une ou l'autre des classes de mots, parce
que l'échange peut s'opérer dans les deux sens : « parisien, un Parisien, la
municipalité parisienne ; français, un Français, la république française,
la langue française, le français ».
Cette grande liberté des échanges a son aspect pathologique, elle engendre
des ambiguïtés :
1. Dans un groupe formé d'un substantif et d'un adjectif épithète (ou
d'un substantif adjectivé), on peut, au moins à la lecture, hésiter sur la
valeur de l'un et l'autre mot : « un pauvre malade, un vieux maniaque, le
noir animal » ; j'ai lu quelque part : « Les tribunaux n'acquittent plus les
jaloux meurtriers ». On se rappelle le tour devenu proverbial : un savant
aveugle. Le « 0 mon souverain roi ! » de la prière d'Esther prête à l'équivoque.
On raconte qu'au lycée, Courteline, déjà pince-sans-rire, répondit à un
examinateur qui lui demandait de nommer un fermier général : Cincinnatus !
2. Il y a équivoque dans l'emploi d'un adjectif, quand son substantif
est ellipsé, parce qu'on court le risque de l'interpréter comme un adjectif
substantivé ; ainsi on hésitera à dire « Les traductions allemandes de la
Bible sont supérieures aux françaises » : sans le secours de l'orthographe
(initiale minuscule), il y a une équivoque ; de même : « Aucun contribuable
n'est aussi lourdement chargé que l'anglais ».
3. Un adjectif, nettement substantivé, peut être tout de même ambigu,
au moins pour l'oreille ; « l'allemand (l'Allemand) d'aujourd'hui » peut désigner
le peuple ou la langue ; de même « l'instinct linguistique du français,
épris de précision et de clarté » (Dauzat, Hist. de la langue fr., p. 528).
c) Adverbe
512. Le cas de l'adjectif adverbialisé est bien connu ; il s'agit d'adverbes
« courts », qui ont la même valeur que les adverbes en -ment : « frapper
fort, chanter haut, refuser net, tenir ferme, tenir bon, voir clair, marcher
droit, raisonner juste, filer doux, s'arrêter court ». Cette formation a une
certaine vitalité ; des tours néologiques le montrent, p. ex. « tous ceux
qui parlent neuf et hardi » (J. de Pierrefeu) ; on va jusqu'à dire « Votez
socialiste. Pensez et agissez français ». Ici, le français se rapproche de l'allemand
qui, on le sait, se passe régulièrement du suffixe (« Das Essen ist
gut, schmeckt gut »).310
Mais cette transposition n'est pas possible avec n'importe quel adjectif ;
je n'oserais pas risquer « penser exact, parler précis ». On le sait : notre
langue ne se laisse pas régenter ; elle a horreur des dérivations régulières,
automatiques. Là où ces adverbes sont usuels, ils permettent des distinctions
délicates entre les adverbes correspondants en -ment : « parler bas :
agir bassement, frapper fort avec un marteau : frapper fortement les esprits,
tenir ferme un bâton : tenir fermement à un principe ».
d) Verbe
513. Le verbe est, encore aujourd'hui, grâce à son armature flexionnelle,
un système clos, où les mots des autres catégories ne peuvent pénétrer
que par voie de suffixation verbale (graisse : graisser, blanc : blanchir, etc.).
En revanche, il se produit à l'intérieur du verbe lui-même des transpositions
aisées où le français manifeste à un haut degré son souci d'économie.
Un verbe neutre peut devenir transitif avec la plus grande facilité ;
F. Brunot (PL, p. 311 ss.) a montré la faveur dont jouit ce type. On
dit « travailler régulièrement » et « travailler le fer », « sortir de l'écurie » et
« sortir un cheval de l'écurie ». On connaît le traitement différent de ces
verbes en allemand : le plus souvent, la transitivation est marquée par
un préverbe : « fleissig arbeiten : das Eisen bearbeiten », et avec une nuance
différente : « verarbeiten » ; « auf einen Berg steigen : einen Berg besteigen,
ersteigen ».
A leur tour, les transitifs employés sans compléments d'objet prennent
une valeur absolue : « L'alcool abrutit, cet homme boit, l'homme propose
et Dieu dispose ». Il y aurait lieu de faire une statistique comparative de
l'emploi absolu en français et en allemand ; on a l'impression qu'elle serait
à l'avantage du français.
Enfin les transitifs peuvent recevoir, sans modification, des compléments
d'objet différents, p. ex. personne ou chose : « voler son patron et voler
de l'argent à son patron ; payer son tailleur, payer une facture, payer
cent francs ». La distinction entre objet affecté et objet effectué (168),
qui est, en même temps, une distinction entre aspect duratif et aspect
terminatif, ne nécessite aucune variation du verbe : « cuire la pâte et cuire
le pain, percer un mur et percer un trou », etc. Là encore, on peut prévoir
que l'allemand, fidèle à sa notation des détails, marque ces différences
au moyen de préverbes ; voyez p. ex. auszahlen, qui ne peut se dire que
311d'une somme, bestehlen, qui demande un nom de personne comme complément,
etc. Notons cependant que l'allemand a une forme remarquable
de dérivation implicite dans le type eine Wunde schlagen dont il a été
question au § 263.
514. La dérivation implicite a son pendant syntaxique ; il s'agit de tous
les cas où un rapport grammatical est rendu par simple juxtaposition,
sans signe spécial. Le français possède beaucoup de tours de ce genre ; le
plus connu est celui qui marque les fonctions de sujet et de complément
d'objet par la place devant ou après le verbe (Paul bat Pierre ; voir cependant
notre opinion sur la nature du complément d'objet, §§ 190, 253 ss.).
Il y en a beaucoup d'autres ; j'en cite, pour mémoire, quelques-uns seulement :
les tours participiaux tels que « Voyant qu'on l'observait, le malandrin
prit la fuite », « Blessé à mort, le soldat s'affaissa » ; les oppositions substantives :
« Jeune homme, on te maudit, on t'adore vieillard » (V. Hugo) ; l'emploi
prédicatif des adjectifs et des participes : « Je l'ai connu riche, je le
retrouve ruiné » ; les constructions dites absolues (93, 152) : « L'ennemi
vaincu, l'armée se retira » ; les compléments circonstanciels sans préposition :
« Veiller la nuit, marcher sac au dos, s'avancer l'épée à la main », etc.
L'allemand répugne, en général, à cette syntaxe par simple juxtaposition.
Autres procédés économiques
515. Il existe encore d'autres procédés par lesquels la langue se rapproche
de la formation explicite, mais qui permettent tout de même une
économie, car ils évitent des changements dans la forme des mots.
Ainsi un verbe peut recevoir des significations différentes grâce à la
présence ou à l'absence de certains signes externes (prépositions vides
de sens, pronoms asémantiques, etc.), dont le choix est d'ailleurs purement
conventionnel. Un même verbe prend des sens différents selon que
son complément d'objet est précédé ou non d'une préposition, ou d'une
certaine préposition par opposition à une autre : s'accommoder aux goûts
de quelqu'un : s'accommoder de tout ; croire en Dieu : croire aux démons ;
user un habit : user d'un droit ; tenir un bâton : tenir à un bijou de famille :
tenir de son père ; jouer du violon : jouer aux cartes ; un outil sert à l'ouvrier :
l'habileté sert mal celui qui en abuse ; un père consent au mariage de sa
fille : il consent une somme pour parfaire sa dot ; ce spectacle satisfait les
312plus difficiles : un homme d'honneur satisfait à ses engagements ; un magistrat
préside une assemblée : Mars préside aux combats ; se mêler à la
foule : se mêler des affaires des autres ; protester de son innocence : protester
contre un abus ; changer son caractère : changer de caractère ; participer à
une entreprise : participer des caractères de l'animal, etc.
516. Mais c'est le complément d'objet à l'infinitif qui permet le plus
de distinctions de ce genre. Comme il est tantôt seul, tantôt précédé
d'une préposition vide (de, à), la langue utilise ces modalités pour marquer
des différences sémantiques : « Paul pense à faire un séjour dans le
midi : il pense partir le mois prochain ; je viens vous prier d'assister à
mon mariage : je viens d'arriver ; s'il venait à mourir ; je prétends avoir
raison : je prétends à être obéi ».
Il est vrai que la distinction n'est pas toujours perceptible : on dit
« Je demande à sortir » et « je vous demande de me laisser sortir » ; elle est
tout à fait nulle aujourd'hui dans « continuer de ou à jouer, aimer se promener,
de se promener, à se promener ». On dit « forcer de et forcer à partir »,
mais seulement « être forcé de partir ».
Ces fluctuations sont naturelles, car la préposition est ici un pur ligament
qui étiquette le verbe de façon arbitraire ; cependant, comme l'infinitif
tend de plus en plus à se faire précéder du signe de (483), c'est cette
préposition qui a le plus de chance de prévaloir.
517. Ailleurs, c'est la présence de l'indicatif ou du subjonctif dans la
subordonnée qui fixe le sens du verbe principal : Je suppose (= je crois)
que Paul a réussi : supposons (= imaginons) qu'il ait échoué ; je comprends
(= je devine) que vous êtes offensé : je comprends (= j'admets, trouve
juste) que vous le soyez ; je prétends (= je soutiens) qu'il a tort : je prétends
(= je veux) qu'il m'obéisse ; il ne voit pas (= il ne s'aperçoit pas) qu'il fait
fausse route : je ne vois pas (= je ne crois pas) qu'il ait des aptitudes
pour cette profession ; je consens (= permets) qu'il parte ; je consens
(= reconnais) que cette étude est difficile ; je doute s'il viendra (= je ne
sais) : je doute qu'il vienne (= je ne crois pas) ; je souffre de ce que vous
ne m'aimez plus : je ne souffre pas (= ne permets pas) qu'on m'interrompe ; j'ai
dit (= annoncé) que le dîner est servi : j'ai dit (= ordonné) qu'on serve le dîner.
Ajoutons que le relatif a le sens du latin qui dans « X. est un maître
qui sait enseigner », et de qualis 1117 dans « Je cherche un maître qui sache
313enseigner ». De même, dans « Il est le seul (le premier) qui ait trouvé la
solution », on comprend « le seul (le premier) homme doué des qualités
qui lui ont fait trouver la solution ».
518. Un verbe est tantôt simple, tantôt réfléchi, sans que le pronom
ait lui-même une valeur réelle ; mais il sert à étiqueter une différence de
sens. Il y a d'abord des cas à peu près isolés, comme « se douter d'une chose »,
qui arrive à signifier à peu près le contraire de « douter d'une chose » ; on
comparera aussi apercevoir et s'apercevoir de, décider de partir et se décider
à partir, jouer quelqu'un et se jouer de quelqu'un, rire de quelqu'un et
se rire de quelqu'un, attendre et s'attendre à, etc.
Mais il est plus intéressant de constater que, dans une série de verbes,
la présence ou l'absence du pronom réfléchi symbolise une différence
aspective et modale, l'intransitif désignant un état d'où la volonté est
absente (p. ex. « un corps plonge dans l'eau »), le réfléchi, une action volontaire
envisagée à son début (« se plonger dans l'eau » ; de même « le blé
lève » et « je me lève »). A la même catégorie appartiennent : (se) tremper,
(se) remuer, (se) loger, (se) plier, (se) coucher, (s')approcher, (s')avancer,
(se) reculer, (se) pendre, (s')enlaidir, (s')embellir.
Parfois le choix entre les auxiliaires être et avoir marque une nuance ;
dans « Il a demeuré à Genève », demeurer veut dire habiter, mais dans
« Il est demeuré inflexible », le même verbe signifie rester. Fait plus général :
il y a une différence bien connue entre « il a vieilli » (action passée) et « il est
vieilli » (état résultant de cette action). Mais cette nuance s'efface de plus
en plus : « Il est grandi » ne se dit plus guère.
519. On peut signaler enfin un grand nombre de locutions toutes faites
qui, avec de minimes changements de forme, ont des significations différentes ;
je me borne à citer : « mettre la main à l'ouvrage : mettre la main sur
un voleur ; je le veux : je le veux bien ; prendre congé : prendre un congé ;
prendre parti pour quelqu'un : prendre un parti : prendre son parti d'une
mésaventure ; prendre quelqu'un pour domestique : prendre quelqu'un pour un
domestique ; traiter en ennemi : traiter de filou ; faire mal : faire du mal ;
voyager à pied : mettre l'arme au pied : un portrait en pied ; exposer quelque
chose à l'air : cette idée est dans l'air : tenir le bras en l'air ; cette viande
est cuite à point : ce travail est au point ; je respire à peine : avoir de la
peine : avoir de la peine à faire un travail : avoir peine à respirer ; donnez-vous
la peine d'entrer : se donner de la peine ; vivre en repos : être momentanément
au repos ; une armée en retraite : un fonctionnaire à la retraite », etc.314
Emprunts
520. Les langues ne tirent pas toutes leurs ressources de leur propre
fonds ; elles en demandent aussi à d'autres idiomes. L'emprunt a été de
tout temps une fonction normale de la vie linguistique ; mais cette fonction
a pris une importance énorme dans les langues modernes. Le fait
est trop connu pour qu'on y insiste.
La linguistique statique n'a pas à rechercher les causes du phénomène ;
ce qui lui importe, c'est d'observer l'action des emprunts sur le système
de la langue. En particulier, nous aimerions savoir si les mots empruntés
par le français subissent, comme les autres, l'action condensatrice qui
aboutit au mot simple.
521. Un mot emprunté tel quel à une langue étrangère, surtout si elle
est très différente de la langue emprunteuse, n'est pas analysé par les
sujets, au moins au début, avant l'action possible de l'étymologie populaire.
Ainsi un anglicisme tel que five o' clock, où un Anglais distingue
au moins deux mots, est un bloc indivis pour un Français (c'est pour cela
que certains restaurateurs annoncent que l'on trouve chez eux « five o' clock
à toute heure », et écrivent sur leurs menus « irish stew à l'irlandaise »).
Ces emprunts isolés s'assimilent généralement au corps de la langue, en
conformant leur prononciation au système phonologique et en accommodant
leur signification aux mots avec lesquels ils sont naturellement
associés ; ainsi meeting tend à se prononcer « métingue », et son sens est
spécialisé grâce à la présence de réunion, assemblée, etc.
Les emprunts ont une tout autre importance lorsque, par leur nombre
et la communauté de leur origine, ils arrivent à former une masse relativement
homogène, offrant des traits communs dans leur structure. Car alors
ils se laissent analyser et fournissent à la langue emprunteuse des éléments
formatifs (racines, préfixes, suffixes, types de composés), avec lesquels
de nouveaux mots peuvent être formés, par voie d'analogie. Il est clair,
p. ex., que des mots tels que indestructibilité, dégrammaticalisation, et tant
d'autres même beaucoup plus simples, ne sont pas sortis tout armés du
vocabulaire latin. C'est cela qui fait l'importance des emprunts latins
(et, à un moindre degré, des emprunts grecs) dans les langues romanes,
car c'est par là surtout qu'elles renouvellent leur vocabulaire.
522. Les latinismes de ces langues obéissent à des règles de formation
qui mériteraient une étude statique plus approfondie. Dans la grande
315majorité des cas, les radicaux latins appellent des préfixes et des suffixes
latins ; si p. ex. le radical roman chant- prend la forme latine cant-,
il ne pourra recevoir ni le préfixe en-, ni le suffixe -ment, comme en-chantement,
mais in- et -ation (incantation).
Cette dualité est encore soulignée dans la diction poétique par l'emploi
de la diérèse (ou hiatus interne devant i et u, voir § 454). En effet, dans
les vers, premier, palier, essieu comptent pour deux syllabes, tandis que
nation, allier, précieux en ont trois. D'où vient cette différence ? La diérèse,
à part le cas de chevrier, etc. (534), n'est admise que dans les mots empruntés
au latin ou imparfaitement francisés. La règle veut que l'hiatus soit observé
là où il existait en latin (nation, séditieux) ou à la place où une consonne
est tombée dans un emprunt remanié (cf. allier et lat. alligare, sacrifier et
sacrificare, marier et maritare). Il en est de même de l'hiatus interne
après u (sinueux, diluer) qui est, lui aussi, un indice d'emprunt.
523. On comprend dès lors que l'analyse de ces mots doit être — en
théorie — transparente, puisqu'ils sont formés de pièces nettement découpées.
Comme d'autre part leur nombre croît sans cesse, ils doivent
faire contrepoids à l'agglutination qui menace les formations romanes du
français, d'autant plus que, à première vue, les éléments latins sont parents
des éléments romans par la forme et le sens (voir plus haut en- : in-,
chant- : cant-).
En allemand, les emprunts devraient — en théorie — avoir une action
très différente sur le système ; là, les formations latines, très nombreuses
aussi, jurent avec les mots de souche germanique (Komposition : Zusammensetzung) ;
ne faut-il pas en conclure qu'ils s'agglutinent plus facilement,
et, par suite, compensent l'analyse si aisée des mots allemands ?
524. Un examen plus approfondi semble montrer que les emprunts,
malgré tout, obéissent aux lois fondamentales, et opposées, de l'un et
l'autre idiome.
L'exemple des composés est particulièrement instructif. Laissons de
côté ceux qui sont tirés directement du grec ou du latin, comme anathème
ou triumvir, et qui, par définition, s'analysent mal (385, 521) ; ne retenons
que ceux que le français a pu former avec des éléments détachés, comme
fébrifuge, régicide, anthropophage, autogénèse. L'analyse de pareils mots
peut paraître aisée à un philologue qui possède, même superficiellement,
son grec et son latin ; l'on pense aussi que la culture du jardin des racines
latines et grecques suffit à éclairer un profane. Mais tout cela échoue
316devant les exigences de l'analyse spontanée, qui seule a une réelle importance
dans le fonctionnement de la langue. Quoi qu'on fasse, régicide
n'est associé qu'indirectement avec roi et tuer ; avec le premier par une
vague analogie de forme, avec le second par la comparaison réfléchie avec
d'autres mots savants tels que parricide, insecticide, etc. ; ainsi, même
pour le latiniste, régicide est plus bloqué dans la mémoire que ne l'est
Königsmörder pour un allemand. De plus, la séquence tʼt, régulière dans
les mots savants, est un nouvel obstacle à la décomposition, puisque les
composés romans observent la séquence inverse (378). Quand j'étais au
collège, un de nos maîtres portait le sobriquet de Barbacole : pendant
longtemps, j'ai cru que ce nom devait s'écrire « Barbe-à-colle ». On cite
aussi cet amusant pataquès d'un anticlérical : il s'était fait une idée à lui
de hydrophobe (qui déteste l'eau) et déclarait qu'il était, lui, hydroprêtre ;
la hantise de l'ordre ttʼ lui faisait croire que l'idée de peur ou de haine
est dans hydro, et non dans phobe. Ces fautes en disent plus long sur la
forme interne d'un idiome que de longues dissertations.
525. Mais la structure des préfixaux et suffixaux formés sur des modèles
latins est plus propre encore à montrer que les latinismes se prêtent mal
à l'analyse spontanée : ils constituent une couche bien distincte du vocabulaire,
et s'opposent d'autant mieux aux mots romans qu'ils offrent des
formations parallèles, comme strangulation (étranglement), dessication
(séchage), etc. Le fait capital est que les éléments entrant dans les latinismes
ne se combinent pas avec les éléments romans, et vice versa :
étranglation serait aussi monstrueux que strangulement. Il ne semble pas
qu'on ait compris toute l'importance de ce fait, qui mériterait une étude
spéciale. Il montre que, si les latinismes s'expliquent souvent par des parallèles
français, cette correspondance est réfléchie, souvent imparfaite, et
que, par suite, la décomposition de ces mots est, elle aussi, consciente chez
les gens cultivés, imparfaite ou nulle chez la majorité des sujets.
Pour en revenir à la comparaison avec l'allemand, rétrograder ne peut
être aussi transparent que rückwärtsgehen, intromission que Einführung,
inoxydable que rostfrei 1118.317
526. Qu'en est-il des emprunts de l'allemand au latin et au grec ?
En apparence, nous l'avons dit, ils doivent, plus encore que ceux du français,
s'agglutiner et faire contrepoids aux mots autochtones, si complexes
et si nettement décomposables. Cette vue semble se vérifier au
premier abord ; on a même prétendu que si l'allemand recourt aux emprunts,
c'est pour échapper à l'obsession des composés (Werneke, Versuch,
p. 19). Toutefois, l'instinct qui pousse l'allemand à décomposer se
retrouve ici comme dans les mots du terroir.
Les latinismes complexes, les seuls qui aient une réelle importance à
ce point de vue, sont, malgré les apparences, moins bloqués que les formations
parallèles du français. Cela tient à des raisons lexicales, grammaticales
et phonologiques ; lexicales : les éléments formatifs conservent plus
qu'en français la forme et surtout le volume des éléments originaux :
Realität : réalité, Realismus : réalisme, surtout notieren : noter, etc. ;
grammaticales : l'ordre tʼt, qui régit la formation des mots grecs et
latins, est aussi celui des mots allemands ; phonologiques : la séparation
des éléments est nette, elle est soulignée par l'hiatus avec coup de glotte
(548), p. ex. dans reʼal, ideʼell, reʼagieren, mais surtout par l'accent, très
intense, qui frappe presque toujours le suffixe dans les emprunts au latin
et au français : national, originell, Autorität, notieren, etc.
Aspects phonologiques de la condensation
Facteurs positifs et négatifs de condensation
527. Si les tendances grammaticales d'une langue ont leur contrepartie
dans son système phonologique, on doit s'attendre à ce qu'en français
les groupes de signes aient une grande cohésion phonique et que
les sémantèmes qui y figurent soient mal délimités dans la molécule, sans
y être complètement noyés cependant ; en effet, si le « mot » a perdu une
grande partie de son autonomie, il donne souvent — nous l'avons vu § 482 l'impression
d'être indépendant du groupe.
Inversement, on peut prévoir que les mots allemands apparaissent
phoniquement beaucoup plus indépendants des groupes, ceux-ci étant
plus morcelés et moins cohérents. Voyons si le régime des accents, des
mélodies et des pauses, la constitution des syllabes et des phonèmes
isolés, confirme ou infirme l'hypothèse de cette différence.318
528. Par leur importance et leur généralité, les caractères du groupe
rythmique français contrastent avec ceux que révèle l'autonomie très
relative des parties du groupe. Ils sont si apparents qu'il suffit de les
signaler.
En français, la mesure rythmique n'a qu'un accent, et dans la parole
non émotionnelle, cet accent est terminal. Or, un principe de phonétique
générale nous apprend que l'accent oxyton unique est un facteur d'unification
(même en allemand, où la barytonie prédomine ; voir Jespersen,
Lehrbuch, p. 216 ss.). Tout mot intérieur de groupe perd son accent s'il
est susceptible d'en porter un : « Joli ! - un joli chapeau ; Regardez ! Regardez-moi ! ».
La pause est, avec l'accent, le procédé essentiel de séparation des groupes ;
sa longueur varie avec le degré d'autonomie de ceux-ci : elle est à peine
perceptible dans la maison de mon père et dans Je te punirai si tu désobéis,
davantage dans les oppositions du genre de pauvre, mais honnête, très
sensible entre les parties de la phrase segmentée (81) : Cette lettre, je ne l'ai
jamais reçue — Si tu désobéis, je te punirai ; dans les fausses coordonnées
(88, 89) : Tu as désobéi, tu seras puni ; encore plus prononcée dans les coordonnées
proprement dites : Napoléon mourut en 1821. Il était âgé de
52 ans.
La mélodie, comme on le sait, va de pair avec la mesure rythmique, et
son importance croît avec le volume de celle-ci.
529. Les facteurs négatifs sont tout aussi efficaces : la constitution des
mots et des syllabes contribue à fondre les éléments dans un tout uniforme :
nous rappelons que l'initiale vocalique n'est pas protégée contre le contact
avec la finale du mot précédent, parce que son articulation n'est pas énergique
et n'est pas précédée d'une occlusion laryngale (548). Les consonnes
finales, de leur côté, sont toutes prêtes à se fondre avec une voyelle
suivante, à cause de leur articulation explosive ou prolongée, en sorte
que toute consonne finale forme une seule syllabe avec une initiale suivante
(pâte : pâ-t'à gâ-teau). On sait qu'une consonne finale amuie à la
pause (p. ex. -s, -t) a la propriété de se prononcer devant voyelle en
formant syllabe avec elle (très zhonnête, Dieu est tamour). Comme la
liaison n'est possible que dans l'intérieur de la molécule, elle contribue à
en accroître la cohésion. Il est vrai qu'on lie toujours moins, mais certaines
liaisons demeurent obligatoires (p. ex. Ils zont, il est taimable).
530. On sait aussi que l'hiatus, qui n'est marqué ni par le coup de glotte,
319ni par un arrêt de la respiration, est plutôt, comme le dit si bien M. Grammont,
une liaison vocalique qu'une interruption. C'est d'ailleurs ce caractère
de l'hiatus qui a créé l'élision, c'est-à-dire la suppression de la première
des deux voyelles en contact. De là cet effacement caractéristique
de la frontière entre les sémantèmes et leurs déterminations préfixées :
c'est, j'ai, m'a, t'ont, d'un, etc. ; il est si difficile de distinguer les éléments
qu'on peut les comparer aux signes cumulés résultant d'anciennes contractions :
au(x), du, des.
531. L'amuissement de l'e caduc (457-459), qui atteint surtout les éléments
grammaticaux, contribue beaucoup à les fondre les uns dans les
autres et avec les sémantèmes, au moins dans la langue parlée ordinaire :
jel'vois, tum'l'as dit, vousn'le voyez plus. Il faut rappeler aussi que ce
même amuissement est en train de compromettre le caractère fondamental
de la syllabe française, qui est de se terminer par voyelle ; en effet, il provoque
des rencontres de consonnes qui ferment les syllabes (459).
Mais le fait capital, c'est que, dans l'intérieur d'un groupe, la frontière
de syllabe ne coïncide que par hasard avec la frontière des éléments
significatifs : tro-p aimable, u-n'agréa-bl'odeur, etc. A plus forte raison la
syllabe ne sépare-t-elle pas les sous-unités des mots : i-nutile, dé-sunir, germa-niser,
peu-reux, rou-geur, etc. Cette carence de la syllabe française est un
des traits fondamentaux qui séparent le français de l'allemand 1119 (312).
Facteurs phonologiques de l'autonomie des mots groupés
532. En face des critères décisifs qui révèlent l'unité des groupes rythmiques
du français, trouverait-on des indices d'une indépendance au moins
relative des « mots », c'est-à-dire des sémantèmes (468) au sein du groupe ?
Nous nous heurtons ici à une question de principe. On a affirmé que
le mot n'est pas une réalité phonologique, parce que rien n'indiquerait
à l'oreille comment il peut être délimité (voir Jespersen, Lehrbuch, p.206 ;
Roudet, Eléments, p. 259). La question est mal posée.
1. Il est clair que, s'il y a des indices de la séparation des mots, ils
sont perceptibles, non aux personnes qui les cherchent dans une langue
étrangère qu'elles ignorent, mais aux sujets qui parlent leur langue maternelle.320
2. Ces indices peuvent être, pour ces sujets mêmes, parfaitement inconscients
sans cesser d'être réels.
3. La notion de mot est, comme on sait, ambiguë ; il faut partir des
unités qu'un idiome distingue, et tenir compte de leur importance relative :
l'unité fondamentale du français est le groupe rythmique ; nous
venons de voir qu'il s'impose à l'oreille ; d'autre part, si les « mots », comme
c'est le cas en français, ne sont pas complètement fondus dans le groupe,
il faut qu'on puisse les reconnaître à certains signes moins généraux, plus
délicats, et qui ont souvent un caractère négatif. Mais le fait que la plupart
du temps ils passent inaperçus ne diminue pas leur valeur démonstrative.
Nous passons rapidement en revue les principaux procédés phoniques
par lesquels le français distingue le mot isolé dans la phrase et le groupe,
et même, dans des cas très rares, les sous-unités dans l'intérieur des mots.
Les indices qui caractérisent le contact entre les mots sont groupés sous
le nom de phonologie syntaxique ou sandhi (d'un mot sanscrit signifiant
« jointure »).
533. Phonèmes isolés, z- initial est rare en français ; zéro et zèle sont à
peu près les seuls mots d'un usage courant où ils figurent ; les autres sont
des termes techniques (zone, zinc, zodiaque, etc.), des onomatopées (zigzag)
ou des interjections (zut). Au contraire, z est très fréquent en sandhi ;
des déterminatifs employés constamment (les, des, aux, ces, mes, tes, ses,
nos, vos, leurs, quelques, etc.) font apparaître z devant voyelle initiale,
indiquant ainsi que le sémantème commence immédiatement après. On
sait que z est même en train de devenir un signe du pluriel ; mais c'est
une erreur de croire qu'il est attaché au mot lui-même. Cela ne se vérifie
guère que pour z-yeux (d'où zyeuter « regarder ») ; mais ici, le pluriel est
totalement différent du singulier œil. Dans les mots ordinaires, l'opposition
avec le singulier (un homme : des hommes) empêche l'agglutination
de z. Il est vrai que l'abondance des z intérieurs et finaux de mots (oser,
maison, cause, etc.) enlève beaucoup de valeur à cet indice.
Une voyelle longue ne peut être finale, car toute voyelle finale est
brève (450).
Le son œ̃(-un) final n'existe que dans un petit nombre de mots usuels :
brun, commun, défunt, emprunt, opportun, importun, parfum, tribun. Au
contraire, l'emploi de l'article un et de ses composés (chacun, aucun,
quelqu'un) est illimité. Il s'ensuit que, pratiquement, ils accaparent à
eux seuls le phonème en question et, par là, signalent l'initiale du sémantème
321(avec cependant l'ambiguïté résultant de la liaison devant voyelle : un
navire : un naviron).
534. Hiatus. Nous avons parlé de l'hiatus comme principe de cohésion
(530) ; il n'en est pas moins vrai qu'il est rare à l'intérieur des mots et
que, d'une façon très discrète, il souligne la séparation des mots entre
lesquels il est prononcé.
A l'intérieur, les sonantes i, u, ou ont valeur de consonnes (y, ẅ, w)
devant voyelle : acier, écuelle, équateur. En conséquence, i, u, ou voyelles
devant voyelle sont, dans la majorité des cas, en fin de mot : cf. acier et
il est si épais, viande et ravi en extase, boîte et la boue a taché mes habits,
foin et fou insensé, cuit et j'ai vécu ignoré.
En position interne, l'hiatus est obligatoire quand les sonantes i, u, ou +
voyelle sont précédées d'une occlusive + r ou l, comme dans prière, bouclier,
ouvrière, renflouer, cruel, et, souvent, quand elles se trouvent en
initiale après consonne, comme dans lier, nier, nouer, buée, etc. Or, la
sonante appartient régulièrement au radical et l'autre voyelle à un suffixe
ou à une désinence, car i se prononce y dans pied, lieu, bien, etc. et i
dans pri-er, etc., de sorte que l'hiatus conserve, là encore, une légère
valeur analytique ; la séparation des sous-unités est un cas-limite de sandhi.
535. Quant aux autres hiatus, ceux dont le premier élément est a, e ou o,
ils sont très rares à l'intérieur ; ceux de l'ancien français ont été en grande
partie éliminés (voir la prononciation et l'orthographe de taon, paon,
et les formes anciennes peeur, veü, etc.) ; en outre, l'hiatus est supprimé
par diphtongaison en syllabe atone (paysan, etc., voir 442). Les exceptions
se trouvent surtout dans les noms propres (Raoul), des emprunts
non assimilés (hétaïre, caïman, raout), des onomatopées et mots onomatopéiques
(tohu-bohu, chahut, cahot). Il s'ensuit que, dans la règle, l'hiatus
marque la séparation entre deux éléments de groupe : « Cette soirée a eu un
grand succès ».
Enfin il marque souvent la limite entre radical d'une part, préfixe et suffixe
d'autre part : « proéminence, préhistoire, réagir, coopérer, péage, béant,
agréable ». Donc là, comme pour les hiatus de la première classe, la coupe
correspond à celle des sous-unités.
En outre, les hiatus entre les mots sont de plus en plus fréquents, du
fait que les liaisons perdent du terrain ; le peuple va très loin dans leur
élimination : « Voilà qui est pa ordinaire », etc.
Enfin l'h « aspiré » (256) indique que la voyelle initiale d'un mot ouvre
322toujours la syllabe ; il est en hiatus avec la voyelle finale (un héros = œ̃ ero),
et empêche une consonne finale d'ouvrir la syllabe (comparez : une haute
montagne = un-ot et une autre = u-notr). Le mot se détache donc nettement.
536. Remarque. Le français, comme beaucoup d'autres langues, a trouvé
un moyen de faire coïncider la frontière des sous-unités avec celle des
syllabes : c'est de grossir les suffixes de manière à les faire commencer
par une consonne, extraite du radical par voie d'analogie. Ainsi le suffixe
-ier des noms d'agent est devenu -tier, p. ex. dans clou-tier, ferblan-tier
d'après argent-ier, etc. Le suffixe -ie a fait place à -rie : gendarme-rie,
d'après chevaler-ie, etc. Parfois un changement d'interprétation suffit :
en français moderne, le futur et le conditionnel ne sont plus compris
comme formés sur l'infinitif + ai, ais, mais sur le radical + rai, rais ;
on n'analyse plus j'aimer-ai, mais j'aime-rai.
537. Groupes de phonèmes. On connaît la prédilection du français pour
les syllabes ouvertes ou vocaliques (436 ss.). Certains types de syllabes
consonantiques sont même totalement exclus de l'intérieur des mots et
ne peuvent paraître qu'en contact entre deux mots. Voici les cas qui ont
pu être relevés :
a) Cette prédilection pour les syllabes ouvertes s'affirme surtout dans
les groupes occlusive + sonante (r, l, y), p. ex. pr, cl, ty, etc., dont le premier
élément ne ferme jamais une syllabe précédente dans l'intérieur des mots
(ca-price et non cap-rice). La coupure p-r, c-l, etc., n'est donc possible
qu'entre deux mots : un cap rocheux, un bouc lascif, etc.
538. b) Le français ne doit pas, normalement, tolérer de consonnes
géminées, car la première fermerait la syllabe précédente. Elles sont donc
des indices de sandhi : « bec courbe, cap pointu, teint(e) terne, maux d(e)
dents, il l'aime », etc.
Parfois la frontière de deux sous-unités se trouve entre deux consonnes ;
c'est le cas de certains suffixes après e caduc amui : verr(e)rie, nett(e)té,
embaum(e)ment ; c'est le cas aussi du suffixe du futur et du conditionnel
dans je mour-rai(s) et je cour-rai (s).
L'usage de doubler la consonne dans la prononciation s'est étendu au
delà de ces cas, dans les mots savants, sous l'influence de l'orthographe
(455). Là encore, la géminée contient souvent la frontière entre deux
sous-unités : il-légal, cor-rompu, etc.
539. c) Les groupes consonantiques qui correspondent aux mi-occlusives
323(ts, dz, tch, dj, pf, kx et autres analogues), et dont le premier élément
serait, d'après la phonologie du français, rejeté à la fin de la syllabe précédente,
sont inexistants à l'intérieur des mots (446) ; ils ne peuvent apparaître
que par contact entre deux mots, et la limite est placée entre
les deux éléments ; exemple : cett(e) cité, plein d(e) zèle, tout(es) choses,
grand(e) joie, frapp(e) fort. Certains groupes d'occlusives sont dans le
même cas : « ma bagu(e) tombe, un bec d'aigle, cett(e) contrée », etc.
Ces rencontres de consonnes permettent parfois de distinguer les sous-unités
du mot : lent(e)ment, vêt(e)ment.
540. d) A propos des syllabes fermées, fréquentes surtout dans les emprunts
(aptitude, abdomen, aspiration, objurgation, subsister, etc.), mentionnons
la règle bien connue d'après laquelle deux consonnes séparées
par la frontière de syllabe à l'intérieur d'un mot doivent être toutes
deux sonores ou toutes deux sourdes si le groupe est formé d'occlusives,
de la combinaison d'une occlusive et d'une spirante (s, x, ch, f, v, j) ou
vice versa : voir les exemples ci-dessus 1120. Il suit de là que tout groupe
contraire à la règle indique la frontière entre deux mots ; p. ex. gt : ma
bague tombe, kd : bec d'aigle, zp : ne te rase pas, jf : rouge foncé, etc. Sur
la pronociation réelle de ces groupes (prononciation indifférente pour la
phonologie, parce que les sujets n'en ont pas conscience), voir Grammont,
Prononciation2, p. 97.
541. e) A l'intérieur du mot, les voyelles fermées (á, é, ó) terminent
toujours la syllabe : « hâtif, pêcher, poser », etc. ; elles ne se trouvent pas
en syllabe consonantique : des prononciations telles que « pasteur, poster,
portier, perdre » sont anormales. Les finales du type hâte, passe, pose ne
font pas exception, puique la consonne finale n'est pas réellement fermante
(448). Au + s est prononcé ó dans quelques mots savants :
« auspice, austère, austral, ausculter ».
Il suit de là que, pratiquement, le groupe voyelle fermée + consonne
fermante est indice de frontière ; il s'agit surtout des petits mots les, des,
ces, mes, tes, ses, au, aux, nos, vos, précédant des mots proprement dits ;
la consonne est le plus souvent fermante par amuissement d'un e caduc
suivant : « les r'mords, mes gu'nilles, tes s'rins, nous les m'nons », etc.
542. f) A l'intérieur des mots, les nasales fermantes ont été éliminées
(infantem → enfant, voir 439). Une nasale fermante est donc finale de
324mot : « un(e) fenêtre, j'aim(e) le sport, un homm(e) de cœur », etc. Il est
vrai que l'amuissement de l'e caduc a parfois introduit ces groupes à
l'intérieur des mots : « nous am(e)nons, un enn(e)mi, sam(e)di ». Mais il
n'est pas rare qu'ils se trouvent à la frontière de deux sous-unités, p. ex.
dans les mots ân(e)rie, crém(e)rie, pan(e)tier, vain(e)ment, etc., et au
futur et conditionnel : je mèn(e)rais, j'aim(e)rais, etc.
543. g) Une voyelle nasale (439) termine toujours la syllabe en phonologie
interne : « manteau, quintal, conter », etc. ; en syllabe fermée, elle est donc indice
de sandhi : « dans l (e) train, on m (e) vole », etc. Il est vrai que l'amuissement
de l'e caduc l'introduit à l'intérieur dans certains cas : « maint (e)nir,
enl(e)ver ». On notera aussi quelques mots savants : « instruire, inspirer », etc.
544. h) Une syllabe contenant un e caduc suivi d'une consonne fermante
est impossible à l'intérieur (458 s.). Elle résulte, en sandhi, du contact
de deux monosyllabes atones tels que je, me, te, le, que, etc., dont le
second a amui sa voyelle : « Je le vois » = jelvwa, « Je ne vois pas » =
jenvwa pa, « Que me veux-tu ? » = kemvœ tu, etc. Le groupe e + consonne
fermante précède donc le plus souvent une initiale de mot proprement
dit. L'application de cette règle est fréquente, car les petits mots qui y
donnent lieu sont d'un emploi constant.
545. En dehors des conditions relatives à la syllabation, certains groupes
de phonèmes sont propres au sandhi seulement.
a) Les voyelles nasales, dont il a déjà été question plus haut (533 et
543), jouent un rôle capital dans la délimitation des mots et des sous-unités :
on ne trouve pas, normalement, à l'intérieur des mots simples,
une voyelle nasale suivie de r, l, m, n, v, z 1121. Ainsi, dans les cas, très nombreux,
où cette rencontre se produit, la consonne est nécessairement initiale
de mot, ou, s'il s'agit des préfixes en et in, initiale de radical : On rit,
en lisant, chemin montant, bon nageur, quelqu'un vient ; en-rayer, im-mangeable,
etc.
Enfin, comme z initial est pratiquement impossible (533), il s'ensuit
qu'après nasale il est coincé entre deux mots, c'est-à-dire est un z de
liaison : bons z amis, etc.325
546. b) La consonne r n'est jamais précédée d'une voyelle fermée à
l'intérieur des mots, même en syllabe ouverte ; des groupes tels que ára,
árta, éra, érta, óra, órta, etc., sont impossibles. On notera seulement la
tendance à la conformation des timbres vocaliques dans des cas tels que
serrer (séré) par opposition à serre, serrons (sèr, sèrõ ; cf. heureux et heure).
En conséquence, le groupe voyelle fermée + r est coupé en deux par la
frontière entre deux mots : un beau rêve, assez rude, etc. L'application de
cette règle est abondante avec les mots grammaticaux les, des, ces, mes,
tes, ses, au, aux, eux, etc. ; cf. encore trop rare, peu raisonnable, etc.
Caractères phonologiques des parties de la phrase allemande
547. Si, en allemand, les éléments de la phrase sont beaucoup plus dispersés,
et par suite plus autonomes qu'en français, si cette autonomie, enfin,
se retrouve jusque dans les sous-unités des mots, le système phonologique
doit confirmer cette impression, et présenter des caractères diamétralement
opposés à ceux du français. Or, l'aspect haché de la chaîne parlée
correspond en effet à l'aspect haché de la phrase.
Nous passerons en revue quelques faits caractéristiques qui contribuent
à protéger les éléments significatifs et les empêchent de se fondre dans
l'ensemble, comme c'est le cas en français.
548. L'initiale des unités et des sous-unités est normalement consonantique ;
car, dans la prononciation du nord, considérée comme normale,
toute voyelle initiale de mot ou de sous-unité est précédée de l'occlusion
laryngale ou « coup de glotte » (ʼ) : der ʼ Adler, die ʼ Eiche, Wert ʼ urteil, ver arbeiten,
be ʼ arbeiten. Dans les parlers où elle est négligée, l'attaque vocalique
est encore assez énergique pour empêcher toute fusion avec un son précédent,
notamment une voyelle ; car l'hiatus est produit par un arrêt du
débit d'air. La spirante laryngale h (ʻ) est toujours initiale de mot ou de
sous-unité : helfen, Wind-hose, dort-hin, Krank-heit, leb-haft, et oppose une
barrière infranchissable à tout élément précédent. L'allemand connaît aussi
à l'intérieur des mots l'hiatus glissant, celui du français (530), qui sépare
des sous-unités faiblement distinguées, comme dans zuerst, Höhe, rohes
(Fleisch), sehen, ich gehe, etc., et même gedeihen, Verzeihung, hauen, etc.,
où la limite de syllabe n'est pas marquée par un y ou un w de liaison.
Il est vrai que, dans les cas parallèles à premier élément consonantique,
326la consonne passe dans la syllabe suivante, et la frontière morphologique
est effacée ; fahren, Liebe, geben, ich gebe. Même en dehors de tout secours
phonologique, la coupe syllabique se conforme à la structure du mot :
comparez erb-lich de Erbe et er-blich de bleich. La syllabation permet des
distinctions plus délicates encore, celle p. ex. entre une consonne aspirée
initiale pʻ, tʻ, kʻ (439) et h initial : comparez mit-tʻeilen et mit-helfen (distinction
que le grec ancien ne pouvait pas faire : tháptein « enterrer » :
ka-tháptein « attacher de haut en bas », de kat(a) et háptein). Dans bestimmen,
la tension initiale de syllabe (444) commence avec s (= fr. ch),
tandis que dans der bes-te, elle commence avec t.
549. La consonne finale d'une unité ou d'une sous-unité est fermante ;
les occlusives sont réduites à l'implosion (cf. der Ritt et fr. le rite ; 447 s.) ;
les autres consonnes ont une tenue plus brève qu'en français (der Ball :
le bal). Il suit de là que les consonnes finales ne se lient pas avec les voyelles
initiales, d'ailleurs protégées par le coup de glotte ou l'hiatus fort.
Une consonne réduite à l'implosion tend à s'assourdir, et, par suite,
cet assourdissement est indice de finale, puisque p. ex. on prononce d'une
part des Tages (ou Tayes), et de l'autre der Tag (ou Tax) ; cet assourdissement
persiste devant sonore et voyelle initiale : Bad Ems (= Bat), même
dans l'intérieur des mots : « Radähnlich (t), langsam (k), sich abarbeiten
(p) ». La graphie s'est conformée à la prononciation dans entlang, dont le
premier élément est parent de Ende.
550. Il va sans dire que la séparation des sous-unités ne peut être aussi
absolue que celle des mots ; de plus, il y a, sous ce rapport, une différence
bien naturelle entre préfixes et suffixes ; les premiers, beaucoup plus concrets,
et souvent séparables, sont toujours distincts phoniquement : aus-atmen,
durch-eilen, etc., même s'ils sont inséparables et atones : ent-arten,
be-arbeiten, sich er-eifern ; les suffixes, plus abstraits, et inséparables du
radical, ne sont distincts que s'ils commencent par consonne, mais le
cas est fréquent : -heit, -keit, -schaft, -rei, -nis, -tum, -chen, -lein, -bar,
-lich, -haft, -lei, sans compter les nombreux suffixes concrets dont on a
donné quelques exemples § 498 ; par contre, les suffixes commençant par
voyelle, et qui sont en même temps les plus incolores, se fondent avec le
radical : Lehrer, Löwin, einig, leben. La tendance à faire coïncider l'initiale
du suffixe avec la syllabe a créé de nouveaux suffixes, comme -ner, issu
de -er (Kell-ner, Schaff-ner, d'après Gärtn-er).
Le traitement des désinences est analogue : comparez ich lieb-te et ich lie-be.327
551. L'accent, très intense, a un rôle important dans la répartition des
pièces syntaxiques et morphologiques. Ce rôle consiste à distinguer le
déterminant du déterminé dans les syntagmes grands ou petits. Dans la
phrase, il frappe le mot qui est le but de l'énoncé : « Karl ist heute abgereist »,
fr. « C'est aujourd'hui que Charles est parti » (39, 232). Dans le mot composé,
l'accent principal frappe le déterminant ; le déterminé reçoit un accent
secondaire, qui le met en relief tout en le subordonnant : Hauslehrer ;
même régime pour les préfixaux : les préfixes forts (séparables) ont l'accent
principal en leur qualité de déterminants ; le radical verbal est marqué
plus faiblement : Austrinken. On peut donc avoir trois degrés d'intensité
des accents d'un même mot, p. ex. dans Blitzableiter. Dans les suffixaux
sans préfixes, c'est la racine (le déterminant) qui est accentuée : Lehrer,
einig, leben ; de plus, le suffixe est souligné par un accent secondaire s'il
est formé par une syllabe longue ; on sait en effet que toute syllabe longue
(quelle que soit sa valeur) suivant la syllabe accentuée, est frappée de
l'accent secondaire ; cette syllabe peut être asémantique (Arbeit, Monat),
mais elle est très souvent lexicale, et, de ce chef, le suffixe est souligné
discrètement : Bächlein, Krankheit, etc.
Les emprunts, on le sait (526), font en général exception au régime
de l'accent ; il frappe le plus souvent le suffixe (Struktur, Funktion,
Infanterie, national, originell, induktiv, ignorieren, etc.) ; mais par
là, il détache le suffixe, le motive, et par contre-coup le sépare du
radical.
552. Ainsi l'accent et la syllabation permettent de distinguer les mots
dans les groupes (ein-hoher-Berg), et les sous-unités dans les mots (er
ver-ein-heit-lich-te). Mais l'allemand possède encore d'autres moyens de
différenciation, plus spéciaux et d'un emploi moins général. Nous en citons
trois qui tiennent à l'articulation des phonèmes :
1. L'apophonie (229) a encore un rôle considérable ; mais elle s'exerce
seulement sur la racine, jamais sur les éléments formatifs. C'est donc,
avec l'accent, un moyen de mettre la racine en relief, de l'individualiser
vis-à-vis de son entourage ; une racine comme bind- a d'autant plus d'autonomie
qu'elle peut prendre les formes band- et bund-.
2. La prononciation normale n'admet pas s sourd à l'initiale (c'est
l'inverse du français, qui n'admet pas la sonore z à cette place) ; Sieg
se prononce Zīg ; s sourd ne peut donc être qu'intérieur ou final.
3. Les groupes chp, cht, chl, chr, chv (écrits sp, st, schl, schr, schw) ne
328figurent qu'à l'initiale de racine (Spass, Stein, Schloss, schräg, Schwein) 1122,
en sorte que les mêmes groupes prononcés avec s dental ne peuvent se
trouver qu'à l'intérieur ; comparez sparen, ersparen, Stand, Anstand (avec
ch), et lispeln, Wespe, Liebespaar, erst, Liebestrank (avec s), bestimmen
(avec ch) et der beste (avec s).
553. Si maintenant on compare entre eux les moyens dont disposent
respectivement l'allemand et le français pour souligner phonologiquement
les éléments morphologiques, on constatera une grande différence : les
procédés employés par l'allemand sont moins nombreux, mais ont un
caractère général et systématique qui s'impose à toute la langue ; en français,
au contraire, on rencontre un grand nombre de petites conditions
dont chacune n'atteint que de faibles parties du système, et qui n'ont
aucune cohésion. En outre, elles ne séparent guère que les mots, tandis
que l'allemand parvient, par la syllabation, à distinguer les sous-unités
des mots. On voit donc que le système phonologique confirme les conclusions
tirées du système grammatical au sujet de la condensation relative
des syntagmes.
Aspect mémoriel de la condensation
554. En vertu de la solidarité qui unit les associations discursives et les
associations mémorielles, la condensation syntagmatique des mots a un
contre-coup sur le jeu des associations mémorielles ; le resserrement des
pièces engagées dans le syntagme a pour corrélatif la séparation totale ou
partielle, dans la mémoire, d'éléments qui sont pourtant associés par la
forme des signifiants aux éléments du syntagme en question. C'est là,
avons-nous vu (301), un aspect mémoriel de la synthèse. Il est évident
que si, dans un syntagme, les éléments sont plus ou moins agglutinés,
ils doivent avoir plus de peine à s'associer, dans la mémoire, à d'autres
éléments de même forme. C'est parce que promener ne s'analyse plus qu'il
a perdu tout contact avec mener, que soumettre n'a plus rien de commun
avec mettre, ni celui-ci avec promettre.
Un fait capital résulte de cet état de choses : l'école nous enseigne que
le français possède des familles de mots fondées sur une correspondance
329régulière des formes et des significations ; c'est une grande illusion : l'état
normal du mot français est de vivre totalement ou relativement isolé
de ses congénères étymologiques, et de nouer avec d'autres mots des associations
fondées avant tout sur la communauté du sens. C'est là encore
une des grandes différences qui séparent le français de l'allemand, où le
parallélisme des formes et des significations est beaucoup plus constant.
555. On sait que les cas de discordance entre formes et valeurs se groupent
autour de deux types extrêmes : l'homonymie et la supplétion (273).
La dislocation des rapports sémantiques par homonymie est un cas des
plus fréquents (voir mon Traité, II, exerc. 19) ; mais on l'ignore délibérément.
Contentons-nous de citer quelques exemples pris au hasard : enseigne
/ enseigner ; interloquer / interlocuteur ; manger / démanger ; ménager / déménager ;
ménage / ménagerie ; mépris / méprise ; mirer / admirer ; obsèques / obséquieux ;
pertinent / impertinent ; respectif / respectueux ; saison / assaisonner ;
somme / assommer ; table / tablier ; valise / dévaliser, etc.
Les associations par supplétion sont moins connues, et leur étude mériterait
d'être poussée davantage. La supplétion totale est sans doute assez
rare, et c'est naturel ; mais on n'aurait probablement pas de peine à trouver
d'autres exemples que dormir / sommeil, tomber / chute, se tromper / erreur,
se taire / silence, labourer / charrue ; meurtre n'est pas le fait de meurtrir,
mais de tuer ; ébéniste ne fait pas penser à ébène, mais à meuble ; la hache
n'est pas faite pour hacher, mais pour fendre ; palefrenier est, dès
longtemps, détaché de palefroi, et relié bourgeoisement à cheval, etc.
Mais voici qui est plus délicat encore : souvent le mot qui vient à l'esprit
grâce à l'analogie formelle appartient bien à la même famille sémantique,
mais ne soutient pas le rapport exact supposé par sa structure morphologique :
ainsi sommeil est bien de la même famille que sommeiller, mais il est le
nom d'action de dormir, et sommeiller, c'est faire un somme ; tuer fait
penser d'abord à tuerie, mais c'est meurtre qui désigne le fait de tuer, et
tuerie évoque le verbe massacrer ; demander si quelqu'un est à la maison,
c'est poser une question ; poser une question, c'est interroger ; dans un interrogatoire,
on questionne le prévenu, etc., etc. C'est le caprice élevé à la
hauteur d'un principe.
Il vaudrait la peine de poursuivre l'enquête et de classer rigoureusement
les types de supplétion sémantique ; p. ex. on dresserait la liste a es antonymes
obtenus, non par l'emploi des préfixes privatifs (poli / impoli), mais
par rapprochement de mots séparés par la forme, comme aimable, qui, en
330l'absence de « inaimable », cherche à tâtons son contraire dans grossier,
rude, revêche, etc.
556. Les innombrables emprunts au latin, et surtout les formations
plus nombreuses encore tirées d'éléments latins (521), contribuent beaucoup
au relâchement de la cohésion sémantique des familles de mots.
Là encore, une enquête systématique s'impose ; nous nous bornons à
quelques points de repère.
Les mots empruntés en bloc au latin sont — cela va sans dire — rebelles
à l'analyse (et, malgré les apparences, cela est vrai pour les latinistes
aussi bien que pour les profanes, car la pratique instinctive de la langue
maternelle prime les habitudes acquises par l'étude de l'idiome étranger) :
nous ne décomposons pas adopter, acquiescer, affecter, appétit, concis, concret,
conspuer, perfide, prolixe, professer, prohiber, spectacle, statut, stupide,
et ce ne sont là que quelques spécimens d'un vaste vocabulaire. Chose
curieuse, il arrive souvent que le préfixe ou le suffixe sont compris, tandis
que la racine est asémantique (385) : le préfixe, p. ex., dans émerger, immerger,
submerger (en effet, il n'y a pas en français de racine merg-), le
suffixe dans caution, le préfixe et le suffixe dans immersion, évasion (la
racine de s'évader est aujourd'hui détachée de celle de je vais, tu vas) ;
de même, dans éminent, é- et -ent ont quelque signification, mais minest
vide de sens pour nous.
557. Quant aux latinismes vraiment décomposables (beaucoup plus
nombreux et plus importants), ils essaient de nouer des relations avec les
vocables romans, mais cela ne va pas tout seul, et les associations sont
tenues en échec par les différences de forme. Il y a parfois supplétion
absolue, comme dans ablation, qui évoque enlever, ôter, dans adduction,
qui est le nom d'action de amener, etc. La supplétion partielle est beaucoup
plus fréquente encore ; elle suffit pour gêner les associations spontanées ;
en effet, si œil, œillade, œillère peuvent appuyer leur affinité
sémantique sur l'identité des radicaux, il n'en est pas de même pour
œil et oculaire, oculiste, dimanche et dominical, poitrine et pectoral, croix
et crucifix, fondre et fusion, père et patrie, etc., etc. Dans les cas les plus
favorables, on peut parler d'alternance phonique : nez / nasal, bouche / buccal,
étranglement / strangulation, extraire / extraction, etc. Mais on sait (229) que
l'opposition phonique des signes ne peut être un lien associatif qu'à la
condition d'être réglée dans la forme et significative d'un rapport grammatical
déterminé, comme en allemand : Hand / Hände, binden / band / gebunden,
331etc. En français — les exemples cités plus haut suffisent à le montrer — ces
oppositions sont livrées au hasard ; elles offrent toutes les variétés
possibles de forme et de valeur grammaticale. On notera cependant que
les latinismes sont plus souvent des noms et des adjectifs que des verbes,
et par là ils acquièrent une valeur catégorielle, d'ailleurs assez peu rigoureuse ;
car il y a aussi des latinismes verbaux, p. ex. ceux en -fier et en
-iser : crucifier, sanctifier, fructifier, etc., nasaliser, paganiser, fraterniser,
etc. La seule opposition qui vaille la peine d'être relevée est d'ordre stylistique :
les latinismes, dans leur ensemble, et même après leur introduction
dans le langage usuel, gardent un parfum « savant » qui se traduit de façon
très différente selon les cas : distinction, élégance, valeur plastique (surtout
en poésie), ou, au contraire, lourdeur pédantesque, caractère ésotérique,
etc. Mais toujours cet effet se dégage par contraste avec les mots
usuels correspondants.
Tout ce qui est dit de la couche latine de notre vocabulaire vaut à
plus forte raison pour les emprunts au grec, où la supplétion est presque
toujours totale : estomac / gastrique, cœur / cardiaque, et pour les éléments
formatifs chrono- / temps, géo- / terre, pseudo- / faux, -graphie, -logie / science,
etc.
558. Une conséquence importante de l'imperfection des rapports étymologiques
entre mots parents et de la prédominance des rapports par voie
de supplétion, c'est l'abondance des synonymes proprement dits, c'est-à-dire
de mots reliés entre eux en dépit d'une absolue différence de forme :
garder : conserver ; frivole : futile ; penser : songer, etc. Sans doute trouve-t-on
dans n'importe quelle langue des oppositions de ce genre, mais aucune,
probablement, n'a poussé aussi loin que le français la finesse des distinctions
synonymiques ; leur étude est une excellente leçon d'assouplissement
intellectuel, et j'ai montré ailleurs 1123 quel parti l'école peut en tirer pour
la formation de l'esprit. C'est qu'en français, l'isolement étymologique
des mots étant très prononcé, l'opposition entre mots simples est une question
vitale, qui exige une étude minutieuse, une attention de tous les instants,
parce que les mots n'offrent dans leur forme matérielle aucun appui
pour la mémoire.
559. La conséquence prévue de ce resserrement des sous-unités du mot,
c'est la marche vers le mot simple. La proportion des mots simples est
considérable en français, beaucoup plus qu'en allemand. C'est ce qu'on
332exprime d'une façon un peu naïve, en disant que le français a moins de
mots que l'allemand, parce que l'allemand peut aligner une somme énorme
de mots composés, de suffixaux et de préfixaux que le français est incapable
de former.
Or, précisément parce que le nombre des mots simples n'est pas illimité,
chacun d'eux est chargé de plus de significations que s'il pouvait en
confier une partie à des signes complexes. Pour le français, une enquête
statistique pourrait seule étayer cette affirmation, que le bon sens semble
imposer. Des coups de sonde montreraient en tous cas que des mots usuels
tels que air, terre, jour, pensée, idée, fort, léger, etc., etc., désignent un
grand nombre de notions complètement ou partiellement différentes. Cette
multiplicité de sens se reflète dans les locutions formées avec un même
mot : mettre à jour : mettre au jour (519).
Cet état de choses oblige, dans la pratique, à faire un choix judicieux
des contextes, seuls capables de fixer l'acception que le mot doit recevoir
dans chaque cas. C'est cet effort de combinaison qu'on a appelé souci de
la propriété des termes. L'obligation d'employer le mot adéquat à une
situation donnée existe dans toutes les langues de civilisation, mais la
question est de savoir dans quelle mesure elle est aisée à satisfaire ; tout
porte à croire qu'elle présente plus de difficultés dans une langue qui a beaucoup
de mots simples à sens multiples ; chaque emploi de ces mots demande
plus de précautions que s'ils portaient en eux-mêmes leur détermination.
560. Remarque. L'orthographe elle-même semble subir le contre-coup
de la tendance du français au mot simple. Celle de l'allemand est à peu
près normale, et relativement adaptée aux formes parlées. On sait, au
contraire, combien celle du français s'en écarte. A quoi cela tient-il ?
Sans doute, avant tout à la force de la tradition, qui est grande dans
les langues unifiées. Le prestige du « hochdeutsch » est sensiblement moindre
en pays de langue allemande, grâce à la vitalité des parlers régionaux ;
aussi une réforme orthographique ne soulève-t-elle pas là-bas les mêmes
tempêtes qu'en France.
Mais cette différence tient aussi à des causes internes, inhérentes au
système même de la langue. En général, les mots sont traités par l'écriture
de façon à avoir une physionomie propre, calculée pour que l'œil les
saisisse d'un coup dans leur ensemble ; autrement dit, on cherche à rapprocher
le mot écrit alphabétiquement, analytiquement, du mot-idéogramme,
du mot-image.333
Or, plus un mot est long, plus il se prête à l'analyse, et il est moins
nécessaire de le singulariser pour l'œil : l'écriture phonétique suffit. C'est
le cas de l'allemand plus que du français, où les mots ont normalement
deux ou trois syllabes, et souvent une seule.
D'autre part, on observe que plus une langue tend vers le monosyllabisme,
plus elle tolère les complications orthographiques. C'est que celles-ci
ont pour effet d'identifier immédiatement les homonymes, sans épluchage
du contexte (pois, poids, poix, pouah), et, d'une façon générale, de donner
aux mots une figure personnelle. L'exemple classique est celui de l'anglais,
où des monstres tels que draught, prononcé draft, high prononcé haï, ne
se justifient que de cette manière.
L'exagération de cette tendance consiste à chercher une relation entre
la figure orthographique des mots et leur siginification, c'est-à-dire à en
faire de véritables idéogrammes (204, n.).
Pour les mots allemands, plus longs que ceux du français, et composés
généralement d'éléments analysables, une orthographe fantaisiste comme
celle-là gênerait plutôt qu'elle ne favoriserait l'identification rapide ;elle
est, au contraire, d'un secours efficace pour la lecture dans une langue
comme le français, dont les mots, plus courts, sont noyés dans le groupe
syntaxique. En français même, il semble que plus un mot est long, plus
il se rapproche de la normale (calorifère) ; plus il est court, plus il se
charge de particularités artificielles (que, alors, y, faire).
Formes pathologiques de la condensation
561. Nous savons que l'exagération d'une tendance donne naissance à
des cas pathologiques qui la confirment à leur manière ; il en est ainsi de la
condensation. On peut s'attendre à ce que les mots français, à force de se
serrer les uns contre les autres, et de s'interpénétrer, produisent parfois
des ambiguïtés et des cacophonies. Si nous insistons sur des faits de ce
genre, futiles en eux-mêmes, c'est pour montrer qu'ils sont, en français,
les formes extrêmes d'un état normal, tandis qu'ils sont exceptionnels
dans une langue qui, comme l'allemand, sépare nettement les éléments
de la phrase.
562. Voici d'abord quelques cas d'ambiguïtés résultant du contact trop
étroit des mots entre eux. Est-il besoin de rappeler que, dans la parole,
ces équivoques sont pour la plupart sans gravité, grâce au contexte ou à
334la situation, et qu'ils ne sont pour nous que des indices concrets du principe
qui nous occupe ?
Ambiguïtés relatives aux pronoms : « Je le ferai si cela peut (tʼ)être
utile. — Il a une femme qui l'aime (qu'il aime). — Tu l'as cueilli(e) = Tu
la cueillis, Tu l'accueillis. — On la bâtit (on l'a bâtie). — (On parle de la
dictature et on ajoute :) Nous savons qu'elle fut (quel fut) l'aboutissement
de la révolution russe. — Regarde dans la rue : qu'y (qui) vois-tu ? ».
Certaines tournures deviennent particulièrement gênantes : on hésite à
dire « Qu'est ce défaut, comparé à nos vices ? ». A une question telle que
« Est-ce sûr ? », on ne peut répondre ni « Ce l'est », ni « Ça l'est ».
L'élision de l'article crée parfois des ambiguïtés : l'oreille ne distingue
pas la perception de l'aperception, la traction de l'attraction, la tension
de l'attention, la symétrie de l'asymétrie, la fiche de l'affiche.
La négation ne disparaît souvent ou reparaît indûment grâce au jeu
des liaisons : « L'on (n')a cessé de vous avertir. — Cet homme est plus rusé
qu'on (n')imagine. — Je ne doute pas qu'on (n') y réussisse ».
Les formes monosyllabiques de avoir et être se distinguent souvent mal
de leur entourage : « La maison qu'a ton père (ou : que ton père a). -On est
(on naît) esclave. — Quel goût ces carottes ont ! »
La liaison de p final est scabreuse : « beaucoup oser (poser), trop heureux
(peureux) ».
La rencontre des monosyllabes ménage des surprises : « Soutenant le
front que la mort pâme (Lamartine). — Spa est la ville d'eaux type (Laforgue).
- Je fleuris, doux lis de la zone des linceuls (id.). — Ce fin sang de poitrinaire
(id.) ».
563. Les fausses coupes engendrent des calembours : le français est la
langue où il est le plus facile d'en faire. Ce n'est pas un hasard ; le resserrement
des groupes en est la principale raison. Je m'excuse de le démontrer
par quelques exemples (on en chercherait vainement d'analogues
en allemand) : « Arsène, Alexandre (art ?, scène ? allez ! que cendre) ; pauvre,
mais honnête (pauvre maisonnette) ; l'école a fermé ses portes hier (portières).
J'habite à la montagne et j'aime à la vallée (à l'avaler). (Je demande
la parole) : Allez, vous l'avez ! ». Corneille avait, dans la première édition
d'Horace, lâché ce vers : « Je suis Romaine, hélas ! puisque mon époux
l'est » ; et on lit au vers 42 de Polyeucte : « Et le désir s'accroît quand l'effet
se recule ». Je ne sais plus qui a commis cet alexandrin : « Sur le sein de
l'épouse on écrase l'époux », et cet hémistiche : « L'amour a vaincu Loth ».335
Le lecteur pourra s'amuser — si c'est un amusement — à deviner le
double sens des expressions suivantes : « corps nu, pas encore né, charlatan,
digne d'éloge, herbette, bagatelle, déconfiture, épicier, saindoux, détruite,
il est ailleurs, sans elle, commentaire, misanthrope, bonté, dissous, il est
ouvert, c'est la Confédération ». De là on tombe fatalement dans l'amusette :
« Si c'est neuf, c'est très étroit (6, 9, 13, 3). — L'ours blanc est maître
au pôle, Paris est métropole, Virginie aimait trop Paul. — Gai, amant de
la reine, alla, tour magnanime, galamment de l'Arène à la Tour Magne,
à Nîmes ».
La contre-partie discursive du calembour (produit par associations mémorielles),
c'est le jeu de mots, où l'association est réalisée dans le discours :
« raisonner (résonner) comme un tambour mouillé » ; il en a été question
§ 281 et il est inutile d'y revenir. Mais il est évident que la polysémie
des mots français amène souvent, dans la parole, la rencontre de deux
sens, qui logiquement s'excluent dans un même contexte.
564. Que la fusion des éléments entraîne des bizarreries phoniques, cela
n'a rien d'étonnant. Plusieurs passent presque inaperçues : « Le thé bout-il ?
- La couturière coud-elle ? — La nuit du six au sept ». Mais on accepte
plus difficilement des amalgames, pourtant parfaitement corrects, tels
que : « Il est temps que bébé aille au lit : porte-l'y. - Charles veut aller au
théâtre : mène-l'y. - Sont-ce des bateaux qu'on aperçoit là-bas ? Je ne sais
si c'en sont ». On lit dans André Gide : « Et maintenant, jette mon livre,
émancipe-t'en ! » ; dans Vigny : « Si ton âme enchaînée, ainsi que l'est mon
âme … » ; dans Lamartine : « La poésie n'a guère été pour moi que ce qu'est
la prière ». Je ne sais plus qui a écrit : « L'autre main tient sa robe flottante,
qu'à bonds impétueux souillera l'eau des mers ». Cueilli dans Laforgue :
« C'est sur un cou qui, raide, émerge d'une fraise empesée. — L'amour
dit légitime est seul solvable. — Formuler tout, en fugues sans fin dire
l'homme. — Astre atteint de cécité, fatal phare. — Rosaces en sang d'une
aveugle cathédrale. — Deux grosses prunelles d'un glauque aqueux. - Puis
s'affligent sur maint sein creux. — Les lacs … dans leurs plus riches rades ».
565. Ici l'uniformité des syllabes (451) se fait complice de la fusion des
mots ; c'est alors que surgit le danger du sac à café, du Il est pourtant temps,
du « Quelque accablants que soient nos maux ». « Un rare mérite » ne peut
pas devenir « une rare adresse ». J'ai noté au cours de lectures : « Ceux-ci
sont issus de ceux-là. La syntaxe n'est nette dans aucune langue. La première
étape est atteinte. Nettoie-toi les ongles. Pourquoi t'est-tu tu ? », et
336on lit dans les Harmonies de Lamartine (IV, 2) : « L'Assyrien frappé tombait
sans voir ta main. D'un souffle de ta peur tu balayais sa tente ».
Il faudrait encore parler de l'hiatus, moins gênant par sa dureté (il est
très glissant, voir 530), que par le mélange des mots qui en résulte : « On
m'invite à aller au théâtre : y irai-je ?- Mon grand-père est venu se marier
à Charmes où il a pris sa retraite et est mort » (Barrès).337
Troisième section
Formes générales de l'expression339
Arbitraire et motivation implicite
566. Parmi les conclusions que suggèrent les faits exposés jusqu'ici, une
des plus importantes est celle-ci : le français a une prédilection pour les
mots simples et tend à simplifier ceux qui ont une forme complexe. C'est
dire qu'il pratique largement l'arbitraire du signe (arbre, marcher, rouge,
etc., voir 197 ss.). La motivation implicite (jument = femelle du cheval,
puer = sentir mauvais, borgne = privé d'un œil ; voir 205 ss.) y est plus
poussée qu'en allemand. Car cette motivation-là, toute réelle qu'elle est,
impose aux associations internes une forme condensée et inconsciente qui
donne aux sujets eux-mêmes l'impression que les mots ainsi motivés sont
simples. Enfin nous avons montré quel rôle important les formes agglutinées
jouent en français (217).
Tous ces facteurs, en travaillant pour l'expression simple des choses
dont on parle, doivent finir par donner une forme particulière à l'expression
de la pensée.
567. Mais comparons d'abord cet état de choses avec celui que nous
présente l'allemand : par opposition au français, il motive abondamment
et explicitement son vocabulaire et sa grammaire. Nous connaissons
sa prédilection pour les mots complexes, composés, préfixaux et suffixaux
(fr. se tromper, all. sich versprechen, verschreiben, etc. ; voir L V3, p. 81 ss.) ;
il lexicalise fréquemment les rapports grammaticaux (die Schlacht bei
Leipzig, etc. ; voir 178, etc.).
Même contraste dans l'emploi de la motivation par les procédés phoniques.
Le français leur attribue un rôle assez effacé, l'allemand les met
largement à contribution. En français, l'accent est faible, sa fonction grammaticale
restreinte. Ainsi, tandis qu'en allemand, il permet de distinguer
les sous-unités des mots (406), l'accent du mot français les confond, et
son uniformité confirme la tendance au mot simple et arbitraire.
La syllabe allemande motive, puisqu'elle coïncide avec la frontière des mots
ou des sous-unités ; pour la raison opposée, celle du français est arbitraire.
La syllabe française est simple (451), celle de l'allemand est complexe.
La mélodie de phrase est nette et tranchée en français ; les montées et
les descentes de la voix se font par sauts, et non insensiblement comme
en allemand (voir Klinghardt, Intonationsübungen, § 21) ; ainsi, dans une
interrogation comme Venez-vous ?, la note aiguë de vous se détache sans
transition des notes basses qui précèdent.341
568. Le rôle des éléments sensoriels dans la langue expressive est aussi
très différent ; il est considérable en allemand, beaucoup plus effacé en
français. En outre, et ceci est le pendant du rôle des signifiés, l'allemand
obtient des effets phoniques par les mots isolés et par la nature même
des phonèmes ; le français ne les atteint le plus souvent que par combinaison.
Cela se comprend si l'on se souvient que la syllabe est uniforme et
les sons simples. M. Grammont a montré, dans Le vers français, que c'est
par l'ensemble du vers que les poètes obtiennent des effets musicaux.
Au contraire, l'allemand emploie abondamment des mots expressifs par
eux-mêmes ; et plusieurs de ses phonèmes isolés sont expressifs par leur
caractère propre, p. ex. les mi-occlusives et les diphtongues. Des mots
comme zupfen, rauschen, säuseln, zwitschern, Peitsche, etc., sont légion ;
les emprunts dialectaux en augmentent encore le nombre. Enfin les effets
par combinaison sont beaucoup plus apparents qu'en français (allitérations,
assonances, rimes).
L'apophonie elle-même joue un rôle expressif, car les oppositions virtuelles
du type binden / band, geben / gab, kneifen / kniff, sont si abondantes
qu'elles peuvent à tout instant se réaliser dans le discours et produire
des effets pittoresques.
Dans la périphérie de la langue, on ferait les mêmes constatations :
ainsi la métrique allemande, d'une richesse et d'une variété incomparables,
a un caractère plus concret, plus insistant, plus éclatant que le rythme
de la poésie française, plus abstrait, plus intellectuel. L'alexandrin classique,
qui évite si difficilement la monotonie, est d'un merveilleux secours
pour les oppositions de pensées ; avec ses deux hémistiches égaux, il est
un véritable moule à antithèses (voir 571).
D'une manière générale, le rythme du français est plus intérieur ;
il se dissimule dans des formes discrètes, qui ne touchent
que les oreilles délicates ; mais à celles-là, il réserve des jouissances
profondes.
De tout cela se dégage une impression générale et d'une assez grande
portée : le français pratique l'économie des procédés, et leur fait produire
le maximum de rendement ; l'allemand met en œuvre un nombre si considérable
de moyens d'expression qu'il est tenté de gaspiller inutilement cette
richesse.
569. Considérons maintenant ces caractères du signe dans l'ensemble
du système et au point de vue du fonctionnement.342
Le signe arbitraire ou implicitement motivé est indépendant de la
parole par sa constitution interne et en est tributaire dans son fonctionnement.
Le français permet de vérifier ce paradoxe.
A. D'une part, en effet, le signe simple ne renferme pas de combinaisons
susceptibles d'en restreindre l'emploi. Une pendule reste pendule,
qu'elle soit suspendue à la muraille ou placée sur une cheminée ; cette
liberté n'est pas accordée à un mot motivé comme all. Wanduhr (litt.
« montre de paroi ») ; couper se prête à des emplois plus variés que abschneiden,
et ainsi de suite.
Précisément à cause de cette mobilité sémantique, le signe simple peut
recevoir des sens multiples qui, occasionnels au début, deviennent souvent
usuels, alors que le signe motivé, par sa complexité même, est empêché
de contenir beaucoup de significations ; le besoin d'acceptions nouvelles
se satisfait plutôt par la formation de nouveaux signes motivés (composés,
etc.) ; les innovations sont apparentes et tangibles ; quand les signes
simples prédominent, elles se font au contraire intérieurement, par changement
de sens. Il s'ensuit que les signes simples sont moins chargés sémantiquement
s'ils ont à côté d'eux beaucoup de signes motivés.
De plus, dans une langue qui explicite beaucoup, il est relativement
facile de créer et de faire accepter des formations nouvelles ; cela se comprend :
un mot composé, p. ex., passe plus facilement qu'un mot simple,
qui a quelque chose de définitif. C'est pour cela qu'un mot simple a de
la peine à entrer dans l'usage, et quand il y réussit, c'est généralement
après un stage prolongé. Mais quel est le degré de vitalité de chacun de
ces vocables complexes de l'allemand ? Ont-ils autant de chance d'être
consacrés par l'usage que des mots simples ? C'est là une question qu'on
ne peut trancher théoriquement.
570. B. Nous avons fait prévoir que, dans son fonctionnement, le signe
simple dépend davantage de la parole que le motivé. Cela ressort en tout
cas de la définition même de l'arbitraire : le sens n'étant fixé que par associations,
il est naturel que ces associations tendent à se réaliser dans la
parole. Cela découle ensuite de la multiplicité des sens dont se charge le
signe arbitraire dans une langue qui motive peu. Chacun de ces sens ne
peut être convenablement fixé que par l'appoint d'un contexte ou d'une
situation. C'est le cas en français, et dès lors, le souci de la propriété des
termes, qui hante l'esprit de toute personne désireuse de bien parler sa
langue, apparaît sous un jour nouveau. On dit volontiers qu'il s'agit
343d'un besoin naturel de s'exprimer sans équivoque. Sans doute, et tous
les idiomes de civilisation posent de semblables problèmes ; mais dans
une langue qui pratique largement l'arbitraire, il y a là une nécessité
plus impérieuse, créée par la structure du vocabulaire : il est d'ailleurs
fort possible que cette nécessité donne, par contre-coup, le goût de l'expression
juste. Quoi qu'il en soit, la recherche du mot propre est une des grandes
difficultés du français, parce qu'il faut, pour chaque mot, conserver dans
la mémoire une foule d'associations extérieures, et réaliser l'une ou l'autre
dans le discours pour faire apparaître, parmi les sens possibles, celui qu'on
veut faire entendre.
Etant donnés deux synonymes, p. ex. garder et conserver, rien, dans la
constitution de ces mots, n'indique quand il faut employer l'un ou préférer
l'autre ; sans compter qu'ils ne sont pas toujours synonymes (garder
les vaches, garder la chambre, etc.) ; il faut donc les étayer d'autres mots
capables de faire apparaître le sens propre à chacun d'eux, et ce contexte
doit être, dans certains cas, très complexe pour être clair : « Je garde jalousement
mon trésor, et malheur à quiconque voudrait s'en emparer ! » et
« Je conserve intact un trésor que j'aurais pu dilapider ». Encore sera-t-il
très difficile de définir cette différence par une formule simple ; car chacun
de ces mots ne vit que par les multiples associations que l'usage lui a
fait contracter et que la mémoire seule peut retenir.
571. Il est naturel que ces associations prennent aisément une forme
stéréotype : plus elles sont nécessaires, plus elles se cristallisent en expressions
toutes faites. Or, nous avons vu (222) que l'agglutination enrichit
le vocabulaire aux dépens de la grammaire : le français se rapproche du
type de langue que Saussure (CLG3, pp. 183 et 225) appelle lexicologique.
Cette condensation a aussi sa forme littéraire : le français est une langue
où il est extrêmement facile de parler et d'écrire en enfilant des clichés.
Enfin ce même besoin d'associations fixes a pu contribuer à donner aux
Français le goût des formules définitives, des maximes frappées comme
des médailles ; aucun peuple n'a fait une plus large consommation de
« mots historiques ».
Remarquons encore que ces comprimés de pensée sont presque toujours
à base d'antithèse ; c'est l'antithèse qui leur donne ce caractère tranché
(« se soumettre ou se démettre », « réparer des ans l'irréparable outrage »,
« Rome n'est plus dans Rome »), cet air, souvent trompeur, de vérités
absolues (« Tout est perdu fors l'honneur »). L'antithèse est un fil rouge qui
344court dans la trame de toute la prose et de toute la poésie française depuis
la Renaissance 1124. Classiques, romantiques, parnassiens, les symbolistes
même, aucune école n'y a échappé, et des noms comme Corneille, Racine,
Voltaire, Rousseau, Lamartine, Victor Hugo, Henri de Régnier ne sont
que des têtes de liste. Sans doute l'imitation des anciens est pour quelque
chose dans l'établissement de cet usage ; on se rappelle la vogue dont a
longtemps joui Sénèque, l'incarnation de l'antithèse ; mais le culte des
auteurs latins ne suffirait pas à expliquer une disposition aussi générale ;
la langue a certainement contribué à la former 2125.
Formes statiques de l'expression
572. Ce qui vient d'être dit de l'arbitraire montre déjà que les caractères
généraux de la langue doivent donner à l'expression de la pensée
certains aspects, lui imposer une certaine orientation. Sans doute peut-on
supposer que ce sont plutôt les formes de la pensée collective qui se
reflètent dans la langue. On sait que, en cette matière, il est difficile de
distinguer les causes et les effets, et qu'en définitive, il y a action dans
un sens comme dans l'autre (4). Contentons-nous donc de parler de corrélation.
Comment se traduisent, dans les grandes lignes du style français et de
l'allemand, les contrastes qui nous sont apparus dans l'étude de ces deux
langues ?
Dans le Buch der Freunde, Hugo von Hofmannsthal a symbolisé l'opposition
de l'esprit latin et de l'esprit germanique en comparant un mot
allemand et un mot français : « Dass wir Deutsche das uns Umgebende
als ein Wirkendes — die Wirklichkeit — bezeichnen, die lateinischen Europäer
als die Dinglichkeit — la réalité -, zeigt die fundamentale Verschiedenheit
des Geistes, und dass wir in ganz verschiedener Weise auf dieser
Welt zu Hause sind ».
Cette formule illustre fort bien un contraste que chacun perçoit instinctivement,
et nous pouvons la prendre comme point de départ. Mais notre
tâche n'est pas d'établir des différences ethniques : sans sortir du domaine
linguistique, on se demandera si l'opposition en question a son corrélatif
345dans le langage. Peut-on prétendre que le français est une langue « statique »
et l'allemand une langue « dynamique » ou « phénoméniste » ?
573. On sait que notre esprit ne perçoit les choses que par les impressions
sensorielles que nous en recevons, et que, par une sorte de métaphore,
nous projetons-sur les objets ces réactions subjectives de manière à
les considérer comme des procès, des états ou des qualités attachés d'une
manière quelconque à ces objets (29, 154). Ces procès, ces états, ces qualités
sont les seuls moyens que nous ayons de désigner les choses (automobile :
teufteuf). Tous les substantifs dont l'étymologie première nous
est accessible permettent de faire la même constatation : la lune, c'est la
« brillante » (*loucsnā, cf. lat. lucēre) ; l'allemand Huhn « poule » est dérivé
de Hahn « coq », mais celui-ci contient la même racine verbale que lat.
canere « chanter » ; coq et coucou sont des onomatopées, etc., etc.
Mais l'important pour nous est que l'attitude phénoméniste demeure
attachée au processus psychologique qui est à la base de la perception et
de la désignation des substances, tandis que la tendance statique néglige
le devenir des notions substantielles et les fixe dans leur état psychologique
définitif. Au lieu de les décrire et de les définir, elle se borne à les
étiqueter ; de plus, par une exagération de cette vision des choses, les procès
eux-mêmes sont conçus comme des faits accomplis et tendent vers l'expression
nominale.
Pour illustrer ce contraste, il faudrait passer en revue tout le système
linguistique. Nous nous bornerons aux faits les plus saillants.
a) Rôle du verbe
574. L'attention portée vers le devenir, le déroulement des faits et leurs
particularités — tendance phénoméniste — se reflète naturellement dans le
rôle attribué au verbe et, plus particulièrement, au verbe proprement
dit ou conjugué par opposition aux formes dérivées (infinitifs, participes,
gérondif). Quelle est son importance dans l'une et l'autre langue ? En
allemand, elle est énorme, et beaucoup moindre en français, où l'expression
verbale recule devant l'emprise croissante du substantif. En outre,
les verbes français présentent l'action sous une forme abstraite ; le verbe
allemand est plus concret ; il insiste sur les modalités et les détails. On
sait avec quel soin il distingue legen, stellen, setzen, hängen, là où nous
nous contentons du verbe incolore mettre ; ce même verbe sert à traduire
346« (einen Hut) aufsetzen, (ein Kleid) anziehen, (eine Schürze) umbinden,
(eine Serviette) vorbinden » ; nous rendons le plus souvent « (nach der
Stadt) gehen, fahren, reiten » par aller, toutes les fois qu'une précision
n'est pas indispensable. Même différence dans l'expression des positions :
l'allemand dit stehen, liegen, sitzen, hängen : nous nous contentons de
être ou se trouver, etc. On pourrait citer beaucoup d'oppositions semblables.
575. Il est évident que le verbe intransitif est plus près du procès pur
et simple que le verbe transitif, qui exprime essentiellement un rapport
entre deux objets ; le premier est au second comme l'activité est à l'action.
La tendance phénoméniste, mise en demeure de représenter un rapport
de transitivité, tend à user d'un compromis, au moyen de l'intransitif
accompagné d'une préposition (tirer un lièvre : tirer sur un lièvre). Or,
il semble que l'allemand adopte plus volontiers que le français cette solution
intermédiaire. Un tour tel que zu den Waffen greifen se traduit en
français par la transitivité directe 1126.
576. La comparaison du passif en français et en allemand est très
instructive à cet égard : l'auxiliaire werden, par opposition à sein, marque
nettement l'action en train de se produire ; en français, l'auxiliaire être
la présente comme un état (la maison est construite), et c'est seulement
par l'appoint de compléments que l'idée d'action peut apparaître. Ainsi
La maison est construite correspond à Das Haus ist gebaut, tandis que
La maison est construite par les maçons se traduirait avec l'auxiliaire werden ;
comparez : Les ouvriers sont payés (= sind) et Les ouvriers sont payés
à la semaine (= werden) 2127.
577. Répétons qu'il convient de distinguer l'expression verbale pure
(par le verbe conjugué) et les formes nominales du verbe, toutes plus ou
moins « statiques » : infinitif, participes, gérondif. Ici apparaît une différence
caractéristique entre l'allemand écrit et le français écrit. Dans un
grand nombre de tours syntaxiques, l'allemand est obligé de recourir
à des propositions subordonnées conjonctionnelles là où le français se
contente de formes participiales, gérondives, infinitives, qui effacent partiellement
le caractère phénoméniste de l'action. On trouvera des précisions
dans Strohmeyer, p. 172 ss. ; ici quelques exemples seulement : la
traduction allemande, que nous ne donnons pas, montrera la nécessité
de recourir au verbe conjugué : « Après avoir pris congé, il sortit. — Avant
347de parler, il faut savoir ce qu'on veut dire. — Il a échoué pour avoir trop
attendu. — Décidé à frapper un grand coup, le général fit sonner la charge.
- L'armée, se retirant en bon ordre, gagna une position de repli. — II
protesta, alléguant le droit de priorité. — A la voir, on ne la dirait pas
malade ». On sait quel rôle jouent dans cette syntaxe les constructions
dites absolues, auxquelles l'allemand répugne : « La pluie s'étant mise à
tomber, la fête fut renvoyée. — La paix conclue, l'armée rentra dans ses
foyers. — La raison lui revenant, il comprit son erreur ». Le français acquiert,
par ces tours désinvoltes, une concision nerveuse à laquelle l'allemand
ne peut atteindre, mais dont la rançon est l'effacement de l'expression
verbale concrète et vécue.
578. Mais il y a plus : lorsque l'esprit s'absorbe dans la contemplation
des phénomènes et de leur devenir, il finit par oublier de considérer la
cause du procès, l'agent de l'action ; le sujet du verbe est laissé dans
l'ombre ; de là l'abondance des verbes impersonnels en allemand. Leur
indétermination répugne au contraire au français ; il n'a pas de traduction
adéquate pour beaucoup d'entre eux : Es dämmert devient « C'est
l'heure du crépuscule », Es wird Abend « La nuit tombe », Es ist so still
« Tout se tait », etc. Il traduit Es klingelt par « On sonne », Hier wird nicht
geraucht par « Ici on ne fume pas », Es rauscht im Keller par « J'entends
du bruit dans la cave » ; Gute Nacht, antwortete es aus dem Dunkeln devient
« … répondit une voix dans les ténèbres ». Il n'admet pas que les sensations
et les sentiments aient une cause mystérieuse, étrangère au sujet : Es
ist mir wohl : « Je suis (je me sens) bien », Wie geht es dir : « Comment vas-tu ? », Es
ist mir warm : « J'ai chaud », etc. Il est difficile de rendre en français la nuance
spéciale que certains impersonnels doivent à leur imprécision : Es graut mir.
Es schaudert mich. Es hat mir geträumt. Es zieht mich (nach Hause). Es treibt
und reisst ihn fort (Schiller). Da draussen singt es und klingt es (Heine), etc. 1128.
Sous ce rapport, le français d'aujourd'hui diffère sensiblement de l'ancienne
langue, où l'impersonnel était en faveur comme en allemand moderne
(ajourner, avesprer, aserir, anuiter, iverner, chaloir, peser, (ra)membrer,
etc.). Pour le détail, voir Meyer-Lübke, Grammaire, III, § 99 s.348
579. L'infinitif substantifié, dont l'allemand fait un usage illimité, est
beaucoup plus près du verbe, et du verbe impersonnel, que du substantif.
En effet, il conserve beaucoup des particularités de la syntaxe verbale
(das Alleinsein, das Wein trinken, das In sich hineinschauen, etc.) ; en
outre, comme les impersonnels, il ne désigne pas expressément l'agent de
l'action (das Grauen vor dem Alleinsein), et en cela il diffère de l'infinitif
substantifié du grec ancien. Le contraste avec le français est, ici encore,
très marqué : l'infinitif français ne se substantifie pas volontiers, et quand
cela se produit, cette formation prend très vite la valeur d'un nom d'action
ordinaire (le pouvoir, le devoir). Quant aux substantifs verbaux proprement
dits, les seuls que tolère notre langue, on sait qu'ils matérialisent
l'action et l'assimilent, pour l'imagination, à une chose. Il y a un abîme
entre das Wandern et la marche, entre das Grauen vor dem Alleinsein et
l'horreur de la solitude.
580. Qui dit phénomène dit aussi mouvement : le mouvement pénètre
toute la syntaxe allemande ; celle du français donne l'impression du repos,
de l'immobilité.
Nous relevons deux aspects de ce contraste :
1) Le verbe allemand trace la trajectoire du mouvement et de l'action.
On sait, par exemple, avec quel soin il distingue la direction et la station
dans un lieu : par les prépositions an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor,
zwischen, selon qu'elles commandent l'accusatif ou le datif, par la distinction
entre zu et bei, celle entre wo et wohin, entre da et dahin, hier et
hierher ; hin et her peuvent même marquer la direction en elle-même
comme dans « Geh hin ! - Setzen Sie sich hin. — Du zauberst vor mir eine
reizende Gestalt hin. — Er blickt düster vor sich hin. - Ich rufe jemand
her. - Wir gingen schweigend neben einander her », etc.
Rien de semblable en français ; le mouvement lui-même y est rendu,
dans bien des cas, par l'immobilité ; on s'en rend compte en traduisant
les expressions « in einen Apfel beissen. — Der Mond scheint in das Zimmer.
- Jemanden auf die Schulter küssen. — Aus einem Glas trinken. — Schau
hinter dich ! ». Malgré l'absurdité de la représentation, il n'y a aucune
idée de mouvement dans « un ustensile dans lequel on trait le lait », tandis
que l'allemand précise : « ein Gerät, wo man die Milch hineinmilkt ». C'est
cette indistinction du mouvement et de l'état qui permet de dire « ramener
et maintenir la politique dans la voie de la tradition ».
581. 2) Certaines prépositions composées de l'allemand insistent sur
349la direction du mouvement, là où le français l'exprime par un mot simple :
« um die Stadt herum wandern (: autour), in das Schloss hineindringen
(: dans), sich an jemanden herandrängen (: contre), Gehen Sie nach dieser
Richtung hin (: dans), nach der Insel zu, auf den Wagen zu (: vers) ».
D'autres décomposent le mouvement et indiquent, par exemple, le
point de départ et la direction, ou bien la direction et le point d'arrivée :
« von unten her, vom Gebirge her (: de), zum Fenster hinaus (: par), vom
Turm aus (: de, du haut de), über die Zeit der Blüte hinweg (: au delà),
über das Jugendalter hinaus (: après), über jemanden herfallen (: sur),
hinter der Zeitung hervorgucken (: derrière) ». Plusieurs de ces expressions
peuvent être employées dans la même phrase : « Wir segelten vom Ufer
her über den Fluss hin nach der Insel zu ».
La description du mouvement et de l'action peut fort bien prendre
une forme implicite sans cesser de marquer la succession des faits, p. ex.
dans ce type si fréquent et si caractéristique, qui permet de condenser
en une seule expression verbale une action et son aboutissement : « einen
Schauspieler hinauspfeifen (: siffler), etwas wegdenken (: chasser, oublier),
sich die Füsse wund laufen (: blesser), sein Geld vertrinken (: boire) » (263).
De même, beaucoup de verbes expriment le mouvement et la modalité
du mouvement : « nach der Stadt eilen » (en français, « se hâter vers la ville »
n'est qu'à moitié correct) 1129.
582. Le cheminement des idées ressemble au mouvement des objets :
ils peuvent tous deux être plus ou moins dirigés, et, comme on peut s'y
attendre, l'allemand ne s'en fait pas faute. Dans la prose écrite, les phrases
et les parties de la phrase sont reliées par des charnières visibles, dont le
français se passe volontiers. De là, dans l'expression des rapports temporels
ou abstraits, ces conjonctions, ces particules, ces accumulations
de petits mots qui nous paraissent encombrer inutilement le tissu de la
syntaxe. Je glane au hasard : « Regen und immer wieder Regen. — Sind Sie
immer noch krank ? — Wenn nicht immer, so doch ab und zu. — Was auch
sonst vorkommen mag. — Die Umgangssprache nun zeigt uns aber … »,
etc., etc.
Sous ce rapport, l'allemand rappelle un peu le grec ancien, qui aimait à
faire du discours un tout compact et bien lié dans toutes ses parties
par des ligaments très apparents. Le français, lui, continue plutôt, dans
350sa prose d'art, les traditions de la rhétorique latine, qui associait les
idées en mettant à nu leurs arêtes vives, sans marquer expressément les
rapports qu'elles supportent.
b) Rôle des aspects et des temps
583. La tendance phenomeniste conçoit la position comme le résultat
d'un mouvement, l'état comme le résultat d'une action, tandis que la
mentalité statique envisage le mouvement comme une position anticipée,
et devine l'état à travers l'action qui le crée.
Dans le parfait grec, par exemple, l'état est représenté comme le résultat
d'une action : héstēke « il s'est dressé et se tient debout ». Au contraire, le
latin, lorsqu'il met à l'ablatif-locatif avec in le complément de verbes
tels que ponere, figere, consistere (in aliquo loco), présente une action
comme un état anticipé.
Il va sans dire que l'allemand voit dans la position un mouvement,
pour ainsi dire, pétrifié : c'est ce qui explique l'emploi de l'accusatif dans
« Der Mann war in einen dicken Mantel gehüllt. — Ein auf einen Stuhl gelegter
Mantel. — In den Fuss gestochen », etc.
584. On a déjà vu que c'est surtout par des préverbes (ou préfixes
verbaux) que l'allemand exprime les modalités de l'action : héritage de
l'indo-européen que les langues germaniques, slaves et baltes ont assez
bien conservé, tandis que le latin et les langues romanes ne l'exploitent guère.
Ces préverbes présentent l'action tantôt en train de se développer, tantôt
à son début, tantôt à son terme, tantôt elle se répète ou elle dure.
En principe, ces nuances, qu'on nomme aspects (115 IIb), peuvent être
rendues de trois manières fondamentales : d'abord par la flexion, comme
le slave le fait régulièrement, ainsi que le grec (et le français littéraire,
par la distinction entre l'imparfait, le passé défini et le passé composé) ;
puis par la suffixation ; c'est le cas, en russe, pour les itératifs en -vatʼ
et les momentanés en -nutʼ ; enfin au moyen de préverbes, dont le slave
use largement, et que le grec, le latin, d'autres langues connaissent aussi
(lat. sequi « suivre », exsequi « atteindre » ; facere « faire », conficere « achever »).
L'allemand ne pratique régulièrement que ce dernier procédé, qui est
beaucoup plus concret et expressif que les précédents, parce qu'il décompose
le procès et le déroule devant les yeux de l'esprit, conformément à
la tendance phénoméniste et dynamique que nous essayons de caractériser.351
Il suffit de citer des séries comme schneiden, anschneiden, zerschneiden ;
- fragen, anfragen, ausfragen, abfragen ; — arbeiten, bearbeiten, verarbeiten ;
einen Berg besteigen, ersteigen ; — forschen, erforschen », etc., pour faire comprendre
comment l'allemand se représente le développement de l'action.
Ainsi an- marque son point de départ dans anschneiden, anfragen, etc. ;
elle se déroule progressivement, par étapes successives, dans sich abspinnen,
sich abspielen, abstufen, dans zum Jüngling heranwachsen ; elle est présentée
dans la durée pure et simple dans einen Berg besteigen, etc. ; ver- désigne
l'acheminement vers un résultat dans das Eisen verarbeiten ; le résultat
est atteint dans einen Berg ersteigen, eine Théorie ausarbeiten, austrinken,
ausschlafen, etc.
585. Il est du plus haut intérêt d'étudier l'attitude du français quand
il s'agit de rendre les fines nuances exprimées par ces préverbes.
Tantôt il laisse au contexte le soin de rendre ce que représente le préfixe
(« couper un habit » : zuschneiden), tantôt il opère avec un jeu de synonymes,
en grande partie conventionnels et simples (569), comme couper,
tailler, trancher (« couper les cheveux, tailler la barbe, trancher la tête »).
Dans tous ces cas, on se représente, non pas telle ou telle phase de l'action,
mais le fait global. D'une façon générale, le français — on pouvait le prévoir
— se désintéresse de l'expression verbale des aspects. Tout d'abord
les préverbes, dont les valeurs sont mal définies (382 ss.), ne jouent ici
presque aucun rôle. On ne peut ériger en système des oppositions telles
que Le soleil se lève (ponctuel ingressif) et Le soleil s'élève dans le ciel
(inchoatif ou progressif), tendre le bras (terminatif) et étendre les bras
(indéterminé). En dehors des préverbes, Il se meurt (progressif), en face de
Il meurt (ponctuel), est archaïque. Les suffixes ne marquent des aspects
qu'incidemment : -ailler (criailler), -oter (toussoter) ont une nuance itérative,
mais leur valeur affective et péjorative est au premier plan et fait
oublier l'autre. Le tour formé par aller + participe présent et qui insiste
sur la continuité ou la répétition du procès (le froid va diminuant, il va
partout répétant que …) est plus littéraire que parlé.
Seule la conjugaison permettait — nous l'avons dit — de distinguer trois
aspects par l'opposition du passé défini, de l'imparfait et du passé composé ;
de ces trois temps, le premier isole le fait dans le passé et condense
la durée en un point (Napoléon mourut à Sainte-Hélène ; Napoléon vécut
52 ans) ; l'imparfait insiste sur la durée ou la répétition (Paul travaillait
sans relâche) ; le passé composé désigne un état résultant d'une action
352passée (J'ai réussi). Mais tout ce système est en train de s'effriter, parce
que le passé défini est sorti de l'usage parlé et a été remplacé par le passé
composé, qui cumule ainsi deux groupes de fonctions 1130.
586. La voix passive permet une distinction aspective suivant que le
verbe est ou non accompagné de compléments (576) : ainsi La maison
est construite désigne l'état consécutif à l'action, tandis que La maison
est construite par des maçons italiens marque le terme du procès, envisagé,
mais non atteint (aspect terminatif) ; cependant cet emploi est soumis
à des conditions si complexes que les exceptions étouffent la règle.
On a vu enfin (518) qu'un petit nombre de verbes duratifs (coucher, pendre,
etc.) deviennent ponctuels en prenant la forme réfléchie (se coucher, se
pendre). L'infinitif alterne parfois avec le participe passé dans un même
tour de syntaxe : Je me sens envahir (envahi) par une vague appréhension ;
l'infinitif a une valeur inchoative, le participe indique l'état consécutif.
587. Mais puisque le français donne une si grande place à l'expression
nominale (c'est-à-dire statique !) des procès, ne peut-on pas s'attendre
à ce qu'il arrive à rendre des nuances aspectives indirectement, par le
véhicule des substantifs que la phrase met en contact avec des verbes ?
Question embarrassante, parce que les études ont été peu poussées dans
cette direction ; on cherche toujours l'aspect dans le verbe lui-même,
presque jamais dans son entourage.
Voici d'abord un cas tout à fait général : l'opposition entre objet affecté
et objet effectué dans la syntaxe des verbes transitifs (cuire la pâte : cuire
le pain, percer un mur : percer un trou). Comme il a été dit § 513, l'objet
affecté donne au verbe un sens duratif, l'objet effectué une nuance terminative.
Cette distribution n'est pas propre au français, elle est commune
à toute les langues indo-européennes ; ce qui frappe en français, c'est
l'identité de la forme du verbe dans les deux emplois, et la tendance de
l'allemand à marquer la différence dans le verbe lui-même, notamment
par des préverbes (voir les oppositions fréquentes du type ein Haus bauen :
eine Baustelle überbauen, einen Brief schreiben : ein Blatt Papier beschreiben,
etc.).353
Certains compléments circonstanciels de temps comportent aussi des
nuances aspectives en français : ainsi l'absence de préposition dans Les
marmottes dorment l'hiver, J'ai mal dormi la nuit dernière, etc., entraîne
l'aspect ponctuel complexif (585), tandis que pendant insiste sur la durée
réelle. On marque la durée par en si l'on dit Vous irez à B. en trois heures,
et le terme visé par dans : Vous serez à B. dans trois heures.
588. La formation des substantifs eux-mêmes intéresse les aspects ;
nous avons signalé (291) la différence entre -ment et -age, le premier
formant volontiers des mots à sens ponctuel, le second soulignant la répétition
des actes partiels ou la durée (comparez battement, enlèvement et battage,
élevage), tandis que les mots en -ure marquent le résultat (souvent
concret) d'une action (une piqûre, une brûlure, etc.), un peu comme les
neutres en -ma, -matos du grec ancien. Enfin on sait que le suffixe -ée
donne un sens itératif à certains noms d'action (traînée, chevauchée, randonnée,
etc.), et un sens duratif à des notions temporelles (jour : journée,
soir : soirée, veillée, nuitée).
Rappelons enfin la remarquable propriété qu'a le français d'exprimer,
avec un même substantif, soit l'action abstraite (consolation), et la qualité
pure et simple (cruauté), soit les manifestations concrètes de l'action
et de la qualité (une consolation, des consolations ; une cruauté, des cruautés ;
cf. 502). Or ce genre de transposition permet de marquer l'aspect ponctuel
par le singulier et l'itératif par le pluriel (voir A. Lombard, Constructions,
p. 99 et s.) 1131.
Ce n'est sans doute pas un hasard si les notions aspectives les plus caractéristiques
se trouvent ainsi exprimées en français dans ou par des substantifs.
Nous verrons plus loin (591 ss.) que le caractère statique de cette
langue se reflète dans la prédominance du substantif sur le verbe.
589. On peut supposer a priori qu'une langue qui donne une grande
place à la notation des aspects doit se désintéresser dans la même proportion
de l'expression exacte des rapports temporels. En effet, tandis
que les aspects absorbent la pensée dans la représentation des procès
en soi, les rapports temporels sont extérieurs à ces procès, les localisent
par association avec d'autres procès. En fait, il semble bien que l'indo-européen,
très riche en aspects, ait exprimé les temps d'une façon assez
354rudimentaire. En sémitique aussi, les aspects sont au premier plan, le
régime des temps leur est subordonné. Nos langues modernes occidentales
n'offrent sans doute plus de si violentes oppositions. Cependant certains
idiomes, comme les langues slaves et le hongrois, où les aspects ont une
place d'honneur, présentent des lacunes dans l'expression des temps ; et,
par exemple, les temps relatifs du latin et des langues romanes n'y existent
pas ; dans une phrase telle que « Il avait fait la guerre et rentrait dans sa
patrie », les deux verbes seraient rendus par le même prétérit simple.
A cet égard encore la différence entre l'allemand et le français est
assez sensible. On connaît la richesse du système temporel français, et
notamment l'extraordinaire développement des temps relatifs (« Quand
j'aurai fini mon travail, je sortirai », etc.). Il semble que l'armature temporelle
de l'allemand soit propre surtout à la prose écrite. La langue parlée
répugne aux lourdes constructions periphrastiques du genre de Wenn ich
meine Arbeit vollendet haben werde, etc. Mais les temps absolus eux-mêmes
forment un système assez simple. On sait que le germanique primitif
avait un seul temps passé et pas de futur ; l'allemand a conservé le souvenir
de cet état : il met le verbe au présent dans bien des cas où le français
est obligé d'employer le futur (Wenn du kommst : « Quand tu viendras »).
L'allemand littéraire peut employer un prétérit unique en regard
des trois passés absolus du français littéraire (ich lebte : je vivais, je vécus,
j'ai vécu) ; le choix entre ces trois formes est un supplice pour tout Allemand
qui traduit en français. Il est vrai qu'au cours du temps, le type
ich habe gelebt - peut-être sous l'influence du français ? — s'est introduit
à côté de ich lebte ; mais voici que, par contre-coup, le prétérit simple
perd du terrain dans l'usage courant, soit le prétérit narratif (Da ist
Tante Frieda aus dem Wagen gestiegen und dann hat sie gesagt …), soit
même le prétérit d'habitude (Er hat jeden Tag einen Spaziergang gemacht).
Ainsi, de plus en plus, le passé composé cumule de nouveau les trois
fonctions du passé simple, encore vivant dans la langue écrite. Cette simplification
est absolue dans les dialectes alémaniques.
590. Enfin la tendance phénoméniste cherche le devenir jusque dans
la désignation des objets inertes.
Les composés allemands sont instructifs à cet égard. Au premier abord,
il semble qu'il y ait un abîme entre un mot désignant une chose comme
Wanduhr et un verbe comme hängen ou une expression telle que « Das
Meer erglänzte weit hinaus ». Mais, par sa structure même, un composé
355désignant un objet est la reconstitution d'un fait réel ou possible. Quand
on appelle une pendule Wanduhr, on se représente cet objet appliqué
contre une paroi ; mais s'il s'y trouve, c'est qu'on l'y a mis ; sa position
est le résultat d'un mouvement : c'est une action cristallisée. De même
pour Fingerhut, Handschuh, Schlittschuh, Zeigefinger, etc.
Il est clair que l'ordre anticipateur de la syntagmatique allemande
favorise grandement la tendance génétique et descriptive. Ainsi une construction
telle que ein vom Feinde getöteter Soldat oblige l'esprit à envisager
l'agent et la cause du fait avant le fait lui-même et son objet (ici : Soldat) ;
des composés tels que Landhaus placent le détail caractéristique avant
l'idée générale, et forcent à s'attacher à ce détail. Que dire alors de tours
du genre de Ein im Wohnzimmer zwischen dem Kamin und dem Fenster
stehender Schrank ? Ce n'est pas un tableau achevé qu'on embrasse d'un
coup d'oeil : c'est une peinture qui s'élabore devant nous.
c) Le style substantif
591. Le français est donc bien, dans son attitude en face de la réalité
(572), à l'opposé de l'allemand : bien loin de chercher le devenir dans les
choses, il présente les événements comme des substances. La langue d'aujourd'hui
transpose volontiers le verbe par des procédés nominaux. C'est
le fameux style substantif, honni par M. Thérive, donné par M. Legrand
comme la clé du parler élégant. Dans l'introduction de sa Stylistique française,
ce dernier dit : « A la différence du latin, notre langue tend à faire
dominer sur le verbe et son groupe, le substantif et son groupe. Pour en
donner un exemple frappant, il nous suffira d'un parallèle entre deux
petites phrases : « Ils cédèrent parce qu'on leur promit formellement qu'ils
ne seraient pas punis ». Style écolier. C'est lourd et peu français. Autre
rédaction : « Ils cédèrent à une promesse formelle d'impunité » ».
Ce style substantif, que M. A. Lombard a étudié en détail (Constructions),
est grandement favorisé par la séquence progressive, qui a pour
effet de placer l'élément sémantique et fort à la fin du groupe syntaxique.
Il suffit de rappeler à titre d'exemple les périphrases qui permettent
d'éviter l'ordre tʼt : périphrases adjectives : « un pont en pierre, une statue
de marbre » (all. : steinern, marmorn), tours adverbiaux : « d'un œil sévère,
avec sévérité » (remplaçant sévèrement), enfin et surtout composés verbaux :
« prendre peur = s'effrayer, prendre la fuite = s'enfuir, donner sa démission
356= démissionner, se démettre ». On notera aussi l'emploi de avoir dans
« Il eut un sourire de pitié », tour, il est vrai, essentiellement littéraire.
592. C'est la prédilection pour le substantif qui cherche à bannir les
qui et les que de la langue écrite d'aujourd'hui, alors que le style classique
ne les redoutait nullement. C'est que ces mots introduisent des propositions,
et celles-ci contiennent nécessairement un verbe.
Mais, en évitant les qui et les que, on tombe de Charybde en Scylla :
les substantifs se lient les uns aux autres par des prépositions, parmi lesquelles
de est la plus fréquente, parce que la plus purement grammaticale.
C'est ainsi qu'on en arrive à commettre des phrases de ce genre : « Des
divergences d'interprétation s'étant produites au sujet de l'ordonnance
du président de la Cour de droit public du Tribunal fédéral relative à la
demande de suspension par voie de mesure provisionnelle de l'arrêté du
Conseil d'Etat de Fribourg sur le maintien de l'ordre public, la direction
de police du canton de Fribourg a sollicité de M. le président Muri des
éclaircissements », etc. (J. de Genève).
Comment combattre cette nouvelle maladie ? Le français cherche à
éviter l'accumulation des substantifs en recourant aux adjectifs de relation
(434), dont la plupart sont dérivés de noms : « chaleur solaire, cage
thoracique, questions budgétaires », etc. Mais un nouveau danger surgit :
l'ambiguïté possible de rapports qui ne sont marqués par aucun signe
explicite. Or, la syntaxe française demande que les adjectifs se déterminent
de proche en proche (267, 430) ; c'est le cas dans « situation ferroviaire
italienne, club alpin français », mais la distribution des adjectifs
est plus difficile dans « assemblée générale annuelle, comité central exécutif » ;
on est tenté de mettre les deux adjectifs sur pied d'égalité et de les rapporter
directement au substantif, ce qui est contraire à l'usage ; dans
« inscriptions latines vulgaires », les deux adjectifs, qui remplacent « du
latin vulgaire », déterminent dans leur ensemble le substantif ; on a de la
peine à s'en rendre compte tout de suite.
d) La clarté française
593. On pourrait résumer les vues esquissées plus haut en disant que
le français est clair et l'allemand précis, plus exactement : si le français
aime la clarté, l'allemand a la passion des précisions ; l'un va droit au but,
le second met partout les points sur les i.357
Seulement, il faut s'entendre sur la définition de ces deux termes.
Nous avons soutenu, dans l'introduction, que la plupart de ceux qui vantent
la « clarté française » seraient assez embarrassés de dire en quoi elle
consiste.
La solution nous est offerte par la définition des Cartésiens 1132, selon lesquels
« une idée est claire lorsqu'on la discerne de ce qui n'est pas elle ;
elle est distincte lorsqu'on discerne ce qui est en elle ». Leibnitz (cité par
Goblot, l. c.) dit de même : « L'idée claire est celle qui permet de reconnaître
son objet lorsqu'on la rencontre, comme, lorsque j'ai une idée
bien claire d'une couleur, je ne prendrai pas une autre couleur pour celle
que je demande ; et, si j'ai une idée claire d'une plante, je la discernerai
parmi d'autres voisines » ; et plus loin : « Nous nommons distinctes non pas
toutes celles (sc. les idées) qui sont bien distinguantes ou qui distinguent
les objets, mais celles qui sont bien distinguées, c'est-à-dire qui sont distinctes
en elles-mêmes et distinguent dans l'objet les marques qui font
connaître ce qui en fait l'analyse ou la définition ». Autrement dit, la clarté
naît de la perception des signes qui différencient les objets les uns des
autres et empêchent de les confondre ; elle fait voir les choses par le dehors,
en les opposant à d'autres 2133.
Voilà pourquoi la clarté est à base d'antithèse : elle procède par dichotomie ;
c'est un principe de classement, non d'approfondissement. Elle
rappelle la définition que Bergson donne de l'intelligence conceptuelle
et discursive : « Outillée seulement pour la connaissance des formes et des
rapports, elle ne nous fait jamais apercevoir que les rapports des choses.
Elle nous laisse en dehors d'elles ». Paul Claudel a dit que le Français
se complaît dans l'évidence : mais l'évidence est une illumination qui
éclaire les objets sans les pénétrer. Une idée claire peut ne pas être vraie : elle
ne l'est même jamais complètement. Voltaire a dit de lui-même : « Je suis
pareil aux ruisseaux ; je suis clair parce que je ne suis pas profond ».
594. Par opposition à la clarté, la précision (Descartes dirait la « distinction »)
358est une tendance à approfondir les choses, à les pénétrer et
à s'y installer, au risque de s'y perdre. C'est bien, n'est-il pas vrai, l'impression
que nous laisse une vue même superficielle de l'allemand ?
En définitive, la précision, en matière de langage, s'oppose à la clarté
comme le signe explicite au signe arbitraire (197 ss.) ; car celui-ci tire toute
sa valeur des signes qui diffèrent de lui et soutiennent avec lui des rapports
oppositifs, alors que le signe motivé dit par lui-même quelque chose
de l'idée qu'il exprime ; il restreint d'autant le rôle des oppositions purement
différentielles.
e) Art et poésie
595. S'il était permis de dépasser les limites d'une étude purement
linguistique, on pourrait voir là le reflet de deux attitudes contraires de
l'esprit : l'une, essentiellement intellectuelle et discursive, l'autre, plus
intuitive et teintée d'affectivité. Mais ce sont là des considérations étrangères
à notre sujet ; restons à mi-côte, et demandons-nous s'il n'y a
pas là une opposition entre l'art et la poésie ; en nous confinant dans
les limites de la littérature, nous ne sortirons pas du cadre de notre
étude 1134.
L'œuvre d'art pure est plastique dans son essence ; elle montre plus
qu'elle ne suggère ; l'œuvre poétique pure vit d'indétermination, parce
qu'elle prend l'âme tout entière et la plonge dans une sorte d'hypnose
voisine du rêve ; son expression idéale est la musique, qui devient lyrisme
quand elle s'exprime par des mots. Le but de l'art est d'exprimer la beauté ;
mais le beau obéit à des normes en partie extérieures au moi ; l'artiste
ne les trouve pas uniquement dans ses aspirations, ses joies et ses douleurs ;
elles ont leur racine dans l'intelligence, et supposent aussi un certain
accord entre les esprits. La poésie, en revanche, est essentiellement égocentrique ;
c'est un repliement de l'âme sur elle-même ; elle est sentiment
et n'est que cela. On peut goûter une œuvre d'art par l'intelligence seule ;
l'admiration se passe, à la rigueur, de l'émotion. Telle fugue de Bach
procure un plaisir purement intellectuel, comme un beau théorème de
géométrie ; telle page de Schumann ouvre à l'âme des trésors d'émotion
si intenses qu'on renonce à les analyser, et (c'est là le point) on ne se pose pas
la question de savoir si c'est beau ou non. L'art et la poésie n'existent
pas l'un sans l'autre ; mais l'équilibre qui fait leur force peut se rompre.
359Alors, ou bien l'art tue la poésie, et le métier étouffe l'inspiration ; ou bien
la poésie devient incommunicable.
596. Revenons maintenant au français. S'il est vrai que la langue
imprime à l'esprit une forme générale dont il lui est difficile de s'affranchir
complètement, demandons-nous si la langue française est une langue
« artistique » ou une langue « poétique ».
Le français n'est guère fait pour le prolongement de la pensée dans le
rêve. Il donne aux idées la limpidité du cristal ; il leur en impose aussi
la rigidité. Fr. Paulhan, dans La double fonction du langage, a insisté
sur l'opposition entre la valeur significative des mots et leur valeur de
suggestion. On pourrait dire que le mot français signifie plus qu'il ne
suggère, et que le mot allemand suggère plus qu'il ne signifie. Taine
(La Fontaine, p. 69) a dit : « Notre style, si exact et si net, ne dit rien au
delà de lui-même ; il n'a pas de perspective ; il est trop artificiel et trop
correct pour ouvrir des percées jusqu'au fond du monde intérieur ». Le
français distingue chant, chanson, romance : il y a de tout cela dans le
Lied allemand, et d'autres choses encore, car un lied de Schumann n'est
ni un chant, ni une chanson, ni une romance. Le mot Sehnsucht a derrière
lui tout un monde de poésie ; nostalgie, avec son arrière-goût hellénique,
a bien moins d'intimité que Heimweh : mal du pays ne dit rien
du tout à la sensibilité ; il n'est pas jusqu'à un vocable banal tel que
Mädchen qui ne perde de sa fraîcheur en passant en français.
597. Si la poésie vraie, par son indétermination, se rapproche de la
musique, la langue française ne fait pas grand'chose pour ce rapprochement.
« Notre langue allemande », dit M. C. J. Burckhardt dans un article de la
Neue Schweizerische Rundschau (mars 1930), « n'est pas une langue lapidaire.
Issue de la musique, elle n'a pas cessé de lui appartenir ; c'est une
musique sans notes, une musique qui s'est déposée dans le concret et
l'intelligible. Sa grandeur n'est pas de traduire la pensée en signes infaillibles ;
non, mais elle enveloppe l'âme de puissances obscures ou brillantes.
De secrètes résonances y prennent leur essor et s'envolent sans effort
dans la région où les mots perdent leur sens. La langue allemande a au-dessus
d'elle toute la musique allemande, comme un ciel sonore qui la
borde à l'horizon. La langue française n'a pas de musique au-dessus
d'elle. Elle a en elle une musique parcimonieuse, juste ce qu'il faut pour
l'orner, sans jamais l'alourdir ni la voiler. Telle qu'elle est, elle embrasse
tout ce qui constitue la vie française ».360
De fait, le Français moyen n'est pas musicien ; c'est que la musique
plonge l'esprit dans une sorte d'extase délicieuse et terrible qui est une
domination, et cette rupture d'équilibre effraie l'esprit amoureux de
mesure et de maîtrise. La chanson française vaut par les paroles souvent
charmantes de grâce, d'esprit, de malice ; la mélodie est, en général,
pauvre ou vulgaire, et quand le sentiment cherche à s'y introduire, quelle
misère !
La poésie française, embrassée dans son ensemble, est une poésie d'art ;
le lyrisme y a toujours été un accident, et, chose caractéristique, le sentiment
y prend généralement la forme de l'éloquence ; c'est par là qu'elle
échappe à l'alexandrinisme et à la tyrannie du métier. Ce n'est pas par
hasard qu'en France la littérature s'est appelée pendant longtemps « éloquence »,
alors que pour un Allemand toute œuvre littéraire, même en
prose, est une « Dichtung ». En effet, un souffle d'éloquence passe sur
toute la littérature française depuis la Renaissance ; mais l'éloquence tue
la poésie et le rêve : c'est un produit de la vie sociale ; l'orateur est campé
devant la foule, et c'est la foule qui lui dicte le rythme de ses émotions.
598. La langue écrite, affinée pendant plusieurs siècles par la cour et
l'élite, n'est pas faite non plus pour donner naissance à une poésie naïve
et spontanée comme la poésie lyrique allemande. Il suffit de penser au
vocabulaire « latin » pour voir qu'une pensée naïve ne peut y trouver
son expression ; quand V. Hugo évoque « un cadavre blanc, comme éclairé
de la lividité sépulcrale du rêve », on songe à tout ce qu'il faut de culture
et de réflexion pour goûter cette expression, si distante du langage de
tout le monde, et surtout si plastique.
C'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas en France de poésie
vraiment populaire. Le moyen âge était sur le point d'en léguer une au
monde moderne : la Renaissance a tout bouleversé ; dès lors, l'imitation
des modèles antiques a ennobli la poésie en l'éloignant du peuple ; la poésie
populaire se terre dans l'argot ou végète dans la littérature régionale.
Rien qui rappelle la délicieuse naïveté d'un lied de Mörike ou d'un conte
de Grimm. Aussi n'est-il pas étonnant que la littérature enfantine soit
très pauvre en français. Les contes de Perrault sont faits pour des enfants
très avertis, et les petits Français le sont terriblement. Quant aux fables
de La Fontaine, elles cachent, sous leur apparente bonhomie, un art consommé
au service d'un esprit désabusé ; s'il y a un livre qui soit peu fait
pour les enfants, c'est bien celui-là.361
Les symbolistes ont couru cette aventure de rendre en français des
impressions vagues en effaçant les contours précis des mots et des idées :
Verlaine conseille l'équivoque, et veut « de la musique avant toute chose ».
Il est à coup sûr celui des poètes français qui fait le plus penser à l'indétermination
de certains poèmes allemands. N'oublions pas que la plupart
des tenants de cette école étaient des étrangers ou avaient des attaches
flamandes.
599. On a aussi beaucoup parlé des impressionnistes, et l'on croit volontiers
qu'ils ont rompu avec les procédés traditionnels du style français.
Mais il importe d'éviter, à ce propos, une confusion dont j'ai été moi-même
victime 1135. Les notions de phénoménisme (573) et d'impressionisme
ne se recouvrent pas. Autre chose est de s'absorber dans le phénomène,
de le vivre, de suivre son déroulement, autre chose d'en saisir un moment
fugitif et de le fixer, de lui donner une valeur permanente. En somme,
l'impressionnisme est d'essence statique, et ce n'est pas un hasard s'il
donne la forme substantive aux procès et aux qualités ; c'est une manière
de les cristalliser. Dire, à l'exemple de Daudet ou des Goncourt, qu'une
femme cambre la sveltesse de sa taille, se penche sur le sommeil de son enfant,
employer, au lieu d'une phrase à verbe conjugué, un simple infinitif
exclamatif : Mourir si jeune ! Oh ! revoir la terre natale !, ou encore aligner
des phrases telles que La nuit. La pluie. Un gibet plein de pendus rabougris
(Verlaine), c'est fixer et matérialiser des impressions fugitives 2136. F. Lorey 3137
dit fort justement : « Das Wesentliche solcher Schilderungen ist, dass nicht
Vorgänge als solche, sondern Gegenstände mit einem Merkmal sprachlich
aufgefasst sind ». Les impressionnistes semblent donc avoir poussé à
l'extrême plutôt que répudié certaines tendances du français d'aujourd'hui.
Quant aux créations de l'école mallarméenne, tout jugement est interdit
à quelqu'un pour qui elles restent complètement fermées. Mais une
chose est certaine : ce sont des produits de la réflexion la plus raffinée
et la plus subtile ; parler de spontanéité est ici un contre-sens ; pour
Mallarmé, l'inspiration est une sorte de maladie dont le travail doit guérir
le poète.362
Le français langue de communication
a) Communication et expression
600. Nous avons jusqu'ici envisagé la langue du point de vue de sa caractéristique
interne ; considérons-la maintenant comme institution sociale.
La langue a pour première fonction de permettre aux individus du groupe
de communiquer entre eux. Pour savoir si un idiome répond, et dans quelle
mesure, aux exigences de la communication, il importe de définir ces
exigences : nous les résumons dans une formule volontairement rigide,
et que le contact avec les faits rendra plus souple et plus nuancée : une
langue sert les besoins de la communication lorsqu'elle permet de transmettre
la pensée avec un maximum de précision et un minimum d'effort
pour le parleur et pour l'entendeur.
C'est là, comme on sait, l'idéal « énergétique » préconisé par Ostwald
pour toutes les activités humaines ; l'aspect linguistique de la question
a été exposé par M. Jespersen 1138.
La langue se rapproche de cet idéal par la régularité et la simplicité,
qui ont pour effet d'automatiser le plus grand nombre d'opérations linguistiques
et de les confier au subconscient. Il faut en outre que l'expression
de la pensée soit valable pour tous les individus intéressés et pour
toutes les circonstances. Ces exigences deviennent d'autant plus impérieuses
à l'époque moderne du fait que les relations internationales, toujours
plus intenses, obligent une foule de gens à posséder une ou plusieurs
langues étrangères. Un idiome aura d'autant plus de chances de servir
ces échanges qu'il sera d'une étude plus aisée pour l'étranger.
601. Au fond, la communication tend à réaliser en matière de langue
ce que vise, pour l'industrie, la rationalisation américaine, la « standardisation ».
On rationalise le travail industriel quand on obtient de lui le maximum
de rendement avec le minimum d'efforts, quand un ouvrier, dans
le même laps de temps, produit, avec deux fois moins de mouvements,
deux fois plus de pièces manufacturées. Pour atteindre ce but, la standardisation
ramène au chiffre le plus bas la diversité des types fabriqués
en vue d'un même usage. Mais n'est-ce pas standardiser que de réduire
au minimum les modes d'expression possibles d'une même idée, d'une
363même combinaison grammaticale ? Voici deux mots à peu près synonymes,
cime et sommet ; vous en supprimez un, et par là — avec tous les risques
possibles pour les nuances personnelles de l'expression — vous diminuez
l'effort du parleur, qui n'a plus à se demander quand il doit employer
cime et quand il lui faut préférer sommet. Le français offre le choix entre
Je me crois sincère, Je crois être sincère et Je crois que je suis sincère.
Luxe inutile : supprimez les deux premiers tours, le troisième est le plus
commode, parce qu'il est seul applicable à toutes les conditions d'emploi.
Ainsi on peut dire p. ex. Je crois qu'il est sincère, mais non « Je le crois être
sincère », Je crois qu'il ne ment pas, mais non « Je ne le crois pas mentir »,
etc.
Or, la grande communication standardise infailliblement le langage ;
l'obligation d'être compris d'un grand nombre d'hommes pousse à généraliser,
à simplifier, et M. Jespersen a montré, par exemple, (Progress)
l'énorme travail de décantation qui s'est opéré dans le passage de l'anglo-saxon
à l'anglais d'aujourd'hui.
602. Mais on comprend sans peine qu'une pareille simplification ne va
pas sans de sérieuses pertes pour l'expression nuancées de la pensée personnelle,
et que, en particulier, les mouvements de la sensibilité sont
gênés par cette régularité schématique.
On peut admettre, de façon générale, que les besoins de la communication
sont opposés à ceux de l'expression 1139 ; mais les études de détail manquent
encore pour la démonstration.
Prenons comme exemple l'élimination des genres : l'anglais, qui en
avait trois, n'en a conservé aucun. Le français s'est débarrassé du neutre,
mais conserve la distinction entre le masculin et le féminin ; la répartition
des substantifs entre les deux genres est des plus capricieuses : grosse
surcharge pour la mémoire ! Mais la fantaisie ne trouve-t-elle pas son
compte à cette complication ? On a beau dire que le genre grammatical
est une pure survivance sans signification : le seul fait de mettre le ou la
devant un substantif lui donne une personnalité. La rose serait-elle la
rose si elle changeait de genre ? Il y a du folklore dans l'opposition entre
le soleil et la lune ; le genre personnifie les abstraits comme des entités
mâles ou femelles (le Vice, la Vertu ; cf. 139). Restes de la mentalité
primitive si l'on veut, mais encore bien vivants.
603. Les irrégularités d'une langue servent indirectement l'expressivité
364par ce seul fait qu'elles mettent de la variété dans le discours. Rien de
plus monotone que la répétition des mêmes formes ; or, régularité implique
répétition ; imagine-t-on un français où tous les verbes se conjugueraient
sur marcher, et où tous les noms d'action seraient terminés en -tion :
« ratification de la convention pour la suppression des prohibitions à l'importation
et à l'exportation » ?
Là encore, des enquêtes de détail s'imposent. Nous avons vu p. ex. (397)
que le français a perdu l'usage régulier des suffixes appréciatifs (diminutifs,
péjoratifs, etc.), alors qu'il est normal en allemand (comme en italien et
en espagnol). La répétition des diminutifs en -chen et -lein est un peu lassante,
parce qu'on peut les former avec n'importe quel substantif.
En français, rien ne permet de prévoir quel sera le suffixe diminutif
d'un mot (si tant est qu'il en admette un dans le parler correct) : on dit
frérot, et sœurette ; tyranneau, roitelet et principicule ; diablotin, négrillon ;
longuet et pâlichon, pâlot ; brunet et blondin ; voleter, pleuviner, chantonner,
etc., etc. Chacune de ces formations a quelque chose d'inattendu qui
contribue à donner du pittoresque à l'expression.
604. Mais un fait paraît certain : plus est grand le nombre des individus
qui parlent et écrivent une langue, plus cette langue se simplifie, s'affranchit
des entraves qui gênent la communication quotidienne et terre-à-terre ;
la grammaire se régularise, le vocabulaire devient plus abstrait,
les concepts courants se généralisent. Il est curieux de constater que
les deux peuples qui ont le plus colonisé, les Anglais et les Espagnols,
sont aussi ceux dont la langue possède les formes générales les plus simples
et les plus régulières.
D'ailleurs les nécessités de la communication ne sont plus les mêmes
qu'autrefois ; elles sont devenues autrement plus impérieuses qu'il y a
un siècle encore. La vie sociale, confinée jadis dans la commune, puis
dans la province, déborde aujourd'hui les frontières de la nation. Les
grandes langues sont en concurrence pour la possession du monde. Il ne
s'agit plus seulement, il est vrai, d'imposer un idiome par la force ; même
après une conquête, la résistance des sujets est aujourd'hui plus intense
et plus efficace. Non : ce sont les formes de civilisation qui s'affrontent,
et la compétition des langues double celle des cultures ; la pénétration
se fait par le livre, la presse, la conférence, l'enseignement, le cinéma
parlant, la radio. Mais dans cette lutte pour la vie et la propagation des
idiomes, leur complication relative joue un rôle de plus en plus grand ;
365un peuple qui veut répandre sa langue est forcé de songer aux obstacles
que l'étranger rencontre dans son étude ; il est amené à se demander si
une simplification n'est pas désirable. Ainsi ce qui se faisait autrefois
automatiquement se fera peut-être d'une façon plus réfléchie à l'avenir.
605. Mais ici surgit une question générale d'une grande importance :
quel est le rôle de la réflexion et de la volonté dans le fonctionnement
et l'évolution des langues ? (voir LV3, p. 151 ss.). Jamais l'homme n'a
été absolument passif vis-à-vis du langage ; c'est l'école des néo-grammairiens
qui a popularisé l'idée de l'entière inconscience en cette matière.
En outre, plus la civilisation progresse et s'affine, plus la langue est
soumise à la critique et aux changements réfléchis. Jadis, c'était l'affaire
d'une petite élite intellectuelle et sociale ; les écrivains, les académies
ou la cour donnaient le ton. Aujourd'hui, tout le monde s'en mêle, la
langue correcte se démocratise ; le prestige et l'autorité ne sont plus les
seuls leviers de l'usage. Cette intervention toujours plus active de la pensée
réfléchie donne l'impression que les langues ne sont pas des produits
entièrement « naturels », puisqu'elles présentent une foule de faits (mal
étudiés, il est vrai), où la volonté consciente imprime sa marque. C'est
ce qu'a bien montré M. Jespersen (Nature).
606. Quoi qu'on pense des exigences de la communication, le linguiste
a le droit de se demander si une langue, ou même un type isolé d'expression,
les satisfait, et quelle est la dose d'effort psychique qu'ils nécessitent.
La position respective du français et de l'allemand sur ce point n'est
pas facile à déterminer. Avons-nous des critères sûrs pour juger les langues
au point de vue de la communication ? Guère, car cette réponse supposerait
qu'on a passé en revue tout le système linguistique sous un angle
très spécial. Les quelques remarques qui suivent ne sont qu'une première
indication du travail à faire.
L'un et l'autre idiome sont très loin de satisfaire aux exigences de l'assimilation
rapide et des échanges aisés. Sur l'allemand, nous serons bref :
il suffit de rappeler le lourd fardeau des flexions nominales et verbales,
les doubles emplois, l'enchevêtrement des éléments de la phrase et du
groupe syntaxique, la structure compliquée des mots avec leur armature
de préfixes et de suffixes, la complexité du système phonologique, les
charges consonantiques des syllabes, etc., et l'on conclura, d'une façon
un peu simpliste, il est vrai, que l'allemand est une langue difficile.
607. Le français a sur l'allemand un sérieux avantage : il est unifié ;
366la disparition presque complète des dialectes est une force. L'allemand
est fractionné en une multitude de parlers locaux dont beaucoup diffèrent
sensiblement de la Schriftsprache ; la puissance expansive de celle-ci en
est diminuée, la majorité des sujets parlants étant bilingues. On peut seulement
se demander si l'unité interne du français est égale à son nivellement
spatial ; sous ce rapport, il faudrait faire entrer en compte la dualité
du vocabulaire hérité et du vocabulaire latin (520 ss.), les disparates du
système grammatical, produit de plusieurs siècles de conservatisme, l'écart,
toujours sensible, entre la langue parlée et l'écrite, etc.
Les formes analytiques du langage sont très propres à rendre la pensée
aisément compréhensible et à diminuer l'effort du sujet entendant. Le
français passe couramment pour être analytique et l'allemand synthétique ;
nous avons vu qu'il faut en rabattre ; la marche à la condensation
du côté français, le fractionnement extrême de la syntagmatique allemande,
sont des traits généraux susceptibles de modifier nos idées sur ce point.
Le français aime le signe simple et le signe arbitraire ; théoriquement,
c'est un gain pour la communication. La motivation explicite, grand levier
d'expression, est gênante pour les échanges réguliers. Dans son livre
Die Bedeutung des Wortes, 0. Erdmann reproche à l'allemand de n'être
pas une « gedankenlose Sprache ». C'est vrai : on pourrait dire qu'il fait
un sort à chaque idée qui passe, et c'est là une entrave pour la pratique
journalière. Nous l'avons vu : c'est par l'arbitraire du signe que le français
est clair ; seulement il ne l'est pas à peu de frais ; pour arriver à la propriété
des termes, le parleur doit fixer ces termes au moyen d'associations
compliquées, qui varient d'un cas à l'autre.
Le français a encore cet avantage, pour la communication, d'être une
langue orientée vers l'entendeur (314) et de disposer les signes sur la
ligne du discours de manière à faciliter la compréhension de l'énoncé.
Nous avons relevé à plusieurs reprises ce caractère ; le français unit étroitement
les éléments qui s'appellent naturellement, au lieu de pratiquer la
disjonction chère à l'allemand ; l'habitude de séparer le thème et le propos
dans la phrase segmentée (79 ss.) facilite aussi l'analyse de la pensée :
enfin la séquence progressive, pièce maîtresse de la grammaire française,
consiste à dire d'abord de quoi l'on parle avant d'exprimer l'idée qui
est le but de l'énonciation. Cet idéal, nous l'avons vu, est poursuivi dans
toutes les formes d'agencement, depuis la phrase jusqu'à la constitution
des mots.367
608. Nous disions plus haut que la communication pose nécessairement
la question des rapports entre la langue parlée et la langue écrite ;
car, si elles sont trop distantes l'une de l'autre, on tombe dans le bilinguisme,
et l'échange des idées ne peut qu'en souffrir. Plus la langue écrite
s'écarte de la pratique quotidienne, plus elle demeure une langue de
caste, inaccessible au peuple ; plus, au contraire, le peuple s'élève dans
l'échelle sociale, plus il réussit à combiner les deux formes d'expression.
L'écart entre l'écrit et le parlé est donc un critère social qui intéresse le
problème de la communication.
Mais cette question, souvent débattue, est trop vaste et trop mal délimitée
pour être reprise ici dans son ensemble. Il conviendrait de s'attaquer
à des aspects précis du problème. A titre de spécimen, nous dirons quelques
mots de
b) La langue faite pour l'œil
609. Il y a, dans tous les idiomes de grande circulation, des faits linguistiques
qui ne deviennent clairs qu'à la lecture et restent ambigus
pour l'oreille. Quand ils dépassent un certain degré de fréquence, ils
peuvent devenir un indice de la prédominance de l'usage écrit sur l'usage
parlé.
Ces anomalies sont à peu près inexistantes en allemand, et le français
en offre de nombreux exemples. Nous en avons signalé quelques-uns en
cours de route (412-415, 561 ss.) ; je rappelle seulement les pluriels révélés
par la seule magie de l's muet. Posez ce problème de vive voix : « M. et Mme
Durand viendront déjeuner avec leur(s) fils et leur(s) fille(s) ; combien
de couverts faudra-t-il dresser ? » On répond que ces ambiguïtés sont
réduites à rien dans la pratique, parce que la situation ou le contexte
remettent les choses au point. Pas toujours : mon expérience personnelle
me le montre, et là encore, il faudrait accumuler des observations concrètes.
Mais même dans les cas où la clarté jaillit des circonstances, le linguiste
se trouve devant une question de principe : le degré de dépendance de
la langue vis-à-vis de la parole (cf. 569 s.) 1140.368
610. La langue faite pour l'œil joue un rôle considérable dans la versification
française : ce fait, en apparence étranger à notre sujet, est révélateur
d'une tendance générale. Il vaut la peine de s'y arrêter.
C'est l'œil qui impose tant d'obligations et d'interdictions que l'orthographe
seule justifie : interdiction de l'hiatus, permis cependant quand
une consonne muette le supprime pour l'œil (« soin attentif, chemin escarpé,
en haut ») ; interdiction de rimes parfaites pour l'oreille, imparfaites pour
la vue (p. ex. tyrannie de l'e muet final, qui interdit de faire rimer futile
avec puéril, qui permet vie errante et condamne vie misérable). Tout cela
va de pair avec la prononciation conventionnelle que la poésie conserve
encore (454).
611. Thibaudet dit fort justement : « La rime de Mallarmé est toujours
pour l'œil. Il est fidèle simplement à la tradition de la poésie française,
qui est, depuis Malherbe (« Il voulait, dit Racan, qu'on rimât pour les
yeux aussi bien que pour les oreilles »), une poésie écrite et imprimée.
On sait qu'Hugo n'hésite jamais à faire rimer Lupus et rompus — net et
cornet — Vénus et nus 1141. Cette rime, riche sous sa forme visuelle classique
est un produit du livre. Au contraire, toute poésie dite est assonancée,
et il semble curieux que la rime, née d'un instinct musical, ait pris ce
sens et ce rôle principalement visuels » (La poésie de Mallarmé, p. 194).
« Les Parnassiens, ajoute Thibaudet p. 207, fermés à la musique et d'une
imagination toute visuelle, destinaient leurs vers surtout à être lus. Je
crois, disait Gautier, qu'il faut surtout, dans la phrase, un rythme « oculaire ».
Un livre est fait pour être lu, non parlé à haute voix ».
612. En résumé, le français servirait mieux la communication s'il était
un peu plus « rationalisé » ; mais il met une sorte de coquetterie à ne pas
l'être. Il a horreur de la règle rigide, horreur de tout ce qui pourrait conduire
à l'automatisme, au travail linguistique exécuté en série. En français,
il faut toujours compter avec l'imprévu ; un long entraînement et une
attention de tous les instants ne sont pas de trop si l'on veut éviter les
innombrables embûches que tendent, avec un touchant accord, le lexique,
la morphologie, la syntaxe, l'orthographe. Le français a conservé trois
369cent cinquante verbes irréguliers qui cheminent à la débandade, et sont
bien différents des verbes forts de l'allemand, classés en catégories apophoniques
assez distinctes. Tout au long de notre étude, nous avons
signalé les caprices de la formation des mots, des familles sémantiques,
de la place de l'adjectif épithète, de la formation de l'adjectif féminin,
l'emploi des prépositions devant l'infinitif, celui du subjonctif, de la négation
postiche ne, le danger des fausses relations, des calembours, des cacophonies,
etc., etc. Alors que tout se démocratise, il demeure ce qu'il a été
depuis l'époque classique : le truchement d'une élite et d'une aristocratie.
Si la poussée internationale et affairiste où nous vivons venait à le
bousculer et à le disloquer, on ne pourrait que déplorer l'avilissement
de cet instrument unique d'une pensée faite de raison, de goût, de grâce
et de mesure. Mais s'il faut que le français change — et il ne peut échapper
au changement — on se souviendra que la volonté et la réflexion peuvent
jouer leur rôle ; espérons que nos petits-neveux, tout en conservant ce
que le français a d'incomparable, sauront faire la part du feu, en sacrifiant
ce qui n'est que gêne pour la pensée sans profit pour l'expression.370
11 Cf. L. Weisgerber, Muttersprache, p. 121 ss. L'emprise de la langue sur la pensée se révèle
dans l'emploi des mots les plus ordinaires, car les sujets parlants, tant qu'ils ne veulent pas
en créer de nouveaux ou modifier le sens de ceux qu'ils connaissent, sont obligés d'introduire
et de classer leurs représentations selon des normes impératives et souvent artificielles.
Rien de plus compliqué que la distinction entre des notions pourtant usuelles telles que douleur
et souffrance, liberté et indépendance, nation et peuple, culture et civilisation, etc. La question
est encore plus délicate qu'on ne serait tenté de le croire, car le sujet parlant doit opérer constamment
avec des définitions de mots au lieu de définitions de choses, ce qui est le renversement
de la marche rationnelle de l'esprit.
Le français nous offre un exemple remarquable de cette action de la langue sur l'esprit.
Nous verrons que le français est animé d'un rythme oxyton dont la contre-partie est la prédominance
de la séquence progressive dans l'ordonnance des syntagmes (315 s.). En revanche,
cette même langue favorise l'arbitraire du signe, et a une prédilection pour les mots simples
ou difficiles à analyser (559). Or, il n'est pas douteux que soit la séquence progressive, soit
l'arbitraire du signe forcent à penser d'une certaine façon. Mais l'accent oxyton des mots
aussi bien que leur condensation sont issus de l'énergie autrefois fort grande de l'accent et de
la fusion des éléments du mot. Cet accent a fini par détruire tout ce qui le suivait et à syncoper
la majorité des syllabes prétoniques et posttoniques (cf. mansionáticum et ménaj) ; cette condensation
est due aussi à la faiblesse des consonnes intervocaliques (vidēre, bibere, nucem → voir,
boire, noix).
On a supposé, avec de bonnes raisons, que l'énergie accentuelle est due à l'influence du
« superstrat » germanique, tandis que la faiblesse des consonnes intervocaliques (un des caractères
des langues celtiques) serait attribuable au substrat gaulois. Ainsi, deux traits profonds
du français actuel seraient la répercussion de faits lointains et purement mécaniques (v.
W. v. Wartburg, Posizione, p. 31 s.).
21 B. Hamel, Génie de la langue française, p. 27. N. Finck n'hésitait pas à voir une supériorité
de la race germanique dans l'habitude de la syntaxe à emboîtement : « Ich habe vorhin in
der Vorhalle dem ungeduldig klingelnden Bäckerjungen die Küchentür rasch aufgemacht ».
31 A. Vannier, La clarté française.
41 V. Travaux du Cercle linguistique de Prague, vol. I-VIII, Prague, 1929-1939. Les
Grundzüge der Phonologie de Troubetzkoy occupent le VIIe volume de cette collection.
51 Ed. Hermann, Lautgesetz und Analogie, p. 52.
61 Sur cette question, v. F. de Saussure, Cours de linguistique générale3, p. 187 ss. et passim ;
Bally, Synchronie et diachronie ; W. v. Wartburg, Berichte der sächsischen Akademie, 83,
p. 1 ss., et Mélanges Bally, p. 3 ss. ; A.Sechehaye, Les trois linguistiques saussuriennes.
71 Cf. Bally, Intonation et syntaxe.
81 Cf. A. Meillet, Convergence.
91 Le verbe modal contient ce que les logiciens appellent l'assertion partout où il s'agit de
jugement (de fait ou de valeur).
101 Ces métaphores montrent le lien étroit qui relie la volonté à l'assertion. Cette dernière,
comme on l'a reconnu, est au fond un acte de volonté. Cf. Descartes, cité par Erdmann,
Logik3, § 327, p. 380. Sechehaye, Structure, p. 35 ss.
112 L'expression de la nécessité offre un cas spécial de sujet modal indéterminé : la nécessité
est au fond une volonté imposée par les circonstances, les forces naturelles, etc., qui sont pour
ainsi dire personnifiées par la langue ; p. ex. (« Il fait trop chaud,) il faut que je retire mon
veston » = (la chaleur) m'oblige, veut que… Inversement (« Il fait moins chaud,) je peux remettre
mon veston » = (la température) me permet...
121 Nous verrons que ces notions de thème et de propos correspondent souvent à ce qu'on
appelle communément sujet psychologique et prédicat psychologique. Nous évitons d'employer
ces derniers termes, qui prêtent à confusion avec le sujet grammatical et le prédicat grammatical.
131 V. Bally, Modalité, p. 5 ss.
141 Cette implication d'une idée verbale dans un concret est un fait général, qui relève de
l'hypostase (257). Citons les compléments introduits par une préposition désignant une époque,
un moment : arriver après te potage, deviser entre la poire et le fromage, Louis XIV avant et
après la fistule.
151 Nous empruntons ce terme, ainsi que celui de dirème (phrase à deux membres), à M. Sechehaye
(Structure, passim).
161 Sur la distinction (statique) entre conditionnel et futur transposé, voir 260 ; sur l'imparfait
indicatif, v. 136.
171 C'est ce caractère de réalité imaginée qui empêche de voir dans le conditionnel — comme
on le fait généralement — un mode de l'irréel, parce que l'irréel est l'aspect négatif de la réalité
proprement dite. Il est inexact que les phrases « Si j'affirmais que je suis immortel, je mentirais »,
et « Si j'avais affirmé que je suis immortel, j'aurais menti » impliquent nécessairement
que je ne l'affirme pas et ne mens pas, que je ne l'ai pas affirmé et n'ai pas menti. Il faut
plutôt périphraser sous la forme : « Supposons un instant que je l'affirme (ou que j e l'aie affirmé) :
qu'arriverait-il ? Je mentirais (ou j'aurais menti) ». Si dans telle ou telle circonstance l'interprétation
penche vers l'irréel, ce qui est particulièrement fréquent pour le conditionnel passé,
il s'agit de faits occasionnels de parole et non d'une nécessité imposée par la langue, comme c'est
le cas dans les idiomes où un mode irréel s'oppose nettement au potentiel, en grec ancien p. ex.,
où la première des phrases précédentes comporte deux traductions : 1) ei légoimi. . . pseudoimēn
án (potentiel) ; 2) ei élegon… epseudómēn án (irréel). Il est vrai que la seconde phrase n'aurait
qu'une forme : ei eîpon.. . epseusámēn an, le grec confondant ici le potentiel et l'irréel du passé.
182 Il s'agit, bien entendu, du conditionnel proprement dit, et non de ses emplois dérivés,
comme dans « Je voudrais partir », « Seriez-vous malade ? », « La ville aurait capitulé », etc.
191 Sur le sens à attribuer au mot communiquer, v. 31.
201 Ce n'est pas seulement d'un énoncé à l'autre, au sein d'une même langue, que les procédés
de communication peuvent se manifester clairement ou rester dans l'ombre ; dans son ensemble,
un idiome peut différer d'un autre selon qu'il est plus que celui-ci « orienté vers l'entendeur »,
c'est-à-dire que les formes générales et spéciales de renonciation facilitent à l'interlocuteur la
compréhension du discours, l'y intéressent, préparent et soutiennent son attention. Nous verrons
que bien des caractères du français d'aujourd'hui prouvent que cette langue est plus
« socialisée », moins « égocentrique » que l'allemand.
211 On réservera le terme de parataxe à la coordination où le rapport grammatical n'a,
comme ici, aucun exposant. Nous avons préféré le mot coordination comme plus général et
plut usuel.
221 On ne confondra pas cette reprise de la première coordonnée avec le représentant d'un
terme de cette même coordonnée. Comparez les deux mots soulignés dans la phrase suivante :
« Vous avez mal écrit cette lettre ; à cause de cela, vous la recopierez ».
231 Il y a là un cas général qui dépasse le cadre de la coordination : les instruments découvrent
des pauses dans les phrases telles que : La vie : est courte ; Le soleil : éclaire la terre, prononcées
normalement ; mais les sujets n'ont pas conscience de ces interruptions, elles ne comptent pas
en phonologie.
241 Du grec epexégēsis « explication ajoutée »
251 L'accent d'intensité, d'ailleurs très faible en français, semble constituer un troisième
caractère de la phrase segmentée ; mais en réalité il est un simple facteur concomitant, parce
qu'il précède toujours immédiatement la pause, dont il est fonction : différence essentielle avec
l'accent autonome de l'allemand, où le thème est souligné par l'intensité sans la pause : « Diesen
Brief habe ich nie erhalten, etc. »
261 Cette reprise d'un terme nominal résulte probablement, comme me le fait remarquer
M. Magnenat, de la perte de la flexion nominale en français. On constate en effet que l'allemand
pratique beaucoup moins la segmentation qui l'obligerait à cette reprise : comparez
« Diesen Brief habe ich nicht erhalten » avec « Cette lettre, je ne l'ai jamais reçue ».
271 M. Léo Spitzer remarque fort justement (Le Français Moderne, III, p. 196, n° 4) qu'une
phrase traduite du français « Heftige Stösse scheinen ihn umzurühren, diesen Teig » n'est pas
vraiment allemande. — On remarquera à ce propos que le tour allemand du type « Er gewann
es über sich, die Mädchen zu meiden » a été autrefois segmenté en AZ (cf. « Il s'y est enfin
résigné, à renoncer aux femmes ») ; mais actuellement la phrase est liée et la virgule irrationnelle.
281 V. H. Paul, Prinzipien, §§ 96 s., 212 s.
291 Il n'y a donc pas de différence foncière entre un certain chien (lat. quidam) et un chien
quelconque (lat. aliquis), en ce sens que l'une et l'autre expression sont actuelles ; dans la
première, il s'agit d'une détermination réelle qu'on ne précise pas ou ne peut pas préciser ; la
seconde indique une détermination inconnue, mais qui doit être réelle : le sujet parlant sait fort
bien que le chien en question a des caractères parfaitement individuels.
301 La quantification du substantif fait apparaître la profonde différence qui sépare la catégorie
du nombre de celle du genre grammatical ; le nombre relève, comme on le voit, de la
quantification actuelle, et est du domaine de la parole (119) ; le genre caractérise (qualitativement)
le concept virtuel et appartient, par conséquent, à la langue (139).
D'autre part, si le pluriel appartient à la parole et désigne un nombre déterminé ou déterminable
de choses (les arbres, des arbres), le collectif, lui, est une pièce de la langue, et le nombre
des individus qu'il comprend est indéterminable (forêt, chênaie, etc.). C'est seulement par
l'actualisation du collectif que le nombre des objets qu'il désigne devient déterminable (cette
forêt, etc.).
312 Ce terme a été proposé par M. G. Devoto.
321 Sous ce rapport, le verbe semble présenter un contraste violent avec le substantif, qui a
toujours besoin d'être actualisé ; mais cette différence apparaîtra moins tranchée quand nous
aurons traité de la non-autonomie du mot français (466 ss.).
332 Ce type est, en une certaine mesure, comparable aux noms propres « passe-partout » tels
que Paul, Pierre, Louis, etc. (voire certains noms de famille comme Martin, etc.), qui sont prédestinés
à être des noms propres de la langue, mais ne le deviennent que grâce à une situation
donnée permanente, telle que la désignation d'un enfant dans une certaine famille, ou d'une
famille dans un certain groupe social.
341 Dans un article succinct, mais substantiel (Zur Wesensbestimmung des Satzes), MM. Lohmann
et Bröcker ont émis récemment des idées qui présentent des analogies frappantes avec
celles que j'ai exposées dans BSL, 1922, et dans la première édition du présent ouvrage (1932).
Ainsi « der Satz sagt etwas, das Wort nennt etwas » signifie que la phrase est actuelle et appartient
à la parole, et que le mot s'applique sur un concept virtuel ; « der Satz sagt etwas über
etwas » distingue ce que j'appelle le propos et le thème ; ce que ces auteurs appellent « Entscheidung »
et « Geltung des im Satze Genannten » correspond à ce qu'est pour moi la réaction
subjective à une représentation, c'est-à-dire à la modalité, qui distingue la phrase de tout autre
syntagme, et que j'assimilais à l'assertion (« Geltung ») dans la première édition de ce livre.
Sur le principe « die Frage trifft eine Entscheidung », cf. mon analyse détaillée § 35. La distinction
entre Haus « ein Sein » et das Haus « ein Seiendes » correspond à celle que je fais entre
signe virtuel et signe actuel ; la « Supposition » n'est pas autre chose que l'actualisation des concepts
virtuels, et les « Suppositionszeichen » (article, nombre, temps, mode, désinences personnelles)
sont ce que j'appelle des actualisateurs. La différence entre « der Flieger ist abgestürzt »
et « der abgestürzte Flieger » est celle entre actualisation et caractérisation. Enfin, si en indo-européen
le verbe est la « Sageform » par excellence, cela signifie pour moi que le verbe indo-européen
conjugué est toujours actuel (116).
351 Dans ce tour, l'espagnol emploie l'article : « Séria un gran honor para nosotros el publicar
un articulo de Vd. ». L'italien connaît des tours tels que « Il viver io, il veder noi, l'aver voi
preso moglie » = « Le fait que je vis, que nous voyons, que vous vous êtes marié ».
361 Ces deux notions concernent aussi l'actualisation des verbes ; la différence entre temps
absolus et temps relatifs est bien connue. Dans la phrase « Quand j'eus fini de travailler, je sortis »,
le premier temps est déterminé relativement à celui de sortis, et celui-ci est déterminé absolument,
car il est calculé à partir du moment où parle le sujet.
371 La différence entre les deux types oranges d'Espagne et fauteuil Voltaire est celle qui existe
entre transposition fonctionnelle et sémantique (180), et au point de vue de la forme, entre
transposition par rection et par accord (164 ss.)-
381 En français, une particularité phonologique montre que A est distinct de cZ, et que la
copule est étroitement solidaire du propos : c'est d'une part l'impossibilité de lier A sur cZ et,
d'autre part, l'obligation de lier c sur Z. En effet, si on introduit deux liaisons de t final dans
la phrase « Notre enfant t est t intelligent », on constate que la première est inadmissible et la
seconde, au contraire, obligatoire.
392 Nous symbolisons ce caractère de complémentarité par le signe x ; cf. plus haut A x cZ ;
dans nos formules, la simple juxtaposition (AZ, ttʼ) suppose toujours ce caractère, de même
qu'en algèbre elle suppose la multiplication.
401 Il est évident que l'analyse « Halter einer Feder » est absurde, Halter étant pratiquement
inexistant, de même que Hacker dans Holzhacker, Macher dans Uhrmacher, etc. De même en
français, bien que d'une façon moins apparente, le suffixe accolé au terme t d'un composé
(p. ex. -eur dans tailleur de pierres) indique la dérivation de l'ensemble : « celui (-eur) qui
taille des pierres » ; il en est de même pour les désinences des composés verbaux tels que pêch(er)
à la ligne, etc. Ces analyses sont, bien entendu, strictement statiques.
411 « Extérieur » est pris ici dans un sens purement logique et abstrait.
421 Sur le caractère de ligament des actualisateurs, v. 125. Les quantificateurs ont été définis
§ 115, IIa. On a vu tout d'abord que les noms de nombre ne forment pas une classe à
part : il n'y a aucune différence fondamentale entre deux soldats et des soldats ; ensuite, que
les quantificateurs indiquent quelle partie d'un tout est envisagée dans chaque cas : deux
soldats = « deux des soldats ». Quant aux ordinaux (le premier, le second, etc.), ce sont des démonstratifs
d'un genre spécial : dire que Paul est le premier de sa classe, c'est au fond indiquer
la place qu'il y occupe.
431 La transposition, que j'ai caractérisée brièvement dans BSL, v. XXIII (1922), p. 119,
a été étudiée surtout au point de vue sémantique, par M. Sechehaye (Structure, p. 98 ss.).
M. H. Frei, dans Gr. des f., p. 136 ss., donne au mot « transposition » un sens très large qui ne
recouvre pas la notion définie ici. Cf. aussi L. Tesnière, Comment construire une syntaxe, p. 227 s.
441 La finale masculine -end s'appuie sur l'analogie de différend, révérend, et sur l'opposition
avec les féminins offrande, prébende, provende, réprimande, etc. Par une curieuse coïncidence,
M. Henri Frei a proposé, de son côté, dans une communication faite le 7 février 1942 à la Société
genevoise de linguistique, le terme presque identique de transponende (masculin), fait sur le
modèle de dividende, addende, multiplicande. Le lecteur choisira.
451 Cette transposition par que ou l'infinitif n'est possible qu'avec les verbes modaux (45).
Si, au contraire, un verbe régit un infinitif qui n'est pas échangeable avec que, il n'est pas
modal, mais aspectif ou diathétique. Exemple : Je commence à travailler, Je sais nager, etc.
v. Bally, Modalité, p. 11).
461 Ajoutons qu'on peut parler de transposition phonologique lorsqu'un phonème, que la
conscience linguistique considère comme fondamental dans un cas donné, change de classe
en changeant de milieu phonologique ; p. ex. le n dental de lat. in- privatif (inermis, inimicus,
etc.), qui devient m labial dans imperitus, r liquide dans irritus, etc. ; le g sonore de grec légo,
qui devient sourd dans lektós, etc.
472 Sur cette notation du verbe virtuel par son radical, v. § 175.
481 Ce principe est une pomme de discorde entre les théoriciens modernes (v. Frei, CFS 2,
p. 19 ss.)- Plusieurs y voient une influence des grammairiens grecs, qui considéraient déjà le
nominatif comme le cas fondamental, dont les autres sont des accidents (ptôsis, cāsus). Pourtant
ils voyaient juste, et le fait que cette primauté se traduit, dans les langues modernes,
par d'autres procédés qu'en grec et en latin n'atteint pas cette réalité fondamentale. Celle-ci
s'appuie sur le phénomène psychologique déjà signalé (29), que nous ne pouvons concevoir
un procès (phénomène, action, état, qualité) sans une substance qui en est le siège. Ce lieu du
procès, c'est le sujet ; on ne peut concevoir les mouvements, les bruits, les couleurs, la vie,
la mort, la souffrance, etc., etc., sans un sujet. L'indo-européen, le sémitique et bien d'autres
langues reflètent, des origines à nos jours, cette association nécessaire dans un fait grammatical
auquel, que je sache, on n'a pas fait appel dans le débat : l'incorporation du sujet dans le
verbe, autrement dit, l'impossibilité d'employer un verbe sans son sujet (latin amo, amas,
amat, etc., fr. j'aime, tu aimes, il aime, etc.). Or, il est bien évident que les sujets distincts du
verbe (pater amat filium) sont la projection, sous forme d'apposition, du pronom-sujet, et
participent de son caractère de lieu du procès (voir ce qui sera dit § 236 de la genèse de equus
curri-t, le cheval il court, etc.). Il serait inconcevable qu'une association aussi étroite entre
sujet et verbe ne crée pas une différence radicale entre la fonction de sujet et celle de complément
d'objet, de complément circonstanciel, etc.
492 Les adjectifs de relation purs se distinguent, par leur traitement syntaxique, comme
nous l'avons vu § 147, des adjectifs proprement dits. Ils équivalent si bien à un complément
du nom (polaire — du pôle) qu'il leur est impossible de prendre la fonction prédicative ; il
serait absurde de dire « Cette étoile est polaire, Cette boucherie est chevaline », etc. Lorsqu'un
adjectif transposé de substantif peut prendre ce rôle, c'est que la transposition est, au moins
partiellement, sémantique ; ainsi dans « Ces livres sont poussiéreux », l'adjectif implique une
qualification et une appréciation. C'est pour la même raison qu'on parle de livres tout poussiéreux,
horriblement poussiéreux, etc.
501 On doit au fond considérer comme transpositeurs, et par conséquent comme ligaments,
non seulement les catégoriels proprement dits, mais aussi toute modification interne apportée
au transponend par la transposition. Nous effleurons ici ce sujet pour compléter les données
provisoires du § 181.
Il ne s'agit donc pas ici de la forme du transpositeur : on sait qu'il peut être sous-entendu.
Ce qui importe, ce sont les altérations possibles du transponend et le fait que ces altérations
symbolisent la transposition et relient le transponend à son déterminé. Nous ne donnons que
quelques exemples-types, l'étude de cette question débordant le cadre de notre sujet :
1) altération du radical du transponend : elle est nulle dans le passage de long, longue à
longuement ; mais bref devient, dans le même passage brièvement, et cette altération concourt
avec -ment à transposer l'adjectif en adverbe, et, par suite, rattache l'adverbe à un verbe
(p. ex. résumer) au même titre que le catégoriel ;
2) l'altération du radical est totale (par supplétion) dans (statue) équestre (cf. « boucherie
chevaline ») ; cette forme du radical contribue avec le suffixe à transposer cheval et à en faire
un adjectif accordé avec statue ;
3) le transponend-phrase Vous avez tort est légèrement touché par la transposition dans
Je crois que vous avez tort, par le fait qu'il perd son intonation autonome de phrase : cette perte
marque au même titre que la particule que le nouveau caractère de ce tour. La valeur transpositive
et « conjonctionnelle » de cette perte est particulièrement sensible dans l'interrogation
indirecte : Qui est là ? — Je veux savoir qui est là. Dans « Je ne crois pas que vous ayez tort », le
subjonctif ayez marque clairement la transposition exigée par Je ne crois pas ; lui aussi est un
transpositeur-ligament.
512 Le verbe étant toujours actuel, c'est-à-dire conjugué, les signes de l'accord sont exprimés
par la flexion, mais n'ont en soi rien de commun avec l'actualisation, pas plus que dans Cette
robe est courte l'accord de l'adjectif n'est amené par la copule est (cf. robe courte).
521 C'est en apparence seulement qu'un groupe prépositionnel détermine un substantif ou
un adjectif. D'une part, le « complément du nom » implique toujours un ligament verbal,
comme le prouvent les équivalences fonctionnelles : « La maison de mon père » est « la maison
qui appartient à mon père, qui est à mon père » cf. § 162 ; quant à l'adjectif déterminé par un
terme prépositionnel, tantôt il a une valeur verbale : « une montagne blanche de neige » =
« blanchie par la neige », tantôt il a la valeur d'un ligament lexicalisé : « une bouteille pleine de
vin » = « qui a du vin ».
531 Ce chapitre reproduit, avec quelques modifications, un article paru dans le BSL, t. 41,
fasc. 1, pp. 77-88.
542 Sur les critiques qui ont été formulées au sujet de l'arbitraire, voir mon article : L'arbitraire
du signe, et A. Sechehaye, Acta linguistica, v. II, fasc. 3, pp. 165-169.
551 On sait que la phonologie pragoise ne retient que les associations différentielles qui suppriment
l'homonymie, absolue (arbre : marbre, cabre : câpre, etc.). Mais les associations plus
ou moins relâchées dont il est question ici ne sont pas moins réelles que celles des phonologues.
561 Cf. chaotique, dont .l'origine n'est pas onomatopéique.
572 Molière avait déjà fait la même constatation à propos de u : dans Le Bourgeois gentilhomme,
le maître de philosophie dit : « Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue : d'où
vient que si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquer de lui, vous ne sauriez lui dire que u ».
581 Ce rapide aperçu sur la symbolique des sons a pour unique objet de caractériser schématiquement
cet ensemble de faits et de montrer leur rapport avec la motivation. On connaît
la magistrale étude que lui a consacrée M. M. Grammont dans sa Phonétique, p. 377 ss.
592 Sur l'accent d'insistance, v. Grammont, Prononciation, p, 139 ss.
601 Voir Grundzüge, p. 17 ss. Ce programme me semble d'ailleurs sujet à revision. Auparavant
déjà, M. J. de Laziczius avait attiré l'attention sur les aspects affectifs de la phonation (Probleme
der Phonologie dans Ungarische Jahrbücher, XV [1935]).
611 La motivation par le signifiant a un pendant graphique. On sait que les mots écrits, surtout
dans les langues à orthographe capricieuse et arbitraire, comme l'anglais et le français,
prennent pour l'œil la forme d'images globales, de monogrammes ; mais en outre, cette image
visuelle peut être associée tant bien que mal à sa signification, en sorte que le monogramme
devient idéogramme ; ces rapprochements sont le plus souvent puérils, mais la chose n'est
pas négligeable en soi. Certains prétendent que lys est plus beau que lis, parce que l'y figure
la tige de la fleur, qui s'épanouit dans les deux consonnes. D'autres diront qu'il y a une vague
ressemblance entre l'œil et le mot français qui le désigne. Pour M. Paul Claudel, les deux t
de toit sont les deux pignons de la maison, et dans locomotive, il aperçoit une cheminée, des
roues, etc. Les variantes orthographiques peuvent être évocatrices de milieu (v. Bally, Traité,
I, p. 203 ss.) : nopces fait penser à des gauloiseries, roy ressuscite la majesté de l'ancien régime
(« les camelots du roy »). Théoriquement, ces faits présentent cette curiosité que l'idéogramme
est ici un point d'aboutissement, alors que, dans l'histoire de l'écriture, il est un point de
départ.
622 Sur cette notion, v. Bally, FM, juin-juillet 1940, p. 195-197.
631 Je constate après coup que M. W. Porzig a exprimé des idées analogues, mais non identiques,
dans un article des Paul und Braunes Beiträge, 58, p. 80 ss. En revanche, on verra
que mon point de vue est à l'opposé de celui de M. L. Roudet, BSL, 28, p. 77.
641 Il ne faut pas dire que la jument est la femelle de l'étalon : histoire naturelle et langage
sont deux ; pour l'imagination linguistique, certaines espèces ne comportent normalement que
des mâles (serpent, corbeau, etc.), d'autres que des femelles (girafe, hirondelle, oie, etc.).
Il s'ensuit que jars est motivé comme mâle de l'oie, au même titre que jument comme femelle
du cheval.
652 Nous ne sommes donc pas d'accord avec Saussure qui donne sœur comme exemple de
signe arbitraire ; il l'est par le signifiant seulement.
661 Au point de vue purement logique, on peut ramener la synecdoque, la métonymie et la
métaphore respectivement aux trois formules suivantes : pars pro toto, pars pro parte et totum
pro toto. Ainsi la voile est une partie du tout qu'est le bateau ; les habitants de la ville et les
maisons sont deux parties d'un même tout ; enfin Marie et dinde sont deux êtres assimilés
l'un à l'autre dans leur totalité grâce à un caractère commun. Ce n'est pas le lieu de pousser
cette classification dans le détail. Citons seulement le cas du symbole, intéressant parce qu'il
cadre avec la définition saussurienne du signe : « monter sur le trône » = « devenir roi » est une
métonymie, parce que la royauté et le symbole qui la représente sont dans le même rapport
qu'un signifié et son signifiant, c'est-à-dire deux parties d'un tout que Saussure appellerait
un signe. Notons toutefois que Saussure a innové en définissant le signe par l'union du signifié
et du signifiant, alors que, dans l'usage, signe s'applique au signifiant seulement. En effet, le
propre de la métonymie est de supposer une représentation complexe qui n'a pas de désignation
propre ; on dit « un verre de vin » pour désigner le contenu du verre, parce qu'il n'y a pas de
mot désignant le contenant et le contenu réunis, pas plus qu'il n'y a pas de mot pour signifier
« la ville et ses habitants » ; ainsi la métonymie supplée la synecdoque par nécessité.
671 Les figures grammaticales ne font pas exception : l'emploi figuré d'un temps de verbe
p. ex. (présent historique, présent pour futur, imparfait pour passé défini, etc.) n'est fixé que
par un contexte qui le fait apparaître. Ainsi « le lendemain, il mourait » ne se comprend pas en
dehors du récit (« Nous le quittâmes en bonne santé, et le lendemain il mourait »).
681 Du grec dus-, désignant un état anormal, et taxis, « alignement, ordre ». L'adjectif correspondant
est dystactique.
691 Par la manière dont il forme les mots, l'esperanto donne souvent l'impression d'une langue
agglutinante », c'est-à-dire à sous-unités libres et pleinement significatives ; soit senelirejojn :
-n marque l'accusatif, j le pluriel, o classe le mot dans les substantifs, ej est un suffixe de noms
de lieux, ir veut dire « aller », el « hors de », sen a un sens privatif ; donc « endroits d'où l'on ne
peut sortir », c'est-à-dire « impasses ».
701 Les signes de l'écriture connaissent aussi le cumul : p. ex. la majuscule d'un nom propre
en tête de phrase et le trait d'union à l'intérieur d'un composé en fin de ligne (timbre-poste).
711 Voir E. Schwyzer, Hypercharakterisierung.
721 Sur la perte de la valeur modale du dictum dans « J'affirme que je suis innocent », voir
plus haut § 51.
731 Il faut excepter, naturellement, les cas où un dérivé passe par hypostase (257) d'une classe
de mots dans une autre ; ainsi résolution, nom d'action, pourvu d'un suffixe de nom d'action,
arrive à désigner une qualité, comme s'il était dérivé d'un adjectif ; il rappelle alors, non
résoudre, mais résolu (= « énergique »). Ces échanges, particulièrement fréquents en français,
ne contribuent pas à mettre de l'ordre dans la dérivation.
742 Il est vrai que le français est en train de créer un nouveau jeu d'apophonies dans les mots
dont la syllabe initiale renferme un -e- caduc ; on dit : il chemine, mais : nous ch'minons.
751 Dans le type de phrase « Cet homme, que Dieu punisse, est un traître », d'un emploi
d'ailleurs très limité, le subjonctif est en réalité un impératif (de souhait !) et la soi-disant subordonnée
est une phrase coordonnée introduite en incise (70, 73) ; cf. le tour semblable « Cet
homme -que Dieu le punisse ! -est un traître ». Or, « Que Dieu le punisse ! » correspond exactement
à une 2e personne « O Dieu ! Punis-le ! » ; l'on notera que le grec ancien, dans ces mêmes
phrases relatives, employait l'impératif de la 3e personne : « Hoûtos ho anêr, hôn ho theòs
kolazétō, prodotēs esti ». Cf. Kühner-Gerth, Griechische Grammatik, Syntax, § 397, 3, A. 2,
p. 238 s. L'interprétation de M. C. de Boer (Mélanges Bally, p. 104) ne me convainc pas.
761 L'instrumental pour le nominatif est un autre cas d'équivalence fonctionnelle.
771 Lorsque la préposition introduisant un complément d'objet est lexicalisée, on constate
qu'elle fait double emploi avec le verbe (174A, 234) : monter sur une chaise, pénétrer dans une
caverne, etc.
782 On peut citer à l'appui de cette hypothèse le fait que dans plusieurs langues romanes le
complément « direct » est souvent introduit par une préposition : cf. esp. « busco a mi criado » =
« je cherche mon domestique » (opposé à « busco un criado » = « je cherche un domestique », et
« busco mi carta » = « je cherche ma lettre ») ; le roumain se sert fréquemment dans ce cas de
la préposition pe : « am întălnit pe fratele tĕŭ » = « j'ai rencontré ton frère » ; le gascon a des
tours équivalant à un français incorrect « je l'aime, à cette femme ».
791 Du grec hupóstasis qui, chez Aristote, désigne l'existence indépendante, qui subsiste par
soi-même.
801 Voir M. Lips, Le style indirect libre.
811 Sur le rôle des associations implicites dans l'expressivité, voir LV3, p. 125 et passim.
821 On pourrait croire que la phrase « Je ne sors pas parce qu'il fait trop chaud » comporte
aussi deux interprétations : « La trop grande chaleur n'est pas la cause de ma sortie » et « La
trop grande chaleur me décide à ne pas sortir » ; cependant, dans le premier cas, la phrase est
liée, tandis que dans le second, il s'agit de deux coordonnées séparées par une pause, la seconde
étant l'épexégèse de la première (75).
831 Voltaire écrit encore : « N'ayant jamais pu réussir dans le monde, il (Arimaze) se vengeait
par en médire ». (Zadig).
841 Cette distinction entre expression grammaticale et lexicale des notions abstraites était
déjà connue des scolastiques du moyen âge, qui donnaient à l'expression grammaticale le nom
de actus exercitus (ex. : non venit) et à l'expression lexicale celui de actus signatus (ex. : nego
eum venire). Voir Lohmann, Sprachkunde, 1942, Nr. 1, p. 2.
On peut ramener au même principe la distinction entre modalité implicite (ex. : sortez !) et
modalité explicite (ex. : Je veux que vous sortiez). Voir Bally, CFS, II, p. 3 ss.
851 En latin, bibāmus « buvons » supplée l'impératif, parce qu'il n'y a pas de forme concurrente ;
en revanche, bibas ! est un vrai subjonctif, parce qu'il s'oppose à bibe ! « bois ». Or, c'est cette
opposition que le français a abolie puisqu'il a perdu la forme Que tu boives ! (cf. 288).
861 Certains linguistes étrangers, induits en erreur par le « Nebenton » des langues germaniques,
croient percevoir un accent accessoire à l'intérieur du groupe rythmique en français. Ainsi
M. Gamillscheg (Deutsche Liter. Zeitung, 1934, col. 261) croit que dans « mon chapeau » mon
n'est pas atone, mais « nebentonig » ; c'est une illusion (cf. P. Fouché, L'état actuel du phonétisme
français, p. 51). De même, la distinction que M. G. établit entre deux emplois des
mots « du haut du toit » et « du haut du toit » (col. 263) est imaginaire.
En revanche, cet auteur ne veut pas admettre que dans « Prends-le » le pronom soit accentué !
871 On sait quel rôle prépondérant joue l'affectivité dans cette anticipation de la partie de
l'énoncé qui occupe la première place dans l'esprit du parleur. Il convient de rappeler (202)
qu'en français cette anticipation émotionnelle est marquée symboliquement par le fait que
l'accent du mot mis en relief se double d'un accent affectif qui frappe la première consonne
du mot et, par suite, détache fortement la voyelle qui suit : « Mmagnifique, ce tableau ! » Cette
accentuation, issue originairement de la mise en relief du mot, finit par demeurer attachée à
celui-ci en n'importe quelle position, pourvu qu'il ait une nuance affective, p. ex. : « Ce tableau
est mmagnifique ! »
881 Nous verrons (381) que l'analogie des syntagmes étroits en tʼt, plus résistants que les autres,
a entraîné une permutation inverse des valeurs (ttʼ > t't) ; exemples : sous-officier, arrière-cour.
891 Voir A. Blinkenberg, L'ordre des mots en français moderne.
901 La construction archaïque « Sera passible d'une amende quiconque… » appartient à la
langue administrative ; « Entre le roi » n'est toléré que dans le jargon du théâtre ; « Reste la
question des impôts » est une syntaxe limitée à quelques verbes ; tout cela, d'ailleurs, étranger
à la langue parlée.
L'attribut était en tête dans le tour ancien « Ce suis-je, ce sommes-nous, etc. », qui est remplacé
aujourd'hui par « C'est moi, c'est nous, etc. ».
911 Sur la persistance de l'inversion dans la langue écrite, voir E. Lerch, Mélanges Bally,
p. 347 ss.
922 On sait que oui (oïl) remonte non à hoc illud, mais à hoc illi, celui-ci remplaçant hoc ille,
par analogie avec qui.
931 Je constate après coup que H. Hirt a donné une explication sensiblement analogue du
phénomène dans son Indogermanische Grammatik, V, p. 364.
942 J. Orr, FM, IV (1936), p. 123 ss.
951 Le type j'eusse désiré n'est plus senti comme subjonctif : c'est un conditionnel que le
type j'aurais désiré supplante d'ailleurs totalement dans le parler usuel.
961 Kuhn's Zeitschr. vol. 56, p. 276 ss.
972 Zur griechischen Wortstellung (Göteborg, 1932).
983 Perrochat, Revue des ét. lat., IV, p. 50 ss.
994 Voir Foulet, Syntaxe, p. 316 s. ; Dauzat, Histoire de la l. fr., § 516.
1001 Sans compter le suffixe populaire -o extrait de mots savants amputés de leur finale
(photo, métro, moto, dynamo, radio), et appliqué analogiquement à d'autres mots mutilés
(apéro pour apéritif, proprio pour propriétaire, mécano pour mécanicien, etc.).
1011 A propos de patraster, emprunt au grec patrastḗr (cf. elaiastḗr), voir Bréal, Essai de sémantique,
p. 42.
1021 Cette opposition a déjà été signalée par F. de Saussure, CLG3, p. 256.
1031 Dans la prononciation soignée, le z de liaison prend une fonction autonome. Ainsi on dit
un ver(s) harmonieux, mais des vers z harmonieux, un cour(s) élémentaire, mais des cours z él. ;
de même un éta(t) important, des z états z importants. Autrement dit, z est alors un infixe qui
n'est attaché à aucun des deux mots et qui caractérise le pluriel du groupe entier. Cette autonomie
du z du pluriel semble prouvée par les lapsus du langage populaire, qui va jusqu'à
dire vingt z hommes ; cf. entre quatre z yeux, qui est entré dans le langage correct. Le cas isolé
de zyeuter (regarder) est un cas banal de fausse coupe (des-zyeux).
1042 Œufs (eu) et bœufs (beu) sont des épaves ; d'ailleurs, le peuple dit cinq œf, des bœf.
1051 Ne pas dire « que nous marchions, que vous marchiez » (341).
1061 Je vois une certaine ambiguïté dans le rapport qui unit deux adjectifs allemands comme
« Historische französische Syntax, Vergleichende slawische Grammatik ».
1071 On notera que cet accent oxyton n'est aboli en français ni par l'accent affectif, ni par
l'accent antithétique qui peuvent s'y ajouter. L'accent affectif, très intense, frappe généralement
la première voyelle précédée de consonne et allonge celle-ci (« fformidable explosion,
spectacle effroyable ») ; cf. § 202 ; l'accent antithétique, signalé par M. Marouzeau, est plus
discret : il frappe la première voyelle, et si elle est initiale, la fait précéder d'une légère occlusion
glottale (cf. « se soumettre ou se démettre ; médecine ʼinterne et médecine ʼexterne »). Il
s'agit, comme on voit, des oppositions entre notions. Voir Ch. Bruneau, Manuel de phon.,
2e éd., p. 125 s. M. Fouché (FM, 1934, I, p. 61 ss.) n'est pas d'accord avec M.Marouzeau,
qui a répondu (Ibid., 1934, II, p. 123).
1081 Des monosyllabes brefs tels que ja, nu, da, ne sont pas des mots proprement dits.
1091 On appelle souvent les groupes w, ẅ, y + voyelle « diphtongues ascendantes » ; ce terme
est impropre : une diphtongue est formée de deux sons qui font effet de voyelles ; or w, ẅ et y
sont des consonnes.
1102 Ce n'est là qu'un cas particulier d'une tendance générale : l'intervention de la volonté
inconsciente dans la syllabation. Elle se manifeste aussi dans la manière de couper les syllabes.
On sait par F. de Saussure et M. Grammont (Tr. de phon., p. 97 ss.) que l'initiale de syllabe
est normalement le phonème le plus fermé de la chaîne (a-bla, et non ab-la, etc.) ; c'est en effet
lui qui, par sa fermeture, est prédestiné à déclencher la tension musculaire qui ouvre obligatoirement
toute syllabe. Mais l'allemand peut appliquer cette tension à des sons de n'importe
quelle aperture (Ab-laut, Baum-stamm, Wert-urteil, etc.. . .). Qu'il y ait là une action de la
volonté, cela ressort du rôle morphologique que l'allemand fait jouer à ces variations (548).
Il semble que ce régime soit propre aux langues à forte intensité, et c'est sans doute pour cela
que F. de Saussure, qui a basé sa remarquable théorie de la syllabation (CLG3, p. 77) sur
l'indo-européen, le sanscrit et le grec (toutes langues à accent de hauteur), a cru que l'aperture
relative était le seul facteur à considérer, alors qu'en réalité, dans ces langues, il y a simplement
coïncidence entre l'aperture minimale et la tension musculaire initiale de syllabe (qui
ne manque jamais, si faible soit-elle). En définitive, c'est non pas l'aperture, mais le point de
tension qui est le seul critère nécessaire et suffisant de la frontière de syllabe.
1111 La conservation de e après une seule consonne dans des cas tels que atelier, nous attelions,
vous attelleriez, nous roulerions, etc, est due à une raison morphologique ; la chute de e entraînerait
la vocalisation de y dans les groupes ly, ry (cf. guerrier avec ry et ouvrier avec ri). Or,
le suffixe -ier (-yé) et les désinences -ions, -iez (-yõ, -yé) résistent, grâce à la fréquence de leur
emploi, à l'alternance y/i ; même là où i est régulier, parce que la chute de e n'est pas en cause
(ouvrier, nous voudrions), le parler populaire introduit y : ouveryé, vouderyõ.
1121 La chute de l'e caduc est due à l'action conjuguée de deux facteurs : la tension initiale
de syllabe, particulièrement faible en français après voyelle, et le peu de durée de ə, qui entrave
l'explosion consécutive à la tension de l'ouvrante. L'explosion des occlusives s'abaisse
à un degré incompatible avec l'impression de syllabe, et la consonne devient fermante de la
syllabe précédente : la pətit' → la petit' ; l'impression est la même que dans le type apətitud' (447).
Quant aux continues, elles perdent la totalité de leur explosion : « ficeler » est prononcé fislé,
« bonnetier » bonʼtyé, « serrement » sermã, etc. En revanche, cette même consonne, appuyée sur
une fermante précédente, comme t dans portemonnaie, m dans fermeté, l dans arlequin, etc., a
une tension accrue dont l'explosion dans le ə fait impression de syllabe, et le ə est maintenu.
En fin de mot, on l'a vu (448), l'explosion des occlusives est, en toute position, réduite (phonologiquement)
à zéro, et celle des continues remplacée par un léger allongement ; de là l'impossibilité
de créer une syllabe, même après consonne : on prononce donc non seulement bét'fauve,
mais pertʼsèche, portʼmoi, torsʼnu, fermʼla porte, etc.
1131 Voir Meillet, Le caractère concret du mot (avec discussion) et Naert, Caractère.
1141 Noter expressément que « agglutiner » a ici la même acception que dans les « langues
agglutinantes » (223).
1151 Voir Bally, Au printemps.
1161 Sur les deux définitions de l'apposition, voir 74.
1171 On remarquera que, dans le tour correspondant du latin (magistrum quaero) qui docēre
sciat, qui a aussi le sens de qualis.
1181 C'est en cela que le vocabulaire français diffère profondément de celui de l'italien, où
il n'y a pas de fossé entre mots hérités et mots empruntés. Dans cette langue, en effet, l'évolution
phonétique a relativement peu altéré les formes latines (cf. cieco et le latinisme cecità),
et d'autre part l'italien plie les emprunts eux-mêmes à des modifications qui les rapprochent
des mots romans, si bien que la distinction est parfois impossible (cf. inno « hymne »). Sur ces
faits, voir W. v. Wartburg, Posizione, p. 41 s.
1191 L'hiatus devant h « aspiré » n'est pas une exception : un(e) — hache, cett(e) — hache. L'h
en question se comportant comme une consonne zéro (256), il est naturel qu'il ouvre la syllabe
comme p dans un(e) — porte, cett(e) — porte.
1201 s est parfois maintenu devant sonore sous l'influence de l'écriture, dans des mots savants
ou rares : on prononce tantôt isba, tantôt izba.
1211 Les exceptions sont : pour r ; genre, denrée, et le nom propre Henri ; pour n : ennui, ennuyer ;
pour l ; branle et sa famille ; pour v : chanvre, janvier, envie et sa famille ; pour z ; onze,
quinze, bronze, et le préfixal insurrection. Dans transiger, transaction, transit (cf. transi de froid),
-z- appartient au préfixe.
Dans les passés simples tînmes, vînmes, tinrent, vinrent, impossibles dans la langue parlée,
la voyelle nasale sépare le radical de la désinence.
1221 On sait que s- initial est devenu chuintant devant consonne ; la prononciation hanovrienne
de st-, sp-, est due, comme l'a montré M. Ed. Hermann (Lautgesetz, p. 19) à l'influence
de l'orthographe, puisque à côté de Stein, Spiel, etc. (avec s), on prononce schreiben, schliessen,
schwimmen (avec ch).
1231 LV, p. 227 ss. ; Crise, p. 130 ss.
1241 Voir Albalat, Formation du style, pp. 191-276.
1252 L'antithèse utilise un procédé phonologique que M. Marouzeau a découvert et fort bien
caractérisé : l'accent antithétique, dont il a été question au § 204.
1261 Voir Bally, Impresionismo, § 15, p.29ss.
1272 Cf. Clédat, Rev. phil.fr., 1890, p. 1 ss. et Strohmeyer, Stil2, p. 24 ss.
1281 On ne confondra pas ces cas avec celui des faux impersonnels qu'on trouve dans des
phrases du type « Il est certain que cet accusé est innocent », « Il est désirable qu'il soit acquitté »
(109) ; il s'agit là de tout autre chose, d'un procédé permettant à la partie modale de la phrase
de jouer le rôle de thème vis-à-vis du dictum introduit par que (cf. le renversement « Que
cet accusé soit innocent, cela est certain », où le dictum a la fonction du thème, comme l'exige
la syntaxe d'une phrase segmentée AZ ; voir § 79).
1291 On trouvera de nombreux exemples de cette tendance dans un article de Mme M. Frauendienst
(Neuphilol. Monatsschrift, janv. 1935), qui d'ailleurs les interprète autrement que nous.
1301 On sait que la perte du passé simple est due à des causes avant tout extérieures : complexité
des désinences, variations capricieuses du radical (340), et que le passé composé a triomphé
surtout grâce à son caractère analytique et régulier. Il n'en est pas moins vrai que cette victoire
a renforcé la tendance statique du français. Un récit en langue parlée : « Je me suis levé à cinq
heures, j'ai pris le train de 6 heures 50 et suis arrivé à Genève dans l'après-midi » présente les
événements comme une série de faits accomplis ; de là, bien souvent, le manque de vie qui caractérise
la narration en langage courant.
1311 D'autres procédés « périphériques » ne rentrent dans aucune catégorie : j'ai essayé de dégager
la valeur terminative de la particule en (J'en suis venu à douter de tout) dans les Mélanges
Vendryes, p. 1 ss., et la valeur résultative de tout (des habits tout faits) : Mélanges Boyer,
p. 22 ss.
1321 Goblot, Logique, § 64, p. 100.
1332 Cette définition nous autorise à parler aussi de la clarté du système phonologique français
par opposition à celui de l'allemand. En effet, les sons français sont nettement opposés les
uns aux autres : l'opposition sourde : sonore (p : b, t : d, etc.) est parfaitement systématique,
tandis qu'en allemand la sonore devient sourde en fin de mot (Rad, prononcé rat), et, en initiale
de syllabe, s'assourdit au point de se confondre presque avec une sourde (311) : on voit
à ce trait que la Lautverschiebung est toujours à l'œuvre dans cette langue. Les sons, en français,
n'empiètent pas non plus l'un sur l'autre, comme c'est le cas en allemand p. ex. pour les
voyelles nasales, elles-mêmes suivies de consonne nasale (comparez Onkel : oncle, Anker :
ancre), etc.
1341 Consulter Hytier, Le plaisir poétique, surtout p. 15 ss., 96, 100, 107, 118, 134 s.
1351 Voir Impresionismo et A. Alonso et R. Lida, Concepto, p. 202 ss.
1362 Dans la syntaxe du verbe, je citerai cet emploi de l'imparfait : « Ce soir-là, notre ami nous
quitta plein de santé et d'entrain ; le lendemain matin, il mourait ». Voilà qui est proprement
impressionniste, mais en même temps, nous sommes en face du fait accompli.
1373 Nominalsatz, p. 12.
1381 Energetik ; M. Jespersen a exposé le détail de cette vue dans Language et dans Efficiency ;
mais croire que c'est en cela seulement que consiste le progrès en matière de langage me paraît
être une illusion (voir plus bas).
1391 Voir L V3, et compte-rendu de Efficiency, CFS I, p. 95 ss.
1401 On se gardera de confondre ce cas avec celui où l'intelligence d'un texte est obscurcie
par la graphie. Ainsi en français, l'orthographe ne distingue pas les deux prononciations et les
deux valeurs grammaticales de tous : « Vous connaissez tous les effets de cette maladie » ; elle
induit à des lapsus dangereux : « les fils de la Vierge ». Le principal défaut de la langue écrite
est de ne pas noter les intonations à valeur syntaxique ; de là des ambiguïtés comme celle-ci :
« Je travaillerai tant que le succès me sera assuré ».
1411 On peut ajouter aux exemples de Thibaudet la licence qui permet de faire rimer un mot
accentué avec un mot atone, comme p. ex. chez Verlaine
Et dans la splendeur triste d'une lune
Se levant blafarde et solennelle une
Nuit mélancolique, etc.
Dans Ebauche d'un serpent (strophe 19), M. Paul Valéry fait rimer « Dore-lui les (plus doux
des dits que tu connaisses) » avec « mille silences ciselés ».