 Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
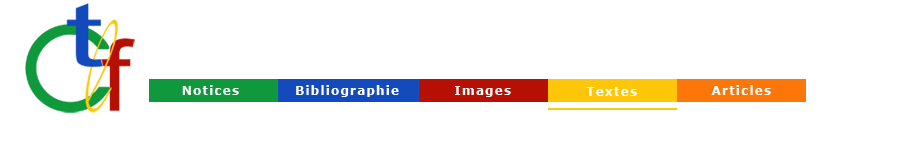
Comment se fait un système grammatical 1
Toutes les langues ont un système grammatical. L'universalité du fait
montre que toutes ont dû, dans leur construction, résoudre un certain et
même problème : le problème grammatical.
La question, dès lors, est d'identifier, sous sa condition la plus générale,
ce problème : de savoir quand et comment il se pose et quelles en
sont les voies de solution.
Le problème grammatical se pose toutes les fois qu'un propos limité
entre comme unité composante dans le système d'un propos plus vaste.
Il y a problème grammatical quand une phrase entre comme unité composante
dans le système d'une phrase plus étendue ; il en résulte, on le sait,
la phrase complexe, avec ses morphèmes translatifs et conjonctifs. Et il
y a de même problème grammatical — et, cette fois, problème grammatical
très varié — quand le mot entre comme unité composante dans la phrase.
Dans l'un et l'autre cas on voit le composant faire appel, afin d'acquérir
la convenance voulue au composé plus large dont il devient une partie,
à des déterminants qui ne lui appartiennent pas en propre, peuvent s'appliquer
à d'autres composants, valent pour toute une classe, toute une espèce,
et accusent par là une généralité relative d'autant plus grande que le
champ de leur application possible est plus vaste, moins délimité.
Des deux cas, le plus riche d'enseignement, et, pour cette raison, le
seul sur lequel s'arrêtera aujourd'hui notre attention, est celui du mot
qui entre en phrase.
Alors que le mot saisi en lui-même (en tant que sémantème, avant
toute grammaticalisation) n'offre au regard que sa signification originale,
n'appartenant qu'à lui, il faut au mot qui entre en phrase se produire
sous des conditions bien connues (de fonction, de genre, de nombre,
d'aspect, de mode, de temps, de personne, etc.) qui, transportables à une
multitude de mots différents, ne sont pas l'exclusive propriété du mot
considéré et constituent de ce chef, à son endroit, des conditions généralisantes,
108c'est-à-dire des conditions qui engagent le mot dans un mouvement
de généralisation.
La grammaticalisation du mot prend ainsi au fond de la pensée, tout
au fond, l'allure d'un mouvement commencé dans le plan du particulier
et progressant en direction et dans le plan du général. Ce mouvement en
est le schème profond.
Figurativement :
image particulier | général
Fig. 1
Schéma du mouvement de grammaticalisation du mot.
(x = la racine ; y = la partie du discours ; B = la phrase)
Un tel mouvement, si prompt soit-il, n'en demande pas moins, ainsi
que tout mouvement, fût-il de pensée, du « temps », si peu que ce soit, pour
s'accomplir. Et la pensée qui, au fond d'elle-même — dans sa représentation
intérieure de ses propres actes — voit ce mouvement s'opérer dans
le temps, le pénètre, l'analyse en le référant à l'écoulement du temps opératif
qu'il exige pour s'accomplir.
A cet effet, conformément à la méthode qu'elle ne manque jamais
d'employer en pareil cas, — j'en ai donné un exemple remarquable dans
mon livre Temps et Verbe, où l'on voit la formation de l'image-temps se
référer, d'instant en instant, au temps concret, si bref soit-il, qu'exige cette
formation — la pensée résout, découpe le procès de grammaticalisation du
mot en une série d'instants consécutifs, aussi nombreux que l'on voudra,
et confrontant ces instants, dans la vue d'en marquer la relative originalité,
elle les ramène à trois cas généraux : trois moments caractéristiques.
Ces trois moments, identifiés par la pensée dans le procès de la grammaticalisation
du mot, sont les suivants (v. figure 1) :
1. Le moment α (désigné ainsi parce qu'il est la racine des autres).
Il se situe exactement entre le particulier et le général. Ce moment est,
pourrait-on dire, le moment-clef de la grammaticalisation du mot.
Sitôt que ce moment s'est institué dans l'esprit, de manière complète,
le particulier et le général accusent leur relativité réciproque, selon un
rapport qui fait le premier intégré et le second intégré, et ce rapport qui
exprime une loi de l'esprit (le général est fait pour envelopper le particulier)
se transporte aux autres moments de la grammaticalisation du
mot : subséquent (y) et antécédent (x).
2. Le moment y : position prise par la pensée à l'intérieur du général.
Ce n'est plus alors, comme précédemment (en α), le général qui intègre
le particulier, mais le général qui se montre intégrant à l'égard de lui-même.
3. Le moment x : position suspensive, prise par la pensée à l'intérieur
109du particulier, lequel, en conséquence, se divise à son tour en particulier
intégrant et particulier intégré.
Ces trois moments caractéristiques : α, y, x, constituent chacun une
vue par profil, une coupe du mouvement de grammaticalisation du mot.
Ces profils, ces trois coupes α, y, x, sont universellement les seuils
déterminants de la morphologie grammaticale. Dès l'instant qu'une langue
a fait choix, pour la construction de sa grammaire, de l'un de ces seuils,
le type structural de cette langue est, dans ses traits essentiels, fixé.
Ces vues initiales déterminées — par les voies d'une analyse fondée
sur l'alliance en toute proportion utile de l'observation fine du concret et
de la réflexion abstraite profonde — il convient d'en vérifier l'exactitude
en les rapportant aux faits visibles qui leur correspondent dans la réalité
du langage.
Je commencerai cet examen par le seuil y qui est (v. fig. 1) le plus
avancé en direction du général, et celui auquel les langues indo-européennes
ont conféré, à date historique, la prééminence.
Ce seuil y, de bonne heure prééminent dans les langues indo-européennes,
est, comme le montre le schéma porté au tableau (fig. 1), un seuil
intragénéral, intérieur au général ; c'est-à-dire un seuil qui oppose le général
à lui-même, le présente intégré, puis intégrant.
Le seuil y est le seuil de fermeture de n'importe quel sémantème
d'une langue indo-européenne. Soit, par exemple, le mot latin : dominum.
On le voit développer en lui : de A en α, l'idée particulière qui en fonde
la signification : celle de maître (de la maison) ; de α en y, des indications
imparticulières, et pour autant généralisantes (elles portent le mot à sa
généralisation finale : la partie du discours), de cas, de genre, de nombre,
dont l'ensemble constitue la flexion ; et, enfin, en y même, seuil de fermeture
du mot, envelopper le tout ainsi formé d'une généralisation intégrante,
transcendante : la partie du discours appelée nom.
Soit encore le mot français : travaillera. On le voit, pareillement, développer
de A en α, l'idée particulière, en lui fondamentale, de travail ; de
α en y, des indications imparticulières, et pour autant généralisantes, de
personne, de mode, de temps, formant ensemble sa flexion ; et enfin, en y,
seuil de fermeture du mot, envelopper le tout ainsi constitué d'une généralisation
intégrante : la partie du discours dénommée verbe.
Dans le mot des langues indo-européennes suffisamment évoluées 2,
le seuil y, qui ferme le mot, est seul agissant. Les seuils antécédents, x et α,
sont franchis sans que la pensée s'y arrête, et le passage qu'elle en fait,
obligatoirement, n'entraîne aucune suspension, si brève soit-elle, de la
progression génétique du mot, qui garde, de bout en bout, sa continuité,
évite tout hiatus entre racine, radical et flexion.110
Figurativement :
image dominum | travaillera | idée particulière fondamentale : maître | indications imparticulières généralisantes (intégrées) : accusatif, masculin, singulier. | généralisation intégrante : le nom | idée particulière fondamentale : travail. | 3e personne du singulier, mode indicatif, futur. | généralisation intégrante : le verbe
Fig. 2
A part le fait qu'il doit, par définition, demeurer intragénéral, le
seuil y, seuil de fermeture du mot et de survenance de la partie du discours,
est dans le champ qui lui est assigné (de α en B) un seuil mobile
qui peut, selon qu'il est utile, se rapprocher ou s'éloigner du seuil antécédent
α.
L'écart entre les deux seuils α et y forme, dans le mot, l'espace mis
par la langue à la disposition de la morphologie suffixale et flexionnelle.
Il suit de là que si cet écart décroît, par suite d'une survenance de plus
en plus précoce du seuil y dans le mouvement de grammaticalisation du
mot, les possibilités s'amplifient à proportion.
Les langues indo-européennes ont tiré des partis fort divers de cette
mobilité du seuil y dans son plan.
Quand il s'est agi du nom, elles se sont accordées, dans l'ensemble,
pour rapprocher le seuil y du seuil α, et il en est résulté une déplétion
progressive de la flexion, qui a tendu constamment, dès la date historique
la plus ancienne, à se vider de son contenu d'indications grammaticales.
Cette déplétion de la flexion nominale est très marquée dans une
langue comme le français qui a éliminé au XIVe siècle les derniers vestiges
de déclinaison du nom. Et elle avoisine son maximum dans une langue
comme l'anglais où le nom ne prend pas la marque du genre.
Quand il s'est agi du verbe, chargé par définition de l'expression du
temps, les langues indo-européennes ont procédé de manière fort diverse.
Une langue comme le français, qu'on peut grosso modo considérer représentative
de la tendance commune des langues romanes, a maintenu et
même, dans certains cas, amplifié la flexion verbale. A l'inverse, une
langue comme l'anglais a porté la réduction de la flexion verbale très loin.
Le verbe français intériorise une large expression morphologique du
temps. Le verbe anglais n'intériorise que la seule expression du temps
mémoriel : le temps dont la mémoire peut garder le souvenir. C'est
pourquoi l'anglais dès l'instant qu'il lui faut exprimer le temps sous sa
condition non mémorielle, — qu'il s'agisse du futur opposable au passé,
111ou bien du temps purement virtuel conçu en dehors de cette opposition, —
se voit dans l'obligation de recourir à des mots grammaticaux. Les auxiliaires
shall et will lui permettent d'exprimer le futur. Le petit mot to,
de construire l'infinitif, qui est l'expression du temps possible, non survenu
effectivement, non mémoriel par conséquent.
L'allemand, de même, a recours à un auxiliaire, werden, pour exprimer
le futur, non mémoriel, et réserve la flexion verbale à l'expression du
passé et du présent, l'un et l'autre mémoriels, le dernier partiellement.
Contrairement à ce qui a lieu en anglais, la compétence de la flexion verbale
s'étend en allemand au mode infinitif. La raison en est que l'allemand,
dont le système modal est plus développé que celui de l'anglais, voit dans
l'infinitif non pas seulement l'expression du possible, senti comme un
futur d'une virtualité supérieure, mais de plus et surtout la forme de
langue, tenue en mémoire présente, à partir de laquelle le futur s'édifie.
Le possible exprimé par l'infinitif est considéré en allemand l'antécédent
mental du futur ; alors qu'en anglais il apparaît plutôt en être une conception
subséquente généralisée. D'une langue à l'autre, ce qui arrive souvent,
la chronologie des notions — chronologie abstraite qui joue dans les
langues un rôle important — s'est inversée.
L'existence dans la langue de mots grammaticaux distincts témoigne,
dans tous les cas, de l'insuffisance de la morphologie grammaticale intériorisée
dans le mot. Et cette insuffisance porte elle-même témoignage de
la survenance hâtive du seuil y, producteur de la partie du discours. Le
mot devient partie du discours avant d'avoir développé en lui toute la
morphologie utile.
Dans le cas, quasi hypothétique, d'une langue où le mot ne se fermerait
qu'après avoir développé en lui toute la morphologie utile, c'est-à-dire
d'une langue dont le seuil de fermeture du mot coïnciderait avec B,
ultime point d'aboutissement du mouvement de grammaticalisation du
mot (pratiquement la phrase), il n'existerait pas dans une telle langue de
mots grammaticaux distincts.
Le mot, intérieurement chargé de toute la morphologie pensable entre
α et B, serait par cela même un mot se déterminant dans l'esprit au
voisinage immédiat de la phrase, en continuité avec elle, et, dès lors, inapte
à s'en distinguer catégoriquement. Cet état de mot existe à un certain
degré dans les langues américaines, dites incorporantes, polysynthétiques,
holophrastiques, où l'on voit un mot long porter l'expression d'une phrase
entière.
L'état de mot en question est chose que les langues qui nous sont
familières, lesquelles tendent toutes à marquer fortement l'opposition du
mot et de la phrase, ont évité systématiquement. Et en vue de l'éviter,
elles ont pris soin de ne pas trop tarder à fermer le mot au moyen de la
partie du discours ; ceci afin qu'il y ait toujours entre la phrase représentée
(fig. 1) par le point B et le seuil y de fermeture du mot, une distance
suffisante à la nette discrimination de ce dernier. Produire cette nette
discrimination dans les meilleures conditions possibles, compte tenu de
l'ensemble du système de la langue, est l'une des fins pratiques de la partie
du discours.112
L'intervalle y → B, variable, y étant un seuil mobile, représente l'espace
mis à la disposition de la morphologie extérieure au mot, laquelle
comprend l'emploi de deux ordres de moyens :
a) l'un qui est le recours à des mots-outils, spécialement grammaticaux,
dont la préposition, telle qu'elle existe et fonctionne en français,
donne une idée nette et suffisante.
b) l'autre plus tardif, qui agit au dernier moment, dans la phrase
même, et consiste en la variation de l'ordre des mots. Il faut y ajouter dans
nombre de langues des variations phoniques subtiles, de ton notamment
(par ex. : ton égal, ton partant, ton montant du chinois), survenant tardivement,
dans la parole même 3, à l'instant où le mot y prend place.
Le seuil y apparaît ainsi non seulement le seuil de fermeture du mot,
déterminant, par généralisation intégrante, la partie du discours, mais le
seuil de fracture entre la morphologie grammaticale intérieure au mot,
inséparable du mot, et la morphologie grammaticale extérieure, séparable.
Dans le mouvement de grammaticalisation que schématise notre figure 1,
l'intervalle α → y représente l'espace dont dispose la morphologie grammaticale
intérieure au mot, la morphologie grammaticale subsumée sous la
partie du discours ; et l'intervalle y -> B, l'espace dont dispose la morphologie
grammaticale extérieure au mot, celle qui échappe à la subsomption
de la partie du discours.
Le seuil y étant un seuil mobile, le volume respectif des deux morphologies,
intérieure ou extérieure au mot, est fonction de la survenance plus
ou moins précoce ou tardive du seuil y, producteur de la partie du discours,
dans le champ morphologique figuré par l'intervalle α -> B — lequel
représente la partie du procès de grammaticalisation du mot développée
au delà du particulier, dans le plan du général.
Considéré in extenso, le champ α → B de la morphologie grammaticale
exprime une somme constante. La survenance plus ou moins précoce
ou tardive du seuil y dans le champ morphologique α → B — autrement
dit son éloignement plus ou moins grand de α et son approche proportionnelle
de B — a pour effet de diviser cette somme constante en deux
parts plus ou moins inégales : la part de morphologie que le mot, par
une sorte d'énexie, retient en lui ; et la part de morphologie qui, échappant
à cette énexie, se développe librement en dehors du mot sous tous
les modes possibles en cette situation.
Le nom français qui ne se décline pas retient en lui une moindre part
de morphologie que le nom latin qui se décline ; conséquemment la part de
morphologie à exprimer en dehors du nom par moyens divers (mots accessoires,
ordre des mots) est plus grande en français qu'en latin.
J'en ai terminé avec le seuil y. Le seuil antécédent (fig. 1) est le seuil α.
C'est un seuil dont les langues indo-européennes ne font pas état. Elles le
113« passent » sans s'y arrêter. Le mot des langues indo-européennes se propage
sans hiatus de sa partie lexicale à sa partie grammaticale, et ne se
clôt qu'avec la survenance de la partie du discours, productrice, nous le
savons, d'une généralisation finale intégrante qui s'étend à l'ensemble du
mot.
Tout au contraire, le seuil a est, dans une langue comme le chinois, le
seuil de conclusion 4 du mot. Le mot ne s'avance pas au delà.
On aperçoit d'emblée les conséquences. Le mot chinois ne pouvant
dépasser le seuil a doit se conclure avant de s'engager, si peu que ce soit,
dans le champ α → B de la morphologie grammaticale généralisante, située
tout entière au delà de α (fig. 1).
C'est pourquoi le mot chinois est un mot qui ne retient d'indications
grammaticales d'aucune sorte. Il n'y a pas en chinois, il ne peut y avoir
en chinois, le seuil de conclusion du mot étant α, de morphologie intérieure
au mot. Toute la morphologie grammaticale généralisante, subséquente
par définition au seuil α, s'exprime à l'extérieur du mot, soit par
mots grammaticaux distincts, soit au moyen de l'ordre des mots, fort habilement
exploité dans cette langue, soit encore au moyen de différenciations
phoniques subtiles obtenues in extremis dans la parole (v. p. 113).
Un mot chinois, considéré en lui-même, dans ses propres et seules bornes,
ne prend la marque ni du genre, ni du nombre, ni de la fonction, ni
de la personne, ni du mode, ni du temps. Il se limite strictement au psychisme
dont il détient la propriété exclusive et ne se propage jamais au
delà. Il n'en saurait être autrement d'un mot qui se conclut au seuil α, non
encore engagé dans le plan du général (fig. 1), et ignore, en conséquence,
toute détermination appartenant à ce plan.
Y a-t-il ou n'y a-t-il pas de parties du discours en chinois ? La question,
souvent débattue, a fait l'objet de controverses. Tout bien examiné, elle se
ramène à ceci. Le chinois ne faisant pas état du seuil y, et arrêtant le procès
de grammaticalisation du mot au seuil α antécédent (fig. 1) — juste
devant ce seuil qui n'est pas franchi ni même occupé 5 — ne ferme pas le
mot au moyen de la généralisation intégrante dénommée « partie du discours ».
Ainsi le mot, au moment de se conclure, ne livre pas celle-ci.
Mais si l'on prend le mot dans la phrase, les choses changent d'aspect.
Le mot apparaît là sous des déterminations grammaticales qui, pour lui
rester externes (mots-outils, ordre des mots, différenciations phoniques
tardives), n'en agissent pas moins sur lui dans le sens de la généralisation
(ces moyens appartiennent par nature, encore que le chinois ait une manière
à lui de les retenir dans le plan du particulier, au plan du général,
figuré sur le schéma porté au tableau par l'intervalle α → B) et, par leur
action combinée, conduisent à quelque chose qui, en résultat, diffère peu de
la partie du discours telle que nous la concevons.
Conclusion : le mot chinois prend fin sans livrer la partie du discours.
Mais les conditions d'entendement (v. pp. 110 et suiv.) dont les parties du
discours sont l'expression linguistique ne sont nullement pour cela bannies
de la pensée — elles ne sont en elles que retardées, différées — et on les
114voit prendre existence tardivement dans la phrase formée ; mais cette
existence tardivement acquise dans la phrase a la fugacité de la phrase
elle-même : être momentané, passager, éphémère, n'ayant pas comme le
mot son siège permanent dans l'esprit.
Il me reste à examiner le seuil x antécédent, dans le procès de grammaticalisation
du mot, au seuil α. Le seuil x est celui dont font état, en
premier lieu, avant de se servir du seuil y, les langues sémitiques. C'est
un seuil intraparticulier, intérieur au particulier, comme le montre la
figure de la page 109, un seuil, par conséquent, qui oppose le particulier à
lui-même, le divise en particulier intégrant et particulier intégré.
Le particulier intégrant a pour expression physique la racine consonantique,
composée généralement, on le sait, de trois consonnes séparées ;
le particulier intégré, les voyelles qui viennent emplir le vide plus ou
moins important que laisse subsister entre les consonnes radicales l'emploi
effectif de la racine. Dans la langue, en dehors de toute actualisation, de
toute application limitative de la racine, les consonnes qui constituent
celle-ci sont des consonnes en espacement ; dans l'acte de langage, réalisateur,
qui comporte une actualisation, une application limitative de la
signification de la racine, les consonnes qui la composent sont des consonnes
en rapprochement. Le propre d'une racine est d'emporter avec soi ce
double mouvement d'espacement et de rapprochement, des consonnes
composantes.
La racine, envisagée du point de vue psychique, est l'expression d'une
notion diffusive en expansion dans tous les sens de la pensée : à cette
expansion diffusive correspond l'espacement physique et mental des consonnes
constitutives. Dans l'acte de langage qui réalise la racine, par l'application
qu'il en fait à une vision limitée, actualisable dans l'esprit, la
racine apparaît soumise à un resserrement antidiffusif de ses consonnes
composantes. Les voyelles finalement insérées entre les consonnes radicales
sont la marque concrète des cas d'équilibre qui s'établissent dans le
mot réel, entre le mouvement diffusif de la racine en visée de puissance
dans la langue, et le mouvement antidiffusif de la racine en visée d'effet
dans le langage.
Il existe, par exemple, en arabe, une racine k… t… b… qui exprime, en
espacement de consonnes, l'idée diffusive d'écrire 6 et en rapprochement de
consonnes, — la racine emporte avec soi la virtualité des deux mouvements,
— une application antidiffusive de cette idée à une vision plus
étroitement définie. Les voyelles insérées entre les consonnes k… t… b…,
dénotent par des variations de volume, les degrés significativement utiles
du rapprochement des consonnes 7. A partir de k… t… b…, racine exprimant
de manière diffusive, et par là tout à fait générale, l'idée d'écrire, on
obtient par intégration des voyelles de liaison a…i. katib, qui veut dire
celui qui écrit (l'écrivain) ; et par intégration des voyelles de liaison i…a :
115kitab, qui signifie la chose écrite, le livre. L'intégration des voyelles a…a,
suivies d'une voyelle quasi suffixale a confère à la racine le sens de l'accompli
dans le passé : kataba « il a écrit ».
Un trait remarquable de la racine pluri-consonantique, sur lequel on
ne saurait trop attirer l'attention, c'est la parfaite congruence de son être
physique et de son être psychique.
Du point de vue psychique, la racine est une notion diffusive, qui se
répand, se propage, par une sorte de dilatation intérieure, dans tous les
sens de la pensée. Physiquement elle revêt la forme, convenante à cette
diffusion, de consonnes espacées et par là intégrantes à l'égard des voyelles
de liaison chargées d'exprimer ce qu'il restera de cet espacement quand
la racine aura subi, dans l'application, rétrécissement sémantique et morphologique
approprié.
La racine pluri-consonantique attend, en quelque sorte, afin de les
loger en elle, dans les vides diffusifs qu'elle développe entre ses consonnes
composantes, les voyelles antidiffusives qui, par le degré qu'elles notent du
rapprochement des consonnes, expriment le resserrement de la signification
de la racine dans les limites d'une compréhension actualisable.
Cette congruence de l'être physique de la racine et de son être psychique
est quelque chose de frappant, qui ne devrait néanmoins pas surprendre
si l'on veut bien considérer qu'un être linguistique, quel qu'il soit,
est l'expression de la convenance d'un fait de parole (physique) et d'un fait
de pensée (psychique) ; que cette convenance fait la valeur du signe linguistique ;
que sans cette convenance le signe linguistique serait inexistant,
de nul effet ; d'où il suit que la convenance en question, acquise à un
degré suffisant, est absolument nécessaire et ne saurait devenir trop
entière.
Les langues ont tendu universellement à accroître dans le signe linguistique
la congruence nécessaire du fait de parole (physique) et du fait de
pensée (psychique). La recherche de cette congruence est, dans toute langue,
une loi directrice.
Les langues sémitiques, dans la grammaticalisation du mot, font état,
en premier lieu, du seuil x, sur lequel les langues indo-européennes les
plus évoluées glissent sans s'arrêter, et en second lieu, quand la racine a
épuisé ses possibilités d'intégration des voyelles, du seuil y qui leur livre,
ainsi qu'aux langues indo-européennes, la « partie du discours » et la morphologie
afférente (par affixes).
La complication des langues sémitiques vient, pour une grande part,
de ce que, après avoir tenté, au seuil x, une intégration précurrente, prévisionnelle
du développement subséquent du mot, après avoir essayé de loger
ce développement, représenté par des voyelles morphologiques, dans la
racine consonantique, il leur faut ensuite, le développement du mot excédant
la capacité qu'ont les consonnes radicales d'intégrer entre elles des
voyelles, soumettre la partie de développement du mot que la racine, pour
cette raison, laisse échapper — et qui revêt, dès lors, la forme d'affixes —
à une seconde intégration récurrente et finale — la partie du discours
— capable d'embrasser, au moment où elle survient, le mot tout entier, la
racine comprise.
Dans la formation diachronique du mot — dont la formation synchronique
garde plus ou moins fidèlement l'image — la partie du discours
et la racine se font, en quelque sorte, vis-à-vis, étant dotées l'une et l'autre
116d'un pouvoir d'intégration s'exerçant en sens contraire. Dans les langues
sémitiques, on voit les deux intégrations, celle initiale et précurrente venant
de la racine, et celle finale et récurrente venant de la partie du discours, se
rencontrer, se rejoindre. Dans les langues indo-européennes les plus évoluées,
la partie du discours embrasse d'un coup si complètement l'entier
du mot que la racine intégrante en devient inutile et passe, en conséquence,
après fixation en elle d'anciennes voyelles morphologiques, à l'état de simple
radical intégré.
En thèse générale, les langues qui, dans la grammaticalisation du mot,
font état du seuil x, et par là deviennent des langues à racines, sont des
langues qui suspendent pour un court instant — l'instant x — la genèse
lexicale du mot au sein d'elle-même. La racine consonantique est la notation
d'un mot en état de suspension génétique. L'expansion diffusive,
« l'incomplétude », du sens de la racine sont d'autant plus grandes que
l'arrêt suspensif de la pensée au seuil x survient plus tôt dans la genèse
lexicale du mot (figurée par l'intervalle A → α dans le schéma de la
page 109).
Une racine est autre chose qu'un radical. Le radical prend position
dans le mot comme élément intégré, au même titre que les éléments formateurs
qui l'accompagnent. Si je dis : chanterons, le radical chant- et la
flexion -erons sont tous deux intégrés dans le mot, sans que le radical soit
intégrant à l'égard de la flexion. La flexion fait suite au radical. Le radical
ne la loge pas en lui.
La racine, elle — et c'est ce qui l'identifie apparemment, sans qu'il
soit besoin de regarder le fond des choses — prend position dans le mot
non pas afin de se faire suivre (ou précéder) des éléments formateurs, mais
dans la vue et avec la capacité de les loger au dedans d'elle, dans l'intervalle
mentalement existant 8 entre les consonnes qui la composent. C'est
le sentiment qu'a le sujet parlant de cet intervalle mental, et de sa variation
possible et utile, qui, en toute dernière analyse, confère à la racine sa
réalité. En l'absence de ce sentiment, la racine (intégrante) cesse d'exister
comme telle et se résout, nantie de voyelles stables, en radical (intégré).
Les langues sémitiques, extrêmement conservatrices dans le plan de la
systématique, sont restées des langues à racines. Les langues indo-européennes,
bien plus portées à innover dans ce plan, sont devenues de bonne
heure, et de plus en plus, des langues à radicaux ; mais bien des choses en
elles, ne serait-ce que le jeu plus ou moins conservé des alternances vocaliques,
sont le témoignage d'un état ancien où elles faisaient un usage régulier
de la racine intégrante. Le seuil x, intraparticulier, ne pouvait alors
être « passé » par elles, comme il le fut plus tard, sans se marquer
par un arrêt de la pensée : une suspension, plus ou moins accusée, du procès
de grammaticalisation du mot, quand ce procès atteint ce seuil.117
Il me reste, pour en avoir terminé, à dire quelques mots indispensables
au sujet de la « partie du discours », et de sa nature profonde.
La partie du discours n'est sensible dans le mot même — dès le mot
— que s'il se ferme sur un seuil y, intragénéral, suscitant dans l'esprit une
généralisation intégrante qui enveloppe, in finem, tout ce que le mot a
développé en lui antécédemment : de A en α et de α en y (fig. 1).
Comment, par quelle opération de pensée, cette généralisation intégrante
finale se produit-elle ? Quel en est le ressort ?
Il convient, pour le bien concevoir, de se représenter que le mot, sitôt
le seuil α dépassé, s'engage dans un mouvement de généralisation que rien
ne limite expressément [B qui, dans le schème de la page 109 (fig. 1), représente
la phrase, est une limite fuyante : la phrase appelle la généralisation
du mot 9, mais ne la borne pas] ; que, par conséquent, ce mouvement de
généralisation non limité rencontre immanquablement, à un moment, en
se développant, la vision universelle.
Or la vision universelle est une vision indépassable, une vision qui n'a
pas d'au-delà. Comment la subsumer sous une vision plus vaste ? Absolument,
l'opération est impossible. L'esprit humain tourne la difficulté ainsi
apparue tout à coup devant lui — qui est une difficulté d'entendement —
en opposant l'univers à lui-même sous les conditions d'entendement antinomiques
qui s'appellent l'espace et le temps. Plus exactement l'univers-espace
et l'univers-temps.
La distinction grammaticale du nom et du verbe n'est que l'expression
linguistique de ces deux visions d'univers.
On est donc fondé à définir le nom, le mot dont l'entendement s'achève
en dehors du temps, à l'espace ; et le verbe, le mot dont l'entendement
s'achève au temps.
Parce que le nom achève son entendement à l'espace, en dehors du
temps, il est inhabile à prendre la marque de ce dernier. Les marques qu'il
prend sont celles de catégories de représentation spatiales : nombre, genre
et classificateur, auxquelles s'ajoute, dans un autre plan, le cas de déclinaison
(fonction). L'extension de ces catégories spatiales au verbe (temporel
par définition) n'a lieu qu'en vertu et dans les limites de fonctionnement
— variables d'une langue à l'autre — de la loi d'accord du mot temporel
porté (le verbe) avec le mot spatial porteur (le substantif ou l'un de ses
substituts). Quant au verbe, parce qu'il achève son entendement au temps,
il est habile à en prendre la marque. Soit, par exemple, les mots course et
courir. L'un et l'autre expriment, matériellement, la même idée de procès ;
mais le mot course achève son entendement en dehors du temps, à l'espace ;
et, de ce chef, il est nom ; tandis que le mot courir achève son entendement
au temps, dont il prend la marque : je cours, je courus, je courais,
je courrai ; et de ce chef, il est verbe.
Le moment est venu de clore cet exposé. Ce que j'ai dit de la manière
118dont se fait un système grammatical est évidemment peu. Par comparaison,
ce qui reste à dire est immense. Mais les faits, en petit nombre, sur lesquels
j'ai appelé l'attention, en les simplifiant un peu trop, sont les faits
majeurs, les faits d'arrière-plan les plus profonds, racine de tous les autres.
Ces faits profonds, dont la connaissance relève d'une science assez
spéciale, utilisant, dans la solidarité la plus étroite, l'observation fine des
faits et là discussion analytique des nécessités qu'ils supposent, science
qu'il m'arrive de nommer : linguistique de position (son objet essentiel
étant de repérer les seuils, les « positions » à partir et en fonction desquelles
se marquent les « oppositions » de la langue : avant d'être un système
d'oppositions, la langue est un système de positions) — ces faits
d'arrière-plan, qui dominent les autres, et dont je viens de donner un
aperçu, sont à mes yeux, la carcasse de diamant des langues ; et, par voie
de conséquence, de la science de langage.119
1. Conférences de l'Institut de Linguistique de l'Université de Paris, Paris, Boivin
et Cie, 1939. La Librairie C. Klincksieck, Paris, nous a aimablement autorisé à reproduire
cet article paru dans un bulletin dont elle a acquis la propriété.
2. L'évolution des langues indo-européennes se produit dans le sens qui consiste
à accuser de plus en plus la prééminence du seuil y sur tous autres seuils.
3. Par rapport à la langue, préexistante par définition à l'acte de langage (nous
possédons la langue en nous en permanence, même quand nous ne parlons pas), la
parole est tardive.
4. Il y a conclusion, non pas expressément fermeture, le mot chinois reste, selon
la juste expression de mon savant confrère M. Burnay, un mot ouvert. C'est la partie
du discours qui, dans nos langues, ferme le mot.
5. Cette position remarquable du mot chinois demanderait à elle seule un long
examen — du plus haut intérêt.
6. Ce sens de la racine k… t… b…, quoique largement diffusif, paraît avoir été
précédé d'un sens plus diffusif encore, malaisément fixable. Il semble que le sens
diffusif attesté de toute racine ait derrière soi un sens plus diffusif, dont il serait en
quelque sorte une émanation déjà plus ou moins antidiffusive.
7. Le rapprochement maximum est noté par le degré zéro de la voyelle.
8. L'intervalle est à la fois mental et physique (congruence du fait de pensée et
du fait de parole). V. pp. 115 et 116.
9. Le mot prend position dans la phrase au titre de sa forme générale : nom
(substantif, adjectif), verbe, adverbe, pronom, etc. La phrase, dans l'immédiat, appelle
le mot-forme ; le mot-matière (signification) fait suite, sans discontinuité. — Ceci, bien
entendu, ne vaut que pour les langues qui ont, dès le mot, la partie du discours.